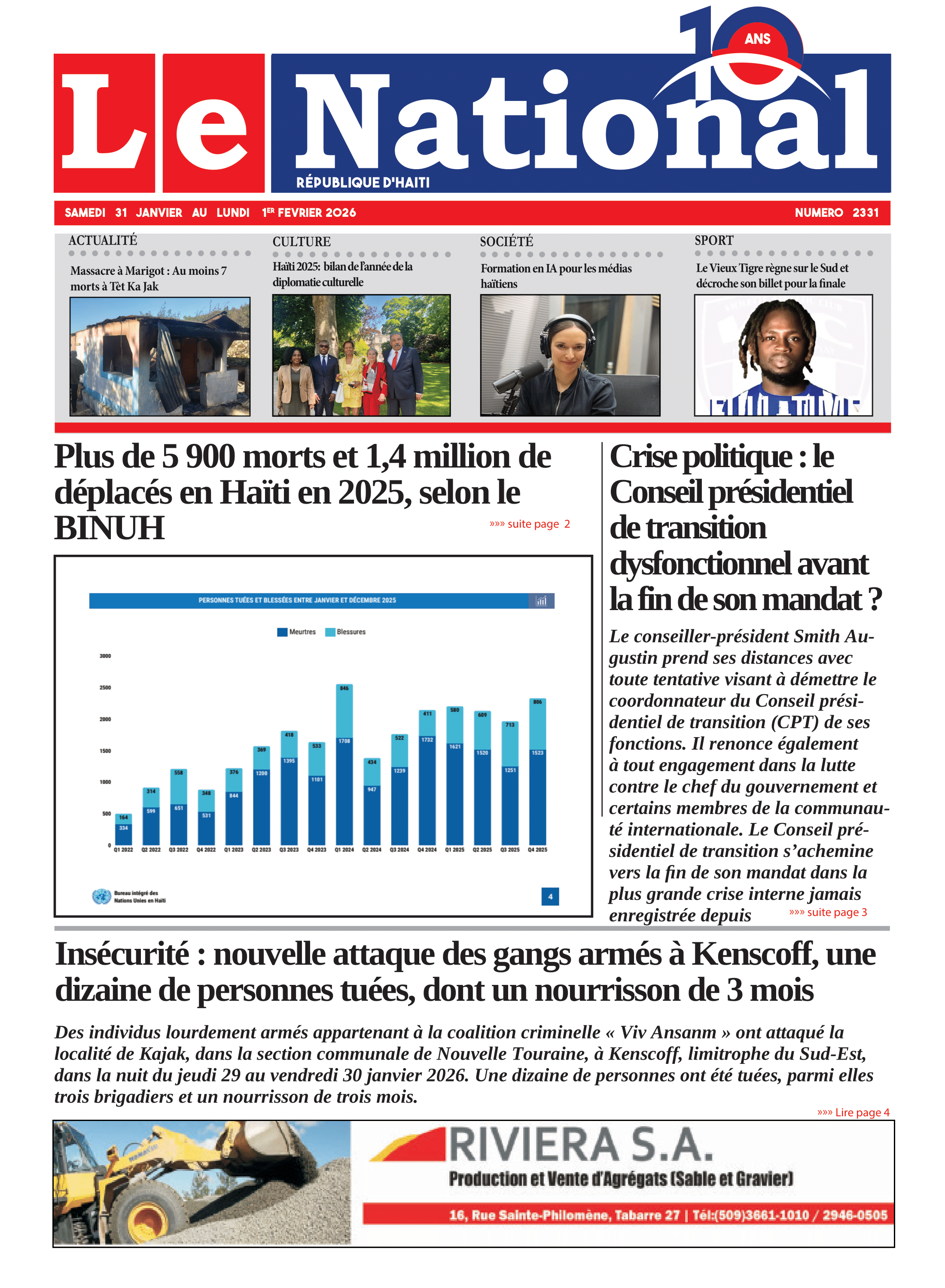Ils ont sacrifié leur jeunesse pour soigner leur pays. En retour, Haïti les contraint à fuir pour rester en vie. Derrière chaque blouse blanche haïtienne se cache une décennie de renoncements et de sacrifices, une voie longue, difficile et exigeante, trop souvent suivie par la peur, l’exil ou la mort. Il faut le dire sans détour : si les médecins fuient le pays, ce n’est ni par manque de patriotisme ni par appât du gain. C’est parce que l’État haïtien a échoué à remplir sa mission la plus élémentaire : protéger la vie de ses citoyens.
Un médecin haïtien est d’abord un jeune de 18 à 20 ans qui termine son secondaire avec un idéal profondément humain : servir. Soigner les malades. Prendre soin des plus vulnérables. Dans un pays marqué par la précarité sanitaire, ce choix relève presque du sacerdoce. Mais dès ce choix, le sacrifice commence. Il sacrifie sa jeunesse, retarde son autonomie et vit longtemps sous la dépendance familiale, souvent sans revenus, pendant que d’autres construisent leur avenir.
Devenir médecin en Haïti, c’est accepter une vie de privations. C’est étudier six jours sur sept, parfois sept, de 8 h à 17 h, souvent jusqu’à 18 h. Ce sont des nuits blanches passées à réviser, à préparer des examens, à répondre aux exigences académiques et cliniques. C’est un stress permanent. C’est l’impossibilité de travailler pendant les études. C’est l’absence de loisirs, de voyages et de divertissements. Le futur médecin n’a ni temps ni argent. Sa vie sociale est quasi inexistante et son cercle se limite à ses camarades, à ses professeurs et à ses patients.
La comparaison avec d’autres parcours universitaires est brutale, mais révélatrice. Deux jeunes quittent le secondaire la même année et entrent à l’université en même temps. L’un choisit l’administration, l’autre la médecine. Quatre ans plus tard, le premier est déjà sur le marché du travail. Il gagne sa vie, acquiert de l’expérience, quitte le domicile familial, sort, voyage et profite de sa jeunesse. Le futur médecin, lui, est seulement en quatrième année, sous pression constante, sans certitude de réussite ni garantie d’aboutissement.
Quatre années supplémentaires passent. L’administrateur cumule déjà quatre ans d’expérience professionnelle et avance dans la vie. Le médecin vient à peine d’obtenir son diplôme de médecine générale et se retrouve plongé dans un système de santé défaillant, sous-financé et mal géré. Il fait face à un marché du travail étroit, mal rémunéré, sans planification claire. Le ministère de la Santé est incapable de valoriser ses propres ressources humaines, transformant des spécialistes en administrateurs pendant que les hôpitaux manquent cruellement de soins. C’est un gaspillage institutionnalisé.
Malgré tout, le médecin persévère. Après huit années de médecine générale, il s’engage encore dans une spécialisation de quatre ans. Douze années d’études. Douze années de privations. Douze années de loyauté envers un pays qui ne lui garantit même pas la sécurité. À 32 ans, il arrive enfin sur le marché du travail sans économies, sans stabilité financière, souvent sans conjoint ni enfants. Pendant ce temps, son camarade en administration cumule déjà huit ans d’expérience professionnelle, une situation stable et parfois une famille.
Et voici la récompense : la peur. En Haïti, être médecin est devenu un facteur de risque. Les médecins sont ciblés, kidnappés, rançonnés, parfois assassinés. Face à cette réalité, l’État reste silencieux. Pas de mesures spécifiques, pas de protection, pas de reconnaissance officielle du danger. Ce silence n’est pas une simple négligence. C’est une démission et, à bien des égards, une complicité.
Alors le médecin part. Non pas par ambition, mais par instinct de survie. Aux États-Unis, au Canada ou ailleurs commence une autre forme de violence : le déclassement. Après douze années d’études de haute qualification, il devient chauffeur de taxi, préposé aux bénéficiaires ou agent de sécurité. Des métiers dignes, certes, mais qui symbolisent l’échec collectif d’un État incapable de retenir, protéger et défendre ses élites.
Ce n’est pas une succession de choix individuels. C’est un phénomène politique. Un drame national. Chaque médecin exilé est une perte sèche pour le pays. Chaque médecin assassiné est une responsabilité politique. Chaque médecin déclassé à l’étranger est le symbole d’un avenir sacrifié.
L’État haïtien ne peut plus se contenter de discours creux sur le patriotisme pendant qu’il abandonne ses professionnels. Les dirigeants, passés et présents, doivent répondre à une question simple : comment peut-on prétendre gouverner un pays que l’on est incapable de soigner ? Protéger les citoyens n’est pas une faveur, c’est un devoir régalien. Sans sécurité, sans planification et sans respect des compétences, Haïti continuera à se vider de ses forces vives.
L’Histoire retiendra que, pendant que des jeunes sacrifiaient douze ans de leur vie pour servir leur pays, l’État les a laissés fuir, se cacher ou mourir. Elle retiendra que l’effondrement du système de santé n’était pas une fatalité, mais le résultat de choix politiques, ou de l’absence de choix. Haïti ne manque pas de médecins. Haïti manque d’État. Haïti manque de dirigeants à la hauteur de son peuple. Et tant que cette vérité sera ignorée, l’exil restera la seule prescription possible pour ceux qui ont juré de sauver des vies.
Abdias Dol, MD, Psychologue, M.A. en administration publique