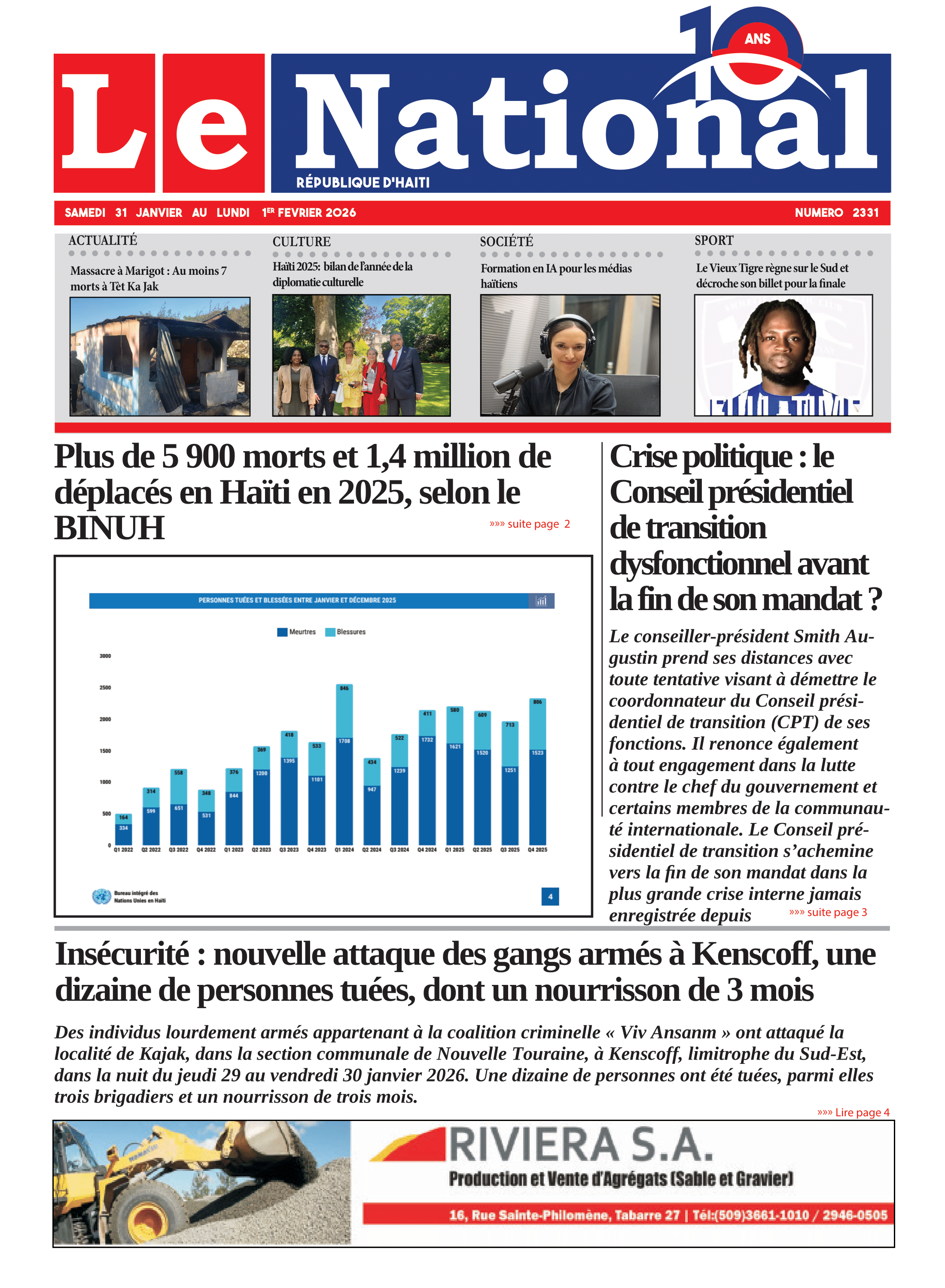« Trump est au-delà de la réparation. Il est obstinément mal informé ; il n’est pas qualifié et il est inapte à être commandant en chef. », déclarait récemment Robert Gates, ancien secrétaire américain à la Défense.
En effet, le monde assiste sous Donald Trump à une diplomatie à la Trump, faite d’improvisations, d’impulsivité chronique, mais surtout de mensonges et de diatribes, où la cohérence stratégique s’efface devant les pulsions d’un seul homme.
Imaginez un navire de guerre dont le capitaine, au lieu de suivre les cartes marines et l’expérience de ses officiers, zigzague au gré de ses humeurs, semant confusion et panique dans l’équipage. Les États-Unis, cette superpuissance qui se voulait phare des nations, ressemblent désormais à un géant qui trébuche, renversant sur son passage les meubles de l’ordre international qu’ils avaient eux-mêmes contribué à bâtir.
L’homme à la chevelure jaune mène une guerre contre les immigrés avec la frénésie de celui qui sape les piliers de sa propre maison. Ces travailleurs forment l’ossature invisible de l’économie américaine — dans l’agriculture, la construction, les services. Les expulser massivement, c’est vouloir fortifier un château en arrachant les pierres de ses remparts : c’est l’architecte qui dynamite ses propres fondations.
Cet ancien homme d’affaires confond la vente de tapis et le concert des nations. Donald Trump applique à la scène internationale les réflexes de l’immobilier new-yorkais : bluff, mensonge assumé, intimidation, revirements opportunistes. Or la diplomatie n’est pas un « deal ». Elle repose sur la constance, la crédibilité et la nuance — tout ce que cette approche strictement transactionnelle finit par dissoudre. Et n’a-t-on pas coutume de dire qu’en diplomatie, les vérités se logent dans les nuances ?
Le nationalisme trumpien, vendu sous le slogan Make America Great Again (MAGA), — dans sa déclinaison version ICE (Immigration and Customs Enforcement) — entre d’ailleurs en collision frontale avec les intérêts mêmes du pays. C’est le propre des idéologies rigides : elles fonctionnent comme des œillères, rétrécissant le champ de vision jusqu’à ne plus laisser passer que ce qui confirme la croyance de départ.
Le cas Maduro
Quand l’idéologie finit par dévorer la réalité, la catastrophe n’est jamais loin.
L’« affaire » autour de Nicolás Maduro illustre cette diplomatie du mensonge grossier : on accuse sans preuves, on martèle l’accusation, puis l’on se rétracte à bas bruit lorsque les faits s’effondrent. C’est la méthode du procureur malhonnête : fabriquer un récit en misant sur une évidence cynique — l’accusation fera toujours plus de bruit que le démenti. Plus grave encore, Donald Trump aurait ordonné l’enlèvement du président vénézuélien, tandis que ses alliés occidentaux préfèrent se taire.
Pendant ce temps, les « fins limiers » installés dans les boudoirs de la Central Intelligence Agency échafaudent des mensonges gros comme des câbles. Il faut être singulièrement dépourvu de bon sens pour avaler de telles fables. Prétendre — et faire relayer sur les réseaux sociaux — que le président vénézuélien serait à la tête d’un cartel de drogue, c’est prendre le public pour dupe.
On a déjà vu ce procédé : le même type de mensonge a servi de prétexte pour justifier l’attaque de Irak. Voilà ce qu’on appelle la diplomatie du mensonge : une stratégie faite de coups montés, d’infantilisme et de vulgarité, au service d’un pouvoir sans constance, balloté au gré des vents, et nourri de barbouzeries aussi grotesques que dangereuses.
Le cas des immigrés et des « ennemis »
Comment peut-on accepter que l’on arrête un enfant de cinq ans et l’enferme avec son père aux yeux du monde entier ?
La diplomatie exige maturité émotionnelle, patience, capacité à différer la gratification. Or, Trump fonctionne selon le principe du narcissisme immédiat : besoin de gagner à chaque instant, incapacité à tolérer la critique, recherche compulsive d’applaudissement. C’est un empereur-enfant qui gouverne avec des tweets rageurs et des décrets impulsifs, transformant la politique étrangère en psychodrame personnel où chaque dirigeant étranger devient soit un faire-valoir, soit un ennemi à humilier.
L’Amérique de Trump a besoin d’ennemis pour exister. Comme un boxeur qui ne se sent vivant que dans le ring, cette administration invente des adversaires quand ils manquent. Le Mexique, la Chine, le Venezuela, l’Iran, tous deviennent des épouvantails interchangeables sur lesquels projeter les frustrations internes. C’est le syndrome du château assiégé : pour souder une base électorale anxieuse, rien de tel que de désigner des menaces extérieures, même fictives. Le dossier fabriqué de toutes pièces devient alors une arme de propagande interne plus qu’un outil de politique étrangère.
Chaque mensonge découvert, chaque revirement spectaculaire affaiblit la parole américaine sur la scène internationale. Les alliés traditionnels apprennent à ne plus compter sur Washington, les adversaires testent les limites d’un pouvoir erratique. Les alliés ne savent plus sur quel pied danser. C’est une diplomatie sans mémoire, où chaque jour efface le précédent. Trump excelle dans le coup d’éclat médiatique mais échoue systématiquement à construire une vision à long terme. C’est le règne du court-termisme spectaculaire.
Le cas d’Haïti
La question fondamentale ici est la suivante : peut-on gouverner un empire sur la base du mensonge systématique et de l’improvisation psychologique? L’histoire suggère que non. Les empires s’effondrent rarement d’un coup, ils se fissurent d’abord par la perte de cohérence interne et de crédibilité externe. Et c’est précisément ce processus que nous observons, accéléré par une personnalité qui confond force et brutalité, leadership et intimidation, diplomatie et spectacle.
Prenons l’exemple d’Haïti. Accuser deux dirigeants haïtiens d’avoir des contacts avec les gangs sans fournir la moindre preuve relève encore et toujours des mensonges que cette administration applique sans vergogne. Des mensonges à tire-larigot, des mensonges pour un oui ou pour un non, des mensonges comme politique d’État. À quoi bon mentir sur des gens qui ne demandent pourtant qu’à obéir ? Nos élites obéissent sans crier gare parce qu’ils ont accepté d’être esclaves de l’Amérique.
Paradoxe cruel : même l’obéissance totale ne garantit aucune protection. Le serviteur le plus dévoué peut être sacrifié du jour au lendemain, sans explication, sans procès, sans dignité. Ces deux dirigeants haïtiens, qu’ils soient coupables ou innocents, subissent une sentence prononcée dans l’ombre, exécutée en pleine lumière, mais jamais justifiée par des preuves tangibles.
C’est le privilège du puissant : il n’a pas besoin de prouver, il lui suffit d’affirmer. Sa parole devient vérité par la simple force de sa position. Et le faible, lui, doit prouver son innocence. Un exercice impossible quand les accusations restent vagues, les preuves secrètes, les tribunaux inaccessibles. Mais il y a ceci que les menteurs ignorent : le mensonge a une limite, et cette limite s’appelle la mémoire. Un jour, celle-ci se transformera en mouvement, et ce mouvement balayera les menteurs comme en 1804 nous avons balayé les « maîtres ».
Maguet Delva
Paris, France