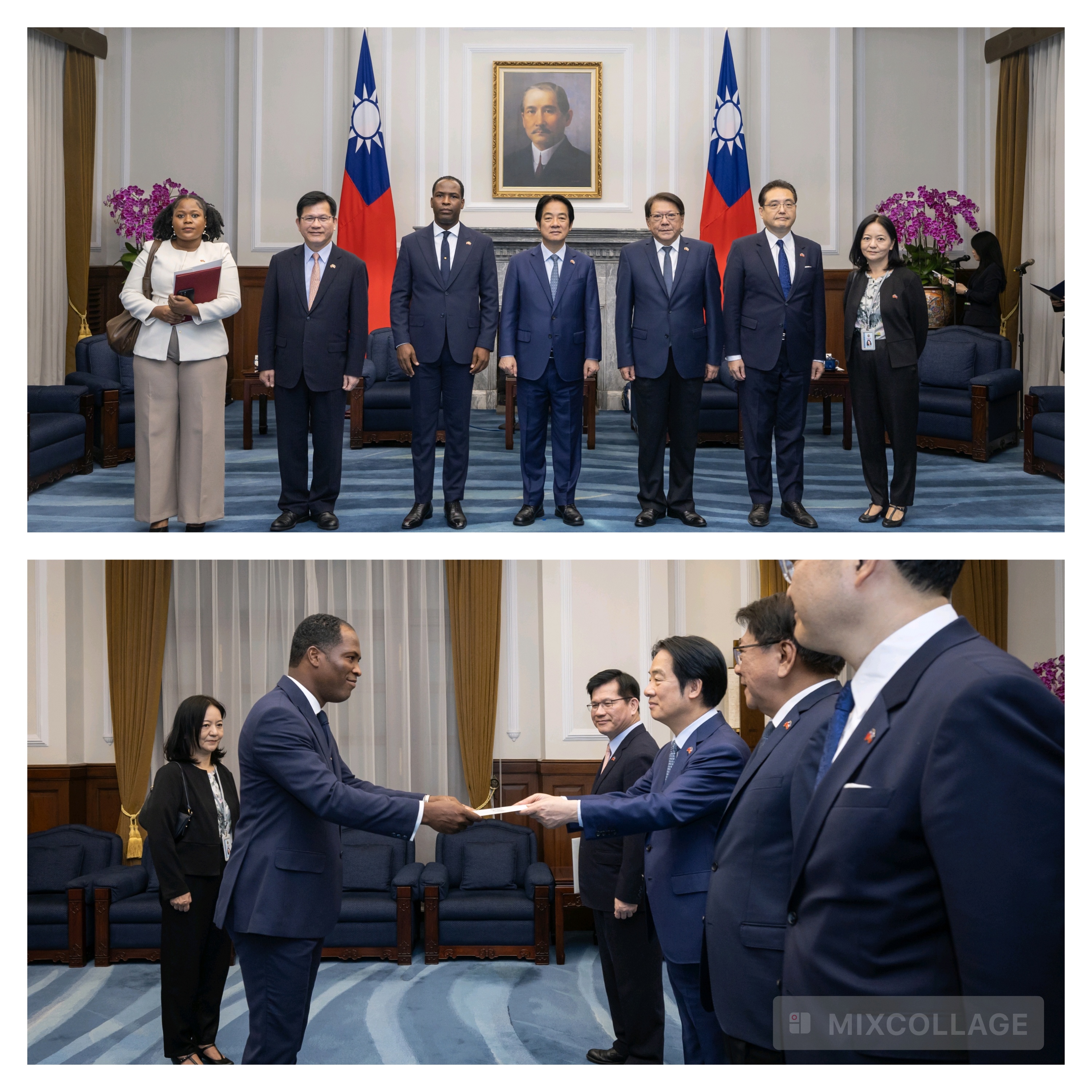Par Alexandra Emmanuel, MD PhD
Introduction
Haïti, pays des Caraïbes parmi les plus vulnérables aux changements climatiques, affronte une crise sanitaire croissante avec la prolifération des maladies vectorielles comme le paludisme, la dengue, le Zika et le chikungunya. Ces pathologies, favorisées par l'augmentation des températures, les inondations et les sécheresses, menacent la santé publique et aggravent la précarité socio-économique. La Déclaration de Turgeau, adoptée le 1er septembre 2023 lors du premier Colloque International d'Éducation aux Changements Climatiques tenu à l'Université Quisqueya, représente un appel vibrant de la communauté scientifique haïtienne pour institutionnaliser cette date comme Journée Nationale d'Éducation aux Changements Climatiques. Signée par des représentants d'institutions comme le Laboratoire Mixte International LMI-CARIBACT, l'Unité de Recherche en Géosciences (URGéo), l'Équipe de Recherche sur les Changements Climatiques (ERC2), le Laboratoire de Recherche sur les Zoonoses et Intoxications Alimentaires (LAREZIA), l'Équipe de Recherche sur la Santé-Environnement (EReSEN) et l'Équipe de Recherche sur l'Économie et la Gestion de la Connaissance (EREGeC), cette déclaration met l'éducation au cœur de la résilience nationale. Pourtant, sans une adoption officielle et un soutien politique ferme de l'État haïtien, les chercheurs sont et seront dans l’incapacité matérielle à initier une lutte coordonnée contre ces maladies. Cet article plaide pour un engagement institutionnel urgent, afin de transformer l'éducation en outil puissant contre les impacts sanitaires du climat.
La vulnérabilité d'Haïti aux maladies vectorielles exacerbées par le climat
Haïti, est un petit État insulaire en développement (PEID) exposé à des aléas climatiques extrêmes. Il subit régulièrement des catastrophes comme les ouragans (Jeanne en 2004, les quatre ouragans de 2008, Matthew en 2016), les séismes (2010 et 2021 de magnitude 7,2) et les sécheresses, amplifiées par le réchauffement global. Ces événements modifient les régimes pluviométriques, élèvent le niveau de la mer et favorisent l'érosion des sols consécutive à la déforestation massive, compromettant ainsi le développement de l'agriculture et la sécurité alimentaire dans le pays. Au niveau mondial, l’augmentation de la température terrestre génère des risques pour l’environnement et la santé humaine. Sur le plan sanitaire, elle a provoqué, entre autres, un accroissement du taux de prévalence des maladies vectorielles, notamment la dengue, le Zika, et le chikungunya, dont leur émergence est due à l’inoculation de germes pathogènes aux humains par des espèces invasives de moustiques. Ces épidémies sont liées au fait que le changement climatique augmente les aires de répartition de ces vecteurs et accélère les cycles biologiques de leurs agents pathogènes. En Haïti, les impacts sanitaires provoqués par le stress thermique et des inondations à répétition sont particulièrement dévastateurs. Entre 2013 et 2017, Haïti a connu des épisodes d’épidémie de maladies vectorielles, notamment, le Chicungunya et le Zika. L’enjeu pour notre pays aujourd’hui est de combler le déficit en ressources humaines qualifiées capables d’étudier l’écologie de ces vecteurs dans l’objectif d’agir sur leur cycle de reproduction et du coup de propagation des infections.
La Déclaration de Turgeau : un cadre scientifique pour l'action, mais un appel ignoré
Adoptée le 1er septembre 2023 à Turgeau, lors d'un colloque organisé, entre autres, par l'ERC2 en partenariat avec le LMI-CARIBACT et l'IRD, la Déclaration de Turgeau est un document fondateur. Elle reconnaît la menace du changement climatique pour le bien-être humain et l'environnement en Haïti, soulignant l'exposition exceptionnelle aux événements extrêmes et la vulnérabilité socio-écologique. Les signataires, une trentaine de représentants, dont des membres de la Fondation SOGEBANK, de la Commission Nationale de la Science, Technologie et Innovation, et des laboratoires précités, proposent explicitement d'instituer le 1er septembre comme Journée Nationale Haïtienne d'Éducation aux Changements Climatiques.
Ce texte insiste sur le rôle fondamental de l'enseignement supérieur et de la recherche pour éduquer les enfants et la population sur les changements climatiques, via un dispositif national soutenu par la société haïtienne. Il appelle à une éducation formelle et informelle, en lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD). Les propositions incluent l'adoption officielle de cette journée par l'État, le soutien du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), et la communication internationale de cette action citoyenne. Les demandes finales visent à intégrer l'éducation climatique dans les programmes scolaires et à notifier les partenaires mondiaux.
Malgré les efforts répétés des tenants de l’initiative, force est de constater qu’en deux ans, elle n’a pas beaucoup bougé. L’Etat attend encore pour prendre ses responsabilités C’est ainsi que le 1er septembre 2025 n'a pas été commémoré comme par le passé. Il est à déplorer que les activités des chercheurs, comme les stages d'immersion pour adolescents et l’organisation de colloques ne soient pas parvenues à capter l’attention de l’Etat pour donner à ces derniers un meilleur encadrement dans leur travail. Il n’est donc pas étonnant que leurs efforts pour lier la recherche et l’action restent encore limités. La Déclaration de Turgeau appelle à la création par l’Etat d’un cadre légal de référence pouvant faciliter une grande mobilisation des jeunes et de la population en général sur la thématique de l’éducation aux changements climatiques.
L'éducation comme rempart : le rôle des chercheurs dans la lutte contre les maladies
L'éducation est le pilier de la résilience, comme le soulignent les signataires de la Déclaration. Elle permet non seulement de transmettre des connaissances sur les risques climatiques, mais aussi de former une génération de scientifiques, ingénieurs, et professionnels de la santé, des spécialistes en sciences humaines et sociales (SHS) du climat pour innover face aux maladies vectorielles. Par exemple, des programmes éducatifs pourraient promouvoir des pratiques préventives et des solutions locales, comme la lutte biologique contre les moustiques, réduisant ainsi la propagation du paludisme et de la dengue.
Face aux épidémies des maladies vectorielles émergentes, des organismes de recherche de la France, soutenus par la plus haute autorité de ce pays, ont lancé en 2021 PREZODE une initiative internationale qui porte sur la prévention, la surveillance et la détection précoce de l'émergence de maladies zoonotiques afin d’assurer une réponse rapide aux risques de pandémies. Cette initiative bénéficie de l’approbation de scientifiques de par le monde et de plusieurs Gouvernements. L'initiative PREZODE est basée sur une approche "One Health", qui lie santé humaine, animale et environnementale. L’Université Quisqueya a signé en 2021 son adhésion à PREZODE et a lancé, à partir d’une convention entre quatre (4) de ses laboratoires de recherche la structure dénommée « Espace Universitaire One Health ». Sans soutien politique, cependant, la recherche reste un peu fragmentée, incapable de passer de la théorie à l'action concrète, comme l'expriment les stages d'immersion pour jeunes.
Le vendredi 11 mars 2022, Haïti a adhéré à PREZODE (https://www.haitilibre.com/article-36159-haiti-sante-haiti-premier-pays-de-la-caraibe-a-integrer-l-initiative-internationale-prezode.html ), et devient le premier pays de la Caraïbe à devenir membre de PREZODE. Les ressources de cette initiative sont à la disposition des décideurs, afin qu’ils puissent mettre en œuvre des politiques publiques adaptées pour réduire le risque d'émergence de maladies infectieuses zoonotiques. Acronyme de Preventing ZOonotic Disease Emergence, PREZODE est une initiative scientifique et opérationnelle formant une plateforme et un réseau international multidisciplinaire unique, doté d’un cadre de recherche fondé sur un principe de co-construction du local au global, dans une dynamique multi-acteurs, pour comprendre les processus et facteurs de risque d'émergence des zoonoses, encourager le partage des connaissances, faciliter la collaboration multilatérale, améliorer la gestion des écosystèmes et renforcer la surveillance des zoonoses. L’absence d’une politique scientifique nationale a mis aujourd’hui le pays sur la liste des membres inactifs ou celle des abonnés absents aux activités de PREZODE.
Pourquoi l'État doit soutenir politiquement la démarche du 1er septembre : urgence et perspectives
Le soutien politique de l'État est impératif pour plusieurs raisons. Premièrement, il légitimerait la Journée Nationale, offrant une plateforme annuelle pour sensibiliser et mobiliser, influençant les politiques publiques vers une adaptation plus robuste. Deuxièmement, il alignerait Haïti sur les engagements internationaux : apposer la signature de la République sur la Déclaration intergouvernementale sur les enfants, les jeunes et l'action climatique (COP25), et lancer une réflexion nationale sur les recommandations des chercheurs et les leçons de l'UNESCO à la COP28 sur l'apprentissage durable. Troisièmement, ce soutien permettrait aux chercheurs d'initier une lutte ciblée contre les maladies liées aux changements climatiques en renforçant les laboratoires et les formations de 2e et 3e cycles. Quatrièmement, il permettrait dans le cadre de l’adhésion d’Haïti à PREZODE, d’initier une réflexion nationale sur la formation technique et scientifique de cadres nationaux dans le domaine One Health. L’idée serait d’arriver à la constitution d’une masse critique de professionnels et de Chercheurs haïtiens dans le domaine de l'entomologie médicale, de l'épidémiologie des maladies émergentes et réémergentes liées aux changements globaux. Cette décision d’État pourrait également permettre le renforcement des stratégies nationales en matière de coopération et de diplomatie scientifiques par la mise en œuvre de programmes de recherche interuniverstaires et transdiciplinaires.
Conclusion et perspectives
La Déclaration de Turgeau n'est pas qu'un document : c'est un plaidoyer pour une Haïti résiliente, où l'éducation combat les maladies dues aux changements climatiques. L'État haïtien, en donnant un soutien politique décisif – via l'adoption officielle de la Journée Nationale, l'intégration dans les politiques éducatives et la collaboration internationale –, offrira aux chercheurs les moyens d'innover et de protéger la population. Une Haïti informée et engagée surmontera ses défis, transformant la vulnérabilité en force. Les autorités doivent entendre cet appel pour forger un avenir sain et durable à la population haïtienne.
Alexandra Emmanuel, MD PhD
Équipe de Recherche sur les Changements Climatiques (ERC2), Université Quisqueya
Groupe Haïtien d’Etudes et de Recherche en Santé-Environnement (GHERES)
Pôle des Amériques, Haïti Sciences et Société (HaSci-So).
E-mail : alex.emmanuel1603@gmail.com