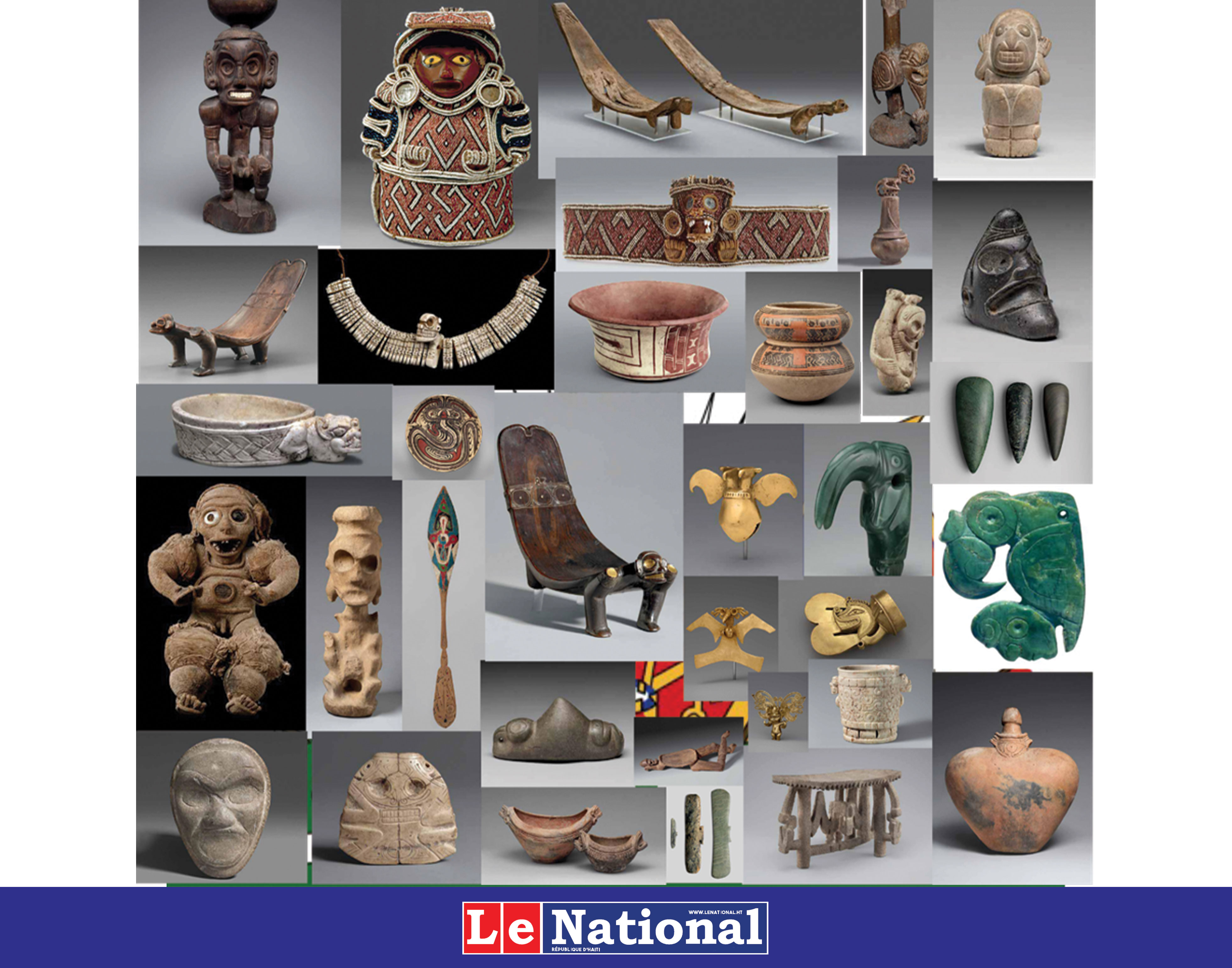(Dernière partie)
IV. Entre chaos organisé et politique de la mort : Cap vers la voie décoloniale des violences imposées
4.1. Quelle(s) autre(s) voie(s) possible(s) ?
Il est urgent de sortir de cette spirale de stigmatisation, d’exclusion, de dépendance et de déresponsabilisation. La lutte contre les groupes armés en Ayiti ne saurait être menée par des puissances étrangères qui ont elles-mêmes contribué à les produire et les reproduire, en profitant de l’extraction des capitaux, des ressources naturelles, des corps et des cerveaux en provenance des espaces insécurialisés.
Un espace insécurialisé est, pour nous, le résultat et la résultante du processus d’application d’une politique du chaos organisé, dans l’intrication des relations impériales, colon(ia)les et dépendantes criminelles, à l’échelle locale, nationale, régionale ou internationale.
Cette intrication de relations met en jeu la politique et le pouvoir de la mort, du crime, de l’extraction des richesses naturelles, des corps et des souffrances des espaces sociaux et spatiaux désignés comme périphéries, par les acteurs de la modernité criminelle — créateurs de terreur à l’époque dite moderne — dotée de moyens rationnels et techniques pour produire des « zones de désolation » et des « zones de non-droit d’avoir des droits », des zones de morts-vivants.
Ainsi, cette intrication trace la ligne de frontière entre ceux et celles qui doivent vivre, circuler, voyager, s’enrichir et être en paix, face à ceux et celles qui ne devraient qu’être confiné·e·s, exclu·e·s des circuits de migration, appauvri·e·s et toujours maintenu·e·s en situation de guerre permanente et profonde. Et cette guerre se fait par tous les moyens possibles.
Dans cette intrication est née une bureaucratie insécurielle, formée sur la rationalité de production de données et d’instruments, de capacités aux sens global. Capacités capables de faire fonctionner les institutions de (re)production de la mort et des espaces de non-droit d’avoir des droits. Ainsi est née une chaîne industrielle et technologique diverse et diversifié qui trouve son existence que dans la condition de possibilité de l’insécurialité toujours mouvante et reconfigurée.
Face à cette condition géopolitique d’incérurialisation, ou de géonécropolitique, la solution d’Ayiti, de la Palestine, de la RDC ou du Soudan ou de l’Ukraine… doit être pensée par et pour les espaces territoriaux et leurs peuples victimes, avec de nouveaux acteurs nationaux et partenaires internationaux respectueux des droits des peuples et de la souveraineté des pays, et non avec ceux qui existent que pour les écraser comme cela a été depuis l’époque dite moderne-contemporaine mais impériale, coloniale, raciste, ségrégationniste. La justification des limites de la souveraineté politique dans les frontières de l’État-nation ne saurait protéger le « droit d’avoir des droits » de tout et de chacun des humains. Cela ne justifie pourtant pas non plus le droit d’ingérence.
Car comme l’a déjà bien vécu en Hayti après la Bataille de Vertières, la dernière Bataille contre l’insécurialisation française à Saint-Domingue de 1791 à 1803, l’État libre et ré-indépendant d’Ayiti est l’État qui a été capable de recevoir les altérisés, les désolationnés, les Damnés de la terre. Et Ayiti a donné l’exemple, en recevant et en donnant le droit du sol, droit de la nationalité, droit de citoyenneté et droit de vie, ou droit d’humanité au rescapés soldats polonais, allemandes, qui ont été embarqué dans le projet militaire napoléonien d’extermination des opprimés, africains, sendomengwen, noirisés, anciens esclavagisés sur la terre d’Ayiti.
4.2. Le « droit d’avoir des droits là où l’humain est », contre l’hypocrisie/l’impérialisme migratoire des régimes d’extrême droite
Le « droit d’avoir des droits, là où l’humain est », est avant tout le premier et le seul droit sur lequel repose tous les autres droits de la personne humaine. Quel que soit le lieu, l’espace géographique, étatique, culturel ou historique. La personne humaine a le droit de vivre en société, fût-elle née là ou migrée là. Depuis toujours, les humains sont nés ici et là, et ont migré ici et là. Mais aujourd’hui encore, les chefs des régimes d’extrême droite et ultra-racistes, qui sont pourtant d’ascendance migrante, ne sauraient contester le droit à la migration dont leurs parents et grands-parents ont eux-mêmes bénéficié dans les sociétés où ils se trouvent actuellement. Fussent-ils de Donald Trump, de grand-père allemand ayant dû migrer vers les États-Unis à la fin du XIXe siècle, ou Luis Abinader en République Dominicaine, dont les grands-parents étaient eux aussi des migrants. Lesquels présidents de régimes d’extrêmes droites racistes ont listé les ressortissants ayitiens dans des cases d’interdiction d’entrée.
Depuis 2017, peu après son entrée en fonction, le chef de l’extrême droite étasunienne, Donald Trump, lors de son premier mandat, il avait déjà tenté de barrer l’accès aux voyageurs ayitiens et des ressortissants d’autres pays comme Cuba, Venezuela ou de plusieurs autres nations d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient, rappelle Courriel international, le 5 juin 2025.
Et sur la même île d’Ayiti, l’autre président d’extrême droite, dénommé Luis Abinader, a, depuis le 6 avril 2025, autorisé le « déploiement de 15 mesures pour contrer les flux migratoires en provenance d’Ayiti ». Parmi ces mesures : augmentation de la capacité de surveillance des trois brigades frontalières présentes dans six secteurs opérationnels ; augmentation du nombre de soldats en service à la frontière ; construction de 13 kilomètres supplémentaires au mur de 54 km déjà érigé à la frontière ; projet de réforme du cadre juridique de la migration existant ; et durcissement des sanctions dans les cas suivants : fonctionnaires, civils, militaires, etc., peut-on lire sur le Site officiel de la présidence.
« Outre le renforcement des contrôles aux frontières, avec 1 500 soldats supplémentaires et la construction de nouvelles sections de la barrière que l'actuel président raciste dominicain a ordonné en 2021, des sanctions sont prévues pour ceux qui aident d’une manière ou d’autre les migrants ayitiens », selon les informations en date du 6 juin 2025 dont dispose Vatican news.
Ces mesures de durcissement des lois et pratiques migratoires de ces deux régimes qui se voudraient être ultra-nationalistes — donc racistes — ne témoignent que de la constante du pouvoir colonial dans sa forme moderne, raciste et ségrégationnelle. Ce pouvoir, depuis l’époque de la modernité impériale, coloniale et raciste a toujours choisi qui doit émigrer ou immigrer et vivre en paix, et qui doit être coincé et péri dans les lieux insécurialisés sur la planète.
À l’époque impériale et coloniale, cette insécurialité — ou impérialité/colonialité géonécrophile — a créé le permis raciste de mobilité locale, nationale et internationale dans l’espace colonisé et colonialisé et postcolonial. Ainsi, les critères spatiaux, raciaux ou d’origines ethniques, de genre, de langue, de croyance, d’organisation politique, de taille, etc., servent de conditions de possibilité et de justifications de la domination impériale, coloniale et raciale (voir Charles Wade Mills, [1997] 2021, María Lugones, 2019, pp. 46-89; Françoise Vergès, 2017 ; et, Gabriella Veronelli, 2012-2025, Mohamad Amer Meziane, 2021).
4.3. Fin de TPS : Une gestion insécurielle des ressortissants Ayitiens aux USA
La décision unilatérale de l’administration Trump en date du 27 juin, par la voix de la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem, de mettre fin au Temporary Protected Status (TPS) pour les Haïtiens dès le 2 septembre 2025 – au lieu du 3 février 2026 fixé sous Biden – révèle une logique d’insécurialisation migratoire et une violence bureaucratique planifiée ciblant une communauté déjà vulnérabilisée tant en Ayiti, en R. Dominicaine ou aux États-Unis. Toutefois, le juge fédéral Brian Cogan (New York) a pourtant bloqué cette décision le 1er juillet 2025, soulignant son « illégalité » : Noem a outrepassé son autorité statutaire en « annulant partiellement un statut en cours sans respecter les procédures de réexamen imposées par le Congrès », argumente le juge Cogan dans le dossier (Case 1:25-cv-01464-BMC).
4.3.1. Historicité et spécificité du TPS pour les ressortissants Ayitiens
Actif depuis 2010 après le séisme dévastateur, le TPS pour Haïti a été prolongé à plusieurs reprises (sous Obama et Biden) face à l’aggravation des crises : choléra, ouragans, et surtout l’effondrement sécuritaire lié aux gangs contrôlent 80% à 90 % de Port-au-Prince ou d’autres grandes provinces telles que l’Artibonite. Selon les données en date du 31 mars 2024 du CRS by U.S. Citizenship and Immigration Services, près de 200 000 Ayitiens en bénéficient le TPS, installés aux États-Unis depuis plus d’une décennie pour beaucoup, contribuant à l’économie locale et nationale, sans compter les 309 000 qui étaient nouvellement élus.
4.3.1.1. Apports socio-économiques vitaux pour les États-Unis
Les détenteurs du TPS Ayitien sont intégrés sous condition juridique à la vie active de la société étasunienne (santé, production, services), payent des impôts, et créent des emplois. Leur possible expulsion juridique et policée brutale priverait l’économie de milliards de dollars et déstabilisent des secteurs clés.
4.3.1.2. Apports socio-économiques vitaux pour Ayiti
Leurs transferts d’argent (remittances) représentent une part significative du PIB national, une bouée de sauvetage dans un pays où près 60% de la population vit sous le seuil de l’appauvrissement et de l’insécurité planifiée.
4.3.1.3. Contradictions entre la désinformation de la DHS sur les réalités sécuritaires ayitiennes
L’argument de DHS – « la situation environnementale en Haïti s’est améliorée » – est un déni des réalités et une tentative de manipulation des faits et de l’opinion publique. Car l’État de la politique du grand bâton (Policy of the Big Stick) fait planer un alerte - Niveau 4 « Do Not Travel » pour enlèvements, crimes et chaos politique ; selon les données publiées en date du 11 juin 2025 de l’OIM , près 1,3 million de déplacés internes (+24% depuis décembre 2024) fuyant les violences criminelles sans oublier les blocus des ports, aéroports et routes nationales etc par des groupes armés, paralysant même l’acheminement des premiers soins ou de l’aide dite humanitaire.
Le juge Cogan a souligné que résilier le TPS avant 3 février 2026 « brisait la confiance légitime » des bénéficiaires ayant « pris des emplois, inscrit leurs enfants à l’école ou entamé des traitements médicaux ».
Toutefois, sans la normalisation des ressortissants haïtiens tant en R. Dominicaine ou notamment aux États-Unis, cette production planifiée d’apatride ce qui traduit la désolidarisation des élites anti-migrants et racistes et désolation d’un peuple déjà vulnérabilisé et déstabilisé. Car, les administrations Trump (USA) et Abinader (R. D.) instrumentalisent le droit comme symbole de leur politique anti-immigration, méprisant tant le droit international que la détresse haïtienne. La rhétorique des extrêmes droites ne font que du droit et du mensonge d’État leur ultime masque pour cacher leur politique de xénophobie structurelle anti-ressortissants ayitiens, illustrée par les propos antérieurs de Trump assimilant Ayiti à « shithole country » (pays de merde) et les Ayitiens à des « mangeurs de chiens ». Pendant ce temps, l’internationale communautaire et la classe dominante au pouvoir en Ayiti « échouent » à endiguer la crise formatée, abandonnant, dirait plus d’un, tout un peuple déjà pris en étau entre groupes armés, formateur de chaos internationalisé et pouvoir défaillant parachuté.
Cela étant, le blocage judiciaire du 1er juillet 2025 n’est qu’une trêve temporaire dans la politique de mise en insécurialité permanente (absence de statut légal permanent avec carte de travail etc.) des ressortissants ayitiens : l’administration Trump a déjà annoncé son appel, s’appuyant sur une décision de la Cour suprême ayant validé en mai 2025 la fin du TPS pour les Vénézuéliens. Cette bataille juridico-politique expose, autrement dit, la précarisation systémique des Ayitiens aux États-Unis, traités comme une variable d’ajustement des ambitions électoralistes et racistes, au mépris de leur intégration et apports socio-économiques dans la société étasunienne mais surtout de mécanismes formatés de (re)production de l’effondrement de leur pays d’origine par tous les moyens de la politique du Grand bâton de l’Oncle Sam et des 11 interventions militaires de dépendance systématisé de l’ONU.
4.4. Respect de la personne migrante : Éthique de la reconnaissance contre la logique de la terreur d'en haut
La migration, loin d’être une simple question de gestion de flux humains, engage une réflexion fondamentale sur la dignité humaine et la reconnaissance de la personne dans sa singularité absolue et sa portée universelle. Face aux dispositifs d’exclusion orchestrés par les politiques migratoires de Donald Trump et de Luis Abinader — dont la démarche s’inscrit dans une logique de la terreur d’en haut — l’éthique vient introduire une exigence de justice au cœur du débat de l'ère.
Jean-Marc Ferry, a répondu à notre invitation et en vient sur la table de discussion avec son deuxième tome « Les puissances de l’expérience : Essai sur l’identité contemporaine : Les ordres de la reconnaissance » accusé du chapitre consacré à l’Identité morale de son livre, explore la question de la reconnaissance de l'Autre comme condition de possibilité d’une identité respectée et intégrée dans la communauté humaine (Ferry, 1991, pp. 115-159 et passim). La migration ne peut être traitée comme une simple menace à la souveraineté nationale, mais comme un appel à la solidarité éthique (trans-étatique). L’identité du migrant ne doit pas être ramenée à une fonction économique, ni à une menace sécuritaire; elle suppose, au contraire, une reconnaissance morale qui dépasse la catégorisation administrative des intérêts capitalistes-racistes. Or, l’interdiction d’entrée aux ayitiens ou la fin du TPS promue par Trump ou l’expulsion massive ordonnée par Abinader se situent aux antipodes de cette exigence. Ce sont des actes qui réduisent la personne dans sa singularité et son incommensurabilité à une figure négative, assignée à l’altérité radicale racialisé et altérisée. Donc la personne humaine est niée dans son humanité même.
En cela, Robert Spaemann revient sur la table de notre discussion avec son approche éthique issue de Les personnes. Essai sur la différence entre «quelque chose» et «quelqu’un », insiste sur le fait qu’être une personne, c’est être porteur d’une dignité inaliénable. La personne ne peut être traitée comme un simple objet de gestion ou d’exclusion. En ce sens, lorsqu’un État établit des politiques migratoires fondées sur des critères raciaux ou géopolitiques instrumentaux, il nie cette distinction fondamentale entre une personne et une chose. Le migrant ayitien devient ainsi un « quelque chose » à éloigner, à gérer, à rejeter — et non un « quelqu’un » qu’on accueille, qu’on écoute, qu’on respecte en tant qu'individu ou personne humaine [moun] jouissant de la capacité ou faculté principielle de droit d'avoir des droits là où l'humain est (Spaemann, 2009, pp. 13-45 et passim).
Dans cette optique de négation des ressortissants ayitiens d’abord dans sa terre natale même puis à l’extérieur, la logique de la terreur d’en haut prend la forme d’un dispositif de contrôle et de peur qui instrumentalise la violence et le droit pour conditionner et justifier l’exclusion. Le droit international public, en revanche, reconnaît dans plusieurs instruments (dont la Convention de Genève sur les réfugiés, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques) le droit à la protection, à la mobilité et à la dignité. La politique de Trump, interdisant l’entrée puis la cessation de TPS aux ressortissants ayitiens au motif sécuritaire ou sanitaire controversé, et celle de Abinader, organisant des expulsions massives, contreviennent au principe de non-refoulement et à la prohibition des traitements inhumains et dégradants.
4.5. Violation du principe de non-refoulement et de la prohibition des traitements inhumains et dégradants
Eu égard aux décisions migratoires de Donald Trump et de Luis Abinader à l’encontre des ressortissants ayitiens, le principe de non-refoulement et la prohibition des traitements inhumains et dégradants sont doublement violés : primo, sur le plan du droit international public, secundo, au regard de l’éthique de la personne humaine.
En cela, le principe de non-refoulement, consacré par l’article 33 de la Convention de Genève de 1951, paraphrasons-nous, interdit à un État de renvoyer un individu vers un pays où il court un risque réel de persécution, de torture ou de traitements inhumains et dégradants. Ce principe, repris par la Convention contre la torture (ONU, 1984, art. 3) et par l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP, 1966), constitue un pilier du droit international des droits humains. En orchestrant des expulsions massives de migrants ayitiens (cas de Abinader) ou en interdisant leur entrée sur le territoire américain et la fin de justesse de TPS (cas de Trump), sans évaluation individuelle de leur situation ni garantie de protection planifiée, ces États contreviennent à ces obligations juridiques fondamentales. En cela, Hathaway, James C. attire l'attention sur ces dernières en ces termes « Comme le montre clairement l'analyse du chapitre I, les obligations découlant de la Convention relative aux réfugiés demeurent d'une grande pertinence, malgré le développement depuis 1951 d'un vaste système de droit international des droits de l'homme » (Hathaway, 2021, pp. 278-293 et passim).
Du point de vue de l'éthique, Robert Spaemann après avoir eu accusé réception cordialement de notre demande de discussion, a insisté sur la distinction entre « quelqu’un » et « quelque chose » (Spermann, 2009, pp. 19-37). C'est-à-dire en traitant les migrants ayitiens comme une « masse indésirable », ces politiques instrumentales les dépersonnalisant, niant leur dignité ontologique et anthropologique. Jean-Marc Ferry eut à ajouter que la non-reconnaissance de l’Autre comme sujet moral participe d’un processus d’exclusion radicale (Ferry, 2000, pp. 125-140 et passim).
Et Fatou Diome, dans Le ventre de l’Atlantique (2005), a fait l'assomption de droits de l'humain pour rechercher son humanité face à l'inégalité inventée par l'« Occident le bien ». Ses idées se trahissent en ces termes « ce n’est pas un crime de fuir la misère » ; la jeune africaine appelle l’Europe – et au-delà, l’Occident – à reconnaître le droit fondamental à la mobilité comme une réponse légitime à l’inégalité structurelle entre les nations. Ce qui explique que « criminaliser les migrants revient à criminaliser les pays appauvris par la machine coloniale de l'Occident ».
Dans le contexte Trump-Abinader, ces politiques bafouent à la fois le droit international et les fondements éthiques du respect dû à chaque personne humaine, a chak moun, quelque soit sa provenance nationale, ou l’étiquetage racial qu’on lui accole.
L’éthique, ici, impose de dépasser les logiques de peur et de sécurité pour revenir à une politique de la personne. Le respect de la singularité du migrant, selon Spaemann, et sa reconnaissance comme sujet moral, selon Ferry, appellent à reconfigurer les politiques migratoires à la lumière d’une responsabilité éthique universelle. Il ne s’agit pas seulement de droits formels, mais de la capacité à reconnaître l'Autre comme condition d'être semblable sur tous les contours biologiques et physiologiques, dans chaque migrant, un visage, une histoire, un monde — un « quelqu’un », irréductible à sa condition de déplacé.
4.6. De la souveraineté sécuritaire confisquée à la « reconquête » populaire : Les groupes armés comme avatars modernes de la domination impériale
Aujourd’hui les groupes armés internes sont les remplaçants de l’armée-police impériale coloniale de l’époque postcoloniale, post-occupation ou nationale-dépendante, pour les pays nouvellement indépendants ou ré-indépendants. Ayiti, Cuba, Venezuela, Congo-Brazzaville, le Tchad, la Guinée équatoriale, l'Erythrée, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, l’Afghanistan, le Yémen, la Birmanie, le Burundi, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan… ne sont que des espaces nouvellement insécurialisés sur l’échiquier de la géopolitique nécrophile, laquelle définit la souveraineté en termes de droit de vie et de droit de mort dans les limites de l’État-nation.
Hors de cet espace d’État-national impérial, colonial, centre du monde hégémonique, la modernité insécurialisée n’impose que la peur, la terreur, la désolation, le non-droit d’avoir des droits, ou l’inimitié. Ainsi, les régimes d’extrême droite d’aujourd’hui, comme c’est le cas avec Luis Abinader, président dominicain d’origine arabe-libanaise, ou Donald John Trump, président étasunien d’origine germanique, ne font-ils que reconfigurer et (re)définir les lignes frontalières du rapport droit à la vie/droit à la mort ou du droit d’asile, de résidence/droit de déportation, de confinement légalisé, sans droit de libre circulation et d’accès au travail.
Conséquemment, face à cette modernité insécurielle néocoloniale, la construction des espaces de vie et de communalité, ou la (re)production de lieux sécurialisés, suppose un contrôle strictement humanisant des frontières, une politique de commercialisation respectant les droits de vie de chaque nation, groupe ethnique, un contrôle sur les circuits de production et de commercialisation d’armes et de munitions, un renforcement massif des institutions de justice et de sécurité, mais aussi une refondation et une pacification souveraine des lignes frontalières tracées par la géopolitique nécropole moderne et contemporaine. Cela implique la participation citoyenne, la revalorisation du tissu social, et la construction d’un projet national, régional et international tenant compte des besoins de paix et de sécurité de chaque peuple et de chaque personne humaine, eu égard à son histoire et à son projet de vie.
La paix et la sécurialité en Ayiti, en Palestine, Soudan, RDC, Afghanistan, Ukraine, Iran, Israël, dans les favelas du Brésil ou dans les ghettos des États-Unis ou sur les frontières ukraino-russes etc. ne viendront ni des décrets de Washington, ni des lettres de supplique adressées à des puissances étrangères, ni des interventions militaires classiques ou actualisées, chapeautées sous les casques masqués bleus de l’ONU, les soldats-mercenaires de l’Alliance agressive de l’OTAN ou par les politiques mercenariales occidentalo-centrées, travaillant aux soldes de l’impérialisme commercial et criminel et crisogène. Mais, cette paix et cette sécurialité viendront de la « reconquête » des pouvoirs par les peuples eux-mêmes, d'une politique d'autosuffisance pour sauvegarder la souveraineté et l'intégrité des peuples — fût-il d’Ayiti ou d’un État sous tutelle, ou mis en situation de domination encadrée, libéralisée, et altérisée sous les bottes des empires pluricontinentaux.
Afin de ne pas conclure
Aujourd’hui encore, la désignation des groupes armés internes comme « terroristes », notamment en Ayiti, et les décisions déchaînés (interdiction d’entrée et fin de TPS) n'auraient pu être une solution rationnelle à la crise multidimensionnelle formatée en Ayiti. C’est un écran de fumée, « yon mizik pou andòmi sèpan venime », une ruse de l’hyperpuissance pour détourner l’attention des causes structurelles de l’insécurialité organisée et endurcie chaque jour. Classer les pays et leurs ressortissants dans des catégories de celles et ceux qui sont privés de droits d’« avoir des droits », privés de « statut légal permanent », illustre cette hypocrisie criante d’une puissance impériale et raciste qui refuse d’assumer ses responsabilités dans la fabrication du chaos au niveau planétaire, préférant criminaliser les victimes plutôt que d’affronter les véritables coupables. (La couleuvre qui mord sa queue ).
Car comme le rappelle Noam Chomsky (2001), « lutter contre le terrorisme impose de réduire le niveau de la terreur, pas de l’accroître. […] Un moyen de réduire le niveau de terreur serait de cesser d’y contribuer soi-même. Puis de réfléchir aux orientations politiques qui ont créé un réservoir de soutien dont ont ensuite profité les commanditaires de l’attentat ». Ce constat vaut pour Ayiti, comme pour la Palestine, le Yémen, la Libye ou les favelas du Brésil, l’Iran etc., les structures insécurialistes globales sont des outils de contrôle politique, économique, idéologique et spatial global. Ces structures (re)produisent la (géo)politique de la mort, la (géo)nécropolitique, où la souveraineté n’est plus définie en termes de dignité collective, mais en termes de droit de vie et droit de mort dans les limites de l’État-nation dominé et colonial.
Dans cet ordre mondial nécrophile (Cf. Erich Fromm, 1991 (1964)), les groupes armés ne sont que les remplaçants modernes et contemporains des anciennes polices impériales et coloniales, dans des territoires nouvellement ou perpétuellement insécurialisés, incapables d’échapper au cercle vicieux de la domination héritée de l’impérialité-colonialité occidentalo-centrée. Le monde postcolonial est ainsi reconduit dans un état de dépendance violente, où l’insécurité permanente, dans ses formes diverses, est moins un effet qu’un outil systémique de gouvernance et d’exclusion, rationalisé et marchandisé au profit d’élites nécropoles, compradores et d’intérêts géostratégiques déshumanisants et meurtriers.
Dès lors, la construction des espaces de vie et de communalité, la pacification des frontières, le contrôle des circuits d’armes, la revalorisation du tissu social et la réappropriation citoyenne de la souveraineté nationale, le respect et l’effectivité du droit d’avoir des droits [tout moun se moun, tout moun gen dwa kèlkeswa kote li retwouve l] deviennent des impératifs de survie pour les peuples altérisés et piégés dans cet ordre mondial insécuriel à géométrie impériale, coloniale et nécrophile.
Plus que jamais, il faut défendre l’idée d’une Ayiti souveraine, digne, libre et en paix, non comme un slogan, mais comme une exigence vitale. Car le combat pour le droit d’avoir des droits ne se limite pas aux lignes frontalières héritées de l’époque moderne impériale-coloniale-postcoloniale, de l’État-nation, donc basé sur le contrat racial. Il se mène partout où l’humain est nié dans son droit d’exister, de s’autodéterminer, de vivre sans peur. Il se mène partout où des peuples, comme les Ayitiens, sont contraints de reconquérir ce qui leur a toujours été refusé depuis le début de la modernité-colonialité (1492) : le pouvoir de vivre pour eux-mêmes, par eux-mêmes, avec les autres.
La modernité insécurielle telle que conçue ici est lié aux structures de domination et d’altérisation imposant la terreur comme langage. Il nous revient de lui opposer la souveraineté comme praxis, la justice comme horizon, et la solidarité humaine comme boussole. Car la paix véritable, celle qui fait peuple et qui fait monde, ne viendra jamais des décrets de Washington, ni des masqués bleus des Nations-Unies, des bottes de l’OTAN, ni des missives désespérées aux chancelleries impériales et raciales, mais de la « reconquête » lente, douloureuse mais inévitable, des peuples eux-mêmes sur leurs propres destins.
Auteurs :
joseph.elmano_endara@student.ueh.edu.ht
Formation : Fondements philosophiques et sociologiques de l’Éducation/Cesun Universidad, California, Mexico, Sciences Juridiques/FDSE, Communication sociale/Faculté des Sciences Humaines (FASCH/UEH
&
Formation : Communication sociale/Faculté des Sciences Humaines (FASCH/UEH)
&
Jeankenleybienaime902@gmail.com
Formation : Relations Internationales/Institut National d’Administration, de Gestion et des Hautes Études Internationales (INAGHEI/UEH)