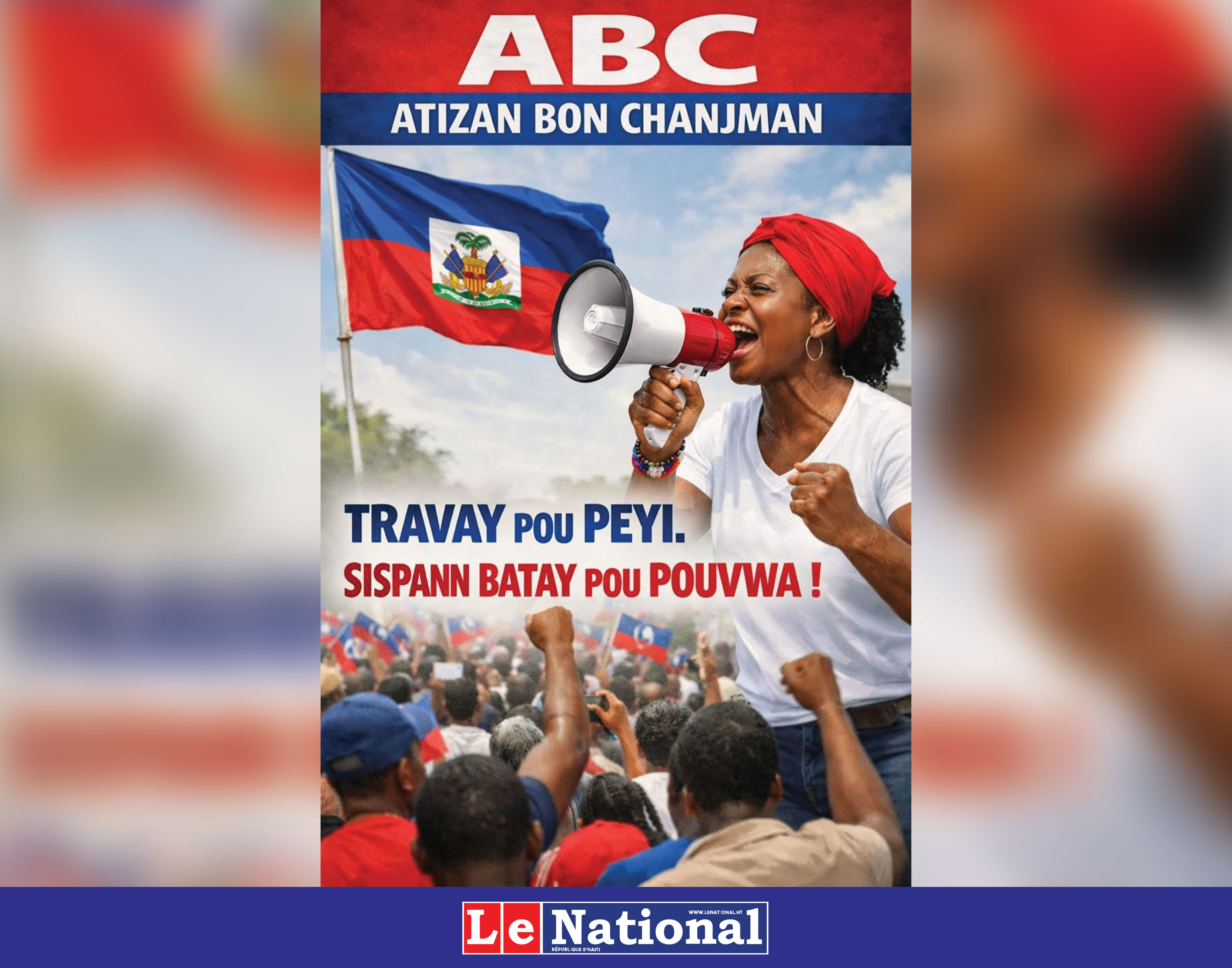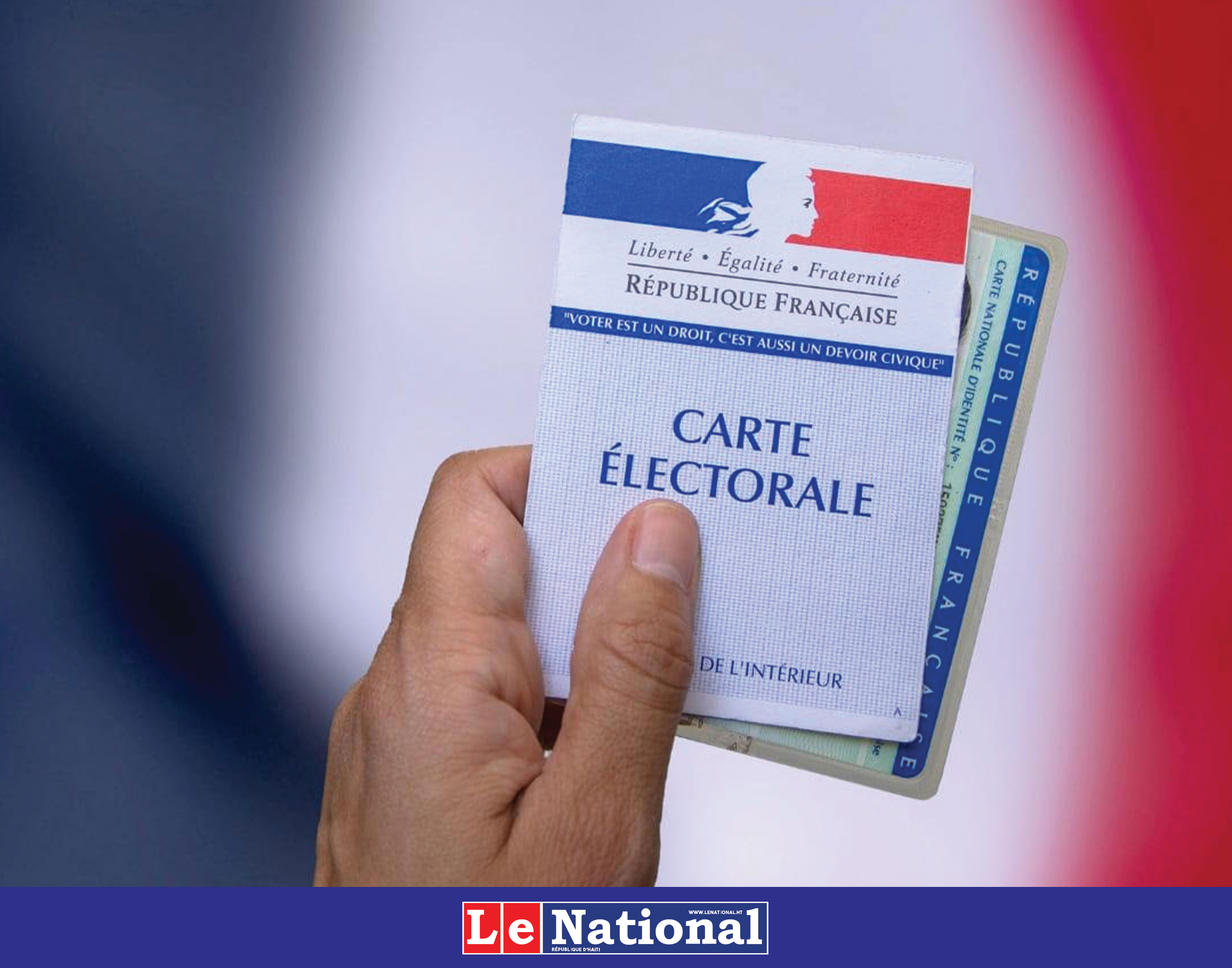(Première partie)
Par : Kenny THELUSMA, Jean Kenley BIEN AIMÉ et Elmano Endara JOSEPH
« Des êtres humains sans nombre sont déclarés indésirables, par des institutions et des idéologies, sont soumis à des discriminations, exclus de leurs communautés et spoliés des droits les plus élémentaires. Ils se trouvent brusquement dans des situations précaires, parce que leur propre État les menace et qu’ils ne trouvent de place dans aucun autre État, ou parce que les règles du jeu de la concurrence économique, aussi bien au plan national que global, leur conteste le droit à une place assurée dans le monde. Face à de tels dangers, Arendt a introduit la notion d’un droit qui serait plus fondamental que les droits de l’homme : le ‘’droit d’avoir des droit’’ ».
Urs Marti (1998), Hannah Arendt et le monde d’aujourd’hui, pp. 19-29
Résumé
Cet article analyse les décisions des États-Unis (annonce, le vendredi 27 juin 2025, de la fin du Statut de Protection Temporaire ou Temporary Protected Status (TPS) pour les Ayitiens, désignation de groupes armés en Ayiti comme « terroristes », le 2 mai 2025 et interdiction migratoire, le 4 juin 2025) comme des instruments politiques impérialistes et racistes.
Ce pose un problème majeur qui nous appelle à interroger les inquiétudes et critiques quant à la prise en compte réelle de leur situation et à l’absence de définition juridique consensuelle du « terrorisme », soulignant que ces mesures visent à altériser puis criminaliser Ayiti et ses ressortissants, tout en occultant le rôle historique des États-Unis dans (re)production de l’instabilité chronique du pays (occupations et interventions militaires, vol des réserves des trésoreries ayitiennes, trafic d’armes, etc.). Comment les décisions étatsuniennes de mettre fin au TPS, de qualifier certains groupes armés en Ayiti de « terroristes » et d’instaurer une interdiction migratoire fonctionnent-elles comme outils de stigmatisation et de domination impériale, au mépris de la réalité sécuritaire et humanitaire en Ayiti et du droit international ?
Ce travail table sur les postulats suivants : a) La fin du TPS contraste avec la crise multidimensionnelle – violence des groupes armés, effondrement institutionnel et déplacements massifs forcés; b) L’instrumentalisation du « terrorisme » : le flou juridique autour du terme permet à la superpuissance dominante étasunienne de stigmatiser des États et ressortissants vulnérabilisés; c) La terreur d’État : les sanctions étatsuniennes s’apparentent à une violence systémique légitimée, reproduisant des logiques impériales et néocoloniales et de déni des droits de « mounite »; d) La responsabilité occidentale : les États-Unis alimentent la crise ayitienne par des déplacements forcés, l’insécurité juridique, le trafic d’armes, le soutien à des régimes autoritaires tout en en rejetant les conséquences sur les Ayitiens; e) Le droit à la mobilité : l’interdiction migratoire viole l’idée « tout moun se moun » (Boumba et al.) ou le « droit d’avoir des droits » (Arendt), niant la dignité des personnes humaines.
Pour démontrer ces enjeux, l’article s’articule en deux grandes parties : Primo sur un cadre théorique critique qui invite à la mobilisation de penseurs tels que Galiand et al., Chomsky, Mbembe, Dussel, Ferry, Spaemann, etc., pour montrer comment la modernité occidentalo-centrée, impériale, capitaliste, extractiviste, raciste et néocoloniale produit l’altérité ennemie et légitimise l’exclusion et la mort sociale de l’Autre; secundo, une analyse empirique qui oblige le recours à des données historiques : sept rançons coloniales occidentales, douze occupations étatsuniennes, onze interventions onusiennes et à des rapports (ONUDC 2023) pour étayer la thèse. En cela, l’article se veut un appel à une résistance décoloniale globale et à une réappropriation souveraine de la sécurialité et des droits « mounite » de la personne humaine en Ayiti et dans les autres sociétés altérisées et insécurialisées.
Introduction
Le vendredi 27 juin 2025, le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) a annoncé la fin au Statut de Protection Temporaire (TPS = Temporary Protected Status) pour les Haïtiens. Cette mesure qui peut paraître exceptionnelle pour plus d’un, témoigne de la volonté des autorités de Washington de mettre fin au statut légal, déjà temporaire, à des milliers de ressortissants haïtiens de vivre et travailler légalement aux États-Unis. Ainsi, cette décision du DHS devait-elle prendre effet officiellement selon le DHS, le 2 septembre 2025, donc moins de six mois avant l’expiration formelle du statut actuel, prévue pour le 3 février 2026. Cette mesure fait suite à la précédente décision prise le 2 mai 2025, par les autorités américaines de désigner les groupes armés actifs en Ayiti Viv ansanm et Gran Grif comme des groupes étrangers et terroristes.
Pourtant peu après, soit le 4 juin 2025, un décret présidentiel signé par Donald Trump classait Ayiti parmi douze pays interdits d'entrer sur le territoire américain, officiellement pour des raisons de sécurité nationale. Ce triple mouvement, à la fois diplomatique, administratif et répressif, s’inscrit dans une série de mesures (géo)politiques adoptées au nom de la lutte contre le terrorisme international et de déni de la réalité de la crise multidimensionnelle d’Ayiti.
Selon la secrétaire de la maison blanche, Kristi Noem, cette décision de cessation de TPS, qui saurait prendre effet le 2 septembre 2025, s’appuie sur une évaluation concluant à « une amélioration des conditions en Haïti », permettant un retour « en toute sécurité ». Le DHS encourage les bénéficiaires à organiser leur départ via l’application CBP Home, tout en leur rappelant la possibilité de régulariser leur statut par d’autres voies, si éligibles.
En effet, cette nouvelle mesure fait suite à l’interdiction migratoire des Ayitiens aux États-Unis en date du 4 juin 2025. Le Bureau de communication du Département d’État des États-Unis, justifiait cette précédente décision en affirmant vouloir « isoler des entités ou des individus, et leur interdire l’accès au système financier américain et aux ressources dont ils ont besoin pour mener leurs attaques », ainsi « tous les biens et les intérêts des personnes aujourd’hui désignées, se trouvant aux États-Unis ou qui sont sous la possession ou le contrôle d’une personne des États-Unis, sont bloqués », peut-on lire dans le Communiqué publié en ligne, et disponible en traduction française sur le site officiel de United States Government.
En revanche, cette décision qui frappe indistinctement les groupes armés en Ayiti et les citoyens Ayitiens dans leur ensemble, soulève des interrogations majeures tant du point de vue juridique, diplomatique qu’éthique. À cela, le Ministère des Affaires étrangères et du Culte (MAEC) avait déjà riposté le 5 juin dernier dans une note rendue publique, pour se dire avoir pris acte de la décision et des conséquences y relatives sur la diplomatie ayitienne, des retombées économiques et politiques des deux pays et de promettre « d'un retour sur la question ». Le MAEC déplorait les restrictions américaines d’entrée visant Ayiti dès le 9 juin 2025, tout en appelant au dialogue et à des solutions face aux impacts sur les familles ayitiennes. Au regard de la « Déclaration de Los Angeles pour une migration régulière, sûre et ordonnée » adoptée lors du 9ème Sommet des Amériques tenu aux États-Unis d’Amérique en juin 2022, le MAEC entendait « poursuivre le dialogue et la coopération avec le gouvernement américain en matière de sécurité et de politique migratoire», pouvait-on lire dans la note.
Alors que ce précédent décret qui, explicitement, classait Ayiti parmi les 11 autres pays (le Congo-Brazzaville, le Tchad, la Guinée équatoriale, l’Erythrée, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, l’Afghanistan, le Yémen et la Birmanie) dont « les ressortissants étaient interdits d'entrée aux États-Unis », convoquent un prétexte officiellement pour « protéger » le pays des États-Unis de « terroristes étrangers ». Aussi pour les citoyens Ayitiens et ceux de 11 autres pays mentionnés, cette décision annoncée, a-t-il précisé, interdit l’entrée des ressortissants Ayitiens sur le sol américain, à compter de 9 juin 2025, au nom de la « lutte contre le terrorisme international ». Et tout ceci, après l'attaque du Colorado visant les participants d'une marche de soutien aux otages israéliens à Gaza, selon RFI.
Cette précédente annonce, aux allures de coup de tonnerre diplomatique, n’était pour plus d’un, qu’une gifle adressée notamment au peuple Ayitien dans son ensemble tant en Ayiti, à l'étranger ou aux États-Unis. Alors que, pour d’autres, elle n’était que la démonstration la plus récente de la manière dont les régimes d’extrêmes droites des puissances impériales, plus particulièrement des États-Unis, utilisent leur poids politique pour imposer leur vision unilatérale du monde, souvent au mépris des réalités locales, de la souveraineté des États historiquement dominés, occupés, de la dignité de ces peuples et de l’histoire des luttes de résistance que ces derniers se sont contribués à écrire depuis des siècles.
Nous avons pu relever deux problèmes majeurs par ce triple action : primo, l’usage contrasté de la fin du TPS et la réalité de la crise multidimensionnelle qui s’érige en Ayiti, secundo, l’usage instrumental d’un concept – le « terrorisme » – dépourvu de définition universelle et juridique claire, qui autorise des interprétations extensives et arbitraires; tertio, la généralisation punitive visant tous les ressortissants ayitiens révèle une dérive vers une forme de stigmatisation (inter)nationale injustifiée, en l’absence de preuve sur l’implication des ayitiens dans des actes jugés terroristes sur le sol américain.
Compte tenu de cette triple tablature, alors peut-on légitimement désigner tous les ressortissants ayitiens protégés par le TPS comme des illégaux après le 2 septembre date de l’effectivité de la cessation ? Ou peut-on légitimement désigner un pays et ses ressortissants comme menaçants en s’appuyant sur des classifications vagues et politiquement orientées du terrorisme ? Dit autrement, quelles sont les conséquences juridiques de l’absence de définition universelle du terrorisme ? Ou du moins, dans quelle mesure cette décision peut-elle refléter une stratégie impérialiste et raciste sous couvert de sécurité nationale ? Ou encore, quels peuvent être les impacts humains, sociaux et diplomatiques d’une telle interdiction pour les Ayitiens aux États-Unis et en Ayiti ?
Il s’agit, en cela, de comprendre comment l’usage stratégique de la classification terroriste participe à une reconfiguration des rapports Nord/Sud et à l'exclusion systémique et systématique des peuples vulnérabilisés, dominés et appauvris. Alors que cette triple désignation (groupes terroristes + interdiction migratoire, fin de TPS) relève ou s'apparente à instrumentalisation politique et géopolitique de la « peur » sécuritaire par une puissance dominante, plutôt que d’une décision objectivement justifiable selon les principes du droit international et selon les réalités actuelles d’Ayiti.
Autrement dit, ces décisions soulèvent des questions profondes sur l’usage politique du concept de « terrorisme », en l’absence d’une définition universellement acceptée au sein du droit international. L’argument sécuritaire, invoqué sans preuve directe d’une menace ayitienne sur le territoire américain, semble surtout s’inscrire dans une logique d’exclusion systémique fondée sur des logiques géopolitiques et raciales. Ainsi devient-il pertinent de se demander en quoi cette désignation peut-elle relever d’une décision sécuritaire objectivement fondée ou d’une instrumentalisation politique du vide juridique autour du concept de terrorisme ?
Comme hypothèse, nous avons soutenu que l’étiquetage terroriste des groupes gangs en Ayiti, l’interdiction d’entrée aux États-Unis et la fin de TPS pour les ressortissants Ayitiens constituent une forme de « terreur d’État », dissimulée sous un vernis légaliste de la domination occidentale capitaliste, nécrophile et raciste. Cela étant, il devient en ce sens fondamental d’analyser les motivations et les implications juridiques, politiques et idéologiques de ces décisions. D'où l'enjeu est de comprendre comment la géopolitique sécuritaire redéfinit les frontières de la souveraineté et de la dignité humaine pour des nations historiquement altérisées, dominées et subalternisées depuis la fondation de la modernité impériale et coloniale de 1492 (Walter D. Mignolo, 2011).
Texte intégral (première partie)
- Etiquetage de terrorisme, restriction migratoire et fin de TPS
1.1. Décisions arbitraires
Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) a mis fin ce 27 juin 2025 au Temporary Protected Status (TPS) pour les ressortissants Ayitiens, estimant que les conditions en Ayiti permettent un retour « sécurisé » des ressortissants. Effective le 2 septembre, cette décision, « prise après consultation des agences concernées », encourage les bénéficiaires à quitter volontairement les États-Unis via l’application CBP Home.
Pourtant, Ayiti reste en proie à une grave crise sécuritaire et humanitaire, remettant en cause l’argument d’une « amélioration ». Le DHS maintient que « prolonger le TPS irait à l’encontre de l’intérêt national, tout en suggérant d’autres voies de régularisation ».
Pour beaucoup d’Ayitiens, cette annonce signifie un retour forcé vers un pays instable, suscitant inquiétudes et critiques quant à la prise en compte réelle de leur situation.
Mais avant tout, il convient de questionner le fondement même de la décision de classification et d’assignation de tous les ressortissants de ces 11 pays (Congo-Brazzaville, Tchad, Guinée équatoriale, Erythrée, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Afghanistan, Yémen et Birmanie), notamment Ayiti dans la catégorie de la liste d’interdiction d’entrée (Travel ban) en date du 4 juin par les États-Unis. Il fallait avant tout questionner la classification des « groupes armés Viv ansanm et Gran grif » en Ayiti de « groupes terroristes » et de se servir de cette dénomination ou d’assignation terroriste pour sanctionner tous les ressortissants ayitiens et leur interdire strictement le droit de migrer et de vivre aux États-Unis. Dès lors, cette chaîne de décision restrictive ne relève-t-elle pas plutôt d’un abus de classification instrumentalisée, de sanction diplomatique et de police, qui ne repose d’ailleurs aucunement sur des études et prise en compte de la réalité ayitienne, où sévit une crise multidimensionnelle – violence des gangs, effondrement institutionnel et déplacements massifs ?
Bien que le DHS affirme que le maintien du TPS serait « contraire à l’intérêt national », des voix s’élèvent pour dénoncer une mesure précipitée, plongeant des milliers de familles dans l’incertitude. La fin de ce statut soulève ainsi des questions sur les critères d’évaluation et les conséquences humanitaires pour les Ayitiens concernés tant aux USA, ailleurs ou en Ayiti. Mais surtout, puisque cette chaine de décisions discriminantes fait suite à la catégorisation d’Ayiti comme « pays à groupes terroristes », il revient de questionner l’instrumentalisation du terrorisme qui a été fait par les États-Unis, eu égard du droit international tel qu’il est reconnu par les Nations Unies.
1.1.1. Indétermination juridique du terme « terrorisme » et/ou instrumentalisation d’une assignation classificatoire
En l’Absence de définition discutée et acceptée universellement : le droit international ne fournit pas de définition consensuelle du terrorisme, comme le soulignent les débats dans les sociétés postesclavagisés d’Afrique (Moda Dieng, Philip Onguny et Issaka K. Souaré (dir) (2019)) ou au sein même de la Sous-Commission des droits de l'homme de l'ONU. Dans les commentaires sur le « rapport entre le terrorisme et les droits de l’homme » (ONU, 2003), depuis 22 ans, des experts ont déjà averti « qu'il pourrait s'avérer dangereux de laisser à d'autres, qui pourraient être animés d'intérêts bien particuliers, la tâche d'établir une définition du terrorisme ». De même, en l’absence d’argument convaincant, prouvé par la justice étasunienne, que les ressortissants ayitiens représentent une menace quelconque pour la sécurité intérieure des États-Unis, que ce soit dans la note de décision en date du 2 mai ou de celle du décret du 4 juin, cette imprécision terminologique a facilité toutefois son instrumentalisation politique par le régime d’extrême droite de Washington (Andonea Dickson et. al. 2025).
Cela étant, la Conformation de politisation d’un vide conceptuel : des experts de l'ONU, dont M. José Bengoa, en se référant aux cas d’Argentine et du Chili à la fin du 20ème siècle, avertissent que l'étiquetage « terroriste » cible souvent à désigner celui à sanctionner notamment dans les États vulnérabilisés ou en situation de crise politique, sans définition objective et base juridique claire. L'absence d'attaque documentée et qualifiée de terroriste commise par des ressortissants Ayitiens aux États-Unis, démontre que cette désignation est particulièrement arbitraire au regard du droit international des migrations, dès lors, une décision qui ne peut être contestable et donc contestée.
1.2. Études de cas sur la production et des usages de la terreur
Le problème de définition conceptuelle consensuelle n’empêche pas pour autant à des chercheur.e.s. de poser des études de cas sur le phénomène de la terreur dans ces formes diverses et plurielles, depuis l’âge de la pierre à l’ère du numérique. C’est ainsi que, pour des auteurs comme Gérard Galiand et Arnaud Blin qui ont publié un livre de référence titré Histoire du terrorisme de l’Antiquité à Daech en 2016 chez les Éditions Fayard, le terrorisme est avant tout considéré comme un instrument ou une technique aussi vieille que la pratique de la guerre (Galiand et Blin, 2016, pp. 19-26 et passim).
En effet, le phénomène terroriste y est défini comme tous les phénomènes politiques, « à travers la dualité qui oppose les idéaux proclamés et leur mise en application. Le terrorisme n’existe que dans un contexte culturel et historique ». Cela étant, selon la provenance, ces deux auteurs classifient les actions terroristes dans deux grands groupes : d’ « en haut » ou d’ « en bas ». En tant qu’instrument, la terreur, qu’elle vienne d’ « en haut » ou d’ « en bas », épouse les mêmes principes stratégiques « faire plier la volonté de l’adversaire en affectant sa capacité de résistance ». et dans la terminologie contemporaine, le terrorisme d’ « en haut » peut être l’œuvre de la terreur de l’État (tant pis si, chez des auteurs romanistes et positivistes occidentalocentrés, ont justifié, légitimé les monopoles, de coercition, de la violence de l’État, des moyens de formatage de l’opinion publique, indépendamment de leurs manifestations et leurs conséquences) comme a été le cas, si l'on croit Jean Louis Vastey, de la violence impériale coloniale raciste de l’Europe contre les Tayino (Taïnos) et contre le reste du monde depuis l’époque dite moderne et colonial (Vastey, 1814); ou le cas de la doctrine de « bombardements stratégiques » développée en Occident durant les années 1930. Cette doctrine, précisent ces deux auteurs, était fondée exclusivement sur la terreur que pouvaient influer des bombardements massifs sur les populations civiles, afin de faire plier les gouvernements.
Et comme exemple de terrorisme d’ « en haut » pratiqué par l’État, Gérard Galiand et Arnaud Blin notifient « les largages de bombes atomiques par les États-Unis sur les populations civiles d’Hiroshima et Nagasaki », au japon, le 6 et le 9 aout 1945 (Galiand et. all. 2016, p. 21). Sans tenir compte des effets à long terme de l’irradiation, ces deux bombardements des États-Unis ont tué 90 000 à 140 000 de personnes pour Hiroshima et 60 000 à 80 000 habitants pour Nagasaki (Barthélémy Courmont, 2023 et Bertrand Jordan, 2018).
Pour tenter de cerner le contour du terrorisme d’ « en bas », Gérard Galiand et Arnaud Blin mettent en avant le composant idéologique qu’il soit politique, religieux, ou nationaliste dans la justification de la terreur. Ainsi, optent-ils pour la définition par exemple en rappelant des cas du groupe Hamas et Al Qaida, dans le Proche et Moyen Orient, qui « mélangent les aspirations politiques ou pseudo-politiques avec une base religieuse […] et du Klu Klu Klan aux États-Unis ».
Mais ce qu'il revient de s'en souvenir ici c’est que, dans une approche communicationnelle et un analyse géopolitique de l’usage de l’instrument de la terreur, c'est ce que, souvent, l’on comprend de manière diffuse aujourd’hui par « terrorisme », il constitue une appréhension héritée de la plupart des spécialistes prétendent nommer et combattre le terrorisme « d’en bas ».
Or, précisent Galiand et Arnaud, auteurs qui ont étudié le phénomène de la terreur depuis l’antiquité à Daech, le terrorisme d’ « en haut » c’est-à-dire celui pratiquer notamment par l’appareil d’État, l’emporte au cours de l’histoire. Fût-elle que cette terreur ait trouvé de justification ou de légitimation dans des théories pseudo scientifiques ou scientistes formatées par des fonctionnaires scientistes, positivistes et travaillant pour la cause de la bureaucratie de terreur, cela n’empêche pas de relever le sens caché des discours et des actions de tablature de la terreur dans la réflexion posée ici.
Alors que pour un pays comme Ayiti, de 1492 à aujourd’hui, le phénomène de la terreur d’en haut (des États impériaux et coloniaux occidentaux et de l’appareil répressif de l’État postcolonial) a tellement fait couler le sang du peuple ayitien, qu'on ne saurait comment les classer. Si tant est que les exemples de violences impériales, coloniales, génocidaires, esclavagistes, racistes, extractivistes (Bartolomé de Las Casas (2004), Vertus Saint-Louis (2004)), patrimoniale culturel (Mariana Françozo et Amy Strecker (2017) et Evgeniy Sergeevich Pankov (2024)), linguistique (Joseph Lefranc, 2025, Guylène Romain (2020, pp. 435-461 et passim) et (Fernand Léger 2020, pp. 2-28 et passim), électorale et genrée (Ketleine Charles, (2018) et Julien Sainvil, (2023), Guerline Toussaint, (2011) et violence dans l’espace domestique et du travail ( Rose-Myrlie Joseph, (2017), capitaliste, épigénétique, microbiologique, anthropologique (Roberson Édouard, 2013) etc. En effet, en plus de ces formes de violence multidimensionnelle et criminelle contre les Ayitiens, les violences subies par ce peuple, prennent aussi de formes symboliques, rituelles et structurelles ce qui ne peuvent impacter de manière néfaste les individus, les familles et les collectivités.
Toutefois, l’urgence de conjoncture nous impose de soulever la question suivante : comment serait-il possible de condamner la victime, ou du moins, celui ou celle qui a passé plus de cinq siècles sur les beaux jours du crime terroriste d’en haut ? Ou comment comprendre la condamnation des ressortissants dans l’illégalité et l’insécurité tout un peuple déjà victime de crimes ou de terreur d’en Haut imposé son propre territoire, mais aussi en provenance de la R. Dominicaine et actuellement des États-Unis ?
1.3. Vers une compréhension des mécanismes de la « (re)production terroriste »
Dans le cadre de cette analyse, Noam Chomsky est invité à notre discussion, avec son étude portée sur « l’art de fabriquer des terroristes » via une séquence de son livre titré : Pirates et empereurs. Le terrorisme international dans le monde contemporain, publié en français en 2003 chez Fayard, sur 362 pages. Cet « art de fabriquer des terroristes » est conçu comme l’opération « Liberté immuable » consistant d’abord à « territorialiser la menace » afin de faire émerger un territoire dans la « diagonale terroriste ». Cette opération continue pour donner « une forme à cet ennemi virtuel autant qu’elle cherche à trouver des États susceptibles de porter cette responsabilité ». C’est ainsi que Chomsky présente l’exemple flagrant qui sautait aux yeux des observateurs du monde entier sous la présidence George W. Bush (Chomsky, 2003, p. 63 et passim).
En cela, le président étasunien George W. Bush, déjà, dans le contexte de la fin du 20ème et du début du 21ème siècle s’est distingué dans « l’art de fabriquer des terroristes » par le fait qu’il a d’abord territorialisé l’ennemi dans le Proche-Orient et ensuite a abouti à l’opération de guerre, qui pour cacher le nom, le Frankfurter algemeine Zeitun du 9 mars 2003 a euphémismement dénommé « Tempêter du désert », bilan stratégique et instrumental. L’octroi d’un « permis de bombarder, donc de tuer », suivi d’une politique sécuritaire et migratoire resserrée aux USA et l’aplatissement des gouvernements des pays du Sud (Amérique latine, Afrique, Proche-Orient, Asie du Sud-Est); lesquels font réagir. Car afin de recevoir une aide économique, et se purger de leurs « rebelles locaux »; et d'échapper aux critiques des organisations de protection des droits de la personne, ces derniers sont obligés de se lancer dans la guerre « anti-terroriste ». D’où, la dernière étape de l’opération, lancement d’une lutte interne et externe qui, selon la logique anti-terroriste, « devait se transformer en une spirale de violence ».
Chomksy, brillant linguiste de MIT, intellectuel et analyste politique étasunien connu pour ses positions très critiques contre la domination de l’empire étasunien dans le monde; voilà comment il a systématisé les étapes, d’un cas historique qui pourtant, s’enracine dans le processus qui a été à plusieurs reprise appliqué et ajusté selon les réalités du moment et de l’espace en question.
C’est pour confirmer la justesse d’une telle réflexion que d’autres cas historiques ont été étudiés et mentionnés. Ce qui est important de souligner ici concerne le cycle de lutte contre l’ « ennemi étiqueté et territorialisé ». De l’étape de violence interne et de sanctions diplomatiques liées à la politique de migration, l’opération anti-terroriste passe par l’étape de ses « proxys ». Là, l’activisme militaire américain est accéléré pour chercher une « coopération tous azimuts avec les régimes en place » ou c’est le lancement des opérations militaires menées avec la coopération d’autres pays contre l’« ennemi qui a été construit, désigné et “propre à combattre” donc à être abattu ».
En cela, pour mener le combat contre ces « adversaires dépravés de la civilisation », le gouvernement américain mis alors en place un réseau terroriste international d’une ampleur sans précédent. « Si ce réseau entreprend des atrocités sans nombre d’un bout à l’autre de la planète, il réserva l’essentiel de ses efforts à l’Amérique latine », déclare Chomsky dans un article publié en décembre 2001 dans Le Monde diplomatique.
Les exemples historiques du terrorisme international des États-Unis ne manquent pas, tant dans les pays du Sahel (Mali, Tchad, Niger, Algérie) au mois de mars 2004 contre le Groupe salafiste, en tête de liste pour le combat, ou en Colombie en janvier 2002, avec les coalition de Pérou, Bolivie, et Colombie contre les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) que Washington a inscrit sur la liste des organisations terroristes. Le Cas du Nicaragua, selon Chomsky, s’agissait « pourtant d’un précédent encore plus extrême que les attentats du 11 septembre : la guerre de l’administration Reagan contre le Nicaragua provoqua 57 000 victimes, dont 29 000 morts, et la ruine d’un pays, peut-être de manière irréversible ». Sur ces crimes de terrorisme international des États-Unis dans le sous-continent Abya yala (Amérique latine), l’article donne à lire (« Occasion perdue au Nicaragua » et « “Contras” et “compas”, une même amertume).
Et cette histoire de perpétuation de la violence où le droit international peine à respecter, pour Chomsky, une telle histoire, notamment le cas du Nicaragua dans les années 1980 révèle plusieurs choses : d’abord, que le terrorisme, cela marche, la violence aussi; ensuite, qu’on a tort de penser que le terrorisme serait l’instrument des faibles; car « comme la plupart des armes meurtrières, le terrorisme est surtout l’arme des puissants. Quand on prétend le contraire, c’est uniquement parce que les puissants contrôlent également les appareils idéologiques et culturels qui permettent que leur terreur passe pour autre chose que de la terreur », écrit-il.
Mais comment font-ils les États-Unis pour y arriver là ? Le linguiste précise que « l’un des moyens les plus courants dont ils disposent pour parvenir à un tel résultat est de faire disparaître la mémoire des événements dérangeants ; ainsi plus personne ne s’en souvient. Au demeurant, le pouvoir de la propagande et des doctrines américaines est tel qu’il s’impose y compris à ses victimes ».
Si Chomsky met le cap sur d’autres pays tels le Guatemala, le Nicaragua et la Colombie, dans les lunettes de son analyse, il est crucial de préciser que pour cet auteur, la lutte contre le terrorisme dans la stratégie américaine passe par « la formation de coalition internationale » notamment entre les États-Unis et des États ou groupes armés, des aides en armement et l’irrespect des principes mêmes les plus élémentaires du droit des peuples ou des procédures judicaires au niveau du droit international.
Ce qui provoque la mise en place de positions d’alignement total aux intérêts des États. Car une fois que des pays sont qualifiés comme tels, contenant des groupes terroristes, souvent ils sont contraints de poursuivre d’une façon ou d’une autre les exigences de Washington car ces derniers sont instabilisés, précarisés et dépendants pour définir eux-mêmes leurs propres stratégies de luttes contre les « groupes armés étiquetés et territorialisés ». Et, quand l’opération ne passe pas formellement entre États et État(s), les Organisations internationales comme l’ONU (casques bleus) ou OTAN, CIA, MI6 etc. (Noam Chomsky & André Vltchek (2015) et Daniele Ganser (2011 et 2017) ces auteurs ont étudié ces guerres illégales notamment en Iran, au Guatemala, en Égypte, au Cuba, au Vietnam, en Nicaragua, au Serbie, en Afghanistan, en Irak, au Libye, en Ukraine, en Yémen et en Syrie, etc.,) c’est la part des groupes mercenaires ou paramilitaires qui rentre sous la scène. Ainsi, le marché international du crime vient-il décréter un nouveau débouché dans le secteur criminel, il faut signer des contrats, débiter ou créditer pour combattre les groupes qualifiés « à combattre ».
Donc, il faut recruter des soldats et policiers retraités, et mettre au service de l’économie du crime formalisé, le nouveau capital disponible qui a été engrangé d’abord dans l’informalité. En cela, sont nés les nouveaux rapports internationaux, où les États-Unis veulent avoir la dernière part de l’affaire du monde, fût-il le marché du crime organisé ou l’oppression de milliers d’individus et des ressources stratégiques pillées. Autrement dit, pour lutter contre la terreur (reproduite), soit on opte pour la coopération étatique et alliance (militaire, casques bleus, policier) ou soit on se résigne avec la coopération mercena-riale (mercenaires recrutés pour la cause), donc, mise en marche de la machine de guerre anti-terroriste rodée d’un arsenal juridique, et militaire, ONG, médias, qui travaillent non pas pour éradiquer les causes et mécanismes de la terreur d’en haut qui produisent la terreur d’en bas. Nais pour protéger et défendre des intérêts contingents et égoïstes.
Ainsi, l’autojustification de la lutte anti-terroriste ne peut-elle que faire tourner de manière durable et éternelle les roues de l’industrie de l’insécurité (re)produite pour faire fonctionner les deux faces du marché de l’économie capitalisme criminel formalisé et criminel informalisé, deux faces qui co-originairement ont produit la violence, la terreur du fort sur les faibles afin d'organiser les conditions de l’affaiblissement de celui désigné et altérisé comme Autre dans le sens de Naomi Klein (2008), Rémi Baudouï (2009), Myriam Benraad (2020), John O. Brennan (2021) Marc Hecker et Élie Tenenbaum (2021).
À cette liste de victime de « l’art de fabriquer les terroristes et de mise en place de ses proxys », les quelques exemples de guerres étasuniennes, occidentales et/ou européennes impériales ou néocoloniales contre la Libye, la Syrie, l’Afghanistan ou la Palestine, le Vietnam, les Philippines, le Cambodge, la Cuba, la Corée, l’Arménie et la RDC, la Burkina Faso, le Soudan sans oublier les cas du Kosovo, l’Ukraine ou de l’Iran…ces quelques cas ne sont pas exempts de l’étiquetage terroriste ou de terreur et de défenses d’intérêt géostratégiques cachés, de mensonges d’État et propagande médiatique ou de champagne de manipulation psychologique et de désinformation croissante généralisé, de violences contre les filles et les femmes, des crimes biotechnologique et épidémiologique etc. (voir Jacques Baud (2016), Laurent Bibard (2016), Pierre Claver Oyono Afane (2022), Moda Dieng, Philip Onguny et Issaka K. Souaré (dir) (2019), Nabons Laafi Diallo (2020), Noam Chomsky et Robert W. McChesney (2005), Sylvie Simon (2013), Ilan Pappé et Michel Collon (2020), Taner Akçam (2020), Hamit Bozarslan et. all. (2022).
1.4. De l'origine de la terreur d’en haut qui plane sur le peuple ayitien
D’où proviennent les causes de la terreur qui servent d’instrument à incriminer les ayitiens ? Si tant est que la terreur en Ayiti ne fasse quantitativement des victimes que principalement au sien de la population civile, mais cette terreur ne peut être comprise que comme l’existence d’un projet idéologique, politique et économique imbriqué dans la logique ultra capitaliste, d’une volonté de destruction non pas de la sécurité de la R. Dominicaine encore moins de celle des États-Unis, ou du moins de d’une remise en cause de l’ordre mondial établi. En revanche, on constate plutôt, c’est une terreur contre la sécurité de l’intérieure et de l’extérieure de chaque ayitien, tant du point vue privé que public, qui est en cause, par la remise en question des droits à la sûreté, à la sécurité, à la circulation, à la migration, de résidence et à la stabilité socioéconomique, politique et spatiale, du point de vue globale, une remise en cause des droits de faire partie du monde dans ses formes et relations diverses et plurielles.
Par ailleurs, en Ayiti, les « groupes armés » qui sévissent depuis plusieurs années ne sont pas des entités dotées d’idéologies extrémistes voire organisées comme c’est le cas pour Al-Qaïda, Daech ou Boko Haram ou Ku Klux Klan (Jenny Raflik, 2016). Leur coalition n’a été que l’œuvre des acteurs bien intentionnés notamment le BUNIH, qui a donné la bénédiction de cette formation par la voix d’Helen La Lime. (voir cet article, qui date de 2023 sur la question, Gangstérisation d’Ayiti : du contrôle territorial au démantèlement des mouvements populaires). Et lorsqu’on se demande d’où proviennent les causes de la terreur d’en haut contre le pays d’en bas, plus d’un se réfèrent au Rapport de l’ONU rédigé par l’ONUDC, titré : Haiti’s criminal markets : mapping trends in firearms and drug trafficking, (2023, pp. 2-43 et passim), où il y est noté en grand caractère que de manière générale :
Les armes à feu et les munitions entrent en Ayiti par voie terrestre et maritime, et la drogue transite généralement par les ports maritimes, les aéroports et des postes-frontières peu surveillés. La plupart des armes proviennent des États-Unis et parviennent aux membres de gangs et aux particuliers par des intermédiaires, souvent via des ports publics et privés et des points de contrôle perméables. Interceptées ou non, la plupart des drogues transitant par Ayiti sont produites en Colombie (cocaïne) ou en Jamaïque (cannabis) et expédiées directement depuis leur source, ou transitent par les Bahamas, les îles Turques-et-Caïques et le Venezuela. D'Ayiti, elles sont ensuite expédiées vers la République dominicaine, l'Europe occidentale et, principalement, les États-Unis (ONUDC, 2023, p. 2, la traduction et les soulignements sont de nous).
Sur la dynamique de la contrebande d'armes à feu qui sévit en Ayiti, le même rapport de l’ONU eu à rappeler que : « Ayiti ne fabriquant pas officiellement d'armes à feu ni de munitions, la quasi-totalité de nouveaux fusils, armes de poing, chargeurs et balles entrant dans le pays sont importés légalement ou illégalement ». Et le rapport poursuit :
La principale source d'armes à feu et de munitions en Ayiti se trouve aux États-Unis, et plus particulièrement en Floride. Des armes de poing populaires vendues entre 400 et 500 dollars dans des points de vente d'armes à feu agréés par le gouvernement fédéral ou lors de salons privés aux États-Unis peuvent être revendues jusqu'à 10 000 dollars en Ayiti, bien que les prix varient selon les préférences locales et l'offre internationale […]. Les analystes parlent d’un « pipeline de fer » qui non seulement traverse les États-Unis, mais transporte également des armes à feu et des munitions vers des pays des Amériques, y compris Ayiti. Les armes sont souvent achetées par le biais d’achats improvisés dans les États américains où les lois sur les armes à feu sont plus souples et où les restrictions d’achat sont moins nombreuses. Une fois acquises, les armes à feu et les munitions sont transportées en Floride, où elles sont dissimulées et expédiées vers Ayiti […]. À l’arrivée en Ayiti, y compris dans les principaux hubs tels que Port-de-Paix et Port-au-Prince, la cargaison est déchargée et transmise aux utilisateurs finaux via une multitude d’intermédiaires […] les armes pourraient d'abord transiter par des ports clés de Saint-Domingue, comme Haina, avant d'être expédiées à travers les postes frontaliers vers Ayiti, notamment depuis Jimani, Comendador et Elias Pina. Les autorités du seul port de Haina auraient saisi plus de 112 000 « unités d’armes à feu et de munitions » au cours des six premiers mois de 2022. La plupart d'entre eux viennent des États-Unis. (ONUDC, 2023, pp. 18-19, la traduction et les soulignements sont de nous).
Si bien que les armes et munitions qui (re)produisent la terreur contre la nation ayitienne et proviennent en grande pompe des États-Unis, selon les dernières études faites par l’ONU. Alors comment comprendre la décision américaine dans le contexte actuel ? Ou du moins, comment sanctionner les ressortissants ayitiens pour payer le prix des crimes du marché criminel auxquels ces derniers sont les premières victimes ? Cela ne témoigne-t-il pas que cette interdiction d’entrée sur le territoire des États-Unis et la fin du TPS ne tiennent aucunement compte des réalités de la crise sécuritaire du pays et de ses enjeux du moment ?
En cela, cette chaîne de décisions ne serait-elle pas trempée d’ignorance du fait que Ayiti ne fabrique aucune arme, qu’elle est purement et simplement victime de trafics illicites de la région ? Pas une seule usine de munitions, pas un seul site de production d’armements à feu n’existe officiellement sur le territoire ayitien, la vérité est bien connue des États-Unis et de l’ONU. Mais comment expliquer alors que les rues de Port-au-Prince et de Petites rivières de l'Artibonite soient inondées de fusils automatiques, souvent plus modernes que ceux utilisés par la Police nationale, selon l’opinion publique et les rapports susmentionnés ?
Ces armes ne sont pas fabriquées en Ayiti, mais bien, des Armes de la Terreur Made in USA. Elles sont importées, en majeure partie depuis les États-Unis eux-mêmes ou via des circuits clandestins transitant par les Caraïbes. Alors, il est clair qu’accuser Ayiti de produire sa propre violence, et de devoir subir les conséquences sans tenir compte ou sans dénoncer et poursuivre en justice ceux et celles qui en fournissent les stratégies de cette politique du chaos, afin de formater les outils… et de réaliser la marche finale vers l’holocauste, cela ne peut relever qu’une stratégie du triplet : coupable qui se fait avocat de soi en se hissant comme juge de soi pour se donner bonne conscience face à ses propres actes répréhensibles, criminels et condamnables.
Parallèlement il est à préciser, si tant est que les États-Unis et l’ONU soient historiquement largement impliqués directement ou indirectement dans la crise sécuritaire d’Ayiti notamment depuis les premières interventions militaires dans le Territoire et les Corps des Ayitiens, de 1914 à aujourd’hui, alors, le sociologue Charmant Fritzer (AlterPresse, 16 mai 2025) qui eut à étudier « les logiques nécropoles dans le contexte d’une démocratie criminelle sous protectorat onusien et américain », rappelle, que du point de vue de l’histoire récente des 11 interventions onusiennes en Ayiti (1993-2025), ces dernières, non seulement elles sont caractérisées par des logiques nécropoles et racistes, mais surtout elles « ont renforcé les mécanismes de dépendance et de violence systémique, entre autres parties prenantes du complexe du désastre », elles ont été selon Fritzer « un support essentiel à la privatisation du public, à la criminalisation de l’État et au déploiement des groupes criminels ».
1.5. Archéologie de la terreur d’ en haut depuis l’Occident contre le peuple ayitien
Il faut clairement préciser aussi la thèse selon laquelle la crise sécuritaire que traverse Ayiti aujourd’hui, les États-Unis et l’ONU sont parmi les principaux responsables et impliqués. Responsables et impliqués dans la production et la reproduction de la terreur contre la population, mais aussi, cette crise sociale, politique, économique… est le produit d’une longue histoire d’interventions étrangères, de soutien à des régimes autoritaires et illégitimes, de politiques de dépendance économique et de dépendance politique etc. Et aujourd’hui par l’Interdiction d’entrée suivie par la fin du TPS par le régime de Donald Trump, cette crise vient de prendre un ampleur encore aggravante par l’isolement diplomatique et migratoire, et la mise en illégalité des ressortissants ayitiens, une mise en illégalité formalisée et orchestrée à dessein.
Et dans cette histoire, les États-Unis, l’ONU entre autres pays de la coalition dénommée Core Group (Brazil, France, Allemagne, Canada etc.) n’ont pas été de simples observateurs, bien au contraire, du grand public, le secret et la fin de cette épisode de tragédie est bien connue. Ces acteurs ont été et sont encore malgré tout, des chefs de file de l’économie criminelle extractive, de l’occupation et coup d’État, de la contre-insurrection et déstabilisation systémique, de la politique nécropole et politique/pouvoir de la mort, et de la logique raciste de l’inimitié pour reprendre Achille Mbembe (2006 et 2016), Josué Merilien et Camille Chalmers (2023), Windy Phele (2025), José Atiles-Osoria (2020), Rainer Bomfim et Alexandre Gustavo M. F. de Moraes Bahia (2022), Christine Jiha (2023) et Kristen Casey, Kathy Fernández et Nikoleta Nikova (2022).
Auteurs :
Formation : Communication sociale/Faculté des Sciences Humaines (FASCH/UEH)
&
Jeankenleybienaime902@gmail.com
Formation : Relations Internationales/Institut National d’Administration, de Gestion et des Hautes Études Internationales (INAGHEI/UEH)
&
joseph.elmano_endara@student.ueh.edu.ht
Formation : Fondements philosophiques et sociologiques de l’Éducation/Cesun Universidad, California, Mexico, Sciences Juridiques/FDSE, Communication sociale/Faculté des Sciences Humaines (FASCH/UEH)