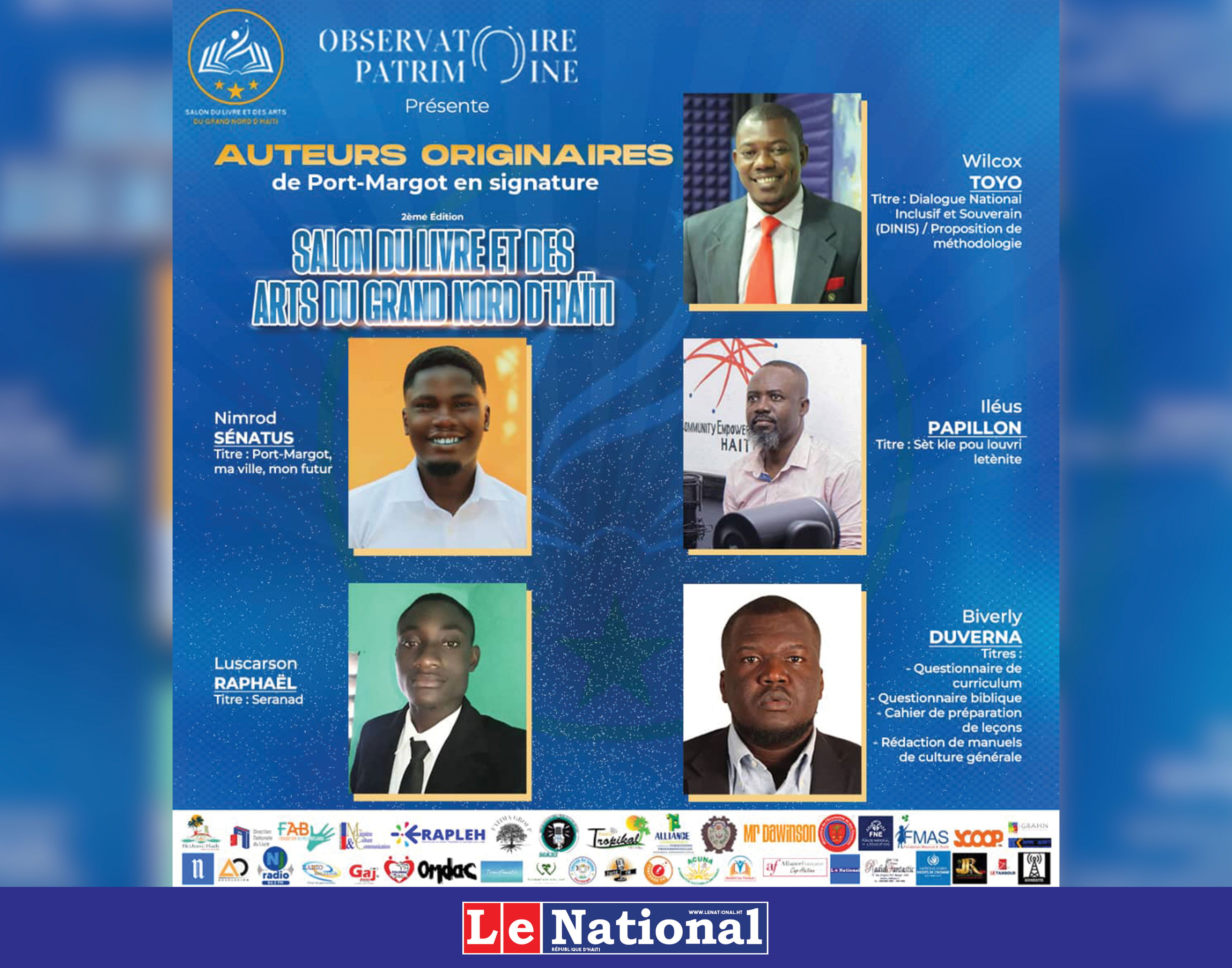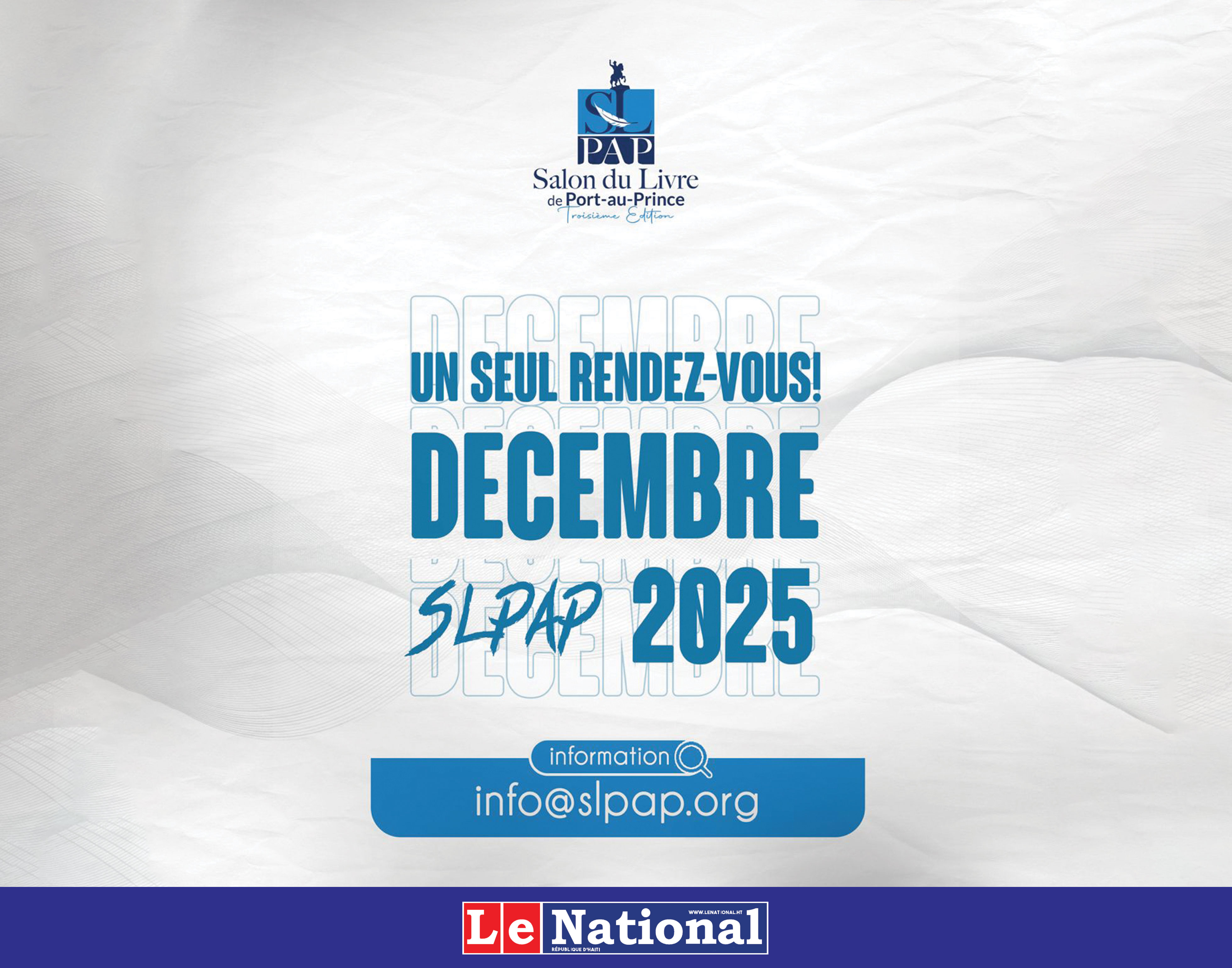La saison littéraire en France vient de s’ouvrir, et déjà l’air en est saturé comme d’un parfum entêtant. Cela se ressent dans les rues, dans les librairies, dans les colonnes des quotidiens : la littérature y devient presque une seconde respiration nationale.
Les journalistes littéraires, eux, se transforment soudain en véritables prêtres d’un culte séculier. Chroniqueurs dans les journaux, critiques dans les revues mensuelles ou trimestrielles, ils sont courtisés comme des oracles, choyés comme des enfants-rois, dorlotés par un ballet incessant d’attachés de presse et d’éditeurs soucieux de placer leur petit lopin de communication. Le tout, bien sûr, pour faire parler de « leur » écrivain, de « leurs » découvertes, de « leurs » révélations.
Durant cinq longs mois, la France se met à vivre au rythme cadencé des livres, comme un pays qui aurait troqué ses pendules contre des romans. Chaque semaine apporte son flot de publications, chaque jour ses intrigues littéraires, chaque heure son bruissement critique. C’est une véritable course de chevaux où les maisons d’édition alignent leurs poulains, bien étrillés, bien préparés, espérant qu’un prix prestigieux vienne couronner leurs efforts.
Et quels prix ! Plus de deux cents distinctions littéraires, véritables pluies d’étoiles tombant sur l’Hexagone. Mais parmi elles, une vingtaine seulement couvre réellement tout l’espace littéraire français. Les autres, distribuées dans une relative indifférence, ressemblent à ces feux follets dans la nuit, brillants un instant avant de s’éteindre dans le silence. Les grands prix — Goncourt, Renaudot, Femina, Médicis, Interallié — jouent le rôle de soleils autour desquels gravitent tous les autres, astres secondaires dont la lumière peine à franchir l’horizon.
La saison littéraire française est donc à la fois une fête et un champ de bataille, une foire d’empoigne et un carnaval. Derrière les sourires polis des réceptions, on devine les rivalités sourdes, les calculs, les stratégies, comme si chaque roman n’était pas seulement un livre mais un soldat envoyé à la guerre de la reconnaissance.
Et pourtant, malgré cette frénésie, malgré l’excès des prix, malgré la mise en scène médiatique, il reste quelque chose d’admirable : cette capacité d’un pays à vivre, l’espace de quelques mois, au rythme des mots et des idées, comme si la littérature était encore capable d’enflammer les passions collectives.
Il est à Paris un quartier qui bat comme un cœur fiévreux au rythme de la littérature. Ses librairies semblent ouvertes presque vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris le dimanche, comme des chapelles où le culte du livre ne s’interrompt jamais. À quelques mètres de là se dresse le Café de Flore, ce temple profane de Saint-Germain-des-Prés, où certains prix littéraires sont proclamés, fêtés, immortalisés. Là, entre les volutes de fumée et les tintements de verres, s’écrit une autre page de la littérature française : celle des rites, des intrigues, des consécrations mondaines.
Gloire et récompense
Dans la brume des cafés de Saint-Germain, on distingue les silhouettes familières : critiques littéraires au verbe tranchant, journalistes flairant le prochain succès, présidents de jury installés comme des notables, éditeurs affairés, agents d’écrivains aux aguets. Tout ce petit monde, tel une ruche en pleine effervescence, s’agite pour donner le ton de la saison. La « rentrée littéraire », comme on l’appelle, n’est pas seulement un moment de culture : c’est une cérémonie sociale, une fête qui commence en août et ne s’achève qu’en décembre, au rythme des remises de prix et des feux médiatiques.
Pour les écrivains, être nominé, c’est déjà une victoire. Car un prix littéraire offre une double récompense : la gloire symbolique, qui inscrit un nom dans l’histoire, et la récompense matérielle, car plus d’une trentaine de prix sont dotés financièrement. Certains ne rapportent que quelques billets d’honneur, mais d’autres changent une vie. Le plus convoité, le Prix Goncourt, ne donne que dix euros en espèces mais garantit l’essentiel : un bond vertigineux dans les ventes, au moins cent mille exemplaires écoulés, parfois davantage. On dit même que recevoir le Goncourt, c’est s’assurer d’un siècle de lecteurs en un seul hiver.
Ainsi va la saison littéraire française : à la fois foire aux vanités et moisson abondante, lieu de rivalités sourdes et de rêves éclatants, où chaque livre devient un joueur dans une partie d’échecs, et chaque écrivain un athlète lancé dans une course de fond. Derrière les vitrines illuminées des librairies de Saint-Germain, c’est tout un pays qui se met à vivre, le temps de quelques mois, au souffle des mots et des idées.
Maguet Delva,
Paris