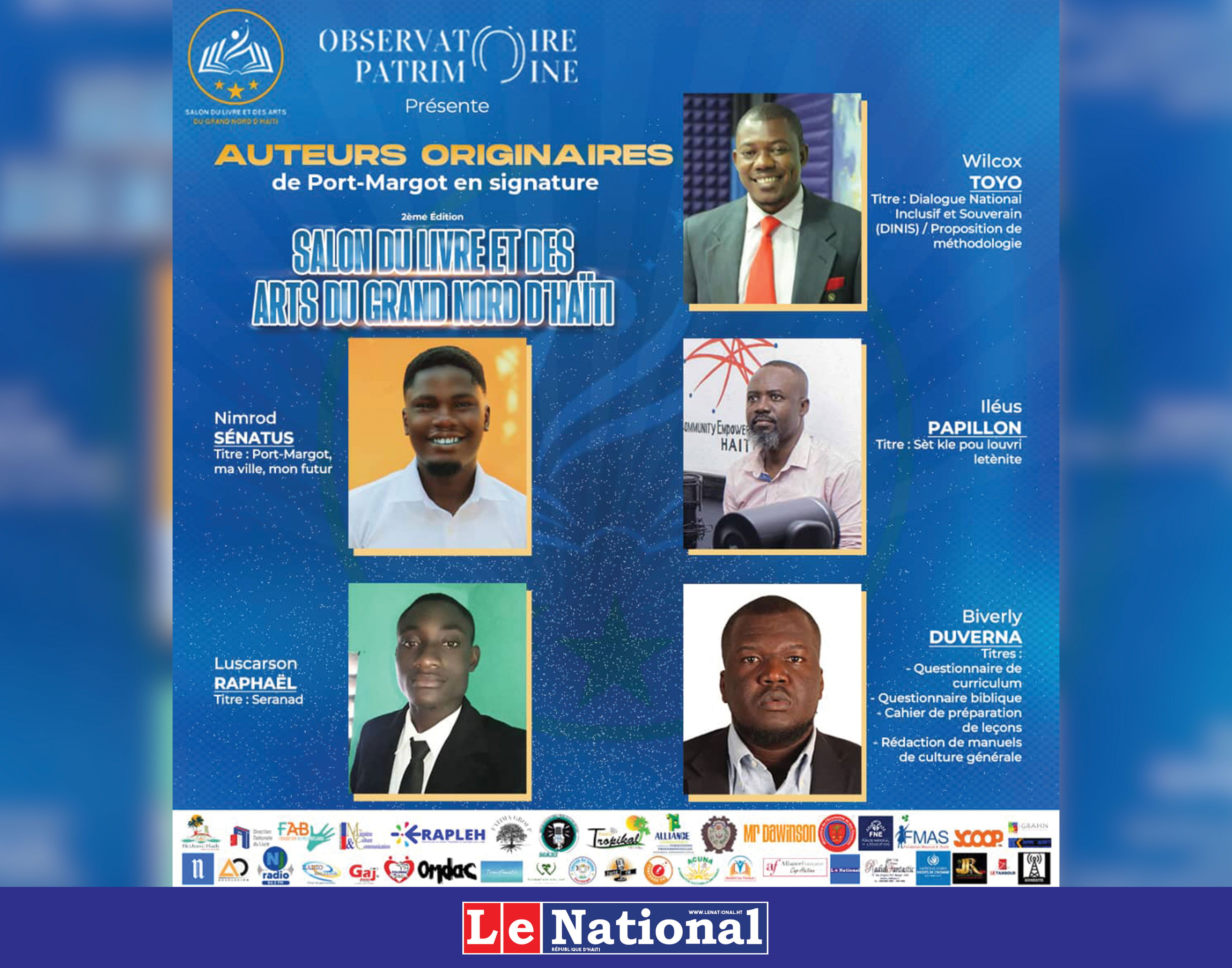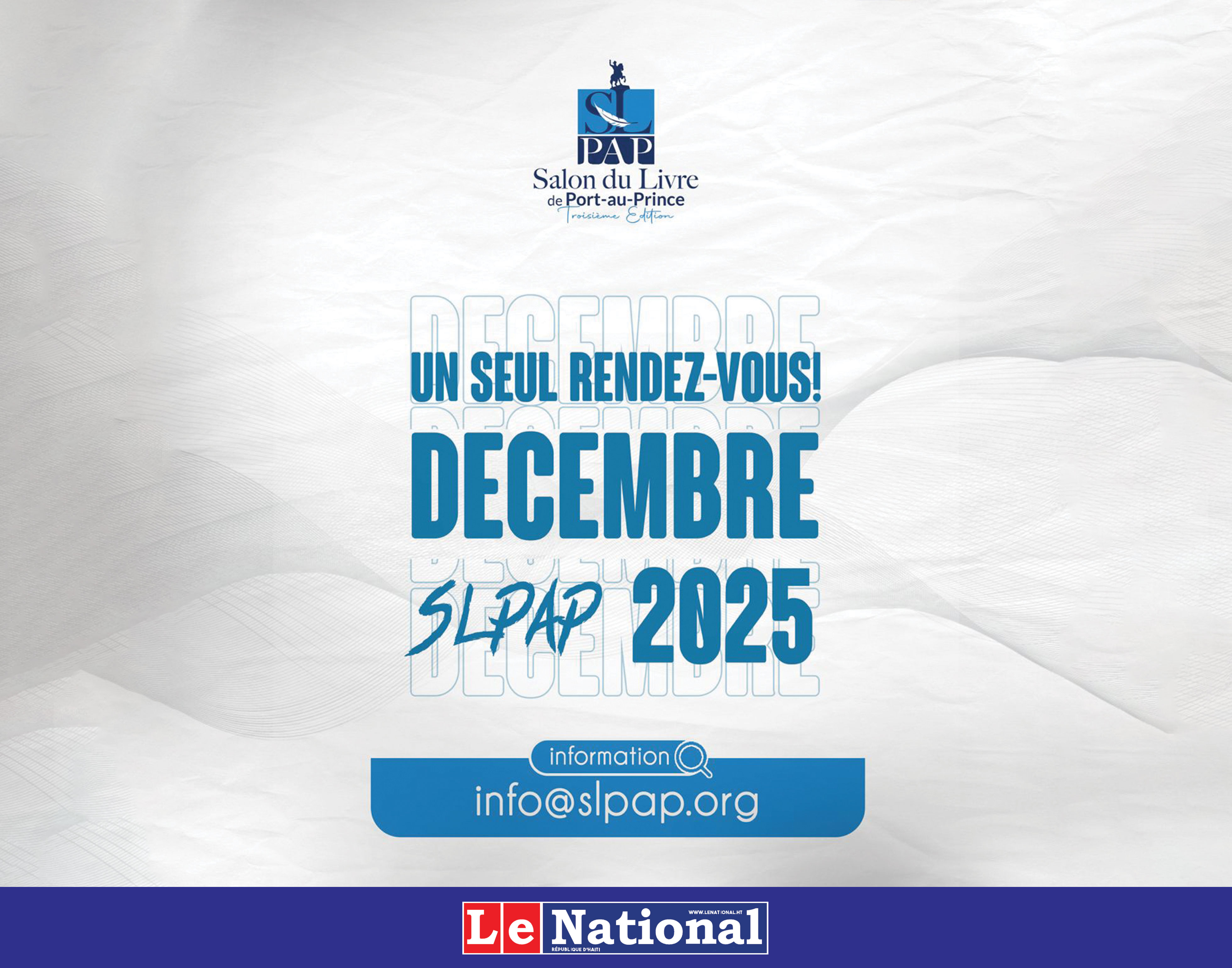C’était une constellation singulière des écrivains-diplomates haïtiens qui, au tournant des XIXᵉ et XXᵉ siècles, se retrouvaient à Paris, la Ville Lumière, pour échanger dans les salons feutrés où se croisaient des confrères et intellectuels venus du monde entier. Dans cette capitale bruissant d’idées, de cafés enfumés et de journaux débattus à la chandelle, Haïti brillait par ces voix qui, malgré leur diversité, portaient haut le nom de leur patrie.
Quelles que fussent leurs divergences ou leurs rivalités, deux paramètres guidaient toujours leurs conversations : Haïti et la littérature. Haïti, cette patrie lointaine qu’ils portaient avec eux comme une bannière et un fardeau, une responsabilité plus qu’un simple souvenir. Et la littérature, qui était à la fois leur arme et leur passeport, leur outil de reconnaissance dans un monde encore fermé, mais aussi leur manière de peser dans le grand débat des idées universelles.
On y voyait Frédéric Marcelin, le romancier devenu mémorialiste ; Anténor Firmin, le penseur flamboyant de L’Égalité des races humaines ; et François Saint-Surin Manigat, diplomate de haut rang. Les deux derniers servaient comme envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires de la République d’Haïti, tandis que Marcelin, déjà familier des cercles diplomatiques, déployait son verbe autant que sa plume. Ces rencontres parisiennes ressemblaient à de petites ambassades littéraires, des chancelleries de l’esprit où l’on discutait des destinées nationales aussi sérieusement que des tendances intellectuelles de l’époque.
Paris, pour eux, était une tribune. Dans les cafés, dans les librairies, dans les salons feutrés de la rive gauche, ils parlaient d’Haïti comme d’un navire fragile qu’il fallait sauver, et de la littérature comme de la voile qui pouvait lui redonner souffle et direction. Chacun, à sa manière, apportait sa contribution : Firmin par sa rigueur scientifique et son idéal d’égalité, Manigat par sa finesse diplomatique, Marcelin par cette capacité unique à transformer les événements en récits vivants.
Nord Alexis
On ne peut parler de Marcelin sans évoquer ses quatre tomes, signés sobrement Nord Alexis, figure centrale et controversée de l’histoire nationale. Au fil de ces volumes, le mémorialiste déroule une fresque. On y croise des héros, des traîtres, des victimes, des ambitions démesurées et des rêves brisés. Il y est aussi question de Massillon Coicou, poète et patriote, que Nord Alexis fit fusiller lors des joutes sanglantes qui ensanglantèrent la capitale — un épisode tragique que Marcelin narre avec une intensité dramatique qui donne au lecteur l’impression d’entendre encore les détonations du peloton d’exécution.
Il y est aussi question d’Anténor Firmin, adversaire flamboyant dont Marcelin restitue la stature avec autant de respect que de distance. Le contraste entre Firmin, l’idéologue de l’égalité, et Alexis, le général devenu autocrate, forme l’arrière-plan de toute l’histoire. Marcelin, en témoin privilégié, nous donne les clefs d’une époque où Haïti oscillait entre l’éclat et la ruine.
Dans ces pages, l’écrivain livre des récits précis, documentés, presque didactiques, mais toujours racontés avec la verve d’un conteur invétéré. Sa plume trace des scènes comme un peintre ses tableaux : les intrigues des palais, les rumeurs des rues, les débats enfiévrés et les trahisons étouffées se déploient sous ses mots avec une intensité presque théâtrale.
Ces tomes sont une archive vivante, une passerelle entre littérature et histoire, où la mémoire nationale trouve refuge. En écrivant Nord Alexis, Frédéric Marcelin ne cherchait pas à régler des comptes, mais à offrir aux générations futures une matière brute et stylisée à la fois, un récit qui éclaire autant qu’il met en garde. Et c’est peut-être là son plus grand mérite : avoir compris que l’histoire d’Haïti, si souvent tragique, devait être racontée non seulement par les vainqueurs, mais aussi par des plumes capables d’en faire une leçon.
Dans cette œuvre, le diplomate et l’écrivain fusionnent, donnant naissance à un mémorialiste dont la voix résonne encore aujourd’hui, comme un écho des heures les plus sombres et les plus lumineuses de notre histoire. Ces quatre volumes nous montre un qu’on ne peut enfermer dans une seule étiquette. Frédéric Marcelin fut à la fois romancier, économiste, diplomate et mémorialiste — quatre visages d’une même figure, quatre miroirs tendus à l’histoire d’Haïti.
Peintre de nos mœurs
Le romancier, d’abord, peignit nos mœurs avec l’acuité d’un moraliste et la verve d’un satiriste. Ses romans sont autant de fables modernes où la société haïtienne se reconnaît, avec ses travers et ses grandeurs, comme dans un miroir implacable.
L’économiste, ensuite, plongea dans les arcanes des finances publiques, des douanes, des banques et surtout dans le fardeau de la dette de l’indépendance. En quatre ouvrages majeurs, il éclaira des questions qui, plus d’un siècle plus tard, demeurent au cœur du débat sur notre souveraineté. En cela, il fut un éclaireur, un pionnier, un penseur d’avant-garde.
Le diplomate, quant à lui, représenta son pays à l’étranger, d’abord à Washington comme premier secrétaire d’ambassade, puis dans les plus hautes charges ministérielles. Dans les salons de Paris comme dans les chancelleries, il fit entendre la voix d’Haïti avec élégance et fermeté, portant sur ses épaules le poids de la représentation nationale.
Enfin, le mémorialiste légua à la postérité quatre tomes foisonnants sur le règne de Nord Alexis. Plus que des souvenirs, il s’agit d’une fresque où l’Histoire se fait récit, où les héros et les victimes se croisent sous la plume d’un conteur qui savait transformer le réel en archives vivantes.
Ces quatre visages, mis ensemble, composent une figure totale. Marcelin n’a peut-être pas cherché à changer le monde comme un révolutionnaire ; mais il a su observer, analyser, raconter et transmettre, ce qui n’est pas moins décisif. Grâce à lui, la mémoire d’Haïti s’est enrichie d’une œuvre où la littérature et l’Histoire dialoguent sans cesse, offrant aux générations futures des clés pour comprendre et penser leur propre destin.
En définitive, Frédéric Marcelin reste l’un de ces hommes dont la vie entière fut consacrée à donner forme, voix et sens à son pays. Sa plume, tantôt critique, tantôt diplomatique, tantôt didactique, résonne encore comme un témoignage et une leçon : qu’Haïti, malgré ses blessures, peut toujours s’écrire et se penser.
Maguet Delva