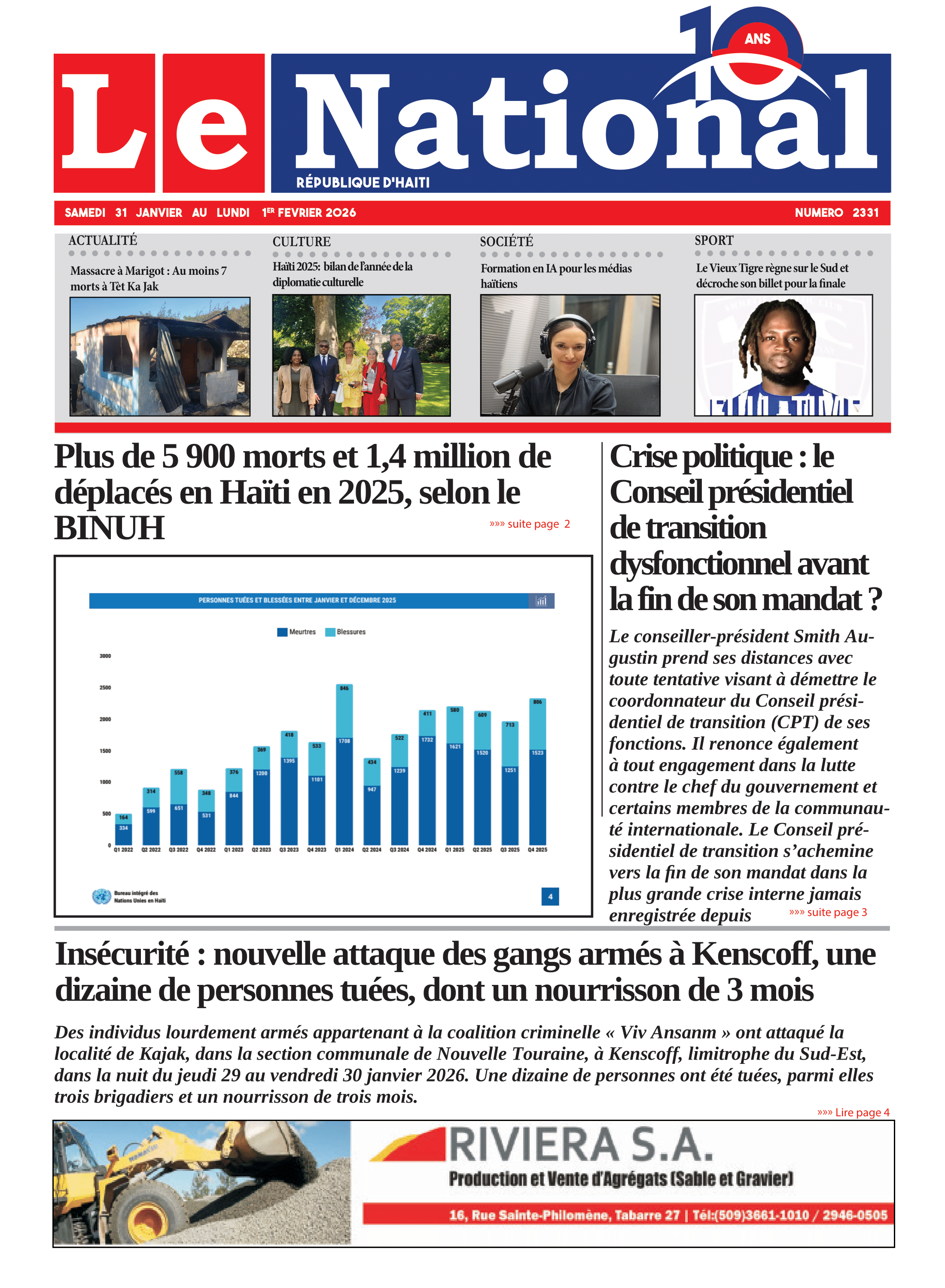La polémique autour du renvoi ou du maintien du Premier ministre, à l’approche de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition (CPT), ne relève pas d’une véritable incertitude juridique. Elle révèle surtout un rapport de force politique qui cherche à se déguiser en débat de droit : en période de transition, le droit ne saurait être invoqué à géométrie variable, au gré des intérêts du moment.
La mise en place du CPT et du gouvernement actuellement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s’inscrit, malgré l’existence de la fonction de Premier ministre dans la Constitution de 1987, dans un cadre essentiellement transitoire. Au regard du décret portant création du CPT, il s’agit d’un dispositif de transition, établi en dehors du fonctionnement institutionnel ordinaire.
Cette solution — parmi d’autres arrangements adoptés après l’assassinat du président Jovenel Moïse — s’explique par l’absence de réponse constitutionnelle effective à la crise prolongée que traverse le pays. Les institutions républicaines, notamment le Sénat et la Chambre des députés, étaient déjà en situation de dysfonctionnement sous l’administration Moïse, faute d’élections organisées dans les délais constitutionnels. À la suite de sa disparition brutale, il est donc devenu impossible de désigner un successeur selon la procédure prévue.
Dans ce contexte, l’article 149 de la Constitution, dont se réclamait le Premier ministre Ariel Henry pour conserver la plénitude du pouvoir exécutif, n’était pas applicable. Cette disposition vise à assurer la continuité constitutionnelle et démocratique de l’État en cas de vacance, non à encadrer une transition politique née d’une rupture institutionnelle.
Dans la tradition constitutionnelle et politique haïtienne, la fonction de Premier ministre est étroitement liée à l’existence d’un Parlement opérationnel : l’absence de l’un rend l’autre, en pratique, dépourvu de fondement. Il est donc juridiquement et constitutionnellement anormal de maintenir un poste de Premier ministre en l’absence des Assemblées parlementaires. Une telle situation entraîne des conséquences lourdes sur le plan institutionnel, puisque le Parlement constitue, en Haïti, la première instance de contrôle de l’action gouvernementale.
Nous sommes ainsi confrontés à une configuration préoccupante : un exécutif qui gouverne et légifère par décrets sur l’ensemble des questions d’intérêt public, tout en s’auto-contrôlant. C’est une gouvernance sans contre-pouvoirs, révélatrice d’un modèle hélas récurrent, où des gouvernements issus du suffrage sont renversés puis remplacés par des régimes de facto, dépourvus de mandat démocratique.
La constitution ne s'applique pas à un régime transitoire
La lutte de pouvoir entre le Conseil présidentiel de transition et la Primature dirigée par Alix Didier Fils-Aimé met en lumière les limites et contradictions d’une gouvernance de fait, issue d’un bricolage juridique visant à donner une apparence de légalité à un pouvoir exercé hors des normes démocratiques.
La fonction de Premier ministre, telle que prévue par la Constitution de 1987, n’a pas été conçue pour s’exercer dans le cadre d’un gouvernement transitoire ou éphémère. Elle s’inscrit dans une architecture institutionnelle précise : le Premier ministre est un véritable gouvernant, non un simple fonctionnaire. La Constitution lui reconnaît des attributions propres, distinctes de celles du président, au sein d’un exécutif bicéphale.
Le Premier ministre constitue ainsi un contrepoids institutionnel au président de la République : il ne lui est pas subordonné et aucun lien hiérarchique n’existe entre ces deux têtes de l’exécutif. La Primature, au même titre que la Présidence, relève d’un cadre républicain fondé sur la légitimité démocratique. Or, gouverner en démocratie suppose un mandat.
Le président de la République tire sa légitimité du suffrage universel et engage sa responsabilité politique devant le peuple. Le Premier ministre, quant à lui, tient la sienne des Assemblées parlementaires, qui lui confèrent un mandat par la ratification de sa déclaration de politique générale. Ce mandat l’autorise à conduire l’action gouvernementale et peut lui être retiré en cas d’insatisfaction, par les mécanismes de responsabilité parlementaire.
Le Premier ministre a une légitimité politique
N’ayant été ni choisi par un président élu au suffrage universel, ni investi à l’issue d’un processus parlementaire régulier — comme le prévoit normalement la Constitution de 1987 —, le Premier ministre de facto tire sa légitimité de l’accord politique du 3 avril 2024, du décret instituant le Conseil présidentiel de transition (CPT) et, en définitive, d’une décision politique du CPT.
Dans ces conditions, se prévaloir de dispositions constitutionnelles conçues pour un ordre institutionnel normal afin de prolonger un pouvoir né d’un cadre transitoire revient à dénaturer l’esprit du droit constitutionnel. La continuité de l’État ne saurait être confondue avec la continuité indéfinie des autorités de transition.
Au 7 février 2026, l’ensemble des institutions et autorités issues de la transition devient caduc : le CPT, le gouvernement et toute autorité qui tire sa légitimité de cet arrangement. Il serait donc incohérent de soutenir que le CPT a une durée déterminée, tandis que le Premier ministre pourrait, lui, se maintenir sans limite. Une telle thèse n’est pas juridique : elle relève d’une fiction politique.
En régime constitutionnel ordinaire, la responsabilité politique du Premier ministre s’exerce devant le Parlement. Mais dans le cadre de la transition, un organe de contrôle spécifique — présenté comme un OCAG de transition — était censé jouer ce rôle. Or, cet organe n’a jamais été mis en place.
À défaut, le pouvoir de contrôle revient nécessairement à l’autorité de nomination : le CPT. Cette logique correspond d’ailleurs au principe selon lequel l’autorité qui nomme dispose, en règle générale, d’un pouvoir de révocation, selon des procédures analogues.
Surtout, le droit ne saurait s’appliquer différemment selon les personnes. Si le CPT a pu procéder au remplacement de Garry Conille, il n’existe pas de justification juridique solide permettant d’affirmer qu’il ne pourrait pas agir de la même manière dans le cas de Didier Fils-Aimé. À défaut, on admettrait une variation arbitraire de la règle de droit.
Devant qui, dès lors, le Premier ministre répond-il ? Il est juridiquement contestable de soutenir qu’il ne peut être renversé que par un organe de contrôle qui n’a jamais existé. On ne peut exiger d’un responsable politique qu’il rende compte devant une institution fictive. En réalité, une telle lecture aboutit à une conséquence grave : elle confère au Premier ministre une forme d’irresponsabilité politique, contraire à tout principe de gouvernance — y compris en période de transition.
Impératif d’un nouvel accord après le 7 février 2026
Au-delà du 7 février 2026, aucune solution stable ne peut être envisagée sans un nouvel accord politique définissant clairement :
- la gouvernance post-transition,
- la durée des mandats,
- et des mécanismes de contrôle réellement opérationnels.
Toute prolongation unilatérale, sous couvert de « gestion des affaires courantes », sans base politique reconnue, ne ferait qu’aggraver la crise de légitimité et creuser le déficit de souveraineté.
La question du renvoi ou du maintien du Premier ministre ne peut pas être tranchée à partir de textes juridiques pris isolément. Elle rappelle une réalité souvent occultée : le droit n’est pas neutre. Son interprétation et son application reflètent des choix politiques et des rapports de force.
Refuser au CPT la possibilité de révoquer le Premier ministre qu’il a lui-même nommé, tout en admettant qu’il avait le pouvoir de le désigner, revient à instituer une incohérence institutionnelle dangereuse. Le pays ne peut sortir de l’impasse qu’en assumant une évidence : à l’échéance, c’est un nouvel accord politique — clair, public et opposable — qui doit refonder la gouvernance.
Tenant compte des différentes positions juridiques déjà exprimées, ma démarche s’inscrit dans une analyse féministe du droit, entendue comme une déconstruction du positivisme juridique qui a dominé la pensée juridique moderne — positivisme souvent mal compris dans nos cercles en Haïti. Elle montre que la prétendue neutralité du droit dissimule, en réalité, une structure de rapports de pouvoir.
Dans cette perspective, j’avance l’hypothèse que certaines argumentations sur le renvoi ou le maintien du Premier ministre révèlent — ou masquent — les intérêts de forces souterraines, en contradiction avec l’intérêt national. La transformation politique et sociale souhaitée, dans le contexte de crise aiguë que nous traversons, ne peut venir que de la mobilisation de forces sociales non inféodées aux acteurs en présence, capables de faire échec au projet néocolonial.
Nous ne sommes plus dans un débat encadré par la Constitution ou par le décret créant le Conseil présidentiel de transition. Le minimum de droit invoqué pour justifier la situation actuelle a cessé d’opérer ; il est remplacé par la logique de la force. La question devient politique, au sens le plus brut : une politique sans garde-fous effectifs. Et cette brutalité, on la voit chaque jour à l’échelle internationale, où les rapports entre États sont de plus en plus gouvernés par l’intérêt et la contrainte, au détriment des principes.
Dans ce contexte, le CPT risque de perdre le bras de fer face à Didier Fils-Aimé — pour toutes les raisons que l’on connaît. Non parce qu’il serait juridiquement incompétent pour révoquer le Premier ministre, mais parce que les rapports de force lui sont défavorables. Il devra se plier, au risque de disparaître.
Certains Haïtiens s’indignent — à juste titre — des sanctions américaines visant les conseillers ayant signé la résolution de révocation du Premier ministre. Mais peut-on, pour autant, offrir notre solidarité à des dirigeants qui ont conduit le pays à la déchéance ? La question est à la fois bouleversante et inconfortable pour tout patriote qui aime son pays.
La nécessité d'un droit de manœuvre
Le risque d’ingérence est évident. La position américaine, même si elle s’explique par un argument d’opportunité – celui de ne pas bouleverser l’exécutif à quelques jours de l’échéance -, soulève une autre question : celle de la limite entre accompagnement et ingérence.
De plus, le raisonnement américain et canadien est creux : on ne peut pas, d’un côté, reconnaître au CPT le pouvoir de nommer un Premier ministre, et de l’autre, contester son pouvoir de le révoquer, surtout lorsque cette compétence a déjà été exercée sans provoquer les mêmes réactions. Cette asymétrie est d’abord politique, ensuite diplomatique, et seulement en apparence juridique.
Dans les rapports avec les puissances du moment, on peut toujours invoquer le droit international, qui proclame l’égalité souveraine des États. Mais, dans les faits, il n’est pas un outil de protection. Le droit international des principes cède la place à un droit international de la puissance : c’est le grand basculement.
Les intérêts des grandes puissances imposent la logique de la force aux pays faibles, incapables de se défendre face aux menaces de sanctions — ou face aux sanctions réelles qu’on leur inflige. Nous évoluons dans un champ de rapports de force où l’argument économique et militaire est brandi sans cesse pour briser les résistances, même les plus modestes.
Face à cette réalité, dans le cadre d’un droit de manœuvre — d’un droit de gestion limité —, il faut apprendre à agir avec intelligence : par la ruse, la diplomatie et la capacité de séduire.
La ruse est dolosive en droit civil et en matière contractuelle ; mais, dans un ordre international dominé par la force, elle devient compréhensible comme technique de survie. Elle consiste à confondre l’adversaire par l’esprit plutôt que par la puissance dont on ne dispose pas.
Haïti ne dispose ni de flux financiers décisifs, ni d’armement dissuasif, ni d’une force militaire capable d’inspirer la crainte ou d’imposer une décision. Pays appauvri, placé par la géographie sur la route des États-Unis, nous devons être assez lucides pour que cette proximité ne devienne pas une fatalité. La ruse, la diplomatie et l’art de convaincre sont alors des instruments de souveraineté, même relative, pour maîtriser la question internationale.
Il était donc important, dans cette analyse, de démasquer certains biais juridiques, car le problème n’est pas d’abord sur le terrain du droit. Il me semble que le Conseil présidentiel a été façonné par l’international pour satisfaire les appétits de pouvoir de groupes persuadés d’être dominants, tout en repoussant les perspectives d’un retour effectif à l’État de droit par l’organisation d’élections libres et transparentes. Tout a été conçu pour écarter une classe politique devenue inutile et incapable d’évoluer.
« L’étranger est trompeur et diviseur », écrivait le Dr Louis-Joseph Janvier, l’une des plus belles intelligences que notre pays ait produites. La communauté internationale n’est ni à gauche ni à droite : elle déploie sa stratégie à l’égard d’Haïti en fonction de ses intérêts.
Dans cette conjoncture où les Haïtiens ne maîtrisent plus pleinement leur destin, la question de la transparence des élections à venir se pose avec acuité, alors même que l’érosion de la souveraineté se constate dans plusieurs secteurs de l’État.
L’avenir d’Haïti demeure incertain. Mais, malgré les incertitudes, il nous faut préparer le printemps du peuple. Cette transition fait tomber les masques comme des fruits mûrs : nous sommes à l’heure des choix — et des bons choix. La pâte est mauvaise, et elle le restera tant que les mêmes pratiques se reproduiront. Cette élite, aux actions tristes et négatives, a fait son temps. De cette crise peuvent naître d’autres élites, décentralisées, portées par la préparation des classes et par de nouvelles forces sociales, capables d’ouvrir la voie à la rédemption de la patrie.
Car ceux qui croient être aujourd’hui à la manœuvre ne contrôleront pas ce qui adviendra demain. Ce qui vient portera une autre réalité, ouvrira de nouvelles perspectives, brisera les tendances actuelles et les pratiques indécentes, et rendra l’avenir à d’autres possibles. C’est dans cet esprit que s’inscrit notre combat pour changer la vie en Haïti.
Sonet Saint-Louis av
Professeur de droit constitutionnel et de méthodologie avancée de la recherche juridique.
Professeur de philosophie
Université du Québec à Montréal
Montréal, 28 janvier 2026
sonet.saintlouis@gmail.com
Tel 44073580/2635580083