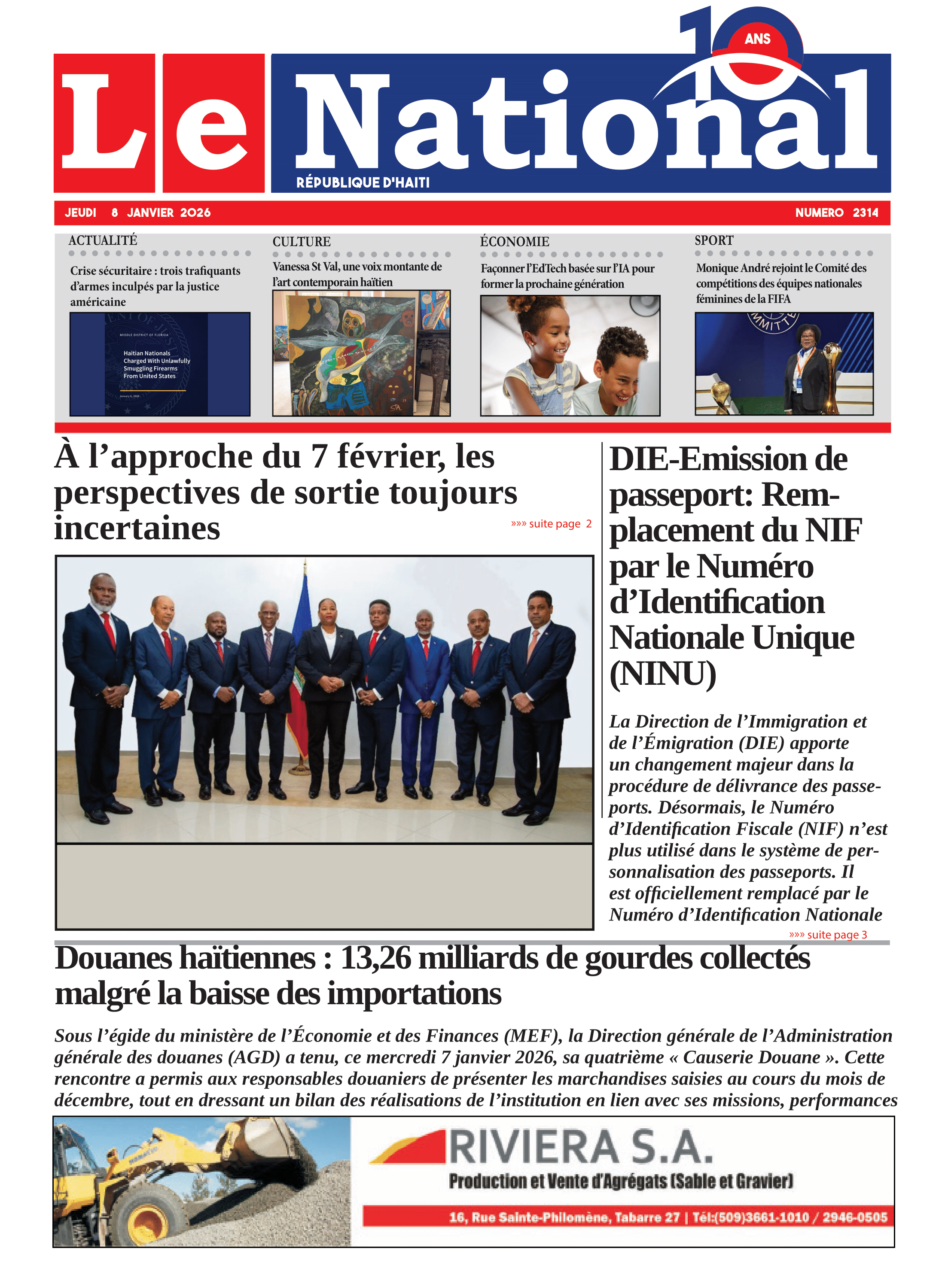Juridiquement, la notion de dette implique un débiteur et un créancier liés par un rapport d’obligation du premier envers le second pouvant résulter d’un acte ou d’un fait juridique. S’agissant des faits juridiques, indépendamment de la volonté du débiteur de s’engager, ce dernier peut être tenu d’une dette envers son créancier si les conditions d’engagement de sa responsabilité sont réunies, c’est-à-dire une faute, un préjudice et un lien de causalité. L’acte juridique, par ailleurs, nécessite une volonté. En outre, la dette peut être aussi due en raison d’un quasi-contrat, notamment dans le cadre d’un enrichissement sans cause ou injustifié tel que défini par les Codes civil haïtien et français.
Dans le cadre du contentieux mettant face à face Haïti et la France, ancienne puissance coloniale et esclavagiste, la dette relève d’un autre registre. Elle découle de l’événement fondateur de la nation haïtienne, en l’occurrence l’indépendance d’Haïti et la liberté proclamée pour tous les esclaves de Saint-Domingue le ler janvier 1804. Cette indépendance n’a jamais été acceptée par la France. En 1814, une commission ayant à sa tête le commissaire Dauxion Lavaysse fut déployée en Haïti avec pour instructions de rappeler à Pétion dans l’Ouest et Christophe dans le Nord que le roi de France n’entendait pas perdre cette colonie. Christophe fit arrêter Medina, un des commissaires. Ce dernier a été jugé, condamné et exécuté car considéré comme un espion travaillant pour les Français.
Moins radical, Pétion accepta de recevoir le commissaire Dauxion. Il récusa l’idée que la France revînt sur l’île pour y rétablir l’esclavage. Selon lui, les propositions de ce commissaire, si elles étaient acceptées, compromettraient la sécurité et l’existence de la nouvelle République. Il demandait par conséquent au roi de France de reconnaître l’émancipation du peuple haïtien dont les malheurs ont commencé avec les siens. Par ailleurs, pour afficher la volonté des Haïtiens de rester libres et indépendants, le président Pétion, dans une lettre qu’il a adressée à ce commissaire, proposa une indemnisation à la France en ces termes : je proposerai à votre Excellence agissant au nom de S.M. Louis XVIII, et pour lui donner une preuve de dispositions qui nous animent, d’établir les bases d’une indemnité convenue, et que nous nous engageons tous solennellement à payer avec toute garantie juste qu’on exigera de nous, et dont elle fera l’application qu’elle jugera convenable. (Cf. Lettre du président Pétion au Commissaire Dauxion LAVAYSSE. 27 novembre 1814, p. 44.)
Cette commission a été un échec pour les Français. Plusieurs autres ont été déployées avec les mêmes résultats. Les autorités haïtiennes refusèrent de remettre en question l’indépendance de la première République noire. Mécontent des échecs de ces pourparlers, le roi Charles X a décidé de faire un coup de force en 1825 et d’imposer d’autorité en contrepartie de la reconnaissance de l’indépendance proclamée par Haïti, le paiement d’une indemnité de 150 millions de francs pour les colons en compensation de leurs biens accaparés ou détruits par les révolutionnaires de Saint-Domingue. C’est cette somme, payée dans la douleur par Haïti, qui constitue ce qu’on appelle la dette de l’indépendance ou la double dette si l’on tient compte des sommes payées aux banques auxquelles elle a dû emprunter les 150 millions exigés par la France.
En 2003, à l’approche du bicentenaire de l’indépendance d’Haïti, l’ancien prêtre devenu président Jean-Bertrand Aristide, dans un élan patriotique et anti-impérialiste, et après avoir dénoncé le fait qu’Haïti avait été contrainte de payer cette forte somme d’argent à la France pour la reconnaissance de son indépendance, a réclamé la restitution de cet argent au peuple haïtien. À l’époque, l’argent a été évalué à plus de 21 milliards de dollars. Selon lui, il s’agit de rendre sa dignité au peuple haïtien. Il réclamait une restitution et non une réparation.
S’il n’avait pas formalisé officiellement cette demande par la voie diplomatique, il n’en avait pas moins ouvert un débat tu jusqu’alors en exprimant un ressenti séculaire dans la conscience collective. Depuis lors, le débat reste pendant, et les Haïtiens ne cessent de réclamer ce qu’ils considèrent dorénavant comme un dû.
Une décennie plus tard, cette question de restitution a pris une dimension juridique lorsqu’une association de défense des noirs en France, en l’occurrence le CRAN, a décidé d’intenter une action en justice contre l’État français lui réclamant la restitution intégrale de cet argent qu’il considère comme une créance en faveur de l’État haïtien.
En effet, par acte d’huissier en date du 28 février 2014, le CRAN a précisé que, du fait de son statut, il défend la mémoire des populations qui sont issues de l’esclavage et les intérêts matériels et moraux de leurs descendants. À ce titre, il estimait avoir la qualité et la capacité à mener cette action pour réclamer la restitution de cet argent pour Haïti. Contactées par le président de cette association Louis-Georges Tin, les autorités haïtiennes ont refusé d’intervenir dans l’instance au nom de l’État haïtien comme partie demanderesse pour ne pas, semble-t-il, soulever la colère de l’ancienne métropole. Ce refus n’a pas été sans conséquence.
Si le juge de la mise en état a décidé que l’action en responsabilité pouvait être traitée par une juridiction française, il a déclaré a contrario qu’aucune juridiction n’était compétente pour traiter la demande de restitution. Cette décision, rendue le 25 novembre 2014, a montré que le traitement juridique de cette affaire n’est pas sans difficultés tant du point de vue du droit des deux États (I) que celui du droit international (II). Il paraît improbable, en raison des obstacles juridiques, qu’une telle action prospère.
- L’incompétence des tribunaux internes
La restitution, impliquant une mutation de détention ou de propriété, soit de fonds, soit de biens matériels, est un mécanisme juridique très fréquent, notamment en droit civil. Elle est présente dans les contrats, notamment de vente, de prêt, ou de location et dans les quasi-contrats dont les plus connus sont la gestion d’affaires, de paiement de l’indu prévus expressément dans les Codes civil français et haïtien et l’enrichissement sans cause. Dans les premiers cas, le contrat est signé avec le consentement des parties. Dans le cadre des quasi-contrats, aucun accord de volonté préalable ne lie les parties.
Ces rappels sont nécessaires pour mieux comprendre la complexité juridique de cette demande de restitution en faveur d’Haïti. En effet, dans son action, le CRAN a fondé sa demande sur le fait que les Haïtiens n’avaient aucune obligation légale, a fortiori, aucune dette à honorer en faveur de l’État français, car l’ordonnance de 1825, pour avoir été imposée manu militari à Haïti, doit être déclarée nulle et de nul effet et ce, pour plusieurs raisons.
D’abord, en faisant référence à la lourde menace que constituait la flotte d’une vingtaine de bâtiments armés envoyés en Haïti en 1825 par Charles X pour imposer militairement l’acceptation du paiement des cent cinquante millions de francs prescrits par l’ordonnance en échange de la reconnaissance de l’indépendance du pays, l’association invoque la nullité de l’ordonnance en vertu des anciens articles 1112 et 1113 du Code civil relatifs à la violence. Selon le CRAN, le consentement d’Haïti a été altéré par la menace d’une invasion militaire qu’elle n’était pourtant pas prête à combattre. Dès lors, tout en sachant que les conditions de l’ordonnance lui étaient défavorables, la violence que le pays avait subie l’avait contraint de consentir à payer la dette qui lui était imposée. Ensuite, après avoir rappelé que depuis 2001 l’esclavage et la traite négrière sont reconnus comme crime contre l’humanité, il arguait que cette ordonnance de 1825 était nulle et ne pouvait être source d’obligation car elle était sans cause, ou reposait sur une cause illicite, en l’occurrence l’esclavage.
Avec ces arguments, le CRAN a considéré l’ordonnance de 1825 comme un simple contrat dont la nullité, en raison du vice de consentement de l’État d’Haïti qui l’avait acceptée sous menace, entraînerait selon lui une obligation pour la France de restituer la somme que Haïti avait payée en contrepartie de la reconnaissance de son indépendance. Il a voulu démontrer aussi que cette transaction constituait un cas flagrant d’enrichissement sans cause de l’ancienne puissance coloniale aux dépens de son ancienne colonie.
À première vue, et sur un plan moral, ces arguments paraissent logiques car ils visent à remettre en cause les conditions de validité de l’ordonnance de 1825 ; ils n’en présentent pas moins juridiquement des difficultés majeures s’agissant de cette affaire toute singulière. En effet, il est d’une jurisprudence constante en France, et ce depuis les arrêts Blanco et de Rotschild du Tribunal des conflits et du Conseil d’État français, que les dispositions du Code civil ne peuvent être appliquées dans des contentieux impliquant l’État comme elles le sont dans ceux des particuliers à particuliers.
Ainsi, si les arguments du CRAN pouvaient être recevables dans le cadre d’une affaire impliquant des personnes relevant du droit privé, il en va autrement lorsqu’il s’agit d’une affaire comme celle-ci impliquant deux États dans le cadre d’activités encadrées par le droit international public.
C’est ce qui ressort de la position exprimée par le juge de la mise en état parisien, dans son ordonnance de 2014 lorsque, après avoir rappelé que le montant total que Haïti avait versé à la France ne l’était pas dans le cadre d’un contrat de droit privé, il déclare : quelles qu’aient pu être les conditions de contrainte dans lesquelles l’État d’Haïti a été conduit à accepter les conditions imposées par le représentant de l’État en 1825 pour accéder à son indépendance, et le contexte d’esclavage ayant préexisté sur l’île, la juridiction de l’ordre judiciaire n’est pas compétente pour connaître de la demande de restitution des sommes d’argent perçues pour le compte de l’État français par la Caisse des dépôts et consignations, aux fins de redistribution aux anciens colons […] en exécution de l’ordonnance royale de 1825 et le traité de 1838. Ces textes ne sont pas des actes administratifs. Par conséquent, la demande de restitution des sommes d’argent perçues en exécution de ces actes […] ne relève de la compétence d’aucune juridiction s’agissant d’actes de gouvernement. ( Cf. TGI, Paris, Juge de la mise en état, 25 nov. 2014, n° 14/04420.)
Cette notion d’acte de gouvernement qui est invoquée dans cette décision par le juge de la mise en état, renvoie par définition à un certain nombre d’actes émanant des autorités exécutives et dont la caractéristique commune est de bénéficier d’une immunité juridictionnelle absolue ( in. Acte de gouvernement, in Gérard CORNU, Vocabulaire juridique). Ces actes, en ce qu’ils sont l’accomplissement de ce que Maurice Hauriou et Pierre Serrand peuvent considérer comme la raison d’État, et puisqu’ils constituent l’expression extrême de la souveraineté notamment lorsqu’ils se tournent vers l’international, jouissent dès lors d’une immunité globale les rendant ainsi injusticiables par nature. (V. Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif contenant le droit public et le droit administratif, 2e éd. Paris 1893, p. 191).
Ainsi, selon la jurisprudence française, les actions judiciaires tendant à remettre en cause la régularité pour ensuite réclamer l’annulation d’un traité provoqué, négocié, signé et ratifié par les autorités françaises sont irrecevables. Lorsque ces actes se rattachent directement aux rapports internationaux de l’État français avec les puissances étrangères, ils représentent l’archétype même des actes de gouvernement et par conséquent, ils échappent de fait à toute compétence juridictionnelle.
Par conséquent, s’agissant de l’ordonnance de 1825, nonobstant les conditions léonines et contraignantes dans lesquelles Haïti a dû l’accepter et des lourdes conséquences qu’elle a entraînées à terme pour le peuple haïtien, le juge français est catégorique : sa régularité ne peut être contestée devant une juridiction française car elle n’est pas détachable de l’activité diplomatique de l’État français. Ni le juge administratif, ni le juge judiciaire n’a donc compétence pour prononcer son annulation : une décision en ce sens entraînerait en effet ipso facto un empiètement dans la sphère de compétence du pouvoir exécutif, seul qui était chargé, à l’époque comme aujourd’hui, de conduire les relations diplomatiques de la France.
Au final, il faut admettre que les obstacles juridiques sus-détaillés rendent illusoire toute idée de réussite d’une action judiciaire menée devant une juridiction française tendant à l’annulation de l’ordonnance de 1825, s’agissant d’un acte de gouvernement, puis la restitution de l’argent de l’indépendance à Haïti. Si cette impossibilité paraît flagrante en raison de l’état du droit positif français, d’aucuns pensent néanmoins qu’il existe une dernière possibilité juridictionnelle, celle de la justice internationale. Mais cette voie n’en présente pas moins, une issue incertaine.
- L’option des tribunaux internationaux
Du côté haïtien, il est fréquent d’entendre dans les médias ou lors de débats de rue à Port-au-Prince que la France doit rendre aux Haïtiens l’argent de l’indépendance. Pour les partisans de ce point de vue, c’est une obligation. L’ancien président de la République française, François Hollande, peut en témoigner à la suite d’un voyage officiel, sur fond de tension qu’il a effectué en Haïti en mai 2015. Après avoir déclaré, quelques jours auparavant lors d’un discours en Guadeloupe qu’il s’acquitterait symboliquement de la dette de la France envers Haïti à son arrivée à Port-au-Prince, faisant ainsi preuve de reconnaissance de l’existence de la revendication, des centaines de manifestants l’ont amèrement accueilli, pancartes en mains, pour rejeter toute réparation symbolique et réclamer la restitution de l’argent que la France avait extorqué à Haïti. Conscients que cette restitution ne peut être l’œuvre de la justice ni française, ni haïtienne, certains Haïtiens pensent qu’il faut que l’État haïtien saisisse la justice internationale pour rendre justice à Haïti. Cette idée qui est chérie par bon nombre d’Haïtiens mérite quelques précisions sur les obstacles juridiques liés à la fois aux faits, objets du contentieux, et à la compétence juridictionnelle des instances internationales. Des Haïtiens évoquent en effet l’idée d’une action devant une juridiction internationale pour contourner les obstacles juridiques du droit interne des États. Ils arguent que cette affaire est internationale et que seule une juridiction supra-étatique est en mesure de dire le mot du droit. Mais, lorsqu’ils évoquent une juridiction internationale, certains font maladroitement, référence à la Cour pénale internationale (CPI), beaucoup plus médiatisée que la Cour internationale de justice (CIJ). Or, il existe entre ces deux institutions qui, certes, font partie de l’ordre juridique international, une différence fondamentale concernant l’étendue de leurs compétences.
La CPI a été créée en 2002 dans le but de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. Elle n’a compétence pour juger que des personnes physiques et pour des crimes qui sont exhaustivement énumérés dans le statut de Rome, à savoir crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crimes d’agression. A contrario, la CIJ a été créée en 1945, dans le contexte de l’après-guerre, en remplacement de la Cour permanente de justice internationale, qui, elle-même, avait été créée en 1922 par la Société des Nations. Contrairement à la CPI, elle traite exclusivement les différents juridiques entre États. Les conditions d’exercice de sa compétence sont explicitées dans son statut qui fait partie intégrante de la Charte des Nations Unies. Ces précisions permettent d’exclure la compétence de la CPI pour traiter une affaire de ce genre. Donc, la CIJ est seule susceptible de la connaître, à condition qu’un des États agisse devant elle et que les conditions de recevabilité des requêtes, telles que définies par son statut, soient réunies. En effet, comme l’a signalé M. Pierre-François Laval, la juridiction de la CIJ est toujours limitée.
L’article 36 du statut dispose en ce sens que la compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur. Outre ces conditions d’existence de sa compétence, l’article précise par ailleurs que les États parties peuvent à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique. Deux éléments essentiels apparaissent à la lecture de ces articles. D’abord, l’existence d’un différend juridique entre les parties concernées est le préalable nécessaire à toute saisine de la CIJ ; ensuite la compétence de celle-ci pour les faits objets du litige doit être acceptée ou reconnue par les États en question.
S’agissant du différend, selon la jurisprudence de la Cour internationale de justice, il est défini comme un désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre des parties (v. Aff. Timor oriental (Portugal c. Australie), C.I.J. Recueil 1995, p. 100 § 22). Afin d’expliciter cette notion dans le cadre de la justice internationale, M. Pierre-François Laval propose d’établir une différence entre ce qu’il considère comme des divergences de vue et le moment où celles-ci se cristallisent en différend pouvant être porté devant la CIJ. Selon cet auteur, la divergence se situe là où les parties expriment des points de vue différents sans pour autant que leur désaccord ne fasse apparaître la volonté de faire intervenir une tierce partie pour y mettre un terme via un arbitrage ( Cf. Pierre-François LAVAL, La compétence rationae temporis des juridictions internationales. Thèse, Bordeaux, 2011, p. 529 ).
Quant à la date de naissance du différend, la Cour internationale de justice, comme son ancêtre la Cour permanente de justice internationale, la fixe au moment où le défendeur oppose un refus à la prétention de l’État demandeur. Elle a déclaré que l’existence d’un différend suppose que la démarche d’un État visant à régler un contentieux avec un autre État par voie de négociations diplomatiques se heurte à l’opposition manifeste de l’autre. C’est donc selon la Cour, ce non possumus ou ce non volumus qui fait naître un différend entrant dans le champ de sa compétence.
Ce point de droit sur la notion de différend étant établi, il importe à présent de déterminer, au sens de la jurisprudence développée par la Cour internationale de justice, si entre Haïti et la France, il existe un différend juridique de nature internationale relevant de la compétence de cette Cour.
Si à la veille de la célébration du bicentenaire de l’indépendance d’Haïti le 1er janvier 2004, le président haïtien d’alors, Jean-Bertrand Aristide, avait jugé nécessaire d’ouvrir le débat sur la restitution par la France à Haïti de l’argent que ce dernier avait été contraint de verser à la première à partir de 1825, sa démarche, puisqu’elle n’a pas été suivie par les gouvernements qui lui ont succédé après le coup d’État de 2004, doit être considérée comme informelle.
En effet, au lieu de choisir la voie diplomatique pour mener sa revendication qui était pourtant considérée par plus d’un comme juste, il avait choisi- en réduisant sa revendication à de simples spots publicitaires et articles de presse dans les médias haïtiens ou étrangers, d’en faire un simple argument politique hors de tout cadre juridique et diplomatique. À cette demande médiatique, la France a opposé un non catégorique. Une déclaration faite par le président français d’alors Jacques Chirac peut en témoigner. Répondant à une question d’un journaliste lors d’une conférence de presse à Évian le 2 juin 2003 qui lui demandait d’exprimer sa position sur la demande du gouvernement haïtien, le président a répondu ceci : avant d'évoquer des contentieux de cette nature, je ne saurais trop conseiller aux autorités haïtiennes d'être très vigilantes sûr, je dirais, la nature de leurs actions et leur régime.
Plus tard, selon Régis Debray dans un rapport sur les relations entre Haïti et la France en 2004, cette revendication médiatique a été « réputée sans objet » par la diplomatie française qui réfutait alors l’idée même de restitution en ces termes : Il doit être clair […] que nous nous inscrivons […] dans une logique de solidarité et non de remboursement. Au nom d’une obligation d’ordre moral et non d’un fantasmatique compte bancaire débiteur. On dira donc oui au devoir de mémoire, qui n’est pas repentance mais reconnaissance, et non au ressassement, car c’est le futur qu’il nous faut mettre en chantier. Par ailleurs, selon Marcel Dorigny, les autorités étatiques françaises n’ont jamais été saisies d’une demande officielle de restitution de l’argent de l’indépendance d’Haïti. Par conséquent, il est possible de considérer, au sens de Pierre-François Laval cité plus haut, qu’il y a bien une divergence de vues entre Haïti et la France sur la question de cet argent, mais cela ne constitue aucunement un différend juridique international relevant de la compétence de la CIJ.
Il est important de préciser toutefois que cette situation peut évoluer. En effet, il suffit qu’un gouvernement haïtien décide de porter la réclamation de cet argent à l’État français dans les formalités diplomatiques reconnues par la CIJ et que la France rejette officiellement par la même voie ses prétentions pour que naisse un différend juridique susceptible d’être traité par cette Cour.
La naissance d’un différend entre Haïti et la France sur cette question ne résoudrait pas pour autant le problème car il reste l’obstacle de la compétence juridictionnelle de la CIJ. Celle-ci a en effet l’obligation, avant toute autre chose, de vérifier si elle a compétence pour connaître d’une affaire portée devant elle et de s’assurer que l’exercice de cette compétence n’est pas entravé par des circonstances qui rendent la requête irrecevable.
S’agissant de la compétence juridictionnelle de la CIJ, il est clairement établi dans son statut qu’elle n’est conditionnée que par le consentement des États en litige. Ce consentement peut être conventionnel, c’est-à-dire donné par deux ou plusieurs États lors de la signature d’un traité dans lequel ils insèrent une clause dite compromissoire prévoyant la compétence de la Cour en cas de différend entre eux dans l’application de ce traité ; il peut ensuite être unilatéral, dans ce cas, l’État fait une déclaration selon l’article 36, § 2 de la CIJ pour reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour. Dans ce cas, les États insèrent très souvent des clauses limitant ratione materiae et ratione temporis le champ de compétence de la Cour. Enfin, il y a le forum prorogatum, qui fait référence à un État qui n’admet pas la compétence de la CIJ pour traiter ses différends avec d’autres États, mais qui va l’accepter ultérieurement après la saisine de la Cour par au moins un autre État pour traiter un contentieux les concernant.
L’on peut se demander si la Cour internationale de justice peut trouver, sur la base d’une de ces trois conditions au moins, la possibilité d’asseoir sa compétence juridictionnelle pour juger une éventuelle affaire Haïti contre France portée devant elle relative à cette demande de restitution de l’argent de l’indépendance haïtienne.
Sur la première condition, il est évident qu’aucun traité n’existe entre Haïti et la France reconnaissant la compétence exclusive de la CIJ pour connaître d’un différend potentiel né de cette question de dette de l’indépendance.
S’agissant de la deuxième condition, la dernière déclaration facultative de reconnaissance de la compétence de la Cour, faite par la France remonte à 1966. À l’époque, comme auparavant, même lorsqu’il s’agissait de la CPJI, elle avait inséré une clause ratione temporis pour circonscrire la compétence reconnue de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis des autres membres des Nations-Unies acceptant la même obligation à tous les différends qui s’élèveraient au sujet de faits ou de situations postérieurs à la présente déclaration. La France avait donc, par la formulation même de sa déclaration, limité dans le temps la compétence de la CIJ.
Consciente que sa compétence est strictement liée au consentement des États, la CIJ a jugé qu’il fallait respecter le consentement des États en interprétant leur déclaration telle qu’elle se présente. car sa juridiction n’existe que dans les termes où elle a été acceptée par les États.
Depuis 1974, la France a cessé de reconnaître la juridiction obligatoire de la CIJ. Cette décision a été prise après que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont décidé de saisir la CIJ en 1973 pour contester la légalité des activités nucléaires de la France dans le Pacifique et demander que la Cour ordonne à la France de cesser ces activités jusqu’au prononcé d’un jugement définitif. Ainsi, toute action contre elle devant cette juridiction est depuis irrecevable par définition. En tenant compte de ce qui précède, il est donc difficile, voire impossible en l’état actuel sur la base de cette deuxième condition de reconnaissance de la compétence de la CIJ, d’envisager la réussite d’une éventuelle action qu’aurait engagée Haïti contre la France devant cette juridiction pour réclamer la restitution de la dette de l’indépendance.
Face à l’impossibilité de trouver une base juridique pour asseoir la compétence de la CIJ en application de ces deux premières conditions, il ne reste que le mécanisme du forum prorogatum qui est prévu à l’article 38.5 du règlement de la CIJ. Cet article offre la possibilité à un État demandeur de fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par l’État contre lequel il entend agir. En vertu de ce mécanisme, Haïti semble pouvoir disposer d’une possibilité d’action contre l’État français pour mener cette affaire de restitution devant la CIJ. Mais la réussite d’une telle action peut buter encore sur le consentement de la France.
En effet, cet article 38.5 précise que l’action intentée par un État contre un autre dans le cadre d’une instance relevant du forum prorogatum n’est pas automatiquement inscrite au rôle général de la Cour et qu’aucun acte de procédure n’est effectué tant que l’État contre lequel la requête est formée n’a pas accepté la compétence de la Cour aux fins de l’affaire en question. Dans ce cadre-là, la requête de l’État demandeur est transmise par la CIJ à l’autre État qui doit expressément accorder son autorisation afin que la Cour entame l’analyse du dossier. On comprend donc, si Haïti engage une action contre la France devant la CIJ dans ce cadre, le dernier mot reviendrait à la France dont le consentement est obligatoire pour établir la compétence de ce tribunal.
En outre, le différend doit être en mesure d’être traité en application du droit international. Or, en l’espèce, aucune règle du droit international ne s’applique. Dans ce cas, la CIJ ne pourrait statuer qu’ex aequo et bono, c’est-à-dire en équité et non en droit, avec le consentement exprès des deux États, en l’occurrence Haïti, mais surtout la France. La diplomatie française ayant déjà déclaré sans objet cette revendication, à moins d’un changement de position sur la question, la France aurait sans doute du mal à donner son feu vert à une telle procédure.
Il en découle par conséquent que ni le juge national, ni le juge international n’a compétence, en l’état actuel du droit, pour d’abord connaître de ce contentieux lié à l’esclavage et à la naissance même de l’État d’Haïti, et pour ensuite imposer la restitution aux Haïtiens de l’argent que leurs ancêtres ont été contraints de verser, au prix des pires conséquences, à l’ancien État colonial, et, partant, aux anciens colons ou leurs ayants droits. Le traitement de cette demande ne relève donc que d’une volonté politique et diplomatique. La réponse à la demande de la restitution de la somme extorquée par la France à Haïti en 1825 doit être donc extrajudiciaire.
Windy Phele
Docteur en droit pénal et sciences criminelles / Université de Strasbourg
Journaliste
E-mail : windyphele@yahoo.com
Réf. Windy PHELE, la réparation des séquelles de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage colonial français : obstacles juridiques et perspectives politiques, Thèse, Université de Strasbourg, 2025, pp. 374 – 392