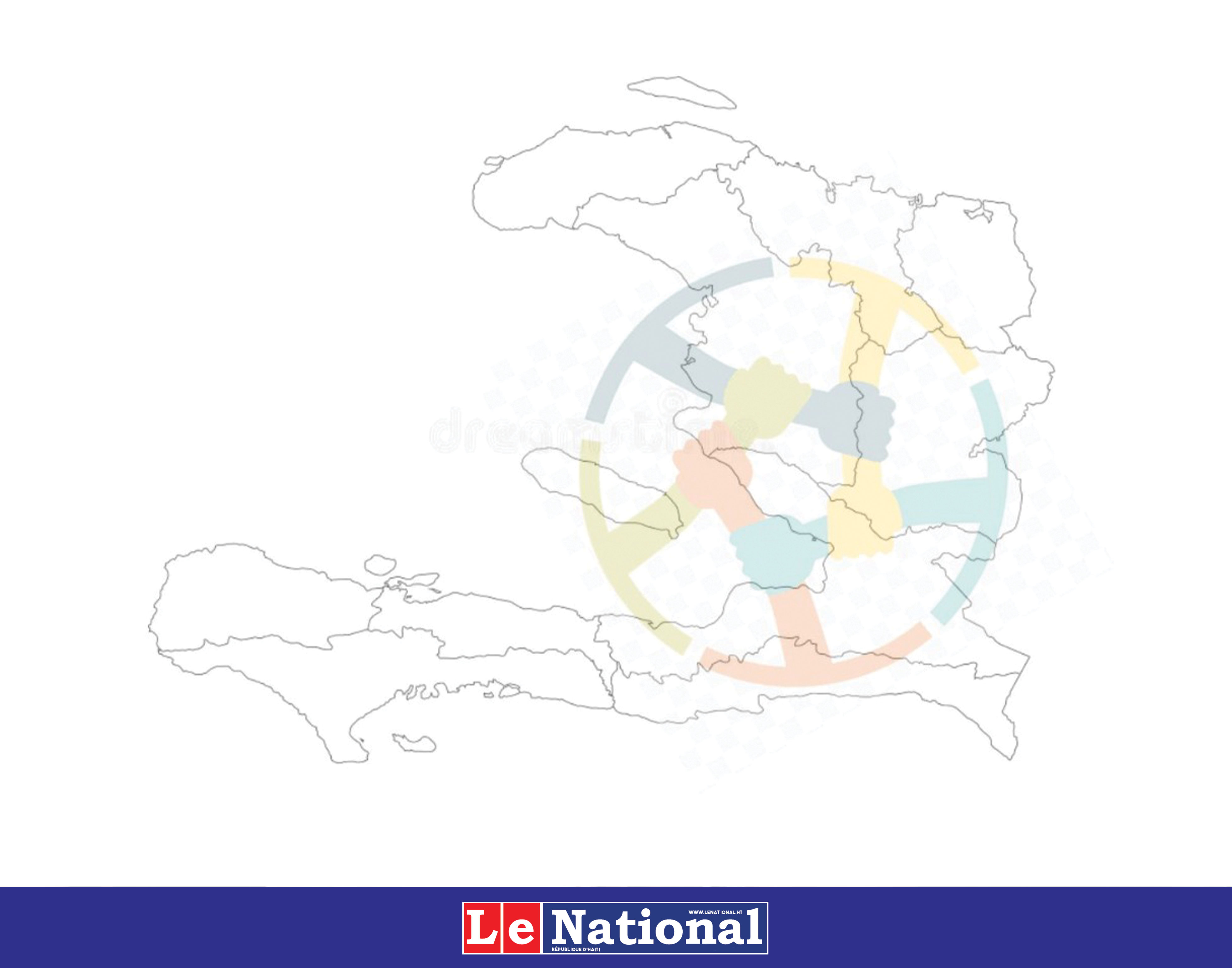Résumé
En Hayti, chaque rentrée scolaire révèle une fracture béante, car entre uniformes neufs et cahiers vierges d’un côté, et classes désertes ou occupées par des déplacés, de l’autre côté, elle devient paradoxalement le reflet d’une société où les inégalités se transmettent comme un héritage invisible, renforcées par la loi tacite des rues. Plus de 60 % de parents n’ont pas d’emploi formel, un tiers des enfants quittent l’école faute de moyens, et les frais prohibitifs, uniformes imposés et manuels coûteux transforment l’éducation en privilège réservé à quelques-uns. Le droit constitutionnel à l’éducation (art. 32 de 1987) demeure lettre morte. Comme le souligne Amartya Sen, la liberté de développer ses capacités est confisquée dès l’enfance. L’école choisit son camp, celui des privilégiés, comme l’avait averti Cheikh Hamidou Kane. Les enjeux sont d'ordres historiques embrassant d'une part la reproduction coloniale des hiérarchies (Frantz Fanon), d'autre part, du genre sociolinguistique traduisant la glottophobie et la marginalisation des savoirs populaires culturels au détriment de savoirs communautaires coloniaux (Kenny Thelusma). De plus, ce problème épouse un axe culturel d'une aliénation dénoncée par Cheikh Anta Diop. Enfin, il est d'ordre social car le taux élevé de redoublement (17 %) et d’abandon (15 %), 79 % d’élèves exclus d’internet (Yves ROBLIN, 2022; UNICEF, 2024). L’idéologie méritocratique promet l’ascension, mais les réalités structurelles enferment l’individu dans la pauvreté. Comme le rappelle Édouard Glissant, l’exception n’existe que pour légitimer la règle : les « premiers de classe » issus de milieux défavorisés ne sont que des mirages tolérés par un système inégalitaire. Notre préoccupation exige la réponse à l’école comme bien commun : gratuité réelle et égalité d’accès ; intégration des savoirs endogènes ; valorisation des capabilités (Sen) ; libération des schémas de dépendance (Fanon). Haïti doit choisir : veut-elle une école qui rassemble et émancipée, ou une école qui divise et exclut ?
Texte intégral
Il est des nations où l’école brille comme un phare de justice sociale, et d’autres où elle chancelle tel un flambeau étouffé par ses propres cendres. Haïti appartient hélas à cette seconde catégorie, où l’éducation — au lieu d’ouvrir les chemins de l’avenir — se mue en une fabrique d’exclusions sévèrement orchestrées par le système lui-même. Ici, chaque banc d’école coûte l’équivalent d’un plat aleken marchandé à prix d’or, et l’enfant du pauvre appauvri se voit contraint de solder son avenir avant même d’avoir appris à lire le mot « liberté ou justice sociale ».
Or, ce paradoxe est criant car la Constitution de 1987, dans son article 32, proclame le droit à l’éducation gratuite et universelle ; mais la réalité, crue et nue, trahit ce serment républicain. Comme l’enseigne la sagesse épistémique de Amartya Sen, la justice réside dans la capacité effective à développer ses potentialités. Pourtant, en Hayti, ces potentialités se brisent contre les murailles des frais prohibitifs, des uniformes imposés et d’une logistique discriminatoire. L’école, qui devrait être un ascenseur social, s’est transformée en escalier mécanique : il monte pour quelques-uns, se bloque pour la majorité.
Et lorsque Cheikh Hamidou Kane a taillé sa place à cette discussion, il a gentiment préconisé que « l’école ne peut rester neutre », la réalité haytienne confirme tristement que son camp est choisi, mais à l'autre sens : celui des privilégiés. Ainsi, à l’image de ce que Frantz Fanon dénonçait-il de la colonisation — une servitude qui s’enracine dans les esprits —, l’école en Ayti polit aujourd’hui les chaînes de l’inégalité sociale avec des diplômes, érigeant les infortunes de la masse en loi silencieuse de la République. Dès lors, une interrogation brûle nos pupilles, telle une braise sous la cendre du pays lock : quelle école voulons-nous ? Une école émancipatrice, ou une école de caste, gardienne des privilèges hérités ?
L’inégalité programmée des catégories d’écoles en Haïti
S'il faut avoir de l’argent pour payer sa place sur les bancs de l’école, il est sans conteste que, dans une société comme Hayti, certaines familles ne peuvent s’assurer de cette régularité, puisqu’elles ne travaillent pas à ce compte. Autrement dit, plus de 60% de parents ne détiennent pas un travail. Le paradoxe est que l’article 32 et suivants de la constitution de 1987 établit la justice en garantissant le libre accès à l’éducation alors qu’un tiers d’enfants quittent l’école pour n’avoir pas pu payer leur scolarité. Après avoir accepté notre invitation sur le plateau de la discussion via cette quête de compréhension, celui dont nous avons trouvé une part de sagesse incarnée, le penseur indien Amartya Sen, soutient que « la liberté de développer ses capacités est au cœur de la justice » in Development as Freedom, (1999, p. 36). En contrepartie, en Hayti, cette liberté est confisquée dès l’enfance par un système logistique discriminatoire par les frais prohibitifs, les uniformes imposés et les manuels scolaires importés à prix d’or. Ces obstacles transforment l’école en une machine à gaz qui reproduit po pou po, sinon pire les mêmes inégalités, là où elle devrait être un instrument d’équité ou de justice sociale. Quitte à comprendre les différentes stases d'élasticité y relatives aux traces du passé que contenant ce phénomène, nous avons jugé bon de prendre à cœur le conseil de notre ami sénégalais, Cheikh Hamidou Kane, qui a fait prévaloir l'idée selon laquelle « l’école (coloniale ou postcoloniale) ne peut rester neutre, elle choisit toujours son camp » in L’Aventure ambiguë, (1961, p. 74). En Haïti, ce camp est trop souvent celui de privilégiés. Ce qui expliquerait que la politique linguistique de l’État va dans le sens de l'organisation structurelle et biomécanique de l’école en Ayiti, où un groupe est privilégié et un autre banalisé, discriminalisé.
L’école en Haïti, perçue par l’opinion publique comme l’ascenseur social par excellence, semble se transformer en un escalier mécanique - à toutes les stases de l'échelle éducative -, qui ne monte que pour certains, et se bloque pour la majorité. Elle reproduit presque mécaniquement dans le même sens de la coloni(ali)sation les inégalités sociales, au point de devenir une industrie de hiérarchies sociales discriminatoires préétablies comme à l’époque coloniale. En cela j’ai dû recourir à l'immortel martiniquais Frantz Fanon, qui eût à dire que « la colonisation ne se contente pas d’asservir les corps, elle enracine dans l’esprit des schémas de dépendance » (op cit. p. 172). Transposée dans le champ éducatif, cette réflexion éclaire la permanence d’un système où l’institution scolaire, loin de briser les chaînes de l’inégalité des classes, les polit avec des diplômes et les rangs sociaux qui intériorisent les individus sur le marché.
Ce qui fait que, cette problématique nous est devenue criante, en ce sens que, plus les classes aisées scolarisent leurs enfants, moins l’école favorise l’insertion d’autres catégories sociales, accentuant l’injustice qui déboucherait sur ce que, socio-politiquement admis, notre société encourt aujourd'hui un échec sociolinguistique payant de l’école. En témoigne le constat que la mobilité sociale des enfants issus de quartiers défavorisés reste un mirage, confinée dans une répétition cyclique de précarité et d'inégalités qui leur fait dire à longueur de journée que l'école en Haïti leur tue davantage, et n’aura qu’aucune assortie favorable puisque les parents de la masse ne peuvent payer la scolarité de leurs enfants convenablement.
Dès lors, la question fume avec acuité comme l'effluve d’un plat délicieux prêt à savourer : quelle école voulons-nous : une école qui rassemble et émancipée, ou une école qui divise et exclut puisque le problème de scolarité devient de plus en plus fréquent chez cette catégorie sociale, dite défavorisée ? Alors que durant la dernière décennie, les inégalités scolaires en Haïti se sont accrues d’au moins 35 %, traduisant un blocage structurel du progrès social, à côté de 79% qui n’ont pas accès à l’internet (UNICEF, nov. 2024), d’autant plus le taux de redoublement et d’abandon avoisinent (sic) respectivement 17 et 15% au niveau national (Yves ROBLIN, 2022, p. 29).
Le déterminisme individuel
L’individu haytien, compte tenu de son appartenance sociale et l’état financier de sa famille (celle les plus démunies, évoluant à moins de 500 à 1.000 gourdes/jour), face à l’école, semble confronté à un paradoxe cruel qui se traduit en une thèse à double portée critique : d’un côté, l’idéologie méritocratique lui fait miroiter qu’avec des efforts et de la discipline, il peut gravir n’importe quelle échelle sociale, donc il se brise dans la résignation qu'il norme courage et détermination ; de l’autre, les réalités structurelles le maintiennent prisonnier d’un cercle vicieux d’appauvrissement, de chômage et/ou de crise humanitaire aiguë, il s'est abonné et y retournant à chaque instant où les nuances sont appareillées en contre ou en pour. Le déterminisme individuel, ainsi compris, devient-il une illusion entretenue par un système éducatif sélectif et discriminatoire qui façonne les individus à l'abandon et au mépris de l’école laquelle leur laisse le choix de retourner bredouille.
A cela, j'ai recours à Amartya Sen, qui fait son retour magistral sur la table de ma discussion, avec cette pensée qui tient à nous éclairer sur ce dilemme, qui se trahit en ces termes « la liberté réelle dépend des capacités effectives qu’ont les individus de choisir la vie qu’ils ont raison de valoriser » (Op.cit., p. 36). Or, en Haïti, la plupart des enfants issus de classes populaires ne disposent pas de ces « capabilités » : malnutrition, insécurité, déficit d’infrastructures scolaires, enseignants sous-payés, l’irrespect catégorique des premier et deuxième catégories de droits humains. Leur mérite individuel, même débordant, se brise contre les murs épais de l’injustice sociale.
De plus, l’école à l'Haïtienne valorise les normes imposées par les élites économiques et politiques, marginalisant ainsi les savoirs populaires, culturels et communautaires voire son passé historique et son origine précoloniale. À cela, j' avais décroché le ticket pour une visite domestique chez le philosophe sénégalais Cheikh Anta Diop qui nous a rappelé avec force sur la table d’une discussion anterieure dont nous avons eu avec lui, que « nul peuple ne se développe en niant ses propres références culturelles » in Nations nègres et culture, (1954, p. 89). En ignorant cette évidence, le système éducatif ayitien perpétue une aliénation où l’élève est sommé de signer un modèle qui n’est pas le sien, ce que mon ami de lutte de longue date, Kenny THELUSMA appelle en miniature fraco-graphie ou tout court la politique de la glottophobie étatique.
Ainsi, le déterminisme individuel est-il un mythe qui masque la réalité d’une sélection sociale impitoyable. Loin d’être une voie d’émancipation, l’école haytienne devient une machine à l’air qui reproduit scrupuleusement l’ordre inégalitaire établi, où les « premiers de classe » issus de quartiers appauvris sont l’exception qui confirme la règle. Comme le glisse Édouard Glissant, qui aurait lui-même raison face à la règle qui tient en vie l'inégalité « l’exception est tolérée, pourvu que la règle demeure » in Poétique de la Relation, (1990, p. 141).
Les bases socio politiques de l’école
L’école n’est jamais neutre, dirait-on. Elle est traversée par les intérêts, les rapports de pouvoir et les visions du monde des groupes qui la financent et la dirigent. En Haïti, les bases socio politiques de l’école révèlent un paradoxe : censée être l’outil de démocratisation du savoir, elle s’érige en instrument de distinction sociale et de perpétuation des privilèges, d'un côté et de l'autre l'expression plénipotentiaire de la pérennisation des inégalités. De l’ailleurs, ici on choisit bien ceux à qui l'on peut confier le ministère de l'éducation nationale. À cela je me permets le droit de pointer le doigt sur Jean Price-Mars, qui, en 1919, dénonçait dans La vocation de l’élite, l’« exotisme mimétique » qui gangrène nos institutions scolaires, préférant la reproduction des modèles étrangers à la valorisation de la culture nationale (cf. p. 54). Ce glissement de dépendance culturelle par la Francophonie se double d’une dépendance économique : l’école est financée, orientée et souvent réformée en fonction d’agendas politiques et de bailleurs internationaux (comme la France, le Canada entre autres UNESCO, UNICEF…). Elle devient alors le reflet des hiérarchies sociolinguistiques et géopolitiques plutôt qu’un outil de libération et d’entente nationale.
Du côté de cet invité, à qui notre correspondance s'est adressée tôt, le pédagogue indien Krishna Kumar, il insiste sur la manière dont les politiques éducatives, lorsqu’elles s’alignent sur les intérêts des élites, « façonnent les inégalités dès le plus jeune âge » in Political Agenda of Education, (1991, p. 102). En Hayti, ce constat s’applique avec une acuité douloureuse : les écoles privées dites bourgeoises, chez les frères et chez les sœurs, bénéficient des ressources considérables comme des subventions de la pointe de l’épée jusqu'à sa manche, tandis que l’école publique et nationale survit dans une indigence chronique. Ce dualisme scolaire traduit, à l’échelle nationale, le clivage socio-politique entre les classes dominantes et les masses populaires (cf. Keber BASTIEN, Fèmen Lekòl, 2024).
A ce stade, j'introduis sur cette tribune, le penseur ghanéen Kwame Nkrumah, qui, dans Neo-Colonialism : The Last Stage of Imperialism (1965, p. 236), avertissait déjà que l’éducation pouvait être « l’arme la plus subtile de l’assujettissement », car elle façonne des élites déconnectées de leur peuple et davantage au service d’intérêts extérieurs qui, ancrées dans leur réalité nationale, au détriment de bien de la Res Publica. L’école haïtienne, en ce sens, est bien souvent une machine à fabriquer des cadres déracinés, aspirant plus à l’exil qu’au service de la collectivité.
Ces bases socio-politiques expliquent pourquoi l’école fonctionne comme un filtre en mode faufilant : elle sélectionne, trie et élimine sous prétexte de mérite, mais en réalité selon les lignes invisibles de la classe sociale et du capital culturel hérité. Ainsi, comme l’affirme le philosophe martiniquais Patrick Chamoiseau, « l’école, au lieu de bâtir des passerelles, érige des frontières » Écrire en pays dominé, (1997, p. 67).
Les fondations de l’école haytienne reposent moins sur l’idéal de justice sociale que sur les nécessités politiques de reproduction des élites. Ce constat met en exergue une vérité dérangeante car le système éducatif, loin d’être un ascenseur social, est une forteresse verrouillée dont les clés ne circulent que dans les mains d’une minorité agissante, “ si gen yon Lekòl kache dèyè vwal, aprann pitit nous sovkipe, kouman pou n pa pwodui ti vòlò, ti asasen nan yon sosyete ?“ (Keber BASTIEN, Ibid., 1’. 37”).
Victimisation d’une classe par le système
Dans l’arène scolaire ayitienne, certaines catégories sociales ne sont pas seulement défavorisées, elles sont littéralement victimisées. Loin de se limiter à une absence d’opportunités, il s’agit d’un processus systématique bien campé où les enfants des classes populaires subissent une double peine : d'une part, l’exclusion matérielle et d'autre part, de la stigmatisation symbolique.
J'introduis ici à cette discussion le sociologue Laënnec Hurbon qui a pris son temps de souligner que l’institution scolaire, en reproduisant les clivages de classes, crée « une hiérarchie de légitimités où l’enfant pauvre devient l’intrus toléré » Culture et dictature en Haïti, (1979, p. 112). Ainsi, l’élève issu de bidonvilles ou de campagnes est-il souvent perçu comme étranger à l’univers scolaire, un passager clandestin qui n’aurait pas sa place dans ce temple réservé aux héritiers du capital culturel bourgeois.
De façon parallèle, l’intellectuel nigérian Chinua Achebe, qui a accepté de faire ce voyage avec nous, dénonçait avec dignité cette ingérence qui tambourine la table de notre discussion, et a montré que, in The Trouble with Nigeria (1983, p. 14), les systèmes de générations historiques des sociétés capitalistes transforment les inégalités sociales en trames héréditaires où l’enfant de paysan ou urbain ou d’ouvrier est d’avance étiqueté comme « inapte » à la réussite scolaire. Ce constat s’applique cruellement à Haïti où, dès l’école fondamentale, les enfants de familles appauvries, discriminalisées sont étiquetés comme « paresseux » ou « incapables », quand bien même leurs échecs découlent des conditions structurelles insurmontables préétablies par le système exclusif.
D'un autre côté, le philosophe sud-coréen Byung-Chul Han, après avoir pris siège dans notre débat, et, qui n’a pas voulu faire marche-arrière face à la concrétude de son doute, met en garde la logique de performance qui « individualise la responsabilité de l’échec en invisibilisant les contraintes collectives » in La société de la fatigue, (2010, p. 45). Telle qu’en Haïti, l’échec scolaire est rarement perçu comme un symptôme d’inégalités systémiques, mais plutôt comme une tare personnelle de l’élève. Cette rhétorique du blâme continue de contribuer à victimiser une classe entière, en la rendant responsable de sa propre marginalisation structurelle.
Cette victimisation n’est pas neutre pour autant car elle prépare une fracture sociale durable. Les enfants rejetés par l’école deviennent des adultes désabusés, exclus du marché formel de l’emploi, souvent réduits à la survie dans l’informel ou dans la migration forcée ou du moins à la machine infernale de la criminalité. À travers cette mécanique d’exclusion, l’école cesse d’être un levier d’émancipation pour cette catégorie pour devenir une fabrique de résignation et, pire encore, une pépinière d’humiliations et d'inégalités sociales.
Édouard Glissant glisse encore, en tablant sur son schéma de départ, que « la domination la plus pernicieuse est celle qui fait croire au dominé que son sort est naturel » in Discours antillais (1981, p. 301). L’école haytienne, en victimisant systématiquement les classes populaires, inculque à ses élèves appauvris sous toutes ses formes l’idée que leur destin est d’échouer, alors la constitution du pays prévoit une scolarité gratuite. C’est là l’injustice la plus cruelle : transformer l’exclusion et la violation criante de la constitution en fatalité.
Rivalités et conflits sociaux autour de l’école
L’espace éducatif haytien est le théâtre d’une rivalité silencieuse mais implacable, où les écoles se hiérarchisent selon des clivages sociaux et culturels. Plus d’un le sachent. Ce morcellement, loin d’être anodin, génère les inégalités et engendre des conflits symboliques qui se répercutent jusque dans les rapports sociaux entre citoyens ou classes sociales.
D’un côté, l’école publique, nationale et communautaire, exsangue, fonctionne comme une institution de survie qui vacille sans répit entre manque et absence : bâtiments délabrés, enseignants sous-payés, manque chronique de matériels pédagogiques, etc. Elle accueille la majorité des enfants issus de familles appauvries, mais leur offre trop souvent une instruction amputée de moyens, d’attentions nutritives et de perspectives. À cela, l’anthropologue Michel-Rolph Trouillot, qui a pris siège à cette tribune de discussion, et attire notre attention sur le fait que « la pauvreté des moyens pédagogiques en Haïti n’est pas un accident mais le reflet d’une économie politique de l’inégalité » in Haiti : State Against Nation (1990, p. 174).
Ce qui fait qu’en face, trône l’école française, perçue comme un sanctuaire du prestige social. Accessible uniquement aux élites fortunées, elle offre des programmes alignés sur l’Éducation nationale française, préparant les élèves aux baccalauréats internationaux. Elle confère non seulement un savoir académique mais surtout un capital symbolique de l’administration publique nationale : la maîtrise de la langue française dans sa variante normative, gage d’ascension sociale et de distinction culturelle jusque-là en Ayiti. Ce monopole du prestige politique et linguistique ravive les fractures entre les « initiés » et les « exclus ».
De l’autre côté se développe l’école américaine, incarnée par les institutions bilingues ou anglophones de Port-au-Prince, de Delmas et de Pétion-Ville. Là encore les frais exorbitants et les infrastructures dites modernes (bibliothèques, laboratoires, accès au numérique) creusent l’écart avec l’école nationale, communautaire. Ces établissements s’érigent en passerelles vers les grandes universités étrangères, renforçant l’exode des cerveaux et creusant la dépendance du pays à l’égard de l’extérieur.
L’on comprend vite que ces catégories d’écoles traduisent une lutte amplement contradictoire pour l’accès à la distinction sociale que notre invité, le philosophe ghanéen, Kwame Gyekye trahit en ces termes « l’éducation devient un champ de bataille où se dispute le pouvoir de définir la respectabilité » in Tradition and Modernity (1997, p. 119). En Hayti, ce champ de bataille se matérialise dans la compétition pour inscrire son enfant dans les institutions les plus prestigieuses, en vue d’assurer ou de tailler une place de choix dans l’administration publique et dans les affaires au détriment de la classe ouvrière, quitte à sacrifier l’économie familiale entière.
En revanche, les moyens logistiques renforcent cette stratification sociale en ségrégation sociale des classes. Là où les écoles élitistes disposent d’ordinateurs, d’internet haut débit, de bibliothèques climatisées et d’enseignants formés à l’international, l’école publique communautaire peine à fournir des bancs en bois et des manuels obsolètes (UNICEF, 2020). La fracture éducative devient ainsi une fracture technologique, culturelle et psychologique sinon structurelle avec les traces des privilèges de l’organisation sociale de la période coloniale. Eu égard à cette adresse, le penseur indien Ashis Nandy, qui a soutenu avec force notre position, a affirmé que « la colonisation la plus durable est celle qui s’exerce par l’éducation et les symboles » in The Intimate Enemy (1983, p. 73).
Ces rivalités engendrent des conflits sociaux larvés. Les diplômés forcés de l’école publique se sentent relégués au rang de citoyens de seconde zone face à ceux issus d’écoles françaises ou américaines qui ont décroché sans tracas leur diplôme, mieux outillés pour conquérir les emplois rares et les positions de pouvoir dans l’administration publique. L’école, au lieu d’unifier, dresse ainsi les murs invisibles d’une ségrégation sociale qui nourrit rancunes, frustrations et tensions intergénérationnelles entre les classes sociales.
Accès, diplômes et réussite scolaire
Qui oserait s’étonner qu’en Haïti la réussite scolaire soit un champ de paradoxes. Les élèves de la classe appauvrie s’épuisent sur les bancs d’école, accumulent diplômes et certifications, mais découvrent bien vite que ces parchemins ne constituent ni une voie vers l’emploi, ni une garantie de mobilité sociale. À cela s’ajoute le dicton populaire « se moun pou w genyen » – autrement dit, il faut « avoir ses gens » pour avancer – traduit mieux que tout traité de sociologie l’absurdité d’un système où les diplômes, vidés de leur valeur intrinsèque, cèdent la place au piston, au clientélisme et au favoritisme jusqu'au plu haut niveau de la chose publique.
Quitte à faire remarquer que le sociologue haytien Gérard Barthélemy qui a taillé sa place en grande forme sur la table de notre discussion affirmait que « l’État haïtien se pense comme une grande maison familiale, où le partage des ressources s’opère selon les liens et non selon les compétences » avec Le pays en dehors (1990, p. 211). Cette logique historico-sociologique imprègne l’administration publique où, en l’absence de concours réguliers et transparents, le recrutement repose sur l’appartenance à un réseau politique, religieux ou familial ou zanmitay. Le diplôme ou la certification devient alors un simple ornement du népotisme, incapable de peser face à l’arme redoutable de l’« appartenance », du clientélisme ou du favoritisme.
Ce qui fait que cette réalité, nous avons vite compris, engendre une contradiction criante dans la mesure où les enfants formés dans les écoles élitistes, disposant déjà de relations solides, cumulant non seulement les diplômes prestigieux mais aussi les connexions décisives sur le marché. Tandis que ceux issus d’écoles publiques, même bardés de mentions, se heurtent à un mur invisible, soit ils deviennent acteurs luttant pour leur intégration dans les affaires publiques, soit ils contactent directement leurs proches, par conséquent l'opinion publique leur traité comme abolotcho. Répondant présent à notre invitation, le philosophe camerounais Achille Mbembe, embrasse son idée et fait prévaloir l’idée selon laquelle « dans les sociétés postcoloniales, la valeur du savoir se dissout dans le jeu des clientèles et des proximités » in De la postcolonie (2000, p. 89).
En revanche, à l'échelle internationale, cette dévalorisation des diplômes haïtiens alimente un cercle vicieux. Les lauréats sans réseau cherchent leur salut dans la migration, espérant que leurs certificats acquièrent ailleurs la reconnaissance qu’on leur refuse au pays. En cela, c'est peut-être à l’écrivain indien Arundhati Roy que revient-il le mérite pour avoir fait assomption à travers Capitalism : A Ghost Story (2014, p. 47), de possibilités criantes de diplômés non pris en compte au profit de non diplômés, pour dénoncer ce type de mécanique où « l’éducation produit des armées de diplômés qui deviennent des fantômes sociaux lorsqu’ils ne trouvent pas leur place dans l’économie ». En Hayti, ces fantômes sont légion car ils hantent les bureaux des ministères, les coins de rue de Port-au-Prince, les files d’attente pour un visa qui se conjuguent à longueur de journée.
Aussitôt, l’accès à l’emploi public, conditionné par le clientélisme, mine-t-il la crédibilité même de l’école. Par le fait que les diplômes cessent d’être un marqueur de mérite pour devenir un prétexte de distinction sociale sans valeur opérationnelle formelle. Loin d’être un moteur de progrès, la réussite scolaire est réduite à un rituel symbolique qui rassure les familles, mais laisse les jeunes face à l’abîme du chômage et du désespoir au bénéfice de ceux qui ne détiennent pas le goût du travail bien fait ou de l’excellence collective de l'administration publique.
Le penseur martiniquais Aimé Césaire, dans son ayitianité, sa culturalité africaine et son sens d’analyse socio-historique du colonialisme a fait prévaloir qu’ « une société qui étouffe le mérite au profit des accointances prépare sa propre ruine » in Discours sur le colonialisme, (1950, p. 23). L’école haytienne, prisonnière du clientélisme étatique, illustre tragiquement cette tragédie qui lui dépasse aujourd'hui en transformant les enfants discriminalisés en agents doubles de la criminalité d’en haut.
Réalité et conflits scolaires actuels
La rentrée scolaire en Hayti est devenue le baromètre de l’injustice sociale. Chaque année, l’ouverture des classes surgit comme un révélateur cruel. Car là où les établissements privés huppés — français, américains ou bilingues — déploient leurs tapis rouges à date fixe, avec uniformes flambant neufs et infrastructures dites modernes, les écoles, nationales, publiques et communautaires s’embourbent dans des retards chroniques, dont la réouverture se remporte sans répit, faute de moyens et d’organisation.
Ainsi, en octobre 2024 encore, plusieurs écoles nationales transformées en abris pour déplacés n’avaient-elles pu rouvrir leurs portes, alors que les lycées français et américains avaient déjà entamé leurs programmes avec discipline et faste. Cette asymétrie engendre une scission spatio-temporelle : les enfants des élites avancent dans le calendrier éducatif, tandis que ceux des masses populaires restent coincés dans une spirale d’attente et de désorganisation. J’appelle à mon support le penseur nigérian Wole Soyinka qui a fait assomption d’inégalités sociales spatio-temporelles dans la mesure où « les inégalités se mesurent aussi dans le temps, lorsque certains avancent et que d’autres stagnent » in The Open Sore of a Continent (1996, p. 131).
À cette fracture redoutable s’ajoute la question des frais scolaires. Car chaque année, en Ayiti, des dizaines de milliers d’élèves abandonnent purement et simplement les bancs d’école parce que leurs parents, étranglés par l’inflation structurelle, sont incapables de payer inscriptions, uniformes, manuels et « frais annexes » imposés même dans les écoles publiques. Selon un rapport de la Banque mondiale (2023), près de 40 % d’enfants haytiens quittent l’école avant la fin du cycle fondamental pour des raisons économiques. Ce drame silencieux alimente un cercle vicieux où l’appauvrissement se reproduit à travers l’exclusion scolaire structurante de la politique de l’État.
Cette réalité nourrit des conflits scolaires profonds. Dans les quartiers dits populaires, les familles vivent la rentrée comme une humiliation. Parce qu'elles voient et constatent que les enfants des classes aisées s'installent dans des salles climatisées, tandis que leurs propres enfants errent, sans classe, faute de moyens. J’embrasse à nouveau la sagesse épistémologique du philosophe indien Amartya Sen qui ne cesse de se rappeler que « la justice ne se mesure pas seulement en termes de ressources, mais en termes de possibilités réelles d’agir » The Idea of Justice (2009, p. 215). L'on sait que le rôle premier de l’État est de réaliser l’égalité. Or, pour des centaines de milliers d’enfants haytiens, ces possibilités sont nulles.
La situation actuelle crée une tension sociale assourdissante. Car les parents appauvris, frustrés, perçoivent l’école comme une loterie injuste, où les dés sont pipés d’avance au profit de groupes aisés de la société. Les plus riches consolident leur avance générationnelle grâce à l’accès garanti à l’éducation internationale, tandis que les plus pauvres s’enfoncent dans l’analphabétisme fonctionnel ou dans l’abandon précoce. Césaire en revient sur la toile via son Discours sur le colonialisme (Ibid., p. 45), et prévient qu’ « une société qui prive ses enfants d’école scie elle-même la branche sur laquelle elle est assise ».
Ainsi, les conflits scolaires actuels en Haïti dépassent-ils la simple gestion administrative, ils incarnent la fracture sociale dans sa nudité la plus brutale de la criminalité armée, où l’avenir d’un enfant se joue à la caisse d’inscription de l'école et à une possibilité d'abandon d’année scolaire.
Milieu social et les abandonnés scolaires
L’école haytienne n’échoue pas seulement à inclure, elle expulse, chaque année, une armée silencieuse d’enfants laissés pour compte. Les chiffres sont explosifs. Près d’un tiers d’élèves abandonnent le système scolaire annuellement, faute de moyens financiers. Derrière ces statistiques froides se cachent des drames humains : familles incapables de payer les frais d’inscription, enfants contraints de troquer leurs cahiers pour des petits boulots de survie, adolescents livrés à l’oisiveté des rues ou des marchés publics.
L’influence du milieu social est déterminante. Dans les familles aisées, l’éducation est un héritage protégé, une valeur transmise comme un capital sacré. Dans les familles appauvries, l’école est une bataille quotidienne, souvent perdue d’avance. De ce point de vue, je fais appel à notre bel esprit, Suzy Castor, qui table son point de vue sur les critères d’exclusion en ce sens que « l’inégalité éducative en Haïti est moins une question de talents que de conditions matérielles de reproduction sociale » in L’Occupation américaine d’Haïti (1988, pp. 92-93 et passim).
La pédagogie implicite des rues remplace alors celle de l’école. Les enfants déscolarisés apprennent vite les codes de la route de survie : débrouillardise, violence, soumission à des chefs de quartier, délinquance, mendicité, vol etc. Ce transfert à contre courant éducatif, loin de bancs de classe, nourrit une culture alternative où la structure de l’école en Ayiti devient synonyme d’exclusion et la rue des pas perdus un espace d’appartenance de socialisation autre dans lequel les enfants largués par l’impuissance de l'État intériorise la violence et la criminalité armée. J'appelle cette fois-ci notre ami de longue date, le penseur jamaïcain Stuart Hall qui tenait à cœur que cette question en titubant que « lorsque les institutions échouent, d’autres formes de socialisation émergent, souvent destructrices » in Policing the Crisis (1978, p. 219). D'où les inégalités sociales engendrent toujours d'autres formes d'inégalités sociales spatio-temporelles.
A cela la hiérarchie scolaire se reflète alors dans la hiérarchie sociale des gangs. Les enfants exclus, frustrés et humiliés, trouvent dans ces groupes armés une reconnaissance que l’école structurelle forgée par l'État leur a refusée. Je cours après un rapport de RNDDH (2024), qui a fait état d’une proportion alarmante de nouvelles recrues de gangs provenant de cohortes d’élèves abandonnés, incapables de poursuivre leurs études faute d’argent. Ce passage forcé, inégalitaire de l’école à la rue illustre une tragédie nationale : l’éducation ratée se transforme en insécurité, criminalité généralisée.
Pour corroborer cette approche, je fais appel à un brillant philosophe sud-africain, Steve Biko, et de fait, il m'a répondu affirmativement en décortiquant sur la table de notre discussion son I Write What I Like (1978, p. 57), et prévient en ces termes qu’ « une société qui refuse l’éducation à ses enfants prépare ses propres bourreaux ». Ce qui explique que ce dont Ayiti vit aujourd’hui est cette prophétie à la fois implicitement malheureuse et redoutable, par le fait que chaque enfant exclu de l’école alimente potentiellement le cycle infernal de la violence armée. L’école, censée pacifier et structurer, se mue en foyer indirect de conflictualité, de criminalité armée entravant le tissu social dans toutes ses trames et racines.
Je viens avec l'idée selon laquelle le milieu social scolaire ayitien ne détermine pas seulement les chances d’apprendre, de s’instruire pour garantir la continuité de la cohésion sociale mais il oriente les trajectoires de vie désormais désorientée par la gestion (mauvaise) d’un État qui, jusque-là, perdure les inégalités sociales à travers sa politique éducative de ne t’attends qu'à toi seul entravant le fonctionnement d'une population doublement victimisée par ses propres fils : privés de couloir éducatif devant garantir par l’État et désorientés par les forces extractivistes d’une politique destructrice et fratricide supportée et maintenue par l’incompétence et l’ingérence de l’État. De cela, pour un tiers d’élèves abandonnés chaque année, l’avenir se joue loin de cahiers et de manuels, dans la rue et parfois dans l’univers sans retour de gangs. C’est là l’échec le plus retentissant d’un système éducatif qui maintient les inégalités sociales, incapable de protéger ses propres enfants et, par extension, la société tout entière.
joseph.elmano_endara@student.ueh.edu.ht
Formation : Masterant en Fondements philosophiques et sociologiques de l’Éducation/CESUN Universidad, California, Mexico; Juriste- Sciences Juridiques/FDSE, Communication sociale/Faculté des Sciences Humaines (FASCH/UEH)