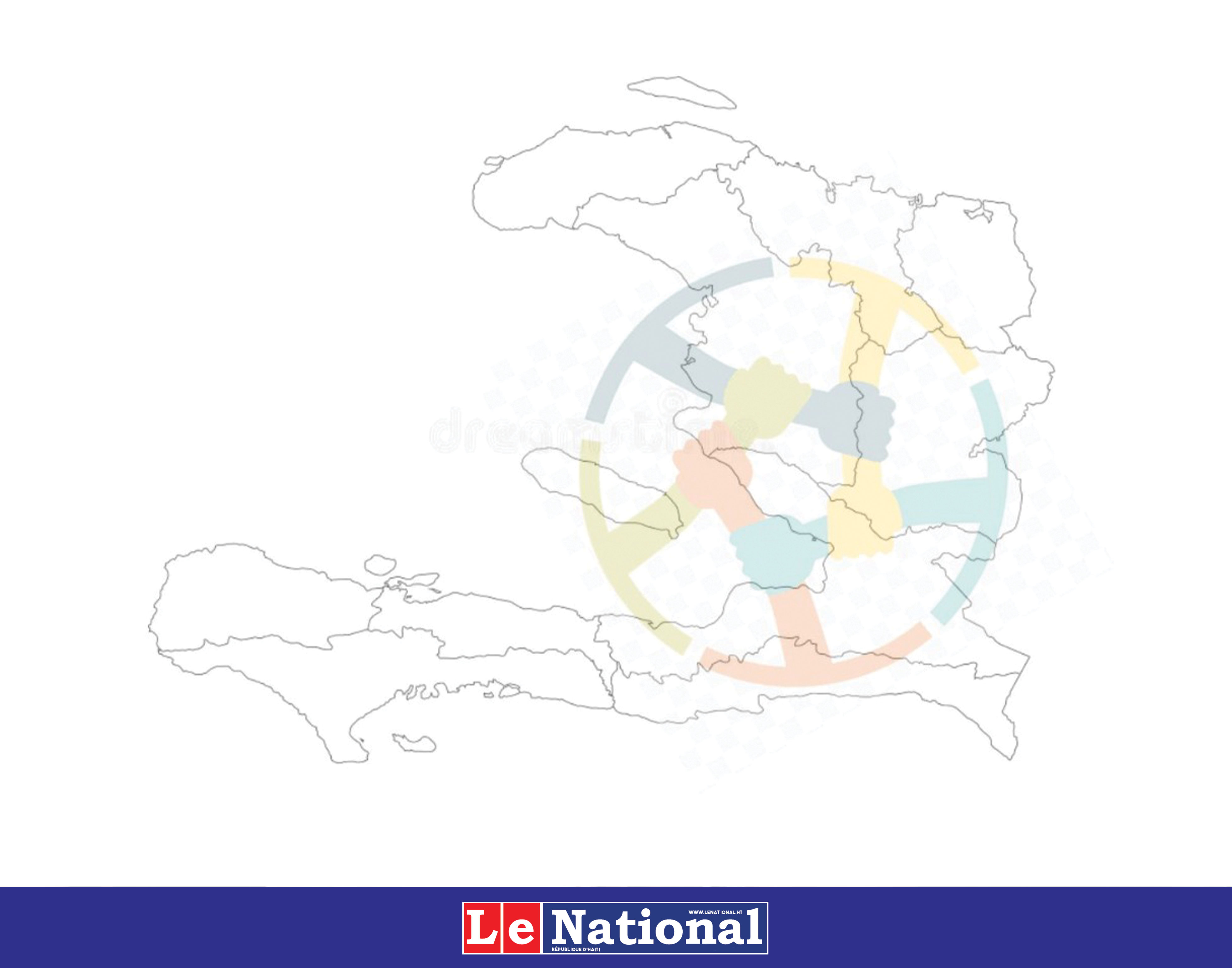Par Hancy PIERRE
L’esclave eut été interdit d’apprendre à lire et à écrire, dans la colonie de Saint Domingue. Ce fut une inquiétude que l’esclave possède ses aptitudes provoquant ainsi l’insurrection et la rébellion « (Ianni, 1976 :56). Cette interdiction s’étendait aussi au mulâtre car une ordonnance royale contenait dans un de ses articles une stipulation atroce : tout mulâtre esclave qui voudrait s’instruire serait puni de cent coups de fouet : tout mulâtre affranchi redeviendrait esclave » Fouchard,1988 : -61).
Des correctifs sont loin de redresser cette situation au fil des temps pour garantir le droit à l’éducation. L’occupation américaine ( 1915-1934) si elle avait prôné l’idée d’accès à “la civilisation”, l’offre d’éducation ne fut plutôt un leurre. Un parti pris a été institué par l’occupant pour la promotion de l’école des fermes inscrites dans le clivage école rurale- école urbaine. Ce qui a porté les paysans à payer la rançon de la domesticité de leurs enfants confiés aux familles bourgeoises en échange de promesse de l’instruction de ces enfants. Le nombre des enfants en domesticité fut alors très imposant.
Sous le poids de la pauvreté rurale, le paysan se trouve dans le dilemme de choisir entre la misère et la domesticité de ses enfants dans la République de Port-au-Prince érigée par l’occupation américaine de 1915-1934 au regard des politiques de centralisation. L’intérêt pour l’enseignement supérieur fut largement absent que Dantès Bellegarde eut à dénoncer fermement dans son plaidoyer pour la promotion de l’enseignement supérieur. Pour lui « l’université est un projet en souffrance » (Bellegarde, 2004 : 80).
Il faudrait attendre 1976, au prix des résolutions des organismes régionaux, pour se mettre au pas dans une perspective universelle en matière d’éducation. Ce qui reste une lettre morte vu la prépondérance du secteur privé dans le secteur éducatif et le rachitisme de l’école publique dans l’accueil des enfants et des jeunes à besoin de scolarisation.
Le système éducatif haïtien a fabriqué une école d’exclusion . Cette école est vouée au tri, à la sélection, à la production d’une élite privilégiée, au maintien et au renforcement des disparités et inégalités sociales considérables et surtout l’exclusion de ceux, forts nombreux, issus des milieux pauvres et défavorisés (Pierre ;1995 :9) cité par Jean (2010).Nous sommes donc interpellés devant ce déficit en éducation qu’il reste à combler et se présente plutôt comme un défi. Des régimes qui ont eu à s’installer au-delà d’une génération, eurent plutôt renforcé le clivage ancré dans l’exclusion inhérente au système qui nie les droits au bien être des » bossales » par rapport aux « créoles ».
Sous l’égide de Duvalier, le nombre des enfants en domesticité grossit davantage. Si entre 1946 et 1960, Port-au-Prince regroupe entre 60,000 et 80,000 enfants domestiques, ce nombre est passé jusqu’à 100,000 au début des années 1970 pour une population d’un demi-million d’habitants selon les statistiques de l’IHSI d’alors. Ce, sous l’effet d’une loi qui a exigé la scolarisation des enfants sous peine d’amende aux parents. Par la suite, en 1971, il revient, devant l’incapacité des pouvoirs publics de garantir le droit à l’éducation pour tous, de confier l’éducation et la protection de l’enfant à des maisons d’enfants. Les enfants sont ainsi coupés de leur attachement familial et enclins à toutes formes de maltraitance selon des enquêtes produites sur ces établissements d’internement par la suite. Il est question d’envoyer les enfants à l’école si les parents sont trop pauvres ou si l’enfant est orphelin. Ainsi selon le décret du 23 décembre 1971, il est disposé des maisons d’enfants, institutions publiques ou privée, laïques ou religieuses peuvent recevoir tout enfant orphelin ou tout mineur dont les parents ou responsables légaux qui ne remplissent pas leurs obligations relatives à son éducation ou ne peuvent les remplir pour des raisons économiques.
Dans ce contexte, nous assistons à un début de privatisation du social, la famille allait s’impliquer seule puis pour céder la place aux maisons d’enfants enclines au risque de trafic. Des chiffres témoignent malgré tout, des déficits flagrants dans l’éducation des enfants qui ne sauraient être comblés par des décrets. Nous observons depuis quelques temps le règne de la charité en matière d’éducation. Ce qui a caractérisé des politiques publiques depuis la création de l’organisme de Fonds de Parrainage par le premier ministre Marc Bazin après le coup d’Etat militaire de 1991 contre le président Jean Bertand Aristide, appelé à assurer une assistance aux écoliers et écolières . Ce qui rejoint la stratégie de privatisation du social de l’opération des Organisations Non Gouvernementales et les Eglises dans le domaine de la promotion de la charité et d’appui à la scolarisation. Les politiques de compensation qui prévalent à nos jours aux famille auraient masqué le faible engagement de l’Etat dans le secteur de l’éducation publique. La situation du secteur de l’éducation devient chaotique dans le contexte de violence des gangs quand ces derniers ont détruit un nombre important des établissements scolaires dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince . La charité s’amplifie davantage et se légitime dans ce contexte.
Aussi la fascination donnée par des politiques dans l’accès à l’éducation par le biais d’une politique de massification dans les années 1990 a-t-elle contribué à renforcer les mêmes facteurs de reproduction des disparités plus haut indiquées. Ainsi c’est l’inféodation accrue des organismes internationaux dans l’organisation du système éducatif et l’influence des Etats comme les Etats Unis, le Canada, la France associés avec des organismes tels que Banque Mondiale, UNESCO, Banque Interaméricaine de Développement (BID), organisation des Etats Américains (OEA) (Tardieu,1990). Il s’établit une balkanisation à partir des sphères d’influences étrangères sur le système de l’enseignement. Il a été érigé un édifice d’éducation apparenté à un tour de Babel en évacuant les intérêts nationaux quand la jouissance du droit à l’éducation pour toutes et pour tous reste un leurre dans les fascinations politiques créées par les différents gouvernants. L’aide humanitaire a étendu son champ d’action au domaine de l’éducation qui est traditionnellement associé au développement et à la reconstruction à long terme.
Hancy PIERRE, professeur à l’Université
Repères bibliographiques
- Ministère des Affaires sociales/UNICEF (1981), “bases pour un programme de réhabilitation des zones marginales de Port-au-Prince”, Haïti .
- Mildred ARISTIDE (2003), l’enfant en domesticité en Haïti, produit d’un fossé historique, Henri Deshamps, Port-au-Prince, 177p.
- Edouard, Francisque(1986),La structure économique et sociale d’Haïti, Henri Deschamps, Port-au-Prince , 255p .
- Yves Saint-Gérard (1984), L’État de mal, Collection « Études américaines », Editions Eche, Toulouse, 126p.
- Charles Tardieu (1990), L’Éducation en Haïti de la période coloniale à nos jours, Henri Deshamps, Port-au-Prince, 399p.
-Dantes Bellegarde (2004), La résistance haïtienne,1e Édition,Collection Bicentenaire, Haïti 1804-2004, Édition Fardin, Port-au-Prince .
- Wilson Junior Jesan (2010), Pour une analyse sociologique des pratiques éducatives des écoles secondaires privées de vacation soir aux attentes de mobilité sociale des adultes en situation d’élève dans une société haitienne bloquée.Faculté des Sciences Humaines, Université d’Etat d’Haiti.Non publié.
-Ivan Beghin, Les problèmes de santé et de nutrition en Haïti. Un essai d’interprétation htttp://www.kaowarsom.be.documents Nat .SC, (consulté le 9 mai 2021)
-Jean Fouchard (1988), Regards sur le temps passé. Les marrons du syllabaire, Editions Henri Deschamps,Port-au-Prince, 139p.