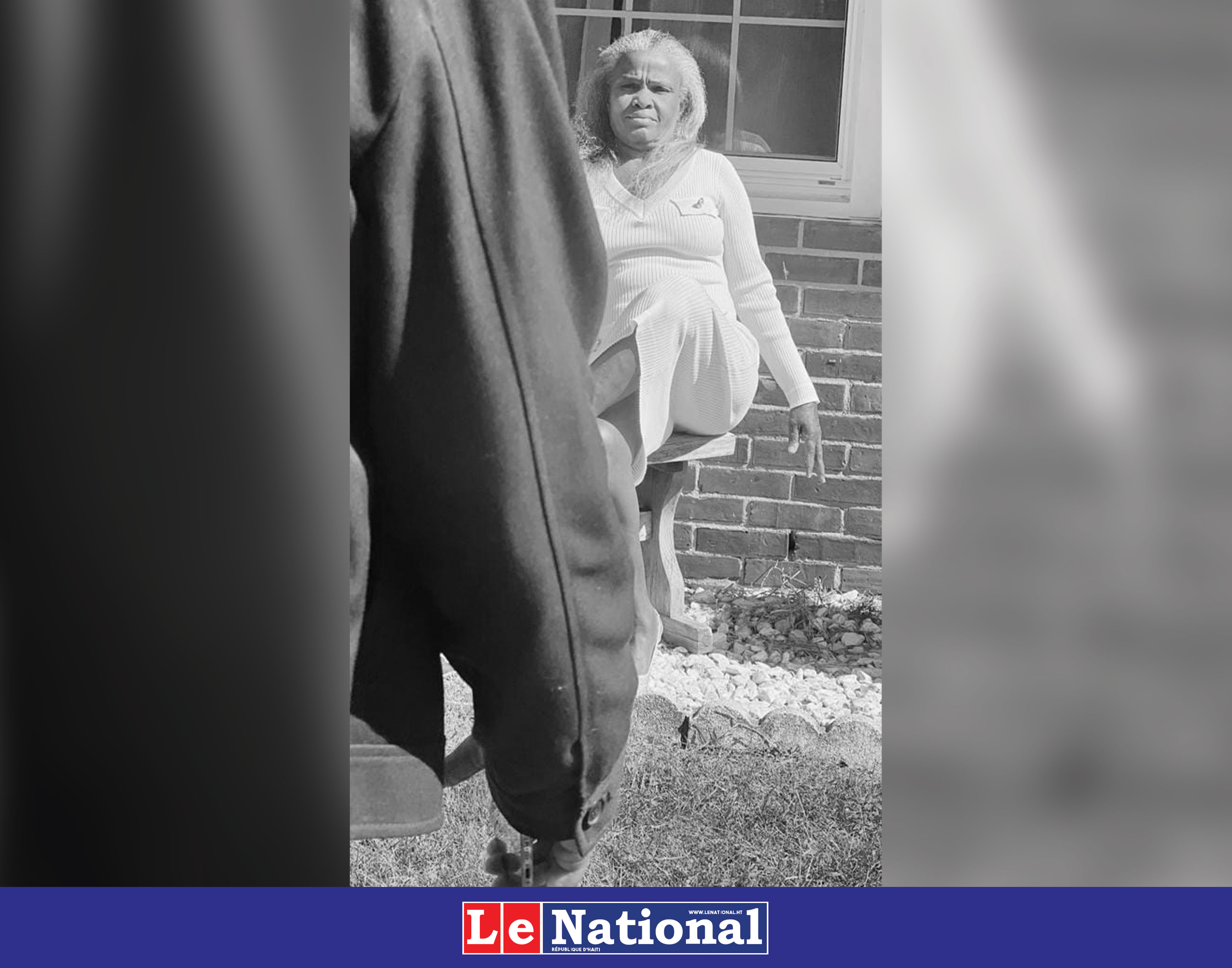Depuis que je partage mes récits sur les loups-garous, mes proches m’envoient régulièrement leurs expériences à ce sujet. Parmi eux, Dieumercie de Mirebalais et qu’Aséfi de Léogane m’ont confié des histoires glaçantes, où ces créatures perfides déploient toute leur ruse.
Une flamme mystique
Dieumercie me raconte qu’un soir, alors qu’il devait sortir, il aperçut en rentrant chez lui une grande flamme derrière la fenêtre d’une voisine qui avait un enfant. Le lendemain, une femme l’interrogea sur ce qu’il faisait dehors à une heure si tardive. Il répondit qu’il était resté chez lui.
Dans ce genre de situation, explique mon ami, il faut toujours nier pour détourner les mauvaises intentions du loup-garou. Pourtant, malgré cette réponse prudente, la femme se mit en colère et déclara que si elle ne s’en était pas prise à lui, c’était uniquement à cause de son père.
Trois jours après l’étrange flamme aperçue derrière la fenêtre de la voisine, son enfant rendit l’âme. Le plus surprenant, c’est que le loup-garou fut la première personne à arriver sur les lieux. Elle pleura plus que la mère et le père de l’enfant. Rusée, la sorcière joua la comédie de la douleur et alla jusqu’à prendre le contrôle des funérailles. En Haïti, on appelle “kanbiz” la maîtresse de veillée, gardienne des rites nocturnes. Elle recevait les visiteurs comme si c’était son propre enfant qui était mort, aidait plus que quiconque, préparait du thé, du café et, en guise de consolation, offrit quantité de choses à celui qui avait vu la flamme derrière la fenêtre, trois jours avant le drame.
Par prudence, ce dernier faisait semblant de boire ou de manger ce qu’elle lui donnait, mais renversait tout discrètement par terre — thé, café, nourriture, etc. Le loup-garou, craignant d’être dénoncé, préférait lui donner ce qu’il n’avait même pas, pour se protéger. Tout compte fait, les loups-garous apparaissent comme des personnages à la fois rusés, habiles et profondément malveillants dans la société haïtienne.
Un bébé sauvé de justesse
À Braches, une localité de Léogâne, s’étend une vaste cour commune où vivent un ougan et plusieurs familles paysannes. En l’absence de clôture, l’espace domestique se confondait avec celui des autres.
Dans cet espace partagé, la vie quotidienne se déroule sous le regard de tous, et chaque événement attire l’attention collective. Ce qui intriguait particulièrement les habitants, c’étaient deux personnes âgées — une dame et un monsieur — inséparables comme Saint Roch et son chien.
Chaque dimanche, on les voyait partir ensemble vers une autre église, située à plusieurs kilomètres, délaissant celle du voisinage. L’un d’eux avait un œil malade, et l’autre, attentive, lui tenait la main pour le guider. Leur amitié suscitait de la curiosité.
La vieille dame, disait-on, était un loup-garou. Elle organisait souvent des cérémonies mystérieuses et occultes.
Dans la même cour vivait Aséfie avec ses deux jeunes enfants. L’un des enfants, âgé d’à peine dix mois, était déjà éveillé et vif. À sept mois, il savait déjà marcher.
Un jour, Aséfie dut se rendre à Port-au-Prince, laissant ses enfants derrière elle. Dans le milieu rural haïtien, un enfant n’appartient jamais seulement à ses parents : toute la communauté en assume la surveillance et la discipline. Chacun veille sur les petits, observe leur comportement et intervient si nécessaire. Ainsi, au-delà du foyer, c’est toute la cour, symbole d’une sociabilité ancienne, qui joue le rôle de famille élargie.
De retour à Léogâne, la mère retrouva son enfant de dix mois presque mourant. Elle en resta abasourdie. La nouvelle se répandit aussitôt dans la cour : chacun accourut pour prêter main-forte, animé par cette solidarité spontanée propre au milieu rural. On murmurait, on priait, on proposait des remèdes — tous voulaient aider, tant l’événement semblait survenu soudainement, sans cause apparente.
Parmi les voisins présents, un parent du ougan, qui habitait à quelques mètres, demanda à la mère si l’enfant n’était pas allé chez la vieille dame d’à côté.
Parmi les voisins présents, un membre de la famille du ougan, qui habitait à quelques mètres, lui demanda si l’enfant n’était pas allé chez la vieille dame d’à côté.
La mère, désemparée, répondit : « Je ne sais pas… je n’étais pas là. Je ne sais pas ce qui s’est vraiment passé. »
Alors l’homme lui conseilla : « Demain matin, avant ton départ, prépare à manger pour l’enfant. Puis va très tôt frapper à la porte de la dame. Dis-lui de garder ton fils pour la journée et d’en prendre soin comme si c’était le sien. Dis-lui que tu es persuadée qu’il sera dans de bonnes mains. » »
Le lendemain, Aséfie suivit son conseil à la lettre. À l’aube, elle prépara le repas de l’enfant, puis alla frapper à la porte de la vieille dame. « Je dois partir à Port-au-Prince. Je te confie mes enfants pour la journée », dit-elle.
Mais la femme hésita, sur la défensive : « Pourquoi moi ? Pourquoi pas un autre voisin ? » demanda-t-elle, visiblement troublée.
Malgré ce refus, la mère s’en alla, laissant son petit ainsi que l’aîné chez la loup-garou. La vieille femme, ainsi placée devant le fait accompli, prit les enfants et les ramena chez elle. Personne ne savait pas ce qu’elle avait fait.
La mère revint deux jours plus tard. À sa grande surprise, l’enfant malade avait retrouvé la santé. Émue, elle remercia chaleureusement la vieille dame : « Merci infiniment pour mon enfant. » Et la dame répondit simplement, d’un ton neutre : « Pas de problème. De rien. ».
La dame s’est soigneusement occupée de l’enfant, non par bonté, mais par prudence. Elle savait que si un malheur survenait, tout le voisinage la tiendrait pour responsable. Placée devant le fait accompli, elle usa de ruse et de sang-froid : en soignant l’enfant, elle protégeait autant sa réputation que son secret. Derrière ses gestes bienveillants, se cachait la malice tranquille de celle qui sait détourner le soupçon sans jamais se trahir. C’est exactement ce qu’avait fait ma mère lorsque, dans mon enfance, une loup-garou avait tenté de me faire du mal.
Dr. Emmanuel Charles
Avocat et sociologue