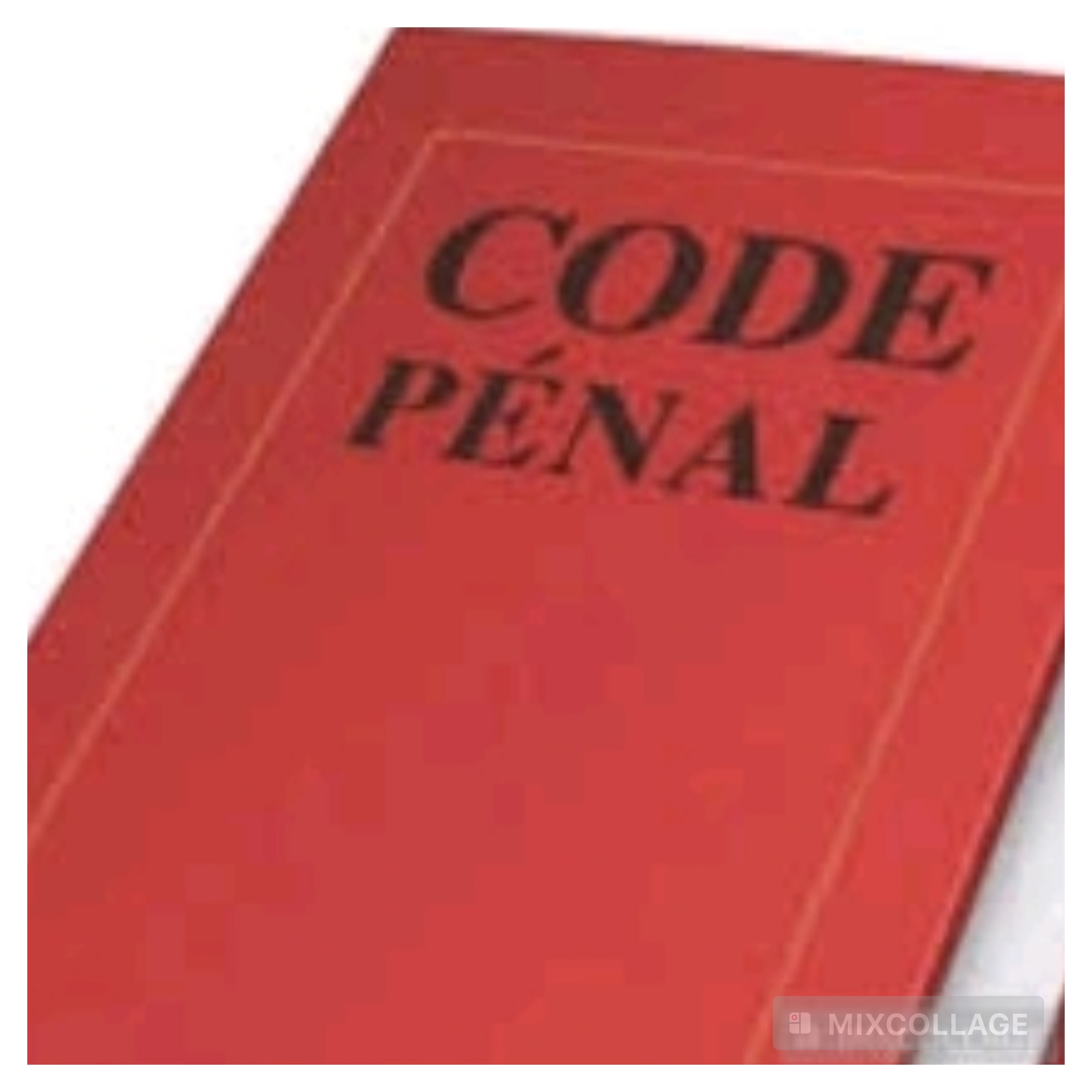L’épilepsie est une maladie neurologique qui atteint près de 50 millions de personnes dans le monde, selon l’Organisation Mondiale de la Santé ( OMS). Connue en créole sous le nom de “Malkadi”, cette maladie est fréquemment associée à la sorcellerie en Haïti. Ceux et celles qui en souffrent sont souvent mal compris. Leurs proches aussi. Le National vous propose de plonger dans le vécu douloureux du jeune écrivain Adboul Kenley Feckzil, témoin des convulsions et des troubles de langage de sa mère.
Avoir une mère épileptique à mes 4 ans d’existence ne fut pas une aubaine pour mon enfance. J’en ai pâti et avalé des poires d’angoisse. Le bambin que j’étais ne savait pas comment courir à la rescousse de sa mère en pleine crise. Nous étions trois à la maison. Ma sœur incluse, nous ne savions pas comment faire face à un mal si capricieux. Haut mal ou mal caduc, dit le langage prosaïque, mais au-delà du dire, de cette belle éloquence de nommer ce mal, se cache un souvenir qui ne fait pas sourire.
Ma sœur et moi, enfants impuissants, témoins d’une maladie chevillée à un corps qui se tord et se convulse, n’avions qu’une seule option en tête : fuir la maison. C’est mon premier souvenir de la maladie de ma mère. Peut-être est-ce la première fois que je fus aussi conscient de mon existence.
Il était peut-être minuit. L’heure où les loup-garous grimpaient à quatre pattes sur tous les toits du quartier. L’heure où l’on entend les chats qui miaulent, les chiens qui aboient… et les enfants qui criaillent. Et ma sœur et moi, au beau milieu de ce chaos, de ces croyances collectives traditionnelles, nous voici deux enfants loup-garous qui braillent dans le silence nocturne de notre sort.
À minuit, on pleurait. Ma mère était malade. On en avait peur. Peur d’elle. De ses yeux qui tournaient un disque de douleur. De son corps qui battait un rythme de souffrance. Mais quoi faire ? On était deux enfants, à peine conscients qu’on avait une mère malade ; une âme si douce emprisonnée dans un corps amer. On sort. Pour aller où ? On ne savait pas. Mais on pleurait. Personne ne pouvait nous venir en aide. À chaudes larmes, nous étions là, à espérer qu’un voisin nous ouvre sa porte. Nenni, on était les loup-garous de minuit.
Les heures s’égrènent, les aiguilles du temps s’approchent des deux heures (ou peut-être plus). Nous vîmes un monsieur et une dame, deux noctambules blottis qui rentraient pédestrement à leur logement. Heureux qu’on voit deux individus qui pouvaient nous aider. Mais à cette heure, on était deux êtres métamorphosés. Médusés ? Ah oui, les croyances ont la vie dure. On balançait nos frêles bras, si excités, comme pour capter la vue des amoureux. On les hélait : “hé, hé !” les mains en louanges, mais pas à Dieu. À l’espoir. Enfin, ils nous virent. Monsieur et madame font un arrêt brusque pour capter nos gestes. Mais dans les minutes qui succèdent à leur pas immobilisé contre l’asphalte, ils courent. Ils courent à toute bouline. Courent comme une ombre. Courent et courent. Et pourquoi ? Ah, les croyances collectives haïtiennes ont la vie dure.
Les heures défilent. Et l’épilepsie de ma mère est itérative. Et nous ? Deux enfants pris pour des êtres maléfiques. Le voisinage nous entendait. Mais nos voix semblaient se fondre dans les murmures mystérieux de la nuit. Heureusement, la nuit sait céder sa place au matin. 5 heures tapantes, un voisin ouvre sa porte et martèle :
— Quoi ? Les enfants de Chimène ? Où est votre maman ?
Et nous, larmes aux yeux, nous lui répondons :
— Elle est morte.
Grandir dans une famille monoparentale, quand le seul parent dont la nature nous a gratifiés est souffrant, n’est pas un trois fois rien. Je vis ma vie pour apporter un peu de bonheur à ma mère. Une enfance orpheline de tout et une âme jeune emprisonnée dans un corps souffrant à l’époque, voilà ce que fut le pèlerinage de ma mère.
Du bonheur, que du bonheur à présent !
Abdoul Kenley Feczil