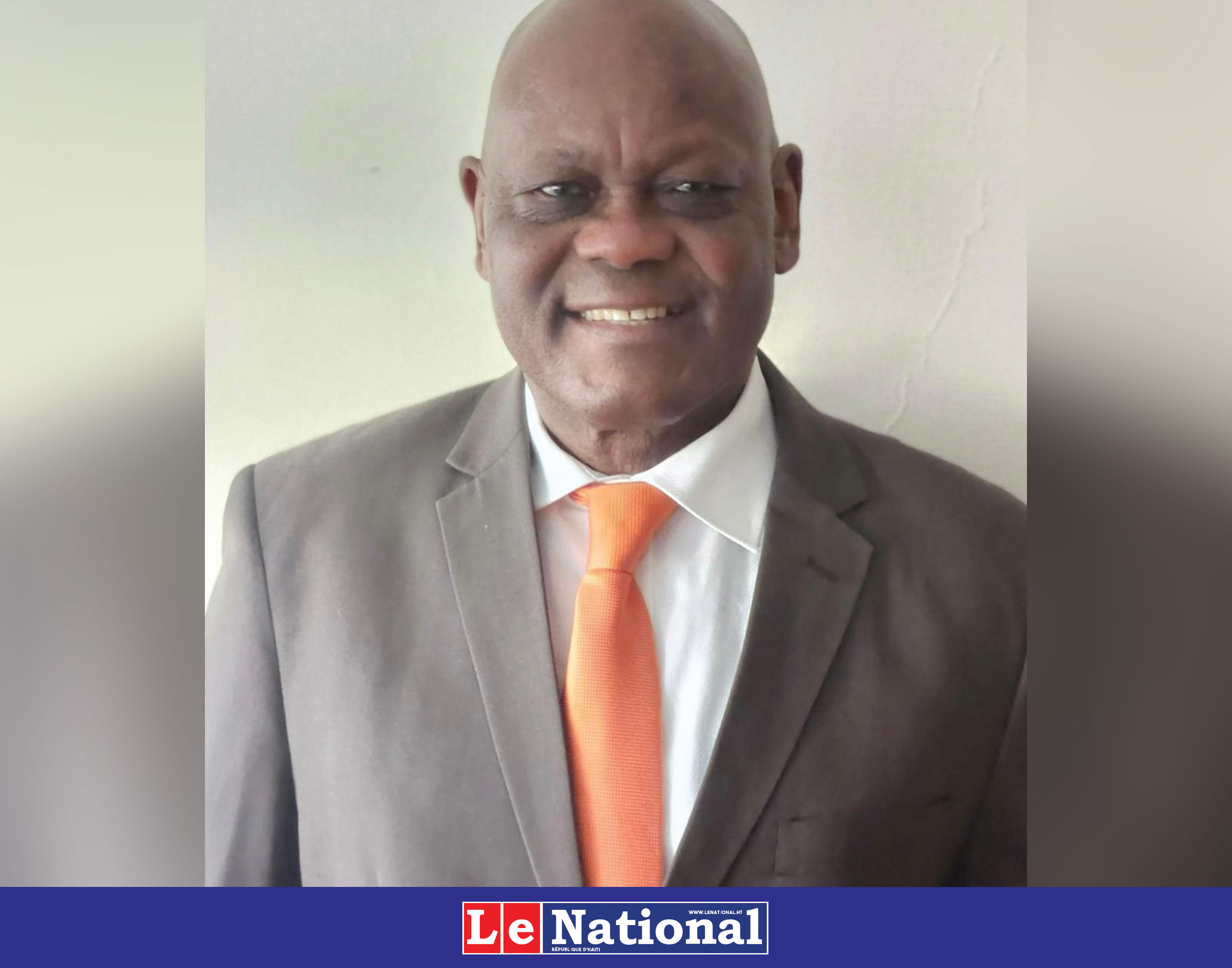Le débat sur la question de la souveraineté aujourd’hui fait rage dans l’opinion. Mais peut-on réellement défendre la souveraineté par des discours tout en affaiblissant, dans les faits, les institutions qui la rendent possible ? Entre nationalisme de posture et nationalisme de responsabilité, l’esprit critique est indispensable pour bien cerner, dans le jeu politique, les actions et les pratiques qui servent la souveraineté ou le jeu des acteurs qui se servent du concept sensible de souveraineté pour déguiser leurs propres appétits de pouvoir, en d’autres termes qui poursuivent leurs propres intérêts privés tout en invoquant à tue-tête la souveraineté.
Il faut dire que ce débat s’intensifie chaque fois qu’une pression extérieure se fait sentir, qu’un partenaire international formule une exigence, ou qu’une décision nationale est perçue comme ou est effectivement influencée de l’extérieur. Elle devient alors un réflexe, un cri de ralliement, un marqueur d’orgueil légitime. Mais à force d’être brandie comme un étendard, la souveraineté risque de perdre son contenu réel.
Il existe en fait une différence essentielle entre souveraineté formelle et souveraineté réelle. La souveraineté formelle est juridique et symbolique. Elle renvoie à la reconnaissance internationale d’un État, à son siège aux Nations-Unies, à son drapeau, à ses institutions officielles, à son droit théorique de décider pour lui-même, bref au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dont Haïti est l’un des pionniers dans les relations internationales du Nouveau Monde. Haïti, à cet égard, est pleinement souveraine. Son indépendance n’est pas en cause dans le droit international.
Mais la souveraineté réelle est d’une autre nature. Elle ne se décrète pas, elle se construit. Elle se mesure à la capacité effective d’un État à exercer son autorité sur son territoire, à faire respecter ses règles, à fournir des services essentiels, à garantir un minimum de sécurité et de justice, à orienter son développement selon des choix collectifs assumés. Elle renvoie moins à un statut qu’à une capacité historique et institutionnelle. Comme l’avait déjà montré Max Weber dans sa définition de l’État moderne — détenteur du monopole de la contrainte légitime sur un territoire — la souveraineté n’est pas qu’une reconnaissance extérieure : elle suppose une autorité effective, des règles respectées et un appareil institutionnel capable de les faire appliquer.
Un État peut exister juridiquement tout en étant institutionnellement faible comme dans le cas haitien. Il peut être reconnu comme souverain tout en étant, dans les faits, dépendant de décisions, de financements ou d’initiatives qui ne viennent pas de lui. C’est pourquoi la souveraineté réelle dépend avant tout de la qualité de la gouvernance.
Un État renforce sa souveraineté lorsqu’il choisit la transparence plutôt que l’opacité. Là où les décisions publiques se prennent dans l’ombre, où les finances échappent au regard citoyen, où les responsabilités se diluent, l’État devient vulnérable aux captations privées et aux influences extérieures. La transparence n’est pas un luxe moral : c’est un instrument de puissance publique qui sert à protéger l’État contre sa propre décomposition.
La souveraineté se consolide aussi par la reddition de comptes et la redevabilité. Un pouvoir qui refuse de donner des comptes à la nation finit toujours par se servir lui-même. Sans mécanismes de contrôle, sans institutions capables de demander des comptes, l’État se transforme en propriété de fait de ceux qui l’occupent. Or un État confisqué n’est plus un État pleinement souverain : il est affaibli, fragmenté, exposé. La redevabilité n’est pas une contrainte imposée de l’extérieur ; elle représente un mécanisme qui empêche la souveraineté de se vider de son contenu.
À cela s’ajoute la responsabilité. Un État souverain assume ses choix, planifie, corrige ses erreurs et refuse de se réfugier en permanence derrière la faute des autres. La tentation de tout expliquer par l’ingérence étrangère peut être politiquement commode, mais elle devient dangereuse lorsqu’elle sert à masquer les défaillances internes. L’irresponsabilité crée des vides — sécuritaires, institutionnels, économiques — et l’histoire haïtienne montre que ces vides attirent toujours des formes d’intervention. La dépendance extérieure naît souvent d’abord de l’impuissance intérieure.
Par exemple, l’occupation américaine de 1915 a été causée par les luttes intestines et les crises politiques, dans le contexte du corollaire à la doctrine de Monroe de Theodore Roosevelt et de la politique du Big Stick. L’ingérence trouve toujours un point d’appui dans les failles internes.
L’ingérence américaine à l’heure actuelle est due à la déresponsabilisation des élites haïtiennes dans le contexte du corollaire de Trump à la doctrine de Monroe — ou de la doctrine Donroe de l’ère America First 2.0, marquée par une réaffirmation de la primauté stratégique américaine dans son “arrière-cour”.
L’histoire haïtienne en donne une illustration brutale. L’occupation américaine d’Haïti en 1915 a été précédée par une instabilité politique chronique, marquée par une succession rapide de présidents, l’effondrement de l’État et des troubles sanglants, notamment l’assassinat du président Vilbrun Guillaume Sam en juillet 1915. Ces facteurs internes ont fourni le prétexte à une intervention américaine visant à sécuriser des intérêts financiers, contrôler les douanes et prévenir l’influence allemande dans la région.
En 1915, prenant occasion des graves troubles internes haïtiens, les « marines » américains ont débarqué et occupé le pays pendant une vingtaine d’années, dans le cadre de la politique du gros bâton (Big Stick policy) et de la diplomatie du dollar. Derrière le discours de stabilisation se profilaient des intérêts stratégiques et financiers. Là encore, l’intervention extérieure s’est appuyée sur l’effondrement interne de l’État. La souveraineté nationale, déjà fragilisée, est devenue non seulement limitée mais presque nominale.
Cette logique ne s’est pas arrêtée avec la fin de l’occupation. La dépendance externe, commerciale et financière, a progressivement installé un rapport de commandement et d’obéissance qui a réduit la souveraineté réelle à une souveraineté de façade. Dans un contexte de dépendance structurelle, la mondialisation elle-même contribue à faire disparaître le pouvoir décisionnel national et à réduire peu à peu la marge de manœuvre autonome d’un pays comme Haïti.
Cela ne justifie pas l’ingérence. Mais cela rappelle une vérité difficile : la souveraineté ne se protège pas seulement par des déclarations, elle se protège en empêchant que les fragilités internes deviennent des portes d’entrée pour les interventions extérieures.
La souveraineté repose également sur la méritocratie. Un État qui marginalise la compétence, qui privilégie la loyauté personnelle au détriment du mérite, qui distribue les fonctions publiques comme des récompenses politiques affaiblit sa propre capacité à décider et à agir. La médiocrité institutionnalisée n’est pas seulement un problème d’efficacité ; c’est un problème de souveraineté. Un appareil d’État incapable d’anticiper, de planifier et d’exécuter devient structurellement dépendant de l’expertise et des solutions venues d’ailleurs.
Tout cela renvoie au sens de l’État : cette compréhension que les institutions sont plus importantes que les individus, que le long terme prime sur l’avantage immédiat, que gouverner signifie préserver un bien commun et non exploiter une opportunité.
C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre le débat actuel autour de la souveraineté en Haïti, notamment face aux pressions américaines concernant la fin de mandat du CPT. Il est légitime de défendre l’indépendance nationale. Mais il est tout aussi nécessaire de reconnaître que la souveraineté réelle ne se résume pas à résister aux pressions extérieures : elle se construit par la solidité des institutions internes.
Il faut le dire avec clarté : certaines prises de position récentes des autorités américaines relèvent effectivement de l'ingérence. Lorsqu’un État étranger se prononce publiquement sur le calendrier politique interne d’un autre pays, cela touche inévitablement à la sensibilité souveraine. L’histoire d’Haïti rend cette vigilance non seulement compréhensible, mais légitime.
Mais reconnaître l’ingérence ne transforme pas automatiquement ceux qui s’en indignent en défenseurs authentiques de la souveraineté. Car il existe une différence entre défendre la souveraineté comme principe national et l’invoquer comme réflexe de survie politique. Lorsque des acteurs qui ont contribué à affaiblir les institutions, à banaliser la corruption, à neutraliser les mécanismes de contrôle et à vider l’État de sa substance ou tout simplement à faire fausse route par rapport à une feuille de route qui leur est confiée dans un contexte de crise spécifique se découvrent soudain une ardeur souverainiste au moment où leur pouvoir est menacé, le discours sonne creux.
En réalité, comme l’avait souligné Leslie F. Manigat, le pays a besoin de patriotes pour sortir de sa situation :
« Le pays ne sera pas sauvé tant que nous n’aurons pas au pouvoir une équipe d’hommes et de femmes compétents, intègres, avec le sens du bien commun, et patriotes. Il faut des patriotes, c’est-à-dire des gens capables de faire passer leur intérêt privé après l’intérêt national, car l’intérêt national est la loi suprême. Or, c’est à nous de promouvoir l’intérêt national. Ce n’est pas l’Américain qui va le faire pour nous. Ce n’est pas l’étranger qui va le faire pour nous. »
Cette exigence du patriotisme comme responsabilité d’État n’est pas nouvelle dans la tradition de la pensée intellectuelle et politique haïtienne. Joseph Anténor Firmin en avait posé les bases avec une lucidité remarquable et tout cela n’avait rien d’un nationalisme primaire, réactionnaire et opportuniste.
Ici la voix de Firmin se déploie dans toute sa force, sa vigueur, son ampleur, son amplitude. Firmin, nationaliste invétéré tout le long de sa propre « évolution doctrinale », et « le plus grand cerveau politique de toute l’histoire nationale », conserve en même temps et à juste titre une lucidité à toute épreuve dans les affaires des États à l’échelle interne et internationale.
« Homme, je puis disparaître, sans voir poindre à l’horizon national l’aurore d’un jour meilleur. Cependant, même après ma mort, il faudra de deux choses l’une : ou Haïti passe sous une domination étrangère, ou elle adopte résolument les principes au nom desquels j’ai toujours lutté et combattu. Car, au XXe siècle, et dans l’hémisphère occidental, aucun peuple ne peut vivre indéfiniment sous la tyrannie, dans l’injustice, l’ignorance et la misère. »
Firmin ne défendait pas un nationalisme de posture, mais un nationalisme de responsabilité. S’il avait prédit qu’aucun peuple au XXe siècle dans l’hémisphère occidental ne peut vivre dans la tyrannie, l’ignorance, la misère, cela est encore plus insupportable pour un peuple au XXIe siècle de vivre sous la tyrannie de la misère, de l’incompétence, du populisme, du byzantinisme, du défaitisme. L’ère de la transformation technologique, de l’intelligence artificielle, des NTIC. Il y a presque du Toffler dans ce Firmin au futurisme bien étoffé, dosé et pointu. La face cachée d’un autre visage du firminisme peut-être. Du firminisme 2.0. Comme quoi il y aurait plusieurs facettes dans chacun de ces visages.
Dans ce monde post-moderne auquel Haïti continue d’appartenir en dépit de son sous-développement ou de son backwardness, l’écosystème politique archaïque doit à un moment sauter par n’importe quelle façon pour donner place à un système plus en adéquation avec les besoins et exigences d’une société dont la modernisation ne peut plus être remise à demain.
Un gouvernement qui gouverne aux antipodes de la transparence, de la reddition de comptes, de la responsabilité et du mérite se place en contradiction directe avec la souveraineté qu’il invoque. En détruisant les institutions, en normalisant la corruption, en affaiblissant les mécanismes de contrôle, il ne défend pas la souveraineté : il en fragilise les fondements mêmes.
Dans ces conditions, ceux qui contribuent à fracturer l’État de l’intérieur deviennent, qu’ils le veuillent ou non, des agents de l’érosion de la souveraineté réelle. Lorsqu’ils invoquent la souveraineté, ce n’est plus comme un principe à construire, mais comme un instrument destiné à manipuler l’opinion et à soustraire leur gestion à l’examen critique.
En somme, de la gunboat diplomacy — la « diplomatie de la canonnière » — à l’ère de la prépondérance des puissances européennes dans les affaires internes d’Haïti, notamment allemandes, au point où le président Lysius Salomon se demandait déjà à la fin du 19e siècle: « Les petits pays ont-ils un avenir ? », en passant par le corollaire de Roosevelt à la doctrine de Monroe, incluant la diplomatie du dollar de William Howard Taft dont le président Sténio Vincent fit les frais, puis par l’occupation militaire de 1994 liée au retour d’Aristide à la faveur de l’Accord de Governors Island et la tutelle internationale qui s’ensuivit, jusqu’à la phase actuelle de la doctrine Donroe, la souveraineté d’Haïti a toujours été soumise à des pressions extérieures. Mais ces pressions ont presque toujours été aggravées, facilitées ou rendues possibles par des luttes intestines de pouvoir entre acteurs internes démagogues, davantage préoccupés par la conquête et la conservation du pouvoir que par la consolidation de l’État.
La souveraineté ne se sauve pas par le bruit des discours, mais par la rigueur des institutions. Elle ne se défend pas seulement contre l’extérieur, mais d’abord contre tout ce qui, à l’intérieur, détruit l’État. Un pays ne perd pas sa souveraineté le jour où un acteur extérieur décide d’appuyer trop fort. Il la perd quand ses propres dirigeants cessent d’en être les bâtisseurs.
Joseph W. Alliance