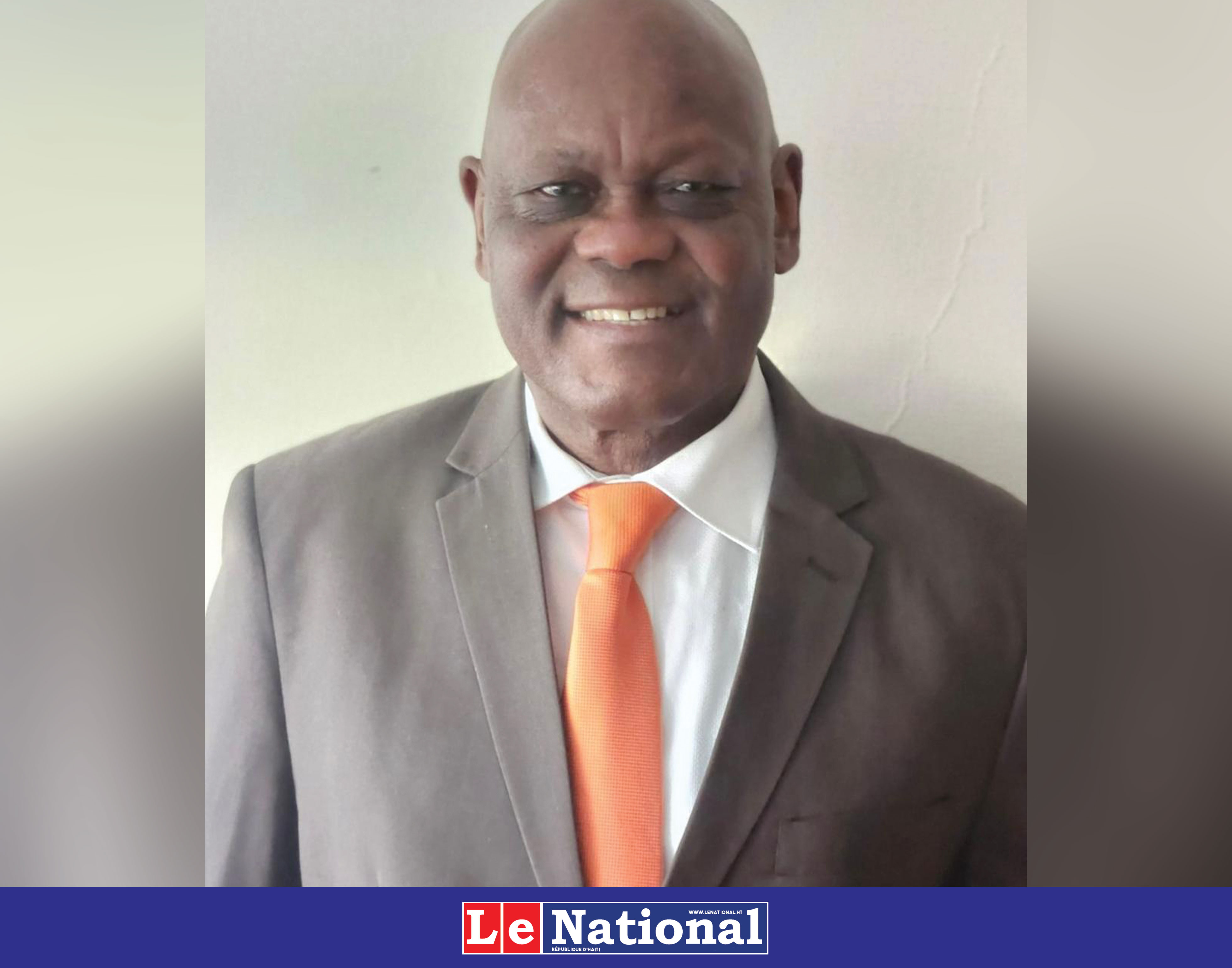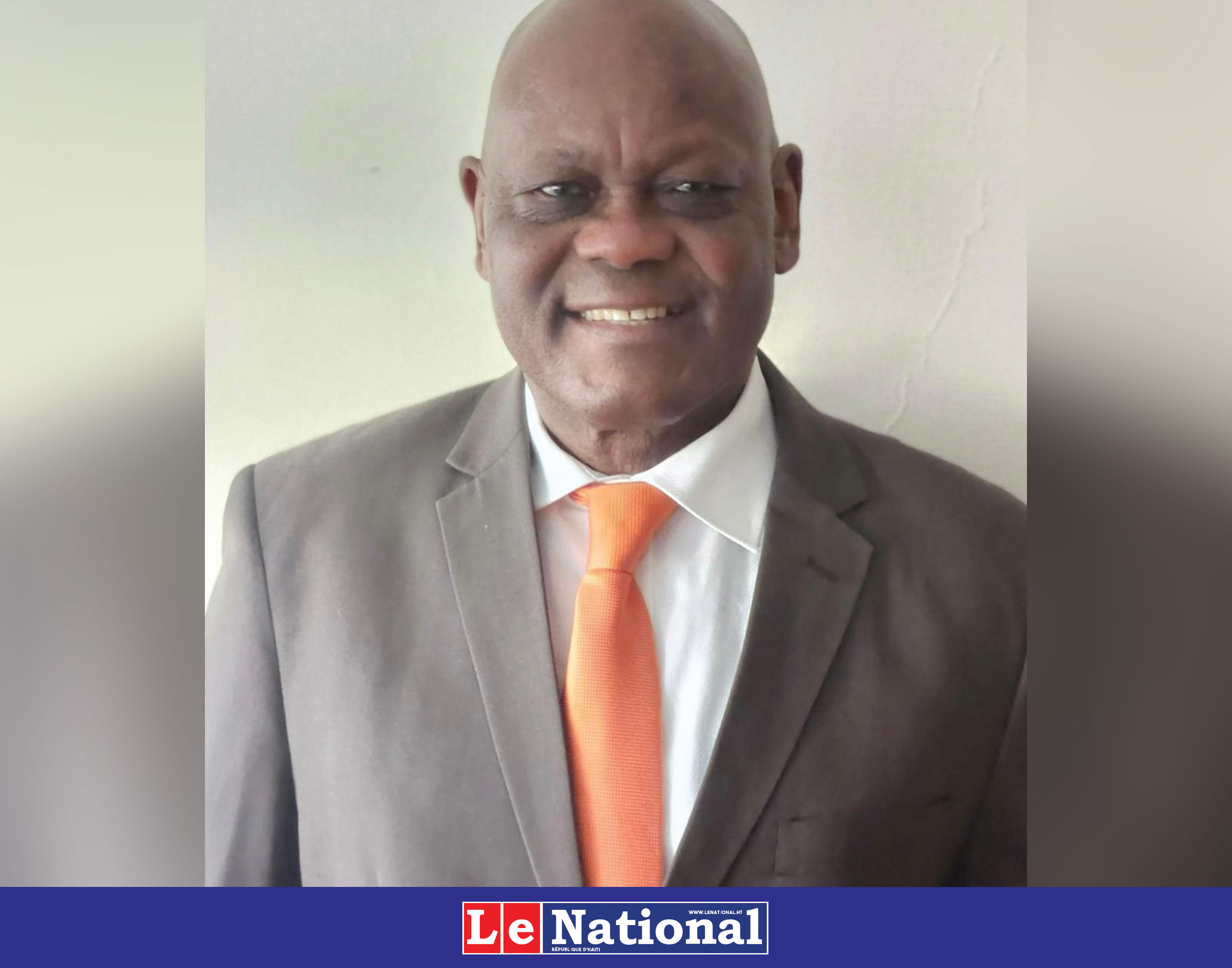Les prises illégales de propriétés constituent depuis toujours une préoccupation majeure pour les Haïtiens, en particulier pour les cultivateurs. Plus de deux siècles après l’Indépendance, l’État a encore du mal à apporter une réponse durable à ce problème.
« En Haïti, la vente se conclut souvent sans documents écrits, du vendeur à l’acheteur ; et, en cas de litige, la responsabilité est généralement imputée à l’acheteur plutôt qu’au vendeur », dit-on. Ce dicton montre la persistance d’une transaction foncière marquée par l’informalité, tout en mettant en évidence une logique dans laquelle l’absence d’actes écrits fragilise la position de l’acquéreur, tenu pour responsable de ne pas avoir exigé les garanties documentaires nécessaires.
Ce proverbe s’articule à une autre formule couramment mobilisée : « Gen papye k ap tann tè, epi gen tè k ap tann papye » (« il existe des papiers qui “attendent” des terres, et des terres qui “attendent” des papiers »). Cette expression souligne, d’une part, l’attribution différée — parfois arbitraire — de titres de propriété à des parcelles et, d’autre part, l’attente, chez certains occupants sans droit, d’une régularisation a posteriori par la production de documents fonciers. L’ensemble met en lumière les ambiguïtés du régime de preuve, la concurrence des légitimités (occupation, titres, reconnaissance locale) et les incertitudes structurelles qui entourent la sécurisation des droits de propriété.
Pourtant, l’article 36 de la Constitution dispose que : « L’expropriation privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites.» En réalité, au regard de l’histoire agraire du pays, la terre a toujours constitué un élément fondamental du tissu politique de l’État haïtien depuis l’assassinat de l’empereur Jean-Jacques Dessalines, père de la Nation.
L’irresponsabilité de l’État
La terre reste sacré pour le paysan, malgré ses multiples usages politiques par les responsables de l’État, qui cherchent à la régir uniquement par les législations positives, appuyées par des déclarations à caractère violent et démagogique, aggravant l’insécurité foncière. Ainsi, le 7 février 1997, dans un message officiel où la réforme agraire était présentée comme devant s’articuler entre la distribution des terres et la politique de l’État, le président René G. Préval a déclaré : « Tè se pouvwa, pouvwa se pèp la, pèp pran pouvwa » (« La terre constitue le pouvoir ; celui-ci appartient au peuple : qu’il prenne le pouvoir ! »).
Une telle déclaration ne rassure pas les propriétaires : elle revient, de facto, à encourager le peuple à envahir des propriétés privées, de manière désordonnée et sous des formes diverses. Elle est déjà ancrée dans l’esprit de nombreux activistes fonciers et contribue à la banalisation de pratiques anormales.
Cela a, en outre, favorisé l’essor de faux propriétaires, de faux mandataires et de bandits de toutes catégories, qui expulsent, sans droit ni qualité, les ayants droit et les véritables propriétaires de leurs terres. Certains se font passer pour des révolutionnaires afin de dissimuler des actes arbitraires portant sur des biens immobiliers privés et publics, sous les yeux des responsables. Ces brigands territoriaux n’ont rien de commun avec des leaders historiques qui ont, par le passé, provoqué des épisodes de dépossession violente sous l’autorité de chefs de file identifiés, tels que Moïse et Goman.
On ne peut résoudre un problème en s’appuyant sur des pratiques déjà profondément ancrées dans la société. C’est le cas de l’usage illégal et frauduleux de biens privés et de biens publics de l’État, alors même que des alternatives existaient, notamment grâce aux ressources financières et aux dons mobilisés après le séisme du 12 janvier 2010.
Après la catastrophe, la gestion de l’urgence s’est surtout traduite par l’installation d’abris dits provisoires, sans véritable politique d’accompagnement ni solution durable pour des victimes livrées à elles-mêmes. Dans ce contexte, l’anarchie s’est installée jusqu’à favoriser l’émergence d’un « État dans l’État ». Le phénomène de « Canaan », sur la route nationale No 1 — devenu un foyer de banditisme — illustre cette défaillance de l’État et l’apparition de nouveaux acteurs dans les conflits fonciers.
La nature a horreur du vide ; mais lorsqu’il s’agit d’un peuple livré à lui-même, ce vide est rapidement comblé par des structures que celui-ci estime capables d’assurer sa survie. Partout dans le pays, des sinistrés ont, avec la complicité de responsables « irresponsables », occupé illégalement les terres d’autrui, aggravant ainsi les conflits fonciers et rendant, dans le même temps, plus complexes les réponses à y apporter. Cette forme d’expropriation de fait, opérée avec la complaisance de certaines institutions, n’a rien à voir avec l’expropriation légalement reconnue par l’article 36.1, qui dispose : « L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation, ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et préalable indemnité, à dire d’expert. »
Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est annulée et l’immeuble, ne pouvant faire l’objet d’aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans qu’il y ait lieu à remboursement au détriment du petit propriétaire. La mesure d’expropriation devient effective à partir de la mise en œuvre du projet.
Ce que disent nos différentes constitutions
La politique agraire influence directement les conflits fonciers : la répartition des terres entre paysans, selon qu’elle privilégie grandes ou petites propriétés, crée des tensions, et le morcellement peut même multiplier les titres issus de grandes propriétés déjà conflictuelles. Ici, nous nous concentrons sur les conflits de titres liés à l’insécurité foncière et analyse les principales réponses constitutionnelles apportées par le législateur.
Dans l’ensemble, les dispositions constitutionnelles de 1935, 1946, 1950, 1957, 1964 et 1971 s’orientent vers une transformation de la société agricole.
Ainsi, la Constitution de 1935, tirant les leçons des expériences antérieures, a imposé pour la première fois, dans l’histoire de la charte fondamentale, une obligation au propriétaire foncier : mettre la terre en valeur. Cette exigence revêt la forme d’une véritable fonction sociale dont le non-respect doit être sanctionné par la loi, ce qui pouvait également contribuer à mieux identifier les acteurs réels des conflits.
La Constitution de 1946, en son article 17, a maintenu le libellé de l’article 7 de la Constitution de 1935, tout en y ajoutant le devoir de « protéger le sol, notamment contre l’érosion ». Elle restreint également le droit de propriété, lequel « ne s’étend pas aux sources, rivières et autres cours d’eau qui font partie du domaine public de l’État ». Elle prévoit en outre la limitation de la « hauteur maxima du droit de propriété ».
L’innovation la plus remarquée de cette Constitution réside dans la création des « tribunaux terriens », dont « le nombre, la localisation et le fonctionnement sont fixés par la loi » (article 103).
La Constitution de 1950 a précisé, en son article 103, la mission et la compétence de ces tribunaux terriens. Elle a aussi été la première à consacrer l’organisation de la « section rurale » afin « d’améliorer les conditions de vie dans les campagnes, d’assurer la protection du paysan et la productivité de son travail » (article 124). S’y ajoutent des prescriptions relatives à l’éducation et à la santé rurales, ainsi qu’à l’organisation du « petit crédit agricole et artisanal ».
Les constitutions ultérieures — notamment celles de 1957, 1964 et 1971 — s’inscrivent dans cette continuité en affichant, elles aussi, l’ambition d’encadrer la propriété foncière et de réorganiser l’espace rural. Toutefois, les réformes annoncées se sont souvent heurtées aux difficultés de mise en œuvre et à l’absence d’évaluation systématique.
En effet, l’absence de suivi — notamment sous la forme de rapports-bilans — n’a pas permis au législateur d’apprécier l’efficacité réelle des mesures adoptées, ni d’adapter l’action publique pour traiter, dans les autres départements du pays, des conflits de même nature, parfois avec des variations seulement marginales.
Échec des lois en matière de conflits terriens
En toile de fond, le problème met aux prises plusieurs acteurs principaux : l’État, les paysans et les citadins. Parmi ces acteurs, l’État, à travers ses institutions, se situe au sommet de la pyramide décisionnelle en matière de politique foncière, ce qui paraît tout à fait normal. C’est ainsi que, par diverses révisions et ajustements, les constitutions ont progressivement précisé le droit de propriété, notamment quant à son étendue et à ses limites.
On y retrouve notamment les axes majeurs du contrôle de la répartition et de l’appropriation de la terre : la recherche (souvent affirmée) d’une distribution plus équitable de la richesse nationale, la limitation des grandes superficies, l’établissement d’un cadastre national, l’impôt foncier, le remembrement, ainsi que l’importance d’un plan directeur d’aménagement du territoire.
Cependant, ces orientations ne peuvent produire d’effets durables sans tenir compte des conflits opposant, d’une part, les paysans — souvent engagés dans des pratiques culturales jugées irrationnelles par l’administration — et, d’autre part, des citadins imprégnés d’une culture juridique d’inspiration occidentale (ou occidentalisée). Or, la conception occidentale du droit ne recouvre pas entièrement, en Haïti, les représentations du droit traditionnel, encore largement pratiqué par une majorité de paysans fortement attachés à la terre. Dans cette perspective ancestrale, la terre demeure « sienne » même en l’absence de titre formel, parce qu’elle est perçue comme l’héritage des ancêtres. On comprend alors que, pour un motif parfois jugé mineur, certains puissent recourir à la force — par exemple brandir la machette — face aux dispositions du Code civil que d’autres, surtout en milieu urbain, invoquent et appliquent strictement.
Il existe donc, à la base du régime foncier haïtien, une contradiction structurelle entre la norme juridique formelle et le corps social qu’elle est censée régir. Ce décalage alimente des tensions qui s’apparentent à un conflit de classes, où l’appartenance sociale, politique et économique du législateur contraste fortement avec celle des masses rurales, souvent maintenues à la marge des mécanismes de décision.
Une analyse objective montre que les amendements relatifs au droit de propriété — y compris les mesures touchant l’agriculture — produisent rarement des effets concrets. Pire, il arrive que certaines réponses destinées à réduire les conflits en génèrent de nouveaux, ce qui contribue, au fil du temps, à aggraver la problématique foncière.
Au lieu d’affronter le fond du problème — notamment la fracture entre citadins et paysans — le législateur se contente parfois d’adopter des lois d’exception visant à contenir les tensions dans une région donnée, présentée comme un projet pilote. À titre d’exemple, on peut citer le décret pris en juillet 1975 pour la région de l’Artibonite, censé servir de référence pour aborder les tensions et les conflits fonciers.
Un rapport particulier à la terre
Il existe, au cœur de la personnalité haïtienne, un rapport particulier à la terre. Celle-ci constitue une dimension essentielle de la vie sociale : il y a, en quelque sorte, un « esprit de la terre », tout comme subsiste l’élan héroïque de préserver l’image d’un grand peuple, forgée par l’événement fondateur de 1804.
Nous sommes ainsi confrontés à un mode de pensée « à l’haïtienne » dans lequel se cristallise le désir d’être propriétaire. Si l’attachement à la patrie semble parfois s’effriter dans le champ des consciences, la volonté d’être — ou de devenir — propriétaire, elle, demeure constante et stable.
Or, l’accès à la propriété dans un cadre légal, conforme aux prescriptions du droit, favorise la participation de tous les citoyens à la cohésion sociale. À cet égard, la responsabilité première incombe à l’État, qui, sur le plan politique, est devenu, après l’indépendance, l’un des principaux détenteurs des grandes plantations laissées par les colons.
Après l’assassinat de l’empereur Jean-Jacques Dessalines, et l’échec de la mise en œuvre d’un projet durable de justice sociale, plusieurs constitutions haïtiennes se sont distinguées par des innovations destinées à apporter des réponses aux problématiques foncières. Toutefois, la Constitution de 1987, dans le cadre de la réforme agraire, semble avoir abordé la question avec une acuité particulière. Elle est l’une des premières, dans l’histoire constitutionnelle haïtienne, à prévoir la création d’une institution chargée d’assurer, conformément à la loi, l’organisation et le suivi du processus agraire.
Cependant, comme souvent, les causes sociales, politiques et économiques du conflit foncier ressurgissent là où les acteurs les attendent le moins, notamment autour de la question des titres de propriété et de la sécurité juridique. Ces difficultés, héritées de la période postindépendance, méritent d’être traitées de manière prioritaire, avant la mise en œuvre de dispositions et de projets visant le développement d’Haïti.
Dr. Emmanuel Charles
Juriste et constitutionnaliste