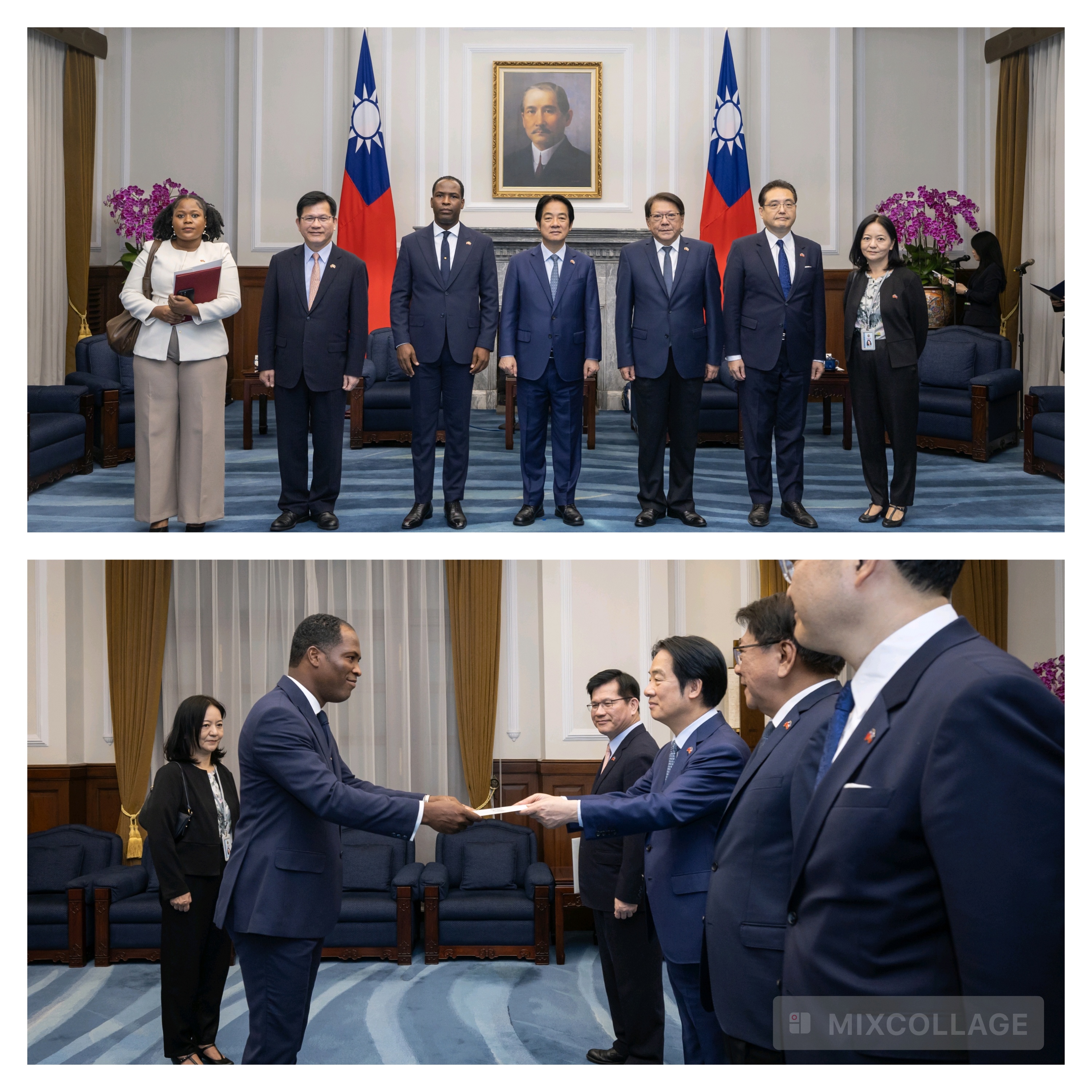(Article II)
NB: Cet article a été rédigé dans le but de donner une vision plus claire de l’article 2 de l’avant-projet de Constitution de Juin 2025 proposée par l’Assemblée nationale de la jeunesse. Cliquez ici pour voir l’avant-projet : https://www.assembleenationaledelajeunesse.com/nos-travaux/2520032_proposition-par-l-anj-d-avant-projet-de-constitution-de-la-republique-d-hayti-2025
Hayti est pays unique avec un environnement particulier, le paysage du pays est en grande partie constitué de montagnes, ce qui a favorisé pendant un mong temps une division territoriale claire et efficace. Cependant en considérant l'évolution et les changements operés dans l'organisation territoriale d'Hayti il est à noter qu'avec le temps l'administration territoriale du pays a considérablement changé. Pour mieux comprendre ces changements il faut remonter à la première division territoriale connu d'Hayti, la période des taïnos, arawaks et caraïbes.
Historicité
Période taïnos (avant 1492)
Depuis le temps des taïnos, la première division territoriale de l'ile d'Ayti était repartie sur cinq grands royaumes fédérés sans un un réel pouvoir central, ces caciquats étaient Marien (Nord-Ouest), Maguana (Centre), Maguá (Nord-Est), Jaragua (Sud-Ouest), Higuey (Est, principalement côté dominicain aujourd’hui). Cette division territoriale favorisait un développement local axé sur l'exploitation et la gestion des ressources locales, par exemple dans le Caciquat du Xaragua tous les ressources xaraguéens était exploité pour la population xaraguéenne; ce fut de même pour les autres caciquats.
Période coloniale espagnole (1492 – 1697)
Avec l’arrivée de Christophe Colomb en 1492, l’Espagne prend possession de l’île qu’elle nomme Hispaniola. Elle implante des encomiendas, principalement dans la partie est de l’île. La partie ouest, future Haïti, reste peu structurée sur le plan administratif durant cette période (Trouillot, 1990).
Période coloniale française (1697 – 1801)
Le traité de Ryswick (1697) marque le transfert officiel de la partie ouest de l’île à la France, qui la nomme Saint-Domingue. La colonie est divisée en trois provinces : le Nord, l’Ouest et le Sud, correspondant aux principales zones d’activités sucrières et caféières (Léger, 1907).
Révolution et fusion de l’Est (1801‑1804)
Louverture, dès 1801, intègre la haute vallée de l’Artibonite, le Cibao et Azua dans les départements haïtiens, créant de fait une emprise à l’Est (Théodat, p. 297‑309).
Révolution et fusion de l’Est (1804‑1807)
Dessalines, en 1805, transforme ces structures en 6 Divisions militaires(Art 15, Constitution 1805), intégrant davantage l’Est mais provoquant des résistances civiles à Santiago et Moca (Théodat, p. 300‑305).
Scission Nord–Sud (1807‑1820)
Après la mort de Dessalines, deux États coexistent : Le Royaume du Nord (Christophe) avec deux départements (Nord, Artibonite); la République du Sud (Pétion) avec deux départements (Ouest, Sud). L’Est contient plusieurs partidos municipaux, conservant son identité locale distincte (Théodat, p. 307‑308).
Unification sous Boyer (1822‑1844)
Boyer unit l’île, mais les structures haïtiennes sont imposées à l’Est via les départements d’Ozama et du Cibao, sans abroger les anciennes limites (Théodat, p. 308‑309). La résistance dominicaine s’organise notamment autour de la défense de la culture régionale et du refus du travail forcé (Théodat, p. 309).
Indépendance dominicaine et réforme territoriale (1844‑1859)
En 1844, la République dominicaine s’affirme, revenant aux divisions antérieures, et rejetant l’assimilation haïtienne (Théodat, p. 310‑312). Haïti adopte au milieu du XIXe siècle une structure reposant sur trois grandes régions (Nord, Sud, Ouest) polarisées par des métropoles régionales (Théodat, p. 314).
Quant à la République dominicaine, elle sera composée de cinq 5 provinces( Art 4, Constitution de 1844 de la RD): la région Compostela de Azua, la région de Santo Domingo, la region de Santa Cruz del Seibo, la region de Concepción de la Vega et la région de Santiago de los Caballeros.
XXe siècle et époque contemporaine
L'epoque contemporaine d'Hayti est marquée par une division plus marquée du territoire. Sous Duvalier vers les années 1962, Haïti passe de 5 à 9 départements (Smith, 2009).
En 2003, le president Aristide créé le département des Nippes, portant le total à 10 départements (Décret 12 sept. 2003). Aujourd’hui Hayti compte 10 départements, 42 arrondissements, 145 communes, 571 sections communales (IHSI, 2009).
Que faut-il comprendre de la division territoriale d'Hayti de 1492 à nos jours?
De 1492 à 2025, Haïti a connu de nombreuses transformations de ses divisions territoriales. Depuis la scission avec la République dominicaine, le territoire haïtien s’est réduit de plus de la moitié, tandis que le nombre de divisions territoriales a considérablement augmenté. En 1492, pour une superficie d’environ 76 480 km², l’île comptait cinq caciquats, équivalents à nos départements actuels ou aux régions dominicaines. En 1805, Haïti possédait presque la même superficie, répartie cette fois en six grandes divisions militaires. Aujourd’hui, avec seulement 27 750 km², le pays est divisé en dix départements. Ce qui veut dire que de 1492 à 2025 Hayti a connu un morcellement excessif de son territoire.
Inefficacité de l’organisation territoriale actuelle
En Haiti quand on parle de decentralisation, on a souvent tendance a l'assimiler au decoupage excessif du territoire. Dans le projet de decentralisation des emis depuis 1987 les dirgeants ont multiplies le nombre de communes du pays dans le but de rendre le pouvoir plus proche de la population; c'est de meme pour l'avant-projet de mai 2025 qui propose environ 725 communes pour seulement 27750km2. Cette multiplication des unités territoriales, malgré une réduction drastique du territoire, entraîne une diminution significative des ressources disponibles pour chaque division. Vincent (2025) souligne que dans un système centralisé, les petites unités territoriales peinent à mobiliser des ressources suffisantes, ce qui affaiblit leur capacité de développement local . De plus, Deshommes (s.d.) évoque la concentration excessive des services publics à Port‑au‑Prince, qui prive les communes de moyens humains et financiers, accentuant les disparités régionales .
En termes de gouvernance, Oriol et ses collègues (1994) notent que la Constitution de 1987 a instauré des structures décentralisées, sections communales, communes, départements mais ces mécanismes restent largement inopérants faute de ressources et de volonté politique. Tout cela implique un blocage dans le développement local et freine la décentralisation, car les collectivités manquent à la fois de moyens financiers et d’autonomie réelle. À l’échelle locale, cette situation limite l’accès aux services publics, empêche les décisions adaptées au territoire, et renforce la centralisation déficiente de l’État haïtien.
Pour que l'administration soit efficace et pour que la decentralisation soit effective, il faudrait prealablement transferer certains des pouvoirs centraux au pouvoirs locaux, des pouvoirs comme la gestion du budget local ou la construction et les infracstructures locaux. Il faudrait donc une decentralisation au sens stricte du terme, pas une decentralisation-decontration qui conserve des capacites importantes au sein du pouvoir central. Il faut plutot une decentralisation qui devolue des porvoirs necessaires axe sur l'autonomie.
Comparaison entre le découpage territorial en Haiti avec ceux d'autres pays semblables en superficie et régions.
Un des facteurs clé du sous-développement haïtien réside dans l’inefficacité de sa stratégie de décentralisation, tant sur les plans administratif, politique, fiscal, judiciaire que territorial. Le pays est actuellement divisé en dix départements pour une superficie de seulement 27 750 km². Ce morcellement excessif ne semble pas justifié si l’on observe la situation d’autres États de taille comparable.
Par exemple, la Suisse, avec une superficie de 41 285 km² (soit 1,48 fois celle d’Haïti), ne compte que 7 régions, ce qui représente un ratio de 5 898 km² par unité territoriale. La République dominicaine, notre voisine directe, dispose de 4 grandes régions pour un territoire de 48 442 km², presque le double du nôtre, soit 12 110 km² par région. Ces pays ont donc fait le choix d’unités territoriales plus larges et plus cohérentes, facilitant la coordination des politiques publiques.
Même en élargissant la comparaison, le découpage haïtien apparaît disproportionné. La France, par exemple, avec ses 96 départements pour 551 500 km², compte un département pour environ 5 744 km². À ce rythme, Haïti, avec 27 750 km², devrait théoriquement avoir 5 départements au lieu de 10. Autrement dit, le pays possède en moyenne deux fois plus de départements que la France au prorata de la superficie.
En se référant à d’autres États de superficie similaire, cette anomalie devient encore plus visible. Le Rwanda (26 338 km²) est divisé en 5 provinces, soit un ratio de 5 267 km² par province. La Belgique (30 689 km²) est divisée en 10 régions, soit 3 068 km² par unité, et les Pays-Bas (41 543 km²) en 12, avec 3 462 km² par région. Ces pays ont misé sur une structure administrative compacte, propice à une meilleure gouvernance, un contrôle plus efficace des ressources et une administration publique plus performante.
En comparaison, Haïti affiche une moyenne de 2 775 km² par département, ce qui fait de son découpage administratif un des plus fragmentés au monde pour sa superficie. Ce morcellement territorial fragmente l’autorité centrale, disperse les ressources, alourdit la bureaucratie, et rend difficile l’exécution des politiques publiques. Ainsi, la multiplication des entités administratives dans un espace aussi restreint limite l’efficacité de l’action publique et empêche l’émergence de pôles régionaux solides, indispensables à un développement territorial équilibré.
Risques d’un morcellement excessif
L’un des problèmes fondamentaux de l’organisation territoriale actuelle d’Haïti réside dans le morcellement excessif du territoire national. Si, à première vue, multiplier les divisions administratives peut sembler rapprocher l’État des citoyens, dans la pratique, cela aboutit souvent à une fragmentation des ressources, une inefficacité institutionnelle et une surcharge bureaucratique. Des études menées par Jean-Paul Faguet (2012) et Jonathan Rodden (2004) démontrent que lorsqu’un État multiplie les subdivisions sans renforcer leur autonomie ni assurer une redistribution équitable des ressources, il affaiblit la capacité de gouvernance à tous les niveaux. Le budget national, déjà limité, est dilué entre des centaines de collectivités territoriales qui peinent à fonctionner de manière autonome. En conséquence, les petites unités administratives sont souvent incapables de financer des infrastructures, de mobiliser des ressources humaines qualifiées ou de planifier un développement local cohérent. D’autres recherches menées par Treisman (2000) et Gennaioli & Voth (2015) mettent également en lumière les effets pervers d’un tel morcellement : une corruption locale exacerbée par le manque de supervision, la redondance administrative et une absence de responsabilité claire. En Haïti, cette situation empire du fait que la centralisation du pouvoir demeure forte, alors que les collectivités locales n’ont ni autonomie réelle, ni ressources suffisantes pour jouer leur rôle. Autrement dit, une multiplication des communes ou des départements sans un transfert réel de pouvoir n’est pas synonyme de décentralisation, mais d’éclatement institutionnel.
Problèmes géographiques et symboliques liés au découpage actuel
En plus des obstacles politiques et institutionnels, Haïti fait face à une série de contraintes géographiques majeures que le découpage territorial actuel ignore complètement. Environ 75 % de la superficie nationale est composée de chaînes de montagnes, rendant difficile la communication, le transport de marchandises, l’accès aux services de base et la mise en œuvre d’une politique territoriale équitable (UNEP, 2023). Le découpage administratif ne tient pas compte de ces réalités physiques et divise souvent des zones enclavées qui devraient être pensées comme des blocs homogènes.
Par ailleurs, un autre aspect souvent négligé concerne les noms attribués aux départements et communes. La toponymie actuelle est non seulement confuse mais parfois contre-productive. Comme le souligne Jacques de Cauna (2022), les noms tels que « Centre », « Ouest » ou « Sud » ne correspondent pas à leur position géographique réelle. D’autres noms comme « Nippes », qui signifie littéralement “vêtements usés” (Larousse), ou « Grande Anse », un oxymore géographique (“grande petite baie”), n’inspirent ni fierté ni modernité. Même Port-au-Prince, capitale du pays, tire son nom d’un navire colonial, ce qui renforce un sentiment d’aliénation et de continuité avec un passé colonial douloureux. Cette incohérence dans la nomenclature territoriale participe à une perte d’identité nationale forte et complique l’appropriation populaire de l’administration locale. Pour qu’un territoire soit fonctionnel, il faut qu’il soit lisible géographiquement, cohérent structurellement et porteur de symboles positifs, ce qui est loin d’être le cas actuellement.
Pourquoi Hayti a besoin d'une nouvelle organisation territoriale ?
Depuis près d'un siècle Haïti fait face à une centralisation excessive du pouvoir autour de sa capitale Port-au-Prince. Cette concentration des fonctions politiques, économiques et administratives dans la capitale nuit radicalement au développement équilibré du territoire et en même temps aggrave les inégalités régionales. De plus, elle limite l’accès aux services essentiels pour les populations vivant dans les zones reculées.
Aujourd’hui, plus que jamais, la crise multidimensionnelle d'Hayti nous prouve que le pays a besoin d’une véritable décentralisation; non pas en théorie comme dans la Constitution de 1987 ou le décret inconstitutionnel de 2006 sur la decentralisation mais en pratique.
Un modèle centralisé aux effets pervers
Depuis son indépendance, et plus encore sous l’occupation américaine de 1915 à 1934, Haïti s’est structurée autour d’un pouvoir central fort, concentré à Port-au-Prince. Ce modèle hyper-centralisé, hérité à la fois du régime colonial, des logiques post-indépendance de contrôle du pouvoir et de l’ingérence étasunienne, a progressivement éloigné l’État des besoins réels de la population, notamment en province.
L’occupation américaine a joué un rôle déterminant dans l’ancrage de cette centralisation. En imposant une nouvelle Constitution en 1918, en démantelant les structures locales autonomes et en plaçant le pays sous une tutelle administrative dirigée depuis la capitale, les autorités américaines ont verrouillé l’ensemble des fonctions décisionnelles à Port-au-Prince. Comme l’explique l’historien Matthew J. Smith, « L’objectif de l’administration américaine était de rationaliser et de contrôler l’État haïtien depuis la capitale, en s’assurant que toutes les décisions passent par un pouvoir central fort et étroitement surveillé » (Liberty, Fraternity, Exile, 2009).
Le géographe haïtien Georges Anglade parlait quant à lui de « monocéphalie administrative », une forme de gouvernance où toute l’autorité converge vers un seul centre, laissant les régions périphériques marginalisées, sous-administrées et dépourvues d’autonomie réelle. Cette organisation a figé le développement national dans un schéma de dépendance vis-à-vis de la capitale, où même les questions les plus locales doivent attendre des décisions prises à plusieurs centaines de kilomètres.
Les réformes entreprises après l’adoption de la Constitution de 1987 ont misé sur la déconcentration administrative. Des antennes ministérielles ont été installées en province, censées rapprocher les services publics des citoyens. Mais en l’absence de transfert réel de compétences, de ressources humaines et de budgets, ces structures se sont révélées largement inefficaces. Elles n’ont pas inversé la logique centralisatrice, mais l’ont simplement maquillée.
L’Institut Haïtien de Décentralisation l’a bien résumé en 2015 : « La déconcentration est un outil technique, mais seule la décentralisation politique permet un changement structurel durable. » Tant que les collectivités locales ne disposeront pas de vrais pouvoirs de décision, de financement, de planification et de gestion, toute tentative de rééquilibrage territorial restera lettre morte.
La decentralisation du pays est loin d’être une simple question technique, la centralisation est aujourd’hui un frein au développement, à la gouvernance démocratique et à la stabilité du pays. Elle maintient les régions dans un état de dépendance et de frustration, alimente l’exode rural vers une capitale déjà saturée, et fragilise le tissu social. Repenser l’organisation territoriale d’Haïti n’est donc pas une option, mais une urgence nationale.
La nécessité d’une décentralisation effective
Haïti doit s’engager dans une réforme profonde de son organisation territoriale, fondée sur des collectivités locales fortes, autonomes et responsables. Chaque grande collectivité territoriale – département, commune, ou une nouvelle division administrative – doit disposer de structures de gouvernance capables de gérer les affaires publiques locales avec des moyens réels.
Selon un rapport de la Banque mondiale (2021), “la décentralisation effective améliore la prestation des services publics, renforce la participation citoyenne et favorise le développement local, à condition qu’elle s’accompagne de ressources financières adéquates et d’une clarification des responsabilités institutionnelles”.
Pour cela, Haïti doit :
- Transférer des compétences réelles aux collectivités locales (infrastructures, éducation, développement économique, etc.) ;
- Garantir l’autonomie budgétaire des territoires, avec des recettes propres et une part équitable du budget national ;
- Renforcer la capacité des autorités locales à planifier, exécuter et évaluer des politiques publiques pertinentes.
Une réorganisation territoriale profonde et cohérente permettrait :
- Un développement plus équilibré entre les régions, en réduisant les inégalités d’accès aux services ;
- Une meilleure gouvernance, en rapprochant les décisions publiques des citoyens concernés ;
- Une réduction des tensions sociales, grâce à une participation plus active des communautés dans la gestion de leurs affaires ;
- Une résilience accrue de l’État, en répartissant les responsabilités au lieu de les concentrer dans un seul pôle vulnérable.
Comme le notait James Morrell (2007), “la décentralisation ne garantit pas à elle seule la démocratie, mais elle en est un pilier fondamental, car elle permet la construction d’institutions locales, ancrées dans la réalité des citoyens”.
Haïti ne pourra se reconstruire sans revoir son architecture territoriale. La simple déconcentration ne suffit pas. Il faut opérer une rupture nette avec le centralisme hérité du passé, pour instaurer une décentralisation effective – financière, politique et institutionnelle. C’est à ce prix que les régions pourront enfin jouer un rôle moteur dans la transformation du pays. La refondation d’Haïti passe par un rééquilibrage du pouvoir sur tout le territoire, pour que chaque citoyen, où qu’il se trouve, ait accès à un État proche, fonctionnel et responsable.
Avantages du modèle territorial proposé par l'assemblée nationale de la jeunesse
La refondation du territoire national haïtien apparaît aujourd’hui comme une nécessité vitale, non seulement pour corriger les erreurs historiques du découpage administratif hérité de la période coloniale, mais aussi pour répondre efficacement aux défis économiques, sociaux, environnementaux, identitaires et géostratégiques auxquels le pays est confronté. Consciente de cette urgence, l’Assemblée Nationale de la Jeunesse (ANJ) a élaboré dans son avant-projet de Constitution une proposition de réorganisation territoriale fondée sur la rationalité, l’efficience, l’équité et la souveraineté populaire, telle que décrite à l’article II du texte.
Ce modèle innovant repose sur trois principes fondamentaux : l’efficacité administrative, la lisibilité institutionnelle et l’enracinement culturel. Il prévoit que le territoire national soit restructuré autour de trois grandes régions historiques Marien (Nord), Maguana (Centre) et Xaragua (Sud) – en hommage aux anciens royaumes Taïnos, premières civilisations de l’île. Chacune de ces régions serait subdivisée en 5 provinces, soit 15 provinces au total, elles-mêmes divisées en environ 80 communes répondant à des critères objectifs de viabilité : superficie minimale de 300 km², présence d’une plaine agricole ou urbaine, et une population d’au moins 50 000 habitants. Cette approche permet d’assurer un meilleur équilibre territorial et d’éviter les dérives clientélistes ou électoralistes souvent liées à la création abusive de nouvelles communes.
L’un des atouts majeurs de cette réforme réside dans sa capacité à défragmenter l’espace administratif haïtien, aujourd’hui morcelé de manière inefficace. En créant des entités administratives plus vastes et mieux outillées, la proposition vise à regrouper les ressources humaines, matérielles et financières, facilitant ainsi la mise en œuvre de véritables pôles de développement régionaux. Chaque commune disposerait de départements municipaux spécialisés dans les domaines essentiels : infrastructures, santé publique, éducation, environnement, sécurité civile, culture, développement économique, etc. Ces départements seraient dirigés par des techniciens et experts sectoriels, permettant une gestion professionnelle et dépolitisée des politiques locales. Le maire jouerait un rôle de coordination, d’orientation et de supervision, tout en étant épaulé par un bureau de conseillers et de consultants, mais ne serait plus surchargé de responsabilités techniques pour lesquelles il n’a ni la formation ni les outils.
Le projet met également l’accent sur une autonomie renforcée des collectivités territoriales. Celles-ci seraient reconnues comme personnes morales de droit public, dotées de compétences propres, notamment en matière de développement local, fiscalité locale, planification, sécurité civile de proximité, gestion des ressources naturelles, et promotion de la culture. L’État central n’exercerait qu’un contrôle de légalité, respectant le principe de subsidiarité, tout en accompagnant les collectivités par des mécanismes de soutien technique et financier. Un Conseil National de Décentralisation serait institué pour garantir une coordination efficace entre le centre et les territoires, assurant ainsi une véritable gouvernance partagée et non plus centralisée.
D’un point de vue économique, cette restructuration territoriale est également porteuse de transformation. Elle permettrait de réduire les coûts de fonctionnement de l’appareil administratif, de diminuer la redondance bureaucratique, et de favoriser l’émergence de villes autosuffisantes capables de générer leurs propres recettes locales, de planifier leur développement et d’attirer des investissements. En parallèle, la création de grandes agglomérations structurées donnerait lieu à une dynamique de croissance inclusive, notamment dans des zones aujourd’hui enclavées ou marginalisées.
Sur le plan symbolique et culturel, le projet de l’ANJ propose une refondation identitaire du territoire à travers un travail réfléchi de renommage des régions et des entités locales, inspiré de l’histoire précoloniale d’Haïti. En remplaçant les noms sans signification ou liés au passé colonial (comme « Nippes » ou « Ouest ») par des noms autochtones porteurs de mémoire et de fierté, le projet contribue à réconcilier la nation haïtienne avec son passé glorieux et ses racines. Cela permettrait de restaurer le sentiment d’appartenance des citoyens à leurs territoires et de réinsuffler une nouvelle cohésion nationale autour d’un imaginaire territorial refondé.
Enfin, comparée au projet irréaliste de 725 communes proposé par le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale, la vision de l’ANJ se distingue par sa praticabilité, sa rigueur méthodologique et sa compatibilité avec les meilleures pratiques internationales. Elle établit un cadre territorial moderne, cohérent, respectueux des réalités haïtiennes, et capable d’accompagner durablement la transition vers un État plus équitable, plus proche de ses citoyens et mieux préparé aux défis du XXIe siècle.
Références
- Casimir, J. (2001). La culture opprimée. Port‑au‑Prince : Éditions Henri Deschamps.
- Décret du 12 septembre 2003 portant création du département des Nippes.
- Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI). (2009). Répertoire des collectivités territoriales d’Haïti.
- Léger, J. N. (1907). Haïti : Son histoire et ses détracteurs. Washington D.C. : The Neale Publishing Company.
- Smith, M. J. (2009). Red & Black in Haiti: Radicalism, Conflict, and Political Change, 1934–1957. The University of North Carolina Press.
- Théodat, J.-M. (s.d.). 1804‑1859 Haïti‑République dominicaine : rémanences et promesses, p. 297‑309.
- Trouillot, M.-R. (1990). Haiti: State Against Nation. New York : Monthly Review Press.
- Vincent, A. (2025). Réflexion sur la gouvernance locale en Haïti : Défis et perspectives. Revue RHSSH, 2(1).
- Oriol, C., Anglade, G., Barthélemy, G. (1994). La mise en œuvre de la décentralisation en Haïti. Revue Autrepart, n° 1.
- Deshommes, F. Décentralisation et développement local en Haïti. Classiques UQAM.
- Faguet, J.-P. (2012). Decentralization and Popular Democracy: Governance from Below in Bolivia. Ann Arbor, MI : University of Michigan Press. https://doi.org/10.3998/mpub.175269
- Rodden, J. (2004). Comparative federalism and decentralization: On meaning and measurement. Comparative Politics, 36(4), 481–500. https://doi.org/10.2307/4150172
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: A cross-national study. Journal of Public Economics, 76(3), 399–457. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00092-4
- Gennaioli, N., & Voth, H.-J. (2015). State capacity and military conflict. The Review of Economic Studies, 82(4), 1409–1448. https://doi.org/10.1093/restud/rdv019
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2023). Haiti Elevation and Geography Map. Darmouth Flood Observatory. https://floodobservatory.colorado.edu/Version2/Hispaniola.html
- De Cauna, J. (2022). Les noms des lieux en Haïti : de la géographie à la mémoire historique. In Mémoires des lieux d’Haïti. Paris : OpenEdition Books. https://books.openedition.org/pur/42464
- Larousse. (n.d.). Anse [Définition]. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/anse/3771
- Larousse. (n.d.). Nippe [Définition]. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nippe/54846
- Ambassade de France en Haïti. (n.d.). Port-au-Prince : Mais quel prince ? https://ht.ambafrance.org/Port-au-Prince-Mais-quel-prince
- Larousse. (n.d.). Artibonite [Entrée encyclopédique]. https://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/Artibonite/106308
- Anglade, G. (2004). Éloge de la décentralisation. Montréal : CIDIHCA.
- Banque mondiale. (2021). Haiti: Gouvernance et renforcement de la capacité de l’État local. Washington, DC.
- Institut Haïtien de Décentralisation (IHD). (2015). La déconcentration versus la décentralisation : où en est Haïti ?
- Morrell, J. (2007). Decentralization and Democracy in Haiti. Haiti Democracy Project.
- République d’Haïti. (2006). Décret portant cadre général de la décentralisation, organisation et fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes. Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales.
- Assemblée Nationale de la Jeunesse. (2025, mai). Proposition par l’ANJ d’avant‑projet de Constitution de la République d’Haïti 2025. Assemblée Nationale de la Jeunesse.
Auteurs: Woldenskee Minviel, Kenny Thelusma.
Éditeur Godson Moulite