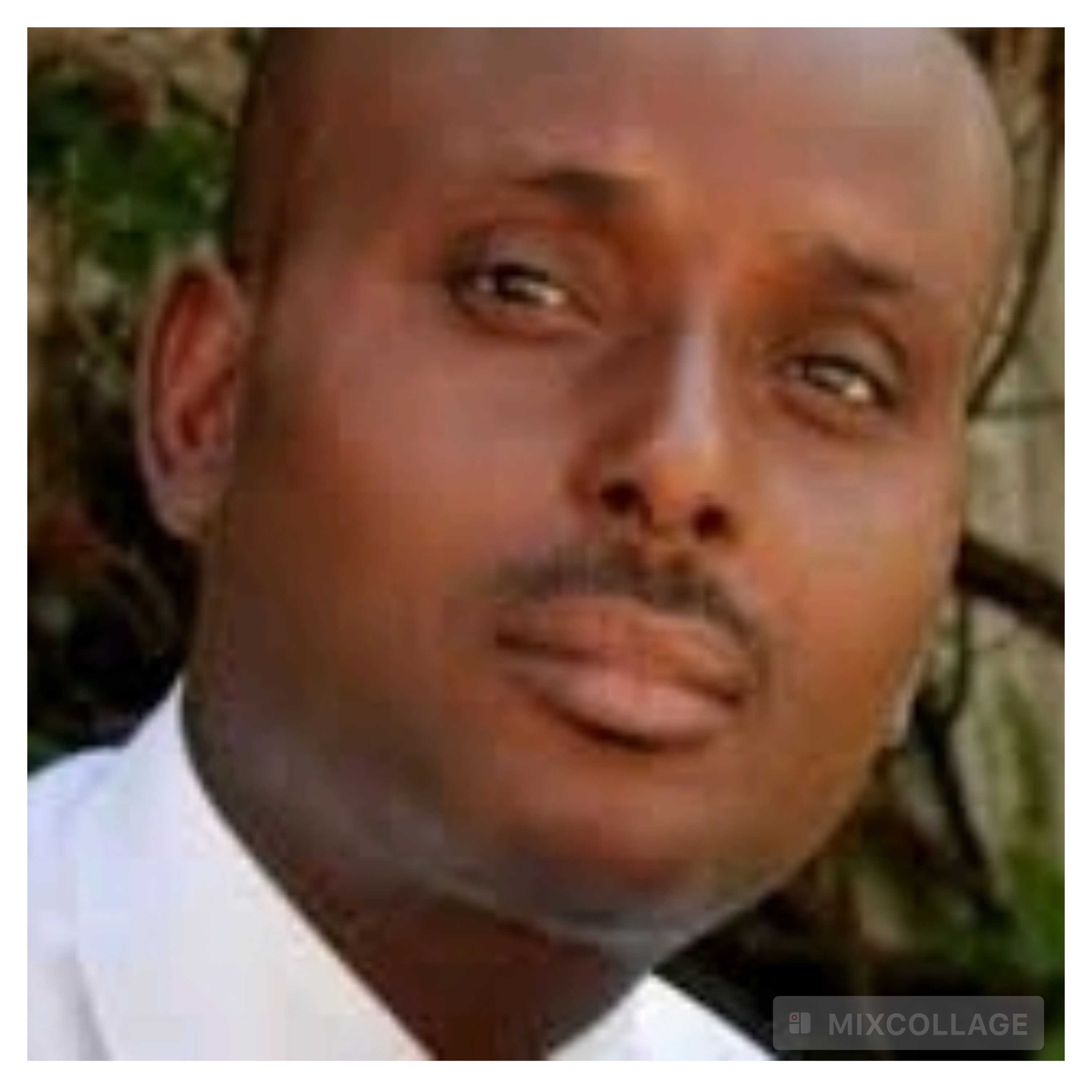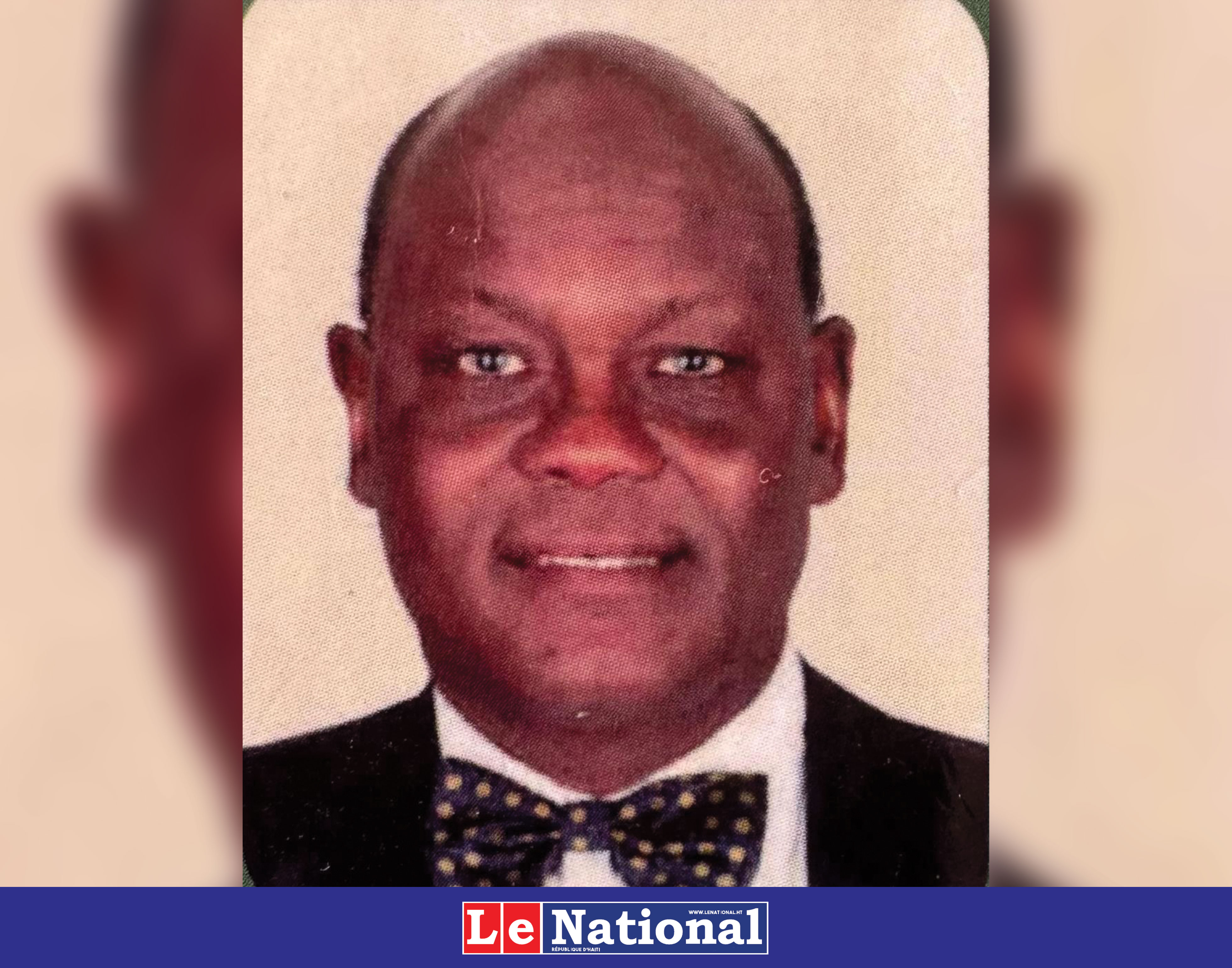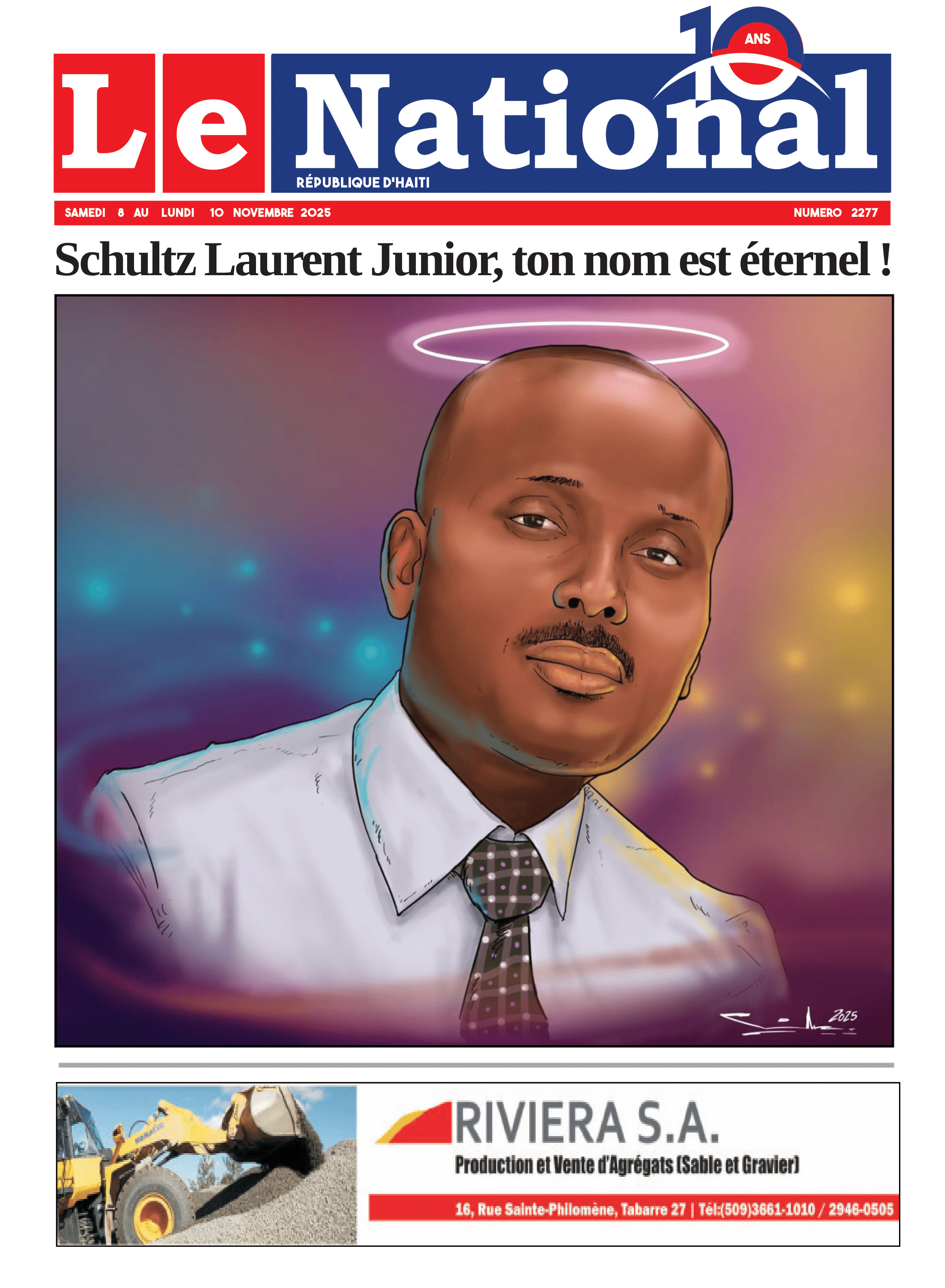Dernière partie
Résumé
La Note #4 de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME), publiée le 25 mars 2025, se présente comme un outil de clarification historique et de sensibilisation autour des enjeux mémoriels liés à l’esclavagisation. Cependant, une lecture critique permet de percevoir cette Note comme une stratégie instrumentale visant à produire un ordre du discours et à cadrer l’action publique dans une logique néocoloniale. Elle mobilise des arguments paternalistes et des tactiques de diversion qui tendent à neutraliser les revendications croissantes des Haïtien.ne.s en matière de restitution et de réparation pour les crimes d’esclavagisation et l’extorsion de 90 millions de francs-or imposés par la France à Hayti le 17 avril 1825. En intégrant cette Note dans le cadre d’une politique franco-française de gestion de l’histoire longue, pourrait-on l’interpréter comme une forme de colonialité de l’esprit, de l’action par la colonialité langagière visant à diluer les demandes de justice historique réparatrice en les replaçant dans une narration nationale maîtrisée et contrôlée. Dès lors, faisons-nous l’hypothèse que cette Note participe à une tentative d’étouffement de revendications de restitution financière estimées à 115 milliards de dollars US (valeur actualisée en mai 2022), en privilégiant une mémoire édulcorée qui protège les intérêts historiques et économiques de l’État français au détriment de la reconnaissance pleine et entière des réparations dues au peuple haytien.
À lire aussi : Partie 2/3 Double dette ou double discours : La Note n°4 de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage comme dispositif néocolonial d’effacement des revendications pour la justice historique de restitution et de réparation dues par l’État français à Hayti
III. Bicentenaire de la rançon du 17 avril 1825 : une négation de justice anticipée ?
3.1. Une Note pour manipuler et occulter la question de la réparation et restitution
Comme nous l’avons démontré dans la première et deuxième parties de ce long travail d’analyse. Il est clair qu’à quelques jours du 17 avril 2025, jour qui marque la commémoration du bicentenaire de la rançon de la France sur Hayti, voilà la sortie d’une Note réponse à la négative à une question fondamentale de restitution financière, et de justice décoloniale globale. En revanche, le cadre juridique du droit public français est plutôt structuré dans « la logique de ne jamais réparer et restituer les crimes coloniaux de la France », car en lieu et place d' une loi de restitution et réparation, les parlementaires français ont plutôt créé une loi fantôme le 10 mai 2001, dite, Loi Taubira, si tant qu’elle reconnaisse l’esclavage et la traite transatlantique comme crime contre l’humanité. Toutefois, Claude Quémar (2019) rappelle que :
À l’origine, ce texte [Loi Taubira] comportait un article 5 qui disait : « Il est institué un comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice subi et d’examiner les conditions de réparation due au titre de ce crime... » Cet article sera rejeté et le texte adopté... à l’unanimité (12 mars 2019, en ligne).
C’est dans la logique même de la Loi Taubira qu’a vu naitre le germe du Comité national pour la Mémoire de l'Esclavage (CNMHE). Celui-ci est à la base de la FME. Ce qui déjà, en France, avait provoqué de vives critiques pour son déni de vraies questions de réparation et restitition par des historien.e.s, juristes et militant.e.s pro-réparation-restitution comme Louis-Georges Tin (2013), Christiane Taubira (2021) et Claudette Duhamel & Alain Manville (2021) etc. Voilà que cette Note de la FME demeure avant tout un acte de boycottage des demandes officielles d'Hayti, en faisant croire à une loi futile, donc symbolique.
Pourtant, le peuple haytien depuis 1825 n’a pas attendu une telle Loi Taubira fantôme, qui fait disparaître la normativité des demandes de réparations financières ni la 3ème Conférence mondiale de l'UNESCO contre le racisme, tenue à Durban début septembre 2001, qui a porté le sujet à l'attention mondiale, pour demander justice contre l’emprise de la France sur les ressources agricoles et financières du pays (voir Mario Laarmann et all).
Par ailleurs, la France est de plus en plus confrontée à des demandes poursuivies notamment à la suite de celles du président haytien Jean Bertrand Aristide en 2003; il y a surtout d’autres, telles que formulées par Fritz Alphonse Jean (actuel premier chef du Conseil Présidentiel de Transition/CPT-Hayti) en 2021; ensuite, par Edgar Leblanc en 2024; en fin, par Leslie Voltaire en 2025.
Sans oublier les mouvement nationaux et internationaux de solidarité à la cause juste et légitime haytienne de demande de justice afin de corriger les dérives de la modernité coloniale esclavagiste et capitaliste franco-centrée et occidentalo-centrée. Ainsi, le grand nombre d'événements majeurs et de publications depuis la conférence de Durban en témoigne, qu'il s'agisse de la création en 2013 de la CARICOM Réparations Commission pan-caribéenne, auquel vient récemment enfin, comme l’a écrit Frantz Duval en aout 2024, siéger Hayti.
Contrairement aux arguments paternalistes et néocoloniaux de cette Note écrite contre les demandes légitimes et justes de restitution et réparation morales et matérielles surtout financières, écologiques… des pays comme l'Allemagne et les États-Unis ont déjà posé des actes de réparation financière pour des crimes contre l'humanité en vue de réparer les atrocités commises lors de la seconde guerre mondiale, sur les Juifs et Juives et les citoyen.n.e.s américain.e.s d'origine japonaise (voir Camille Cottais, 2024). Des réparations versées par le Royaume-Uni aux victimes de leur domination coloniale au Kenya (en 2013), de la publication en 2014 de l'ouvrage influent de Ta-Nehisi Coates The Case for Reparations, ou du très critiqué Aussöhnungsabkommen, reconciliation agreement, un traité de réconciliation conçu par l'Allemagne et le gouvernement namibien en 2021, où préfigure, dans les discours publics des idées morales collectives et dans l’action publique, la négation, la non reconnaissance des souffrances des victimes, de ses descendant.e.s et des demandes de réparations pour les crimes de génocides de l’État colonial allemand en 1904-1908 contre les OvaHerero et les Nama (voir Sahra Rausch, 2023). Pourtant, des exemples aussi imports tirés dans la logique actuelle, où prévalent différents intérêts politico-économiques dans le jeu de la reconnaissance officielle des crimes commis car la réparation par l’aide néocolonial au développement et la coopération humanitaire, est la nouvelle version de la technologie de la modernité-coloniale-occidentalo-centrée, la nouvelle manière de racheter de manière masquée les crimes coloniaux du passé, pourtant ces exemples de justification stratégiques et manipulatrices ont été occultés dans cette Note. L’enjeu ? L’État occidental post-colonialisateur et post-esclavagisateur reconnait officiellement les crimes coloniaux commis comme génocide ou crime contre l’humanité, mais tout en niant scrupuleusement les conséquences politiques, juridiques, financières concrètes ainsi que les revendications matérielles avancées par les descendant.e.s des victimes de l’esclavagisation, de la racialisation…
À lire aussi : Partie 1/3 Double dette ou double discours-La Note #4 de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage : Un néocolonialisme sémantique pour étouffer les 115 milliards que la France doit à Hayti
La Note n’a, à aucun moment de la durée mentionné les divers procès boycottés par la justice française pour la restitution et réparation des crimes contre l’esclavagisation et la commercialisation des personnes d’origines africaines, entamés contre l’État français par des citoyen.n.e.s afro descendant.e.s et des associations comme les ont déjà étudié par Claudette Duhamel & Alain Manville (2021). Le silencement de divers procès boycottés par la France constitue, non un paradoxe, mais une volonté délibérée de manipuler l’opinion publique nationale et internationale et surtout haytienne afin de ne pas comprendre les structures de colonialité juridique et judiciaire de l’État français qui perpétuent les dominations et la conservation des héritages de l’État impérial-colonial et de la société coloniale française.
Cet action communicationnelle stratégique et instrumentale, donc manipulatrice et propagandiste vient de faire passer les enjeux de la restitution de 90 millions francs que l’État français doit aux Haytien.n.e.s pour une question farfelue de mémoire mémorielle franco-française. De prime abord, pour les futur.e.s Français.e.s plutôt que pour les présent.e.s Haytiennes et Haytiens existant.es à travers la mise au centre du débat les voix et voies des descendant.e.s des esclavagisé.e.s haytien.ne.s.
C’est face à cette stratégie de manipulation de la question de crimes de l’Europe contre l’Afrique, la Caraïbes et autres que l’on comprend mieux les incitations d’Achille Mbembe (2019) lorsqu'il affirme que les restitutions de l'art africain pillé sont insuffisantes sans des excuses ou une autre forme de réparation symbolique. « Pour que la restitution des objets africains ne soit pas l'occasion pour l'Europe de s'acheter une bonne conscience à bon compte, le débat doit être recentré autour des enjeux historiques, philosophiques, anthropologiques et politiques de l'acte de restitution », écrit Mbembe (2019, p. 70), plaçant clairement la revendication des restitutions dans le cadre à la fois des réparations matérielles et symboliques.
3.1.1. Restitution financière et restitution des objets mal acquis : un refus délibéré de la France à travers la note de FME ?
Si la Note n'a jamais hésité sur la reprise des arguments du Rapport de Régis Debray de 2003-2004 et des mouvements réactionnaires de quelques personnalités sans scrupules de la classe francopholique, les chiens de garde de la France et des intérêts propres aux français sous couverture de la Francophonie (FME, p. 16), pour justifier : « le non objet, la non recevabilité des demandes de restitution de la part de l'État colonial français, les 21.7 milliards que la France doit au peuple haytien dans la demande faite en 2003 qualifiée de pure comptabilité onirique », ces questions ont été stratégiquement manipulées afin de servir la cause de la FME et de l’État néocolonial français en prélude du bicentenaire du 17 avril 2025.
En effet, cette Note est très importante, parce que tout simplement, elle permet de comprendre les mécanismes profonds de la diplomatie franco-française pour liquider toutes les démarches de réparation et restitution tant morale, financière, matérielle, écologique, linguistique que socio-culturelle ; donc, globales. Ces mécanismes ont été déjà à l’œuvre depuis de longues années afin d’entraver les différentes demandes de restitution de tous les monuments historiques et patrimoniaux d'Afrique qui sont illégitimement croisés en France. Lesquels sont cachés dans les musées coloniaux de la France sous couvert de principe de l’inaliénabilité du droit colonial patrimonial français qui perpétue les normes de séquestration des collections patrimoniales nationales de la France post coloniale mais non décoloniale. Donc, le principe d’inaliénabilité est un héritage colonial qui fait prévaloir la protection de biens mal acquis spoliés durant la colonisation, par les mêmes structures de la colonialité du droit public français, héritière de la spoliation et protégée par un système juridique et judiciaire colonial verrouillé par des mécanismes de normalisation et de légitimation du droit public colonial/moderne français (voir Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia & Rainer Bomfim).
A lire aussi : L’ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 : Faut-il parler de «dette, double dette, d’extorsion, de hold-up ou de rançon» ?
La Note évacue toute information et toute question de Restitution des têtes de résistants algériens qui sont cachés dans les musées coloniaux français, notamment dans les Musées de l'Homme et des monuments historiques des Tayinos, Kalinagos et Haytiens. Lesquels monuments historiques sont coincés dans les musées coloniaux occidentaux et français, particulièrement dans le Musée du quai Branly – Jacques Chirac. Tout compte fait, ne faudrait-il pas réitérer les demandes de réparation et restitution de manière formelle, englobant aussi bien tous les biens mal acquis que la France doit à Hayti ? En revanche, ces demandes sauraient-elles significatives si elles ne sont pas issues des sociétés civiles, des classes paysannes et de l’État haytien ou de tous les États et peuples surtout africains, abya yala (sud amériques), asiatiques et océaniques qui ont été spoliés par l’État colonial français ? Car, non seulement ces demandes exigeraient de dresser des inventaires complets de tous les biens mal acquis coincés dans les collections publiques et privées françaises, mais aussi auprès d’autres anciens États empires colonisateurs.
Toutefois, toute la Note est plutôt déposée pour boycotter le bicentenaire de la rançon que la France a imposée à Hayti, qui servait de mécanismes profonds d'appauvrissement du pays. Ce long processus de paupérisation a duré plus de 120 ans (1825-1947) comme la démontré la série d’articles du Journal New York Times (2022), ou de récentes contributions historiques et scientifiques des chercheur.e.s comme Marcel Dorigny, Jean-Claude Bruffaerts, Gusti-Klara Gaillard, et Jean Marie Theodat (dir.) (2021), Benoît Joachim (1971), Fréderic Thomas (2025), Christine Jiha (2023), Ana Lucia Araujo (2025) François Blancpain (2001) pour ne citer que ceux-là.
La Note évacue les luttes haytiennes pour les questions de restitutions financières et matérielles. Mais place plutôt au centre de la discussion la question de la mémoire mémorielle, et de la réparation futile à la diplomatie franco-française au centre du débat et le néocolonialisme par l’aide au développement. Dirait-on un nouveau rapprochement de la question pour mieux la dribbler comme l’a si bien déjà fait le président Emmanuel Macron quand il s’agit de faire justice aux peuples africains face aux 90 000 objets culturels d’Afrique noire séquestrés dans les musées de France. D’ailleurs le Rapport de 2017 de Felwine Sarr et de Bénédicte Savor sur cette question et le Rapport de plus de 1000 pages de Karine Ramondy (2025) de la Commission Franco-Camerounaise sur le rôle et l’engagement de la France dans les crimes de guerre au Cameroun de 1945-1971, pour ne citer que ceux-là, restent sans suite dans les tiroirs poussiéreux de l’Élysée. Les restes de crânes africains sont, pour reprendre Françoise Vergès (2023), sont encore séquestrés dans les tiroirs des musées-dépôt-de-séquestration de biens mal acquis des Lumières de la modernité coloniale et extractiviste du Musée colonial français.
Contrairement aux dires de la Note de la FME, l’État français est l’un des plus réticents face aux demandes légitimes de restitution financière et réparation, non seulement morale, mais surtout matérielle pour les crimes contre l’humanité liés à la colonisation, à l’esclavagisation et la commercialisation des personnes. Qui a oublié que l’actuel président français, Emmanuel Macron a déclaré en avril 2017 au Ghana « it would be ‘totally ridiculous’ for France to ‘pay a subsidy, or recognize, or compensate’ for colonialism ». Traduction littérale : il serait « totalement ridicule » pour la France de « payer une subvention, ou de reconnaître, ou compenser » le colonialisme.
C’est face à cette longue tradition de la modernité de déni et de mépris de demandes de réparations et de restitution pour les torts et les brutalités de la modernité coloniale esclavagiste raciste capitaliste extractiviste que l’on pourrait questionner avec Christine Jiha (2023), est-ce-que pour être réalisable, toute résolution proposée doit-elle trouver un terrain d'entente entre Haïti, un pays qui exige une réparation intégrale, et la France, un pays qui refuse de payer ses indemnités ? Et, la solution devra-t-elle également surmonter les obstacles juridiques liés à la poursuite d'actions remontant à plus de cent et deux cents ans ? Ou du moins, toujours dans la file d’idée de Christine Jiha (2023, pp. 918-919), la résolution doit-elle tenir compte de la probabilité que la France refuse de qualifier tout financement de « réparations », afin d'éviter un afflux de réclamations juridiques découlant des préjudices passés de la France ?
3.2. Une manœuvre pour boycotter la justice historique
Si tant est que les Haytiens et Haytiennes soient des personnes libres et vouloir justice réparation et restitution, cette Note ne doit-elle être l’objet d’analyse et de critique ? Aussi bien que la politique de déni à la française, ce à quoi s’arrime la performativité de cette Note de la FME, face aux demandes de justice pour les crimes du passé qui ont duré plus de quatre siècles d’exclavagisation. Car, les réactionnaires et manipulateurs.trices de l’opinion publique, essaient déjà de mettre la poudre aux yeux en se lançant dans les couloirs francophoniques et francophiliques. Ce qui, le cas échéant, permettrait aux autorités et aux banques de la bourgeoisie françaises qui ont bénéficié des rentes des coloniaux contre Hayti de continuer sur les pas de la symphonie colonialiste et néocolonialiste lequel ignore toute velléité de reconnaissance et de justice historique de la voie haytienne et africaine … d’avoir droit aux réparations et restitutions.
D’abord, dans les formes de réparation et restitution, morale, humaine, financière, culturel, linguistique, écologique, anthropologique donc globale. Laquelle justice n’est pas une question proprement légaliste, où dans la logique du droit colonial libéral qui, pis est, dans la même logique de normes structurelles et de l’ordre de discours manipulateurs contre les luttes pour la dignité, la reconnaissance, la justice, le respect pour les générations de femmes et d’hommes qui ont été choyée par la modernité coloniale, esclavagiste et raciste, capitaliste et extractiviste occidentalocentrée et qui continuent encore, comme l’a démontré Ta-Nehisi Coates (2019), à en être les perpétuelles victimes face au racisme structurelle et à la blanchité propre à l’Occident.
Aucune personne responsable, critique et libre de toutes obédiences françaises et engagée en Hayti, n'a été membre constitutif parmi les noms mentionnés comme auteur.e.s pour réaliser cette opération de boycottage de la restitution et réparation de la FME. Toutefois, pour souligner la position du géographe-historien haytien, membre du Comité contre rançon de 1825, Dr. Georges Eddy Lucien, a précisé lors d’un interview avec Alternatif Haïti, fait le 22 mars avant même la publication de cette Note, que :
La démarche de justice face aux crimes de la France sur Hayti ne peut pas se circonscrire que dans une approche purement comptable et/ou d’assistanat propre à la logique de l’aide au développement-humanitaire, ou telle que dans des projets de compensations dans ce contexte de crise haytienne, et de prises de décision hégémoniques s’inscrivant dans la ligné des bénéfices des classes dominantes tant du côté français qu’haytien. Car cette approche risque de silencer le symbolisme hérité à la Révolution haytienne de 1791-1806. (Notre traduction).
Alors que Hayti a été pourtant tant souffert et nécessite aujourd'hui, non pas en signe de faveur, d’octroi ou de pitié comme le prétendait cette Note, mais une justice parce que la France doit une justice historique envers les Haytien.n.s et que celle-ci ne pourrait être décidée dans le dos des victimes et de ses descendant.e.s à savoir la classe paysanne, sur dos de qui, le prix de la rançon a été versé.
C’est dans cette même lignée de proposition que s’inscrit surtout les propos du Dr. Yves Dorestal en date du dimanche 6 avril 2025 (sur cette même plateforme), ainsi croit-il : Vu la longue tradition de corruption de la classe dirigeante du pays, la démarche de restitution et réparation d’Hayti implique (1) la formation d’un comité national et d’un cordon géostratégique dans divers autres pays. Ce comité étant formé par des personnalités au-dessus de tout soupçon, (2) travaillera à étamer une discussion nationale et internationale, (3) participe à élaboration d’un plan de réparation et restitution, et (4) et sera superviser par un groupe de contrôle de gestion.
Selon professeur Dorestal, c’est ce travail fondamental qui paraît être nécessaire de matérialiser aujourd’hui.
3.3. Réparation et Restitution : pour le droit aux Haytien.n.e.s d’avoir leur propre voie
La question de la Réparation ne peut pas être l’apanage d’institutions publiques franco-françaises et détacher de la Restitution de tous les biens mal acquis des Tayinos et Haytiens, notamment africains coincés dans des musées et collections publiques et privés françaises, à commencer par les crânes africaines qui sont encore coincées dans les Musées coloniaux de la France, les 90 000 objets culturels d’Afrique noire.
Les haytien.ne.s répondent affirmativement aux réparations et restitutions globales pour les crimes de la commercialisation, de l’esclavagisation coloniale et humaine, matérielle, contre l'écologie et la biodiversité d'Hayti et le rançonnage de 90 millions francs-or qui a causé, selon le New York Times (2022), 115 milliards de pertes aux peuple haytien sur à peu près deux siècles. Mais aussi, les haytien.ne.s répondent affirmativement aux réparations et restitutions globales pour les crimes de la mise en esclavagisation-colonialisation linguistique, morale, politique, juridique, culturelle, artistitique, écologique et épistémique des haytien.n.e.s par l’Occident et notamment la France.
Sinon, cette année du bicentenaire ne serait-elle l'assassinat par l'instrumentation de la mémoire mémorielle des crimes du passé sur la base d'un arsenal de discours solennels et d'arguments dribleurs, paternalistes et condescendants franco-français contre les droits de justice, de reconnaissance, de répartitions morales, humaines et matérielles et aussi de restitution financière ? D'abord et avant tout, ces discours de réparation et restitution, ont été clairement formulé et dûment par les Haytiens et Haytiennes, ainsi vient donc le moment de trouver leur justice historique devant l'humanité auprès de l'État français.
Un comité de scientifiques surtout constitué d’Haytien.n.e.s et étrangers ou des chercheur.e.s libres et engagé.e.s pour la cause de la Restitution et Réparation pour d'Hayti et d’autres descendant.e.s de personnes esclavagisées sur différents continents, ne devrait-il pas travailler pour porter une analyse critique de cette problématique ? Cela permettra, sûrement, de mettre en garde cette manifestation de manipulation de l’opinion publique franco-française et haytienne, instituée à travers cette Note #4 du 25 mars 2025 de la FME. Ce, tout en tenant compte d’arguments paternalistes et néocoloniaux capables de liquider les luttes haytiennes pour la RESTITUTION et REPARATION. Cette mise en garde au respect de demandes de restitution et réparation, ne s'inscrit pas uniquement dans la logique de restitution de la somme de 90 millions francs-or mais aussi de ses conséquences diverses dont la France a imposée pour rançonner les Haytien.n.e.s, qu’elle fût en prélude de ce bicentenaire de l’ordonnance d’indemnité de Charles X du 17 avril 1825 ou pas.
3.4. Pour ne pas souiller les crimes du passé par dans propositions superficielles comme dans la Note de la FME
Il est clair que la Note #4 de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME) traduit une tentative de détournement abusif, visant à diluer non seulement la responsabilité de l’État français dans l’asservissement économique, social et global d’Hayti. Cela attire l'attention aussi que l'État français, par des institutions interposées tend à cracher sur la date historique du bicentenaire de l’ordonnance d’appauvrissement d’Hayti dont faite par la France. En prenant le devant pour mobiliser ses différents mécanismes du développement d’aide ou de l'aide su développement afin de boycotter les demandes de restitution et réparation de la rançon imposée à Hayti, la Note traduit cette triste réalité de propagande et de construction d’un ordre de discours néocolonial, alors que les conséquences des crimes de l’État français sur Hayti et les Haytien.nes sont ô combien incalculables et presqu'irréparables, sour tous les points de vue.
Par ailleurs, nous avons montré, qu’en substituant « rançon » par « double dette », la FME nie la nature coercitive et violente de l’ordonnance du 17 avril 1825, laquelle fut imposée sous la menace explicite d’une intervention militaire agressive. Et, en manipulant des faits et des événements historiques dans une logique d’assistanat et de développement des intérêts propices aux classes dominantes françaises et aux élites corrompues du pays, et surtout les agents de la FME, qui font office de roman national et postcolonial mettant en valeur des morts et victimes pour et contre la République française.
D’un point de vue épistémique et juridique, il importe de rappeler que la notion de « double dette » est celle qui a été utilisée historiquement pour traduire les difficultés réelles d’Hayti à trouver l’argent pour payer la rançon. Et que les intérêts et remboursements ont augmenté la charge. Mais son usage de manière systématique dans cette Note implique un consentement contractuel. Manipulation des mots! Alors que ce qui n’a pas été le cas, ni n'est le cas. Autrement dit, les occurrences du lexique de dette/double sont contraires à l’extorsion armée orchestrée par l’État français sur Hayti durant plus de 60 ans (1825-1888) et 1825-1947, soit 112 millions de francs versés par Hayti et le peuple Haytien à l’État et aux banquiers français. Dès lors, la reconnaissance pleine et entière de la « rançon » comme une spoliation (illégitime et illégale) est un préalable incontournable à toute démarche de justice réparatrice et restitutive.
D'un autre côté, la publication de cette Note à l’aube du bicentenaire de l’ordonnance d’indemnité interpelle tous.tes les Haytien.n.e.s, et combatant.e.s pour la cause d'Hayti pour avoir justice face aux États modernes-coloniaux et les organisations internationales traitant les questions de Droits humains; mais faut-il y voir une manœuvre dilatoire destinée à neutraliser les revendications légitimes d’Hayti et aussi bien de l’Afrique sans oublier les damnés des Caraïbes, d’Abya Yala (Amérique), d’Asie, d’Océanie, et aussi bien du Sud Global ?
Conclusion
Somme toute, d'un point de vue plus large, Hayti devrait encore continuer à mobiliser ses partenaires nationaux, régionaux et internationaux pour exiger la reconnaissance pleine et globale de cette injustice historique et la mise en place d’un cadre juridique décolonial national et international officiel de réparation-restitution pour tous ces crimes contre l’humanité hérités du système d’esclavagisation et de la commercialisation des personnes. Ce cadre de justice ne peut se faire dans aucune forme de précipitation, fût-il dans le contexte du bicentenaire de la rançon de la France contre Hayti, en cette date du 17 avril 2025.
Dès lors, l’horizon est à fixer dans la construction d’un cadre de justice décolonial national et international officiel, basé sur la construction de projet social-plan global, née auprès de véritables discussions publiques populaires-inclusives et de l’analyse globale des conséquences diverses liées à ces crimes du passé.
Une telle démarche est soutenue par une large pan de la société civile haytienne, de la diaspora, et aussi elle a été même bel et bien défendu par des auteur.e.s comme Mario Laarmann et all, Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia & Rainer Bomfim, aussi par José Atiles-Osoria et surtout Camille Chalmers, Georges Eddy Lucien, Yves Dorestal, mais avant on a eu la Caricom qui a proposé son plan de réparation et restitution en 10 points entre 2013-2014, à l’Assemblé de l’ONU en 2024, des appels de justice ont été lancé etc. Ainsi, une commission mixte internationale où se retrouve des réprensant.e.s de pays d’Afrique, de la Caraïbe et d’amis d'Hayti pourrait être créée pour documenter les préjudices subis et formuler des recommandations actualisées concrètes, à long terme, sur les modalités de réparation et restitution.
A côté de cela, une question reste pertinente et percutante sur la toile de l'histoire. Alors pourquoi substituer à la vérité historique un récit dilué (la note de la FME) qui exonère la France de ses responsabilités de restitution et réparation à Hayti faite dans la précipitation et contre le peuple haytien ? Ou du moins, tenant compte de cette Note, à l’aube du bicentenaire de cet étranglement historique, la FME ne participe-t-elle pas à la perpétuation d'un déni colonial historique qui subalternise les damnés déjà victimes de crimes irréparables ?
Auteurs: Elmano Endara J. & Kenny T.
joseph.elmanoendara@student.ueh.edu.ht,
+509 32 32 83 83
Formation : Sciences Juridiques/FDSE, Communication sociale/ Faculté des Sciences Humaines (FASCH), Masterant en Fondements philosophiques et sociologiques de l’Éducation/ Cesun Universidad, California, Mexico.
+ 509 39 18 92 18
Formation : Communication sociale/ Faculté des Sciences Humaines (FASCH)