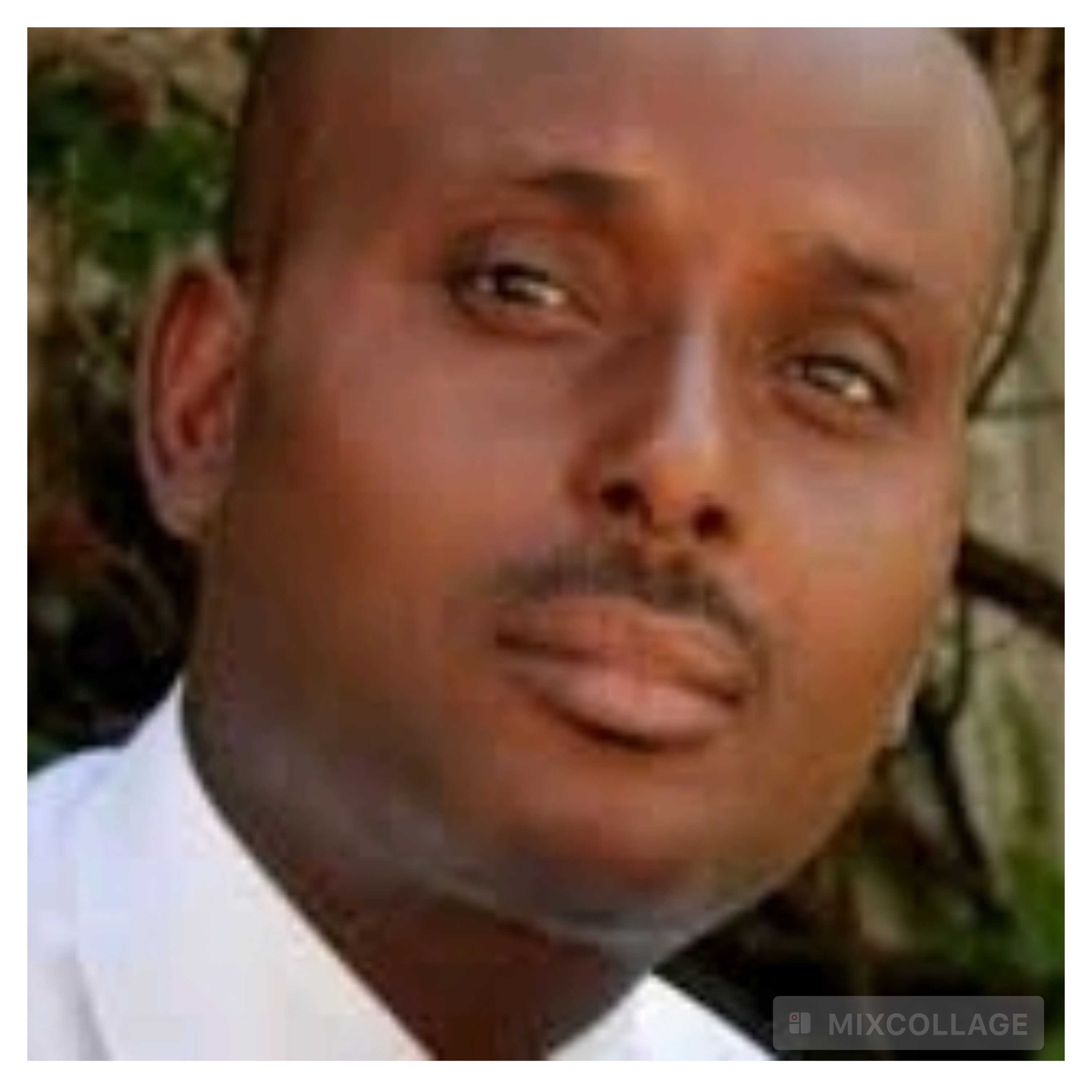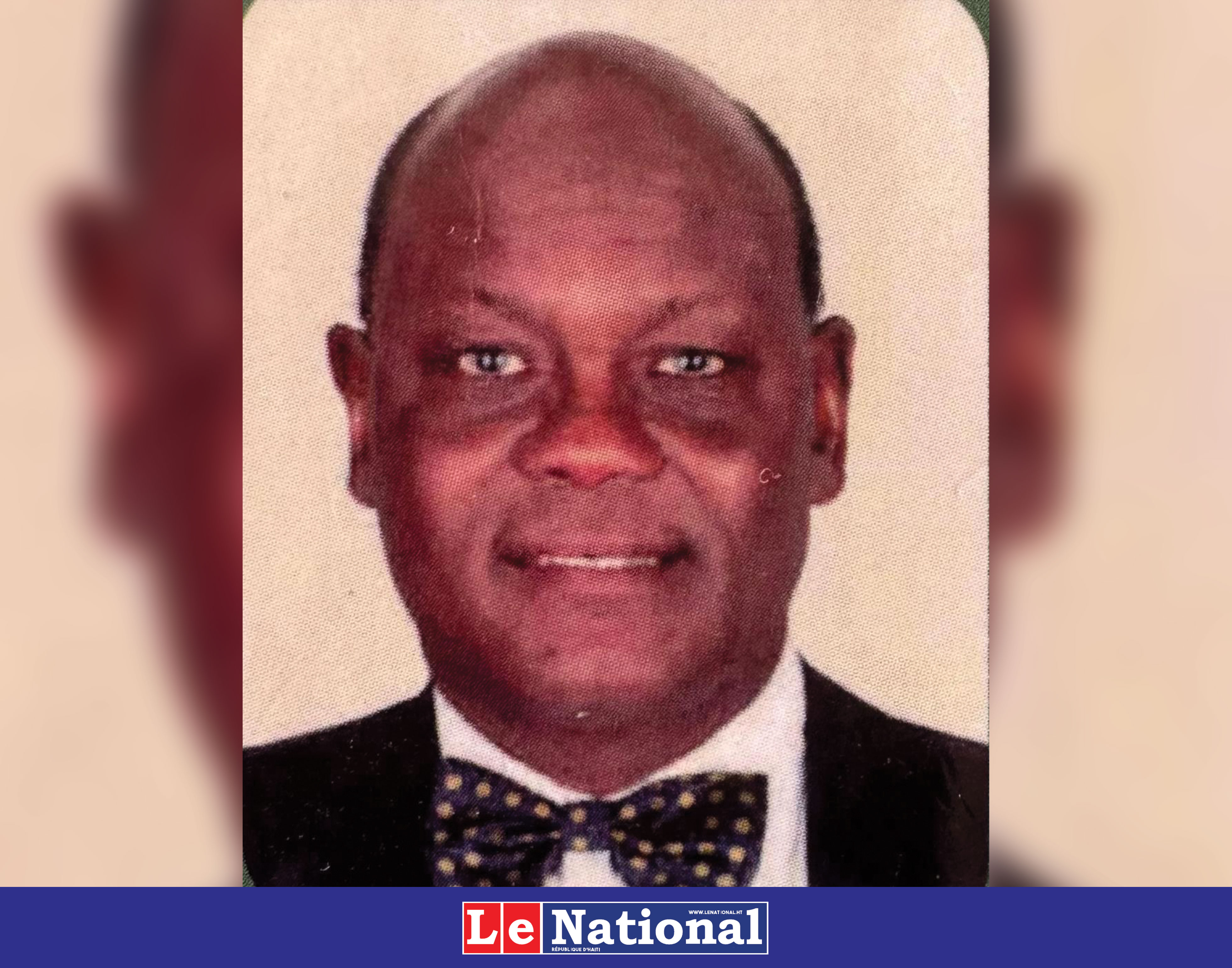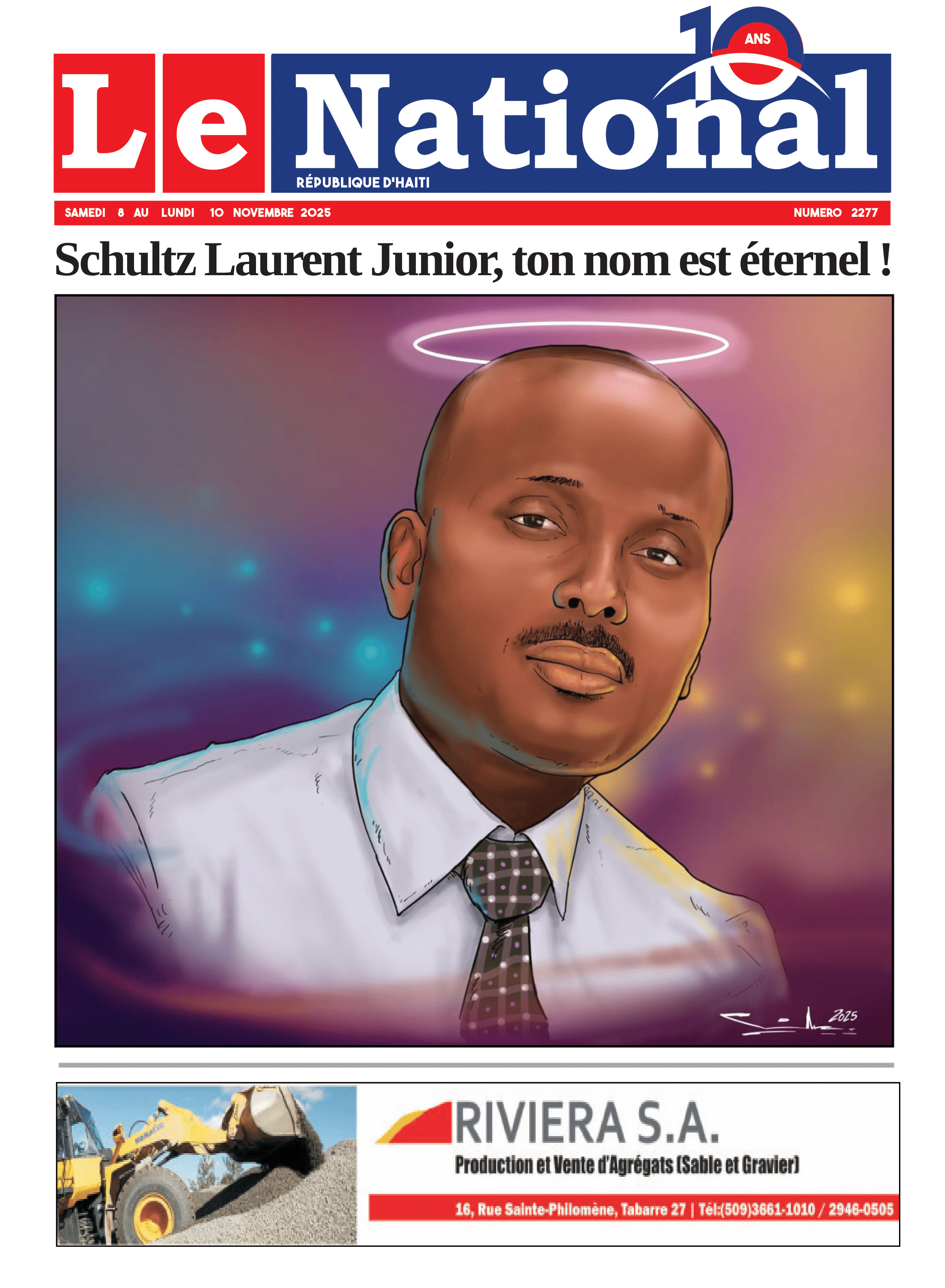Deuxième partie
Résumé
Le propos cardinal de cet article est de susciter une réflexion critique approfondie sur la Note n°4 émise par la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME), en date du 25 mars 2025. En la lisant, nous avons compris que ladite note s’inscrit dans une logique instrumentale visant à ériger un ordre discursif normatif, tout en balisant les contours d’une praxis néocoloniale, d’un étouffement orchestré. En effet, elle charrie des arguments d’essence paternaliste et recourt à des subterfuges rhétoriques destinés à diluer, voire à oblitérer, les revendications de restitution et de réparation formulées par les citoyen.ne.s haytien.ne.s à l’endroit de l’État français, au titre de crimes d’esclavagisation et de l’imposition de l'extorsion de 90 millions de francs-or à la jeune République d’Hayti le 17 avril 1825. Ainsi appréhendée, la Note n°4 de la FME se présente comme un artefact sémantique relevant d’une politique mémorielle franco-française, arrimée à une historiographie de convenance, dont l’objectif inavoué serait de bâillonner les exigences légitimes de justice historique, évaluées à hauteur de 115 milliards de dollars US en mai 2022.
II. Des arguments construits comme arme de diversion afin de silencer la question de la restitution financière
2.1. Renforcement de la colonialité langagière dans la Note de la FME
En lieu et place au terme de « rançon », la FME dès la première page parle de « double dette ». En revanche, une très longue littérature met en question le choix de « dette » et « double dette » quand il s’agit d’aborder la question de l’ordonnance et de ses conséquences sur Hayti. En fait, en lieu et place à « rançon » la Note invective Hayti en accolant la notion de « double dette » et le placer comme principal acteur de la construction des actes d’indemnisation. Ce qui constitue une stratégie de manipulation de la vérité historique et une recouverte des faits du passé par des manœuvres de discours morcelés, instrumentalement propagandistes et de déresponsabilisation de l’État français (FME, pp. 1-3).
La responsabilité du rançonnage par l’imposition de la force des armes - 14 bateaux de guerre et 530 canons - est plutôt silencée et implicitement déplacée sur le dos de l’État réactionnaire et néocolonial français sous les auspices de Charles X en 1825 pour le déposer malicieusement sur le dos d'Hayti. Par ce déplacement malicieux, l’accent est mis sur la signature de Jean Pierre Boyer (FME, p. 4). Pourtant ce n’était que le résultat de la force des armes et des agressions diplomatiques françaises. Hayti a dû subir des menaces de la part de l’État français durant plus de 60 ans (1825-1888) afin de solder cette rançon qui a forcé à cette jeune nation de verser 112 millions à l’État et aux banquiers français comme l’a écrit le Directeur adjoint de la FME, Pierre-Yves Bocquet (2025).
Cette opération de déplacement de la responsabilité et la non présentation de stratégies militaires que la France a utilisé pour imposer à Hayti la destruction de sa finance, de son économie et de son commerce extérieur, pour faire court, de son possible développement est un argument révisionniste propre à la classe des intellectuels liquidés qui publient des essais-bobines, des analyses du Rapport Mackau mythologique et mystificatrice sur le passé d’Hayti. Ces rapports visaient à déresponsabiliser la France de ses crimes historiques et financiers en vue d’espérer bénéficier des prix, des actes de faveurs et de reconnaissance dans les institutions de manipulation de l’ancienne métropole-coloniale française comme la FME et consorts. Cette opération de déplacement et de dribble est à considérer tout compte fait, en tant qu’un énième acte performatif pour tuer les crimes financiers et la justice historique, et en érigeant comme seul kòk chante de la mémoire mémorielle. Dit autrement, pour faire oublier les crimes et injustices du passé en défendant des projets néo-coloniaux comme la francophonie francopholique sur la kreyolofoni en Hayti dans le système éducatif haytien tant au niveau secondaire qu’universitaire (FME, p. 25), sans oublier le développement au plan « les E de la concorde » à l’aune des critères propres à la modernité-coloniale-capitalite-eurocentré et anti-restitution et anti-réparation.
2.2. La Note de la FME silence la diplomatie canonnière de la France contre Hayti
D'un point de vue sémantique, la Note évacue toutes les informations liées aux menaces et agressions de guerre de 14 navires et 530 canons de la flotte navale française qui servaient d'instruments contraignants de la diplomatie canonnière. Cette approche a été explorée avec beaucoup d'intérêt par des chercheur.e.s comme Gusti-Klara Gaillard et Thomas Piketty en 2021. Des agressions sont commises à l’encontre d’Haytien.n.e.s et à l'encontre de l'État haytien en 1825. Et ce, durant toutes les autres années d’agressions militaires jusqu’en 1888. Cette machine d'agression même en 2003-2004 se permet particulièrement l’implication de la France dans le coup d’État contre le président haytien, Jean Bertrand Aristide, qui a osé demander justice, réparation et restitution en 2003. Ce n'est point un point de vue spéculatif, dans la mesure où cette question a été largement documentée par des travaux de recherche, notamment dans le Journal The New York Times en mai 2022 ou dans l’ouvrage d’Alexandra Breaud en 2015.
Par ailleurs, la thèse de Michel-Rolph Trouillot (1995) axée sur les rouages de silencement du passé propre à produire et reproduire l'oubli, l’impensé, et le Non-événement de la Révolution haytienne particulièrement en France, a été criblée. En lieu et place de la Restitution financière, elle ne saurait pourtant racheter toutes les formes plurielles et pérennes des crimes du passé colonial de la France contre la nation haytienne. Ceci étant dit, la Note de FME crée une place toute faite de mémoire « culturelle, scientifique, diplomatique, et politique » d'avenir, de sincérité et de concrétude (MFE, p. 13 et passim).
Cette opération déplace les enjeux des questions de Restitution financière pour non seulement les disqualifier mais aussi pour les rendre anachroniques, impossibles. Ce faisant, la Note n’est que la continuation du Rapport de manipulation et de reproche à Hayti. Celle-ci a été réalisée sous la direction de Régis Debray avec l’objectif de boycotter la question de la Restitution de 21.7 milliards de dollars reclamée par Hayti le 7 avril 2003. Cette démarche a été opérée à l'occasion de la commémoration du bicentenaire de l’assassinat par la France, d’un des principaux chefs de la Révolution haytienne à savoir Toussaint Louverture.
2.3. Nouvelles agressions françaises contre Hayti : une vérité paternalisée et occultée
La Note installe des arguments paternalistes et condescendants comme l'a déjà été en 2004 avec le Rapport de Régis Debray, tout en reprenant et manipulant les discours masqués de Jacques Chirac en 2000. Discours au sein duquel on peut retenir des propos révisionnistes ou négationnistes à savoir que « Haïti n’a pas été, à proprement parler, une colonie française ».
Parallèlement, la Note poursuit avec la mise en contexte du discours de promesse non réalisé de Nicolas Sarkozy (2010), prononcé en février, un mois après le tremblement de terre qui a ravagé Hayti. Dans la même lignée, la FME précise :
Au cours d’un déplacement de quatre heures dans la capitale haïtienne, il [Nicolas Sarkozy] annonce un plan de 326 millions d’euros pour la reconstruction d’Haïti, et ne mentionne la dette de 1825 que de façon incidente dans sa conférence de presse avec le président René Préval (FME, p. 15).
Toutefois, constatant que les stratégies diplomatiques propres à la France de manipuler les événements tragiques d’Hayti et de se faire passer pour les bailleurs de fond à l’oral, la Note silence la question des agressions françaises contre Hayti en profitant du malheur du peuple haytien. Ce, pour se donner la bonne conscience sans d’abord reconnaitre et demander pardon de manière formelle, symbolique et publique pour les crimes que l’État français et ses capitalistes esclavagistes ont commis sur cette terre de liberté.
Ce faisant, la Note revient aussi sur les doubles discours tordus de François Hollande (2015) en Guadeloupe et en Hayti où les crimes contre l'humanité liés à l’Afrique, à Hayti et aux Caraïbes sont réduits en des mots futiles de reconnaissance de « dette morale » et de promesse de « développement à hauteur de 50 millions de dollars tournées vers le renforcement du système éducatif local », toujours dans l'impasse. C’est dans cette logique de silence, les agressions dans les discours et les actions des présidents de la France contre Hayti que la Note s'inscrit. Celle-ci, non pas pour solliciter la France d’assumer sa pleine et entière responsabilité de Restitution et Réparation, mais plutôt à vouloir inscrire le cas d’Hayti « dans le paysage des questions mémorielles françaises ». Ce qui, le cas échéant permettra, pour reprendre Sébastien Ledoux (2012), à la France de revigorer, et ce, de manière unilatérale « son roman de mémoire nationale et postcoloniale » sur les crimes pour et contre la république française.
2.3.1. De 1825 à 2025 : une histoire d’intimidation masquée par l'État français
Les discours d’Emmanuel Macron sur les crimes contre l'humanité africaine ont été aussi instrumentalisés dans cette Note de manière générale et abstraite. Ce qui sert comme moyen efficace et cynique d'occulter les stratégies politiques, et de (re)construction-manipulation par la communication stratégique de propagande gouvernementale proactive dans l’unique but de tuer dans l'œuf le bicentenaire de l'ordonnance française d'indemnisation imposée à Hayti le 17 avril 1825. Ce qui, sur 150 ans a causé l’affaiblissement de l'impact de la Révolution haytienne, et la (re)structuration impériale de la négation totale de l’humanité de la nation haytienne. En fait, selon des études décoloniales, notamment chez Walner Osna (2019), José Atiles-Osoria (2020), l’ordonnance du 17 avril 1825 constitue l’arme qui a déstructuré la base de la construction de la solidarité et de la formation normale des liens Haytiens ; donc, de sa souveraineté globale. Surtout le point de départ de l’engrenage des structures historiques de la modernité coloniale financière française, mais aussi étatsunienne ; 17 décembre 1914, hold-up par les soldats étatsuniens les 500 000 dollars or et l’occupation durant 19 ans, 1915-1934 sur Hayti.
La Note institue un ordre de discours qui essaie d’effacer toutes les formes de boycottage qui ont été orchestrées par les anciens empires occidentaux coloniaux et néocoloniaux. C'est le cas de : Vatican, Portugal, Angleterre, Allemagne, Hollande, Norvège, Suisse, Suède, Espagne… et particulièrement de la France contre les demandes de Restitution et Réparation en provenance de pays de la Caraïbes, d’Hayti et de l’Afrique entière. En revanche, les structures juridiques de l’ordre de la modernité coloniale, faisant face à ces demandes de justice, ont été rigoureusement analysées par des travaux clés. Ces derniers sont ceux de Hilary McD. Beckles (2013), Hon. Ralph E. Gonsalves (2014), Felwine Sarr et Bénédicte Savor (2018) ; José Atiles-Osoria (2020), Ana Lucia Araujo (2023) etc. En deçà de ces travaux, la Note du FME évacue toutes les questions liées à l’inventaire complet des objets culturels Taïnos, Caribés, Ciboney, Arawak et Haytiens qui sont mal acquis et coincés dans les collections publiques patrimoniales françaises.
D’où, il est clair que cette Note écrite par une institution qui fait son beurre sur le sang des crimes contre l’humanité, 2 millions euros comme budget de fonctionnement par an, est une (re)construction épistémique faite aux fins d’évacuer les vrais enjeux et de protéger les biens culturels déportés, se retrouvant illégitimement aujourd’hui sur le sol français. Ils restent, cependant, au vu et au su de l'histoire, des objets mal acquis. Ainsi, prenant la peine de se demander, cette Note n’est-elle un outil diplomatique franco-français qui est né dans la logique de velléités des autorités françaises afin de conjuguer, de manière durable ou éternelle, les structures de perpétuation des formes d’assignation discursives permettant de conserver, ce que Rainer Bomfim et Alexandre Gustavo M. F. de Moraes Bahia (2022) appellent les modèles hégémoniques de la modernité/colonialité ? Lesquels sont des structures épistémiques et juridiques propres à la logique de l’État colonial/moderne, nées depuis le début de la modernité/colonialité (1492), et instituées afin de maintenir l’exclusion de personnes subalternisées et les structures de pouvoir/domination au bénéfice d’anciens oppresseurs. Dans cette perspective, la justice est considérée comme un octroi, une faveur, qui ne doit aucunement mettre en question les privilèges et les biens mal acquis qui ont été pillés durant la longue période de la modernité/colonialité.
La Note est sciemment élaborée par des personnes qui, pour la plupart, instituent des arguments révisionnistes déresponsabilisant l’État français et les banques françaises face aux vraies demandes de restitution financière, notamment face à celles de provenance d’Hayti, et d’Afrique noire entière ou aux populations dites d’Outre-Mer ou comme ceux de Caraïbes, d’Asie et dans le monde océanique. Ces pays ont tant souffert et y continuent sous l’emprise de structures de domination de la colonialité et de la modernité de l’État et de la classe bourgeoise française. Pis est, aujourd'hui encore, ces peuples, ceux qui n’ont pas eu leur indépendance, ne peuvent pas parler leurs propres langues et leurs voix et voies sont encore sous les bottes de cet universalisme monolinguiste parisien de langue françoise-française. Cette longue opération de dominance linguistique joue gros, à travers surtout des programmes socioculturels de la Francophonie, qui ne veulent ni mourir ni accepter une autre langue là où est le nouvel État colonial qui fait prévaloir le monolangagier francophonique-francopholique.
joseph.elmanoendara@student.ueh.edu.ht,
+509 32 32 83 83
Formation : Sciences Juridiques/FDSE, Communication sociale/ Faculté des Sciences Humaines (FASCH), Masterant en Fondements philosophiques et sociologiques de l’Éducation/ Cesun Universidad, California, Mexico.
kennythelusss@gmail.com, + 509 39 18 92 18
Formation : Communication sociale/ Faculté des Sciences Humaines (FASCH)