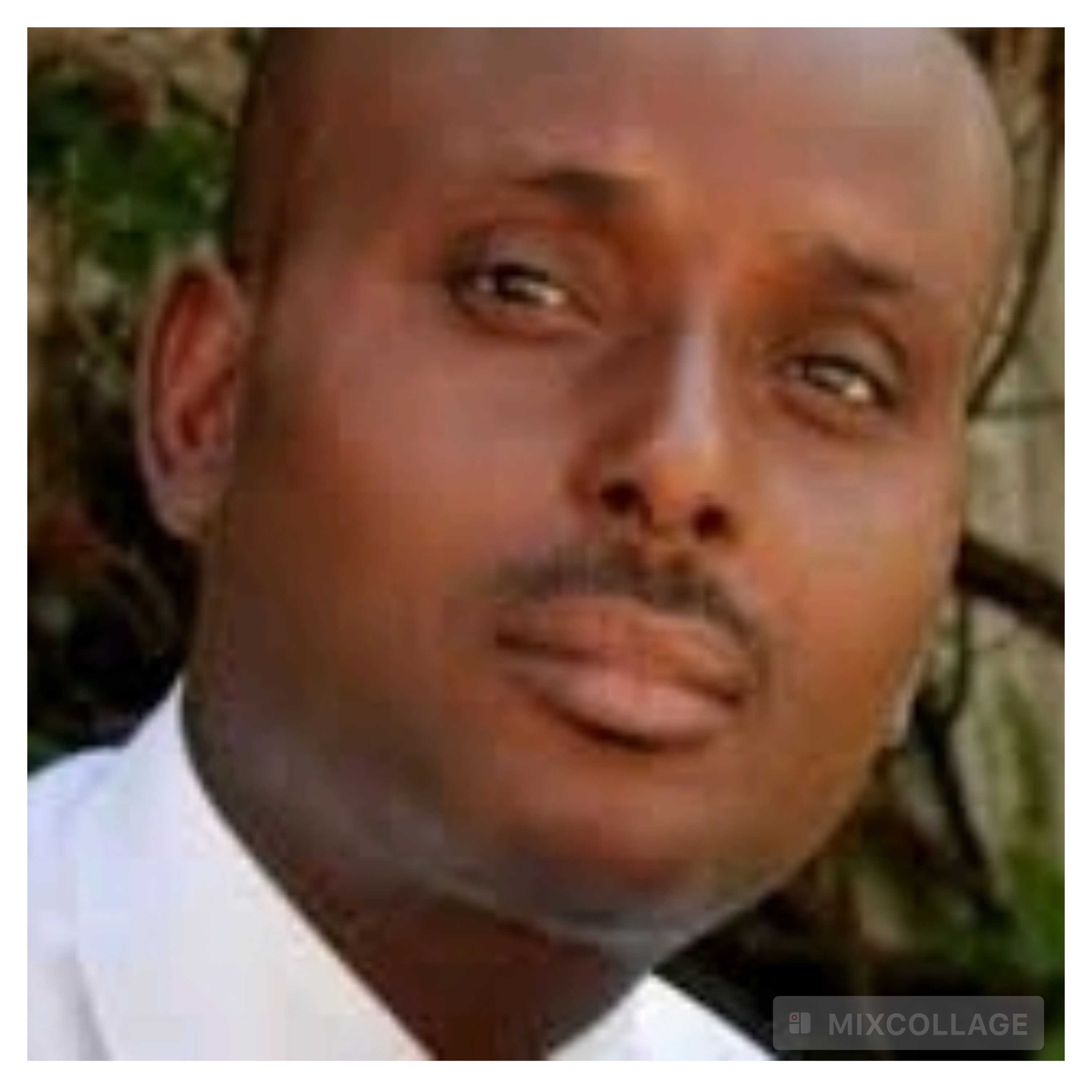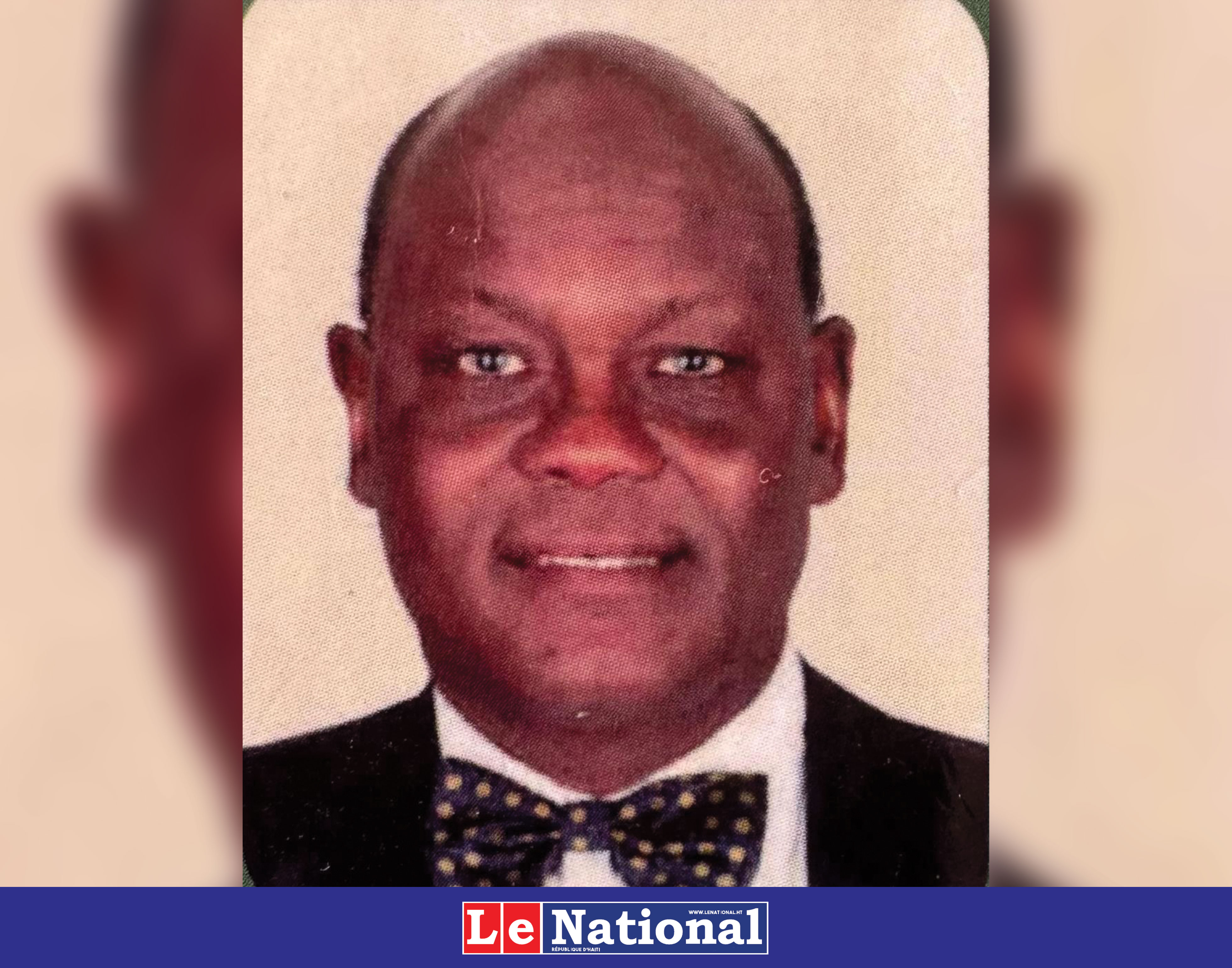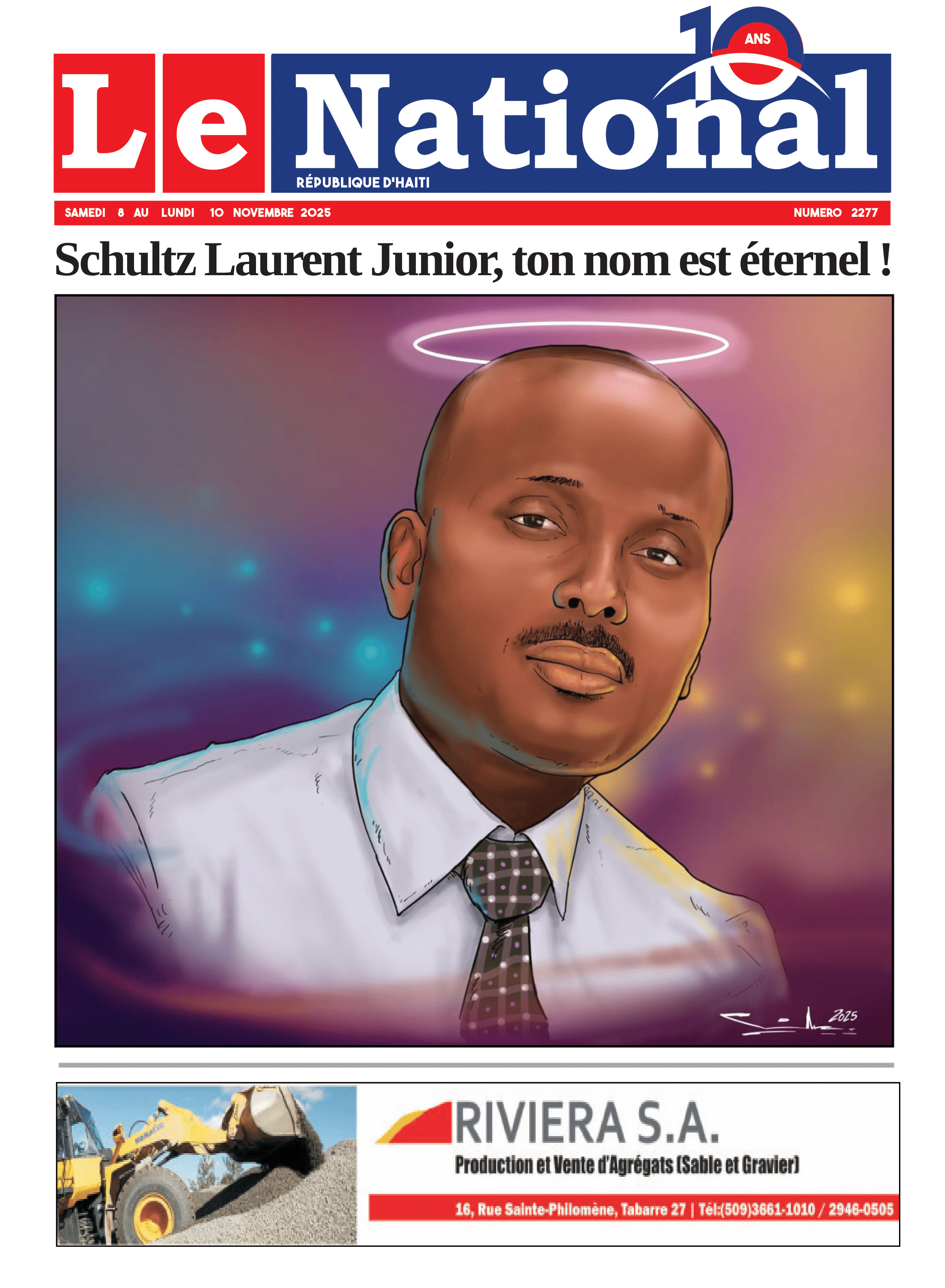Le 17 avril 2025 marquera les 200 ans de la signature forcée de l’ordonnance de Charles X, un texte qui a exigé un lourd tribut pour la reconnaissance de l’indépendance d’Haïti. Deux siècles après cet événement, des étudiants et universitaires ont voulu relancer le débat lors d’une discussion, à l’INAGHEI, animé par des personnalités sélectionnées avec minutie. La question, faut-il qualifier l’obligation financière imposée à Haïti de dette légitime, de double dette, ou d’une forme d’extorsion, voire de rançon ? Un débat essentiel pour comprendre les racines des difficultés actuelles d’Haïti.
Le 1er janvier 2025, à l'occasion de la fête de l'indépendance d'Haïti, une conférence-débat s'est tenue à l'Institut National d’Administration, de Gestion et des Hautes Études Internationales (INAGHEI) sur le thème «Restitution de la dette de l'indépendance». Sur le panel, deux éminents professeurs de l'Université d'État d'Haïti (UEH), Monsieur Derinx Petit Jean et Monsieur Ricardo Augustin.
Le professeur Petit Jean a questionné le vocable «dette» en montrant que, par l’ordonnance de Charles X, la France a imposé la jeune nation haïtienne, qui s’est battue pour sa liberté, et a contraint, de force, à acquiescer à sa requête. Il s’agit, selon le professeur, d’une rançon, non d’une dette, car Haïti n’a jamais contracté d’emprunt à la France ni à une banque française depuis son indépendance proclamée solennellement aux Gonaïves le 1er janvier 1804.
En lieu et place des mots dette et double dette, il souligne que ceux et celles qui traitent cette question de Restitution devraient plutôt opter pour d’autres termes comme rançon, vol, hold up ou encore extorsion pour qualifier les mécanismes d’agression concoctés par les anciens colons français et l’État colonialiste français pour asphyxier les finances, le commerce, et accaparer les maigres ressources économiques d’Haïti. Lesquelles ressources devraient normalement être investies dans la consolidation de la toute jeune nation par la création des infrastructures nécessaires, notamment des routes, des hôpitaux, et des écoles...
Parallèlement, le professeur Ricardo Augustin, quant à lui, a abordé la question sous un autre angle. Son analyse a de préférence porté sur la dimension internationale du problème en soulignant les différentes démarches qui ont été entamées par les empires coloniaux (La France et les États-Unis) pour boycotter la révolution haïtienne.
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, aristocrate français et diplomate, qui occupait le poste de Ministre des Affaires Extérieures de la France, exprimait, selon le Professeur, la position de la France par rapport à la révolution haïtienne, suite à la proclamation de l'indépendance et à la création de l'État d'Haïti dans une double option : «Soit que la France prend toutes les mesures pour reprendre le contrôle de son ancienne colonie » ou qu’elle « laisse les nègres cuire dans leur jus».
Ces propos évoqués par le Ministre des Affaires Extérieures de la France rejoignaient l’intention de celle-ci d’asphyxier l’indépendance d’Haïti en demandant, dans une lettre adressée aux dirigeants des États-Unis de cesser toute activité commerciale avec Haïti. Le 28 février 1806, les États-Unis ont décrété un blocus contre le nouvel État.
Précisions lexicales et phraséologiques
Le vocable dette ou rançon et plus tard, double dette, utilisé pour décrire l’étranglement historique d'Haïti qui a été imposé par la France après son indépendance, s'étend sur la toile de débats et devient de plus en plus pertinent. Des conférences-débats ont eu lieu. Des organisations internationales crachent leurs morceaux. Des années de recherche historique, sociologique et économique ont été consacrées par des revues et quotidiens, publiées dans des livres. Cependant, compte tenu de charges sémantique, littéraire et juridique de ces termes, l’on se demande, tout court, est-ce qu'il y a lieu de parler de dette, de double dette, d’extorsion, de rançon ou de hold-up (vol à main armée) ?
Le vocable dette est un nom féminin (du latin debita, pluriel de debitum, de debere, devoir), qui renvoie, à une somme d'argent, un dû, un emprunt ou un passif, en son sens premier, que l'on doit à quelqu'un à qui on l'a empruntée (créancier), qu'il devra en retour rembourser (débiteur). En ce sens, cet acte consenti juridiquement devient un devoir hautement qualifié d’intérêt capital qui est fait au débiteur de se sentir lié à une exigence d’une forme d’obligation morale.
Dans l'autre sens, il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour aborder la question. Toutefois, leur validité peut être mise en question. A côté de toutes considérations historiques et de nuances épistémologiques et théoriques liées à la question. Il y a deux catégories de considération à prendre en compte : d’une part, la question de la dette et de la double dette, renvoie à l’expérience de la dette imposée par la France à Haïti le 17 avril 1825 (Gusti-Klara Gaillard, aout 2021).
Le vocable rançon, faisant référence au paiement exigé en échange de la libération d’une personne ou d’un bien ou le lexique d’extorsion, désignant : une situation où une personne ou un pays impose, par la force ou la menace, le versement d’une somme d’argent ou la réalisation d’une action. Ces lexiques ne sont pas systématiquement retrouvés chez certains auteurs ; cependant, d’autres l’ont soulevé avec une pincette plus élargie comme dans les travaux d’enquête méticuleuse et approfondie du quotidien New-York Times, publiés le 20 mai 2022 titré : Série sur les effets à long terme de la Double Dette imposée à Haïti.
Si une dette est un ensemble d’engagements juridiques et financiers librement (consentis) à la charge d'un État ou d'une tierce, contractés à l'occasion des émissions d'emprunts. Dans le cas d’Haïti, il est impropre de parler de dette ou de dette de l’indépendance. Toutefois, les lexiques juridiques d’extorsion, de rançon, de vol ou de hold-up manigancés par la France (vaincue) à Haïti, (vainqueure), nous en disent long. Autrement dit, juridiquement et sémantiquement ces derniers termes lexicaux sont mieux aptes que le vocable dette à exprimer l’usage de la force des armes et des pressions dont se sert la France dans la rade de Port-au-Prince pour forcer illégalement et illégitimement à Haïti de verser cette considérable somme d’argent en or franc à longueur des années, ce qui tout compte fait représente la plus grande escroquerie de toute l’histoire du monde moderne de l’Atlantique (Horard W. French ; 2021).
Tout cela s’est institué le 3 juillet 1825, où 14 navires de guerres armés de 528 canons arrivent dans la rade de Port-au-Prince. Et à bord, le baron de Mackau, chargé par le roi Charles X de d’imposer les conditions, prises unilatéralement par la France, à imposer par la force si nécessaire… Sous la menace d’un blocus maritime et d’une intervention militaire, le 8 juillet 1825, le président d’Haïti Jean Pierre Boyer accepte de payer l’indemnité, contre la volonté du peuple haïtien qui scande « Blan franse mande lajan / kote na pran ? / kote na pran ? / na ba yo boulèt / na ba yo kannon ». Pour la payer, Haïti devra contracter un prêt auprès de banques françaises. L’ensemble – l’indemnité et l’emprunt – est communément appelé la double dette de l’indépendance.
Après 1804, la France aurait dû verser une dette d'honneur à Haïti, mais a préférer de renverser la donne à partir de 1813-1814 (Péan ; juin 2015, en ligne). Autrement dit, la France a plutôt exigé à Haïti de payer par divers mécanismes de contrefaçons comme s'il devait purger une peine pour avoir acquis son indépendance en écrasant l’armée napoléonienne (la plus puissance d’alors).
Dans le premier sens lexical du terme, s'il relève d'Haïti le droit de réparation et restitution, la France doit à Haïti une compensation financière, pour laquelle elle lutte pieds et mains pour garder dans sa trésorerie. Si la France a pris l'argent par la force, c'est par la force qu'elle doit la restituer. C'est pourquoi un français tenait à rappeler que «Rien ne porte malheur comme payer ses dettes» (Jean-François ; 1709).
La France a fait un hold-up historique. C'est un revirement dans le monde juridique : un vol historique, une escroquerie historique, un étranglement financier, économique, commercial, qui a des conséquences politiques, militaires et sociales néfastes sur Haïti. Une contrefaçon qui s'ouvre sur la voie d’une nouvelle forme de pillages, de contrôle total. C'est un fait, une réalité existante et existentielle. Cela étant, ne faudrait-il pas repenser les termes du débat ?
Considérations historiques
Après s'être mis en déroute l’appareillage colonial occidental sur le sol haïtien, la lutte menant à l'indépendance d’Haïti, s'est devenue la première révolte des captifs couronnée de succès dans le monde. Haïti est le fruit de la première révolte des captifs victorieux, où les noms de ceux et celles qui ont combattu pour l’indépendance haïtienne ne sont pas forcément retenus ni connus dans les livres d’Histoire écrits pour les grandes figures historiques (Carolyn Fick ; 2014).
La révolution haïtienne a inspiré et contribué grandement aux mouvements abolitionnistes à travers le monde, particulièrement dans la Caraïbe, l’Amérique du sud et l’Afrique (aide militaire et diplomatique dans la Victoire d’Éthiopie contre l'impérialisme et le colonialisme d’Italie en 1896), sans oublier sa contribution majeure à l’indépendance et à la reconnaissance le 15 janvier 1822 de la nouvelle Nation-État Grecque indépendante qui s’est combattu contre l’empire Ottomans, dominée depuis 1453 (plus de trois siècle), dans l’accueil humanitaire des juifs et des arabes (fuyant les férocités qui s’évinçaient dans le Proche et Moyen orient depuis la conquête des Turcs ottomans au 15ème siècle) à la fin du 19ème siècle mais surtout durant les deux grandes guerres génocidaires d’Europe. Haïti a été l’un des premier pays à avoir voté aux l’Organisation des Nations Unies pour la création de l’État Israël en 1947 etc.
Très tôt en 1804, la réussite de la révolution haïtienne a inquiété les puissances coloniales, notamment la France, qui craignait que cela ne déclenche d'autres révoltes dans ses colonies.
La France a utilisé sa puissance militaire et mis ses pions politiques (Alexandre Pétion, entre autres, entrés en Haïti dans l'exposition de 1801) pour contraindre Haïti à payer cette somme exorbitante, en échange de la reconnaissance de son indépendance.
Imposée par la France en 1825, cette manne financière que la France a obtenue après avoir mis un couteau à la gorge de ses vainqueurs (1813-1883 et 1947) s’élevait à 150 millions de francs or, représentant une forme de "réparation" aux anciens colons esclavagistes et racistes qui ont esclavagisé les habitants de l'île de Saint-Domingue (aujourd'hui Haïti).
Cette pendaison financière a contraint l’État haïtien à contracter des prêts internationaux pour honorer cette exigence manœuvrée par la force expansionniste et militaire de la France qui s'attaque à toutes les puissances coloniales de l'Europe d'alors. Créant un "double crime barbare" qui a lourdement pesé sur les finances publiques et entravé le développement du pays depuis.
Après l'assassinat de Dessalines, le faiseur de la liberté pour tous, Alexandre Pétion, en 1814, a proposé des "réparations" aux anciens colons via Dauxion-Lavaysse (Péan ; ibid.) et établi les mécanismes essentiels pour l’accord officiel de 1825 sous Jean-Pierre Boyer.
Cette initiative est critiquée comme une délibération stratégique majeure, contribuant à un cycle de violence financière et de dépendance économique capitale vis-à-vis des puissances coloniales occidentales.
En contraste avec Pétion, le roi Henri Christophe (1814), au Nord, avait résisté à toute idée de capitulation face à la France. Il avait exécuté des traîtres et affirmé la souveraineté d’Haïti. C'est un modèle de fermeté et de défense des acquis de l’indépendance, exprimé à la dimension de Dessalines.
En ce sens, Leslie Péan invite à une autre réflexion plus approfondie sur les conséquences historiques de l'escroquerie de l’indépendance d’Haïti. Une approche conséquente pour comprendre les défis structurels qui ont marqué l’histoire économique et politique du pays.
Professeur Péan critique sévèrement les dirigeants haïtiens (passés et présents) qu’il accuse d’avoir souvent manqué de vision stratégique et de capacité à défendre l’intérêt national. Cette dynamique aurait permis à des élites incompétentes de perpétuer des inégalités et une mauvaise gestion qui entrave le développement socio-économique du pays.
Sa position historique invite à revisiter et à comprendre l’histoire d’Haïti sans filtres idéologiques ou émotionnels. Cela inclut une analyse honnête des actions des figures historiques telles que Pétion et Boyer. C’était l’implantation de tout un projet de destruction de la triomphe de l'indépendance d'Haïti, en commençant par l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines en date du 17 octobre 1806, à laquelle Pétion a joué son double rôle macabre.
Les historiens haïtiens comme Leslie François Manigat (1953) et Benoit Joachim (1971) ont examiné les conséquences économiques et sociales de cette imposition par la force. Elle est perçue comme une ‘’rançon imposée’’ pour la reconnaissance de l'indépendance.
Freins au développement
Cet extorsion, vol ou hold-up a pesé lourdement sur l'économie haïtienne pendant des décennies, retardant ainsi son développement et l'empêchant de se re-construire après les ravages de la colonisation française de Saint-Domingue (1503-1803).
Toutefois, la France a reconnu officiellement avoir extorqué Haïti comme un acte "illégitime et injuste" seulement en 2004, mais sans offrir de réparations concrètes.
Chantage financier : un sujet au cœur des débats actuels
Aujourd'hui, la question de réparation et de restitution de la France à Haïti continue de faire débat. Certains historiens et activistes réclament une restitution complète de la somme versée, tandis que d'autres plaident pour des mesures de coopération et de développement.
Sous le couvert du comité pour le remboursement immédiat des milliards envolés d’Haïti (Crime), une organisation siégeant au Canada, exige au gouvernement français réparation et restitution de la somme extorquée à Haïti. Le 16 août 2010, CRIME a souligné l'importance de la restitution et a porté sa signature et celle d'autres instances internationales comme le Collectif Politique Sida en Afrique au regard du monde entier.
Nous comprenons qu’en qualifiant cette somme de dette ou d'une double-dette, on souligne le caractère injuste et coercitif de cette avidité impositionnellement affreuse de la part de la France. C'est une question importante pour comprendre l'histoire d'Haïti et les défis auxquels ce pays est confronté depuis son indépendance.
Le professeur Thomas Piketty nous rencontre en ce sens que deux lignes de conduite s’imposent à l’État français, ancienne puissance colonisatrice : « Au minimum, la France devrait rembourser plus de 28 milliards de dollars à Haïti », et « il faut accepter la logique des réparations » (cité par Gaillard, 2020).
L’occupation américaine d’Haïti (1915-1943) et ses conséquences
Le quotidien New York Times, à travers une enquête sur la question, relayée par Le Monde, soutient que c’est une manœuvre alimentant «tragédie économique historique et politique» qui a façonné la pauvreté structurelle d'Haïti (Slavicek, 24 mai 2022).
Ce double «clé-cou» est un lourd fardeau économique imposé pour entamer le cruel chantier du néocolonialisme, si l’on considère le rôle que jouent les banques françaises et étrangères.
La Banque nationale d’Haïti, créée en 1880, était contrôlée par des intérêts étrangers. Les profits générés allaient directement aux actionnaires français, allemands et américains, tandis que les couteaux à double tranchant que la France imposait à Haïti s'accumulent. En 1914, les États-Unis ont pris le contrôle des finances haïtiennes, derrière le masque impérialiste de l’instabilité.
Dès 1825, Haïti a été forcé par la puissance occidentale notamment la France de concert avec ses agents double qui dirigeaient Haïti de contracter des emprunts pour verser pour la reconnaissance de son indépendance. Ce schéma s’est répété en 1875 (sous la présidence de Michel Domingue), en 1896 (sous Tirésias Simon Sam) et en 1910 (sous Antoine Simon), renforçant l’asservissement économique du pays.
Le 17 décembre 1914. Huit Marines américains franchissent le seuil de la Banque Nationale d’Haïti en début d’après-midi et en ressortent les bras chargés de caisses en bois remplies d’or. Valeur de la cargaison : US 500 000 dollars. Quelques jours plus tard, l’or repose dans la chambre forte d’une banque de Wall Street.
De 1915 à 1934, les États-Unis ont imposé une occupation militaire et économique, qui a canalisé les ressources d'Haïti au profit de banques américaines comme la National City Bank. Cet acte d'imposition fatal pour l'économie haïtienne a renforcé la corruption, l'instabilité intérieure et renforcé l'économie américaine en retour.
Complété en 1947, ce couteau à la gorge d'Haïti a pesé lourdement sur l'économie haïtienne, limitant ses capacités de développement et plongeant le pays dans une spirale de pauvreté sans précédent.
Depuis le départ officiel des impérialistes yankees en 1943, leur influence ne cesse de contrôler le marché import/export d’Haïti par le moyen de la douane haïtienne et surtout par l’implantation des forces internationales en Haïti de 1993 à 2024. La violence armée et l’instabilité sociopolitique qui se font prévaloir en Haïti en sont des exemples considérables. De plus, l’assassinat odieux d’un président en fonction dans sa résidence officielle dans la nuit du 6 et 7 juillet 2021.
Les tremblements de terre, ouragans et crises humanitaires successives ont accentué la vulnérabilité et la mainmise de l’international communautaire en Haïti via le détournement de fonds du projet de la CIRH et de la fédération de bandes armées sur la satisfaction de la directrice du BINUH, Madame Helen Meagher La Lime, août 2018 - mars 2023.
Demandes de restitution et conséquences dans le panorama de la politique actuelle
En 2003, le président Jean-Bertrand Aristide a demandé à la France de restituer environ 21 milliards de dollars correspondant aux pertes infligées par la double indemnité. Cela a contribué à son terrible éviction en 2004, dans une opération manigancée, tout court, par la France et les États-Unis, comme mise en garde à toutes autres tentatives de demande de restitution comme celle-ci.
La « double escroquerie » que la France a imposée à Haïti en 1825, qui incluait à la fois le coût de la reconnaissance de l’indépendance par la France et les intérêts liés aux emprunts forcés pour payer cette indemnité (soit 560 millions de dollars US, selon les estimations du New York Times pour le mois de mai 2022), a joué un rôle dévastateur dans la trajectoire historique, économique et politique du pays. Ce poids financier exorbitant a entraîné Haïti dans une spirale de crise économique et d’une instabilité sociopolitique qui a perduré sur plus d’un siècle, affectant gravement sa souveraineté et son développement.
Cercle vicieux des emprunts-forcés
La gestion de cette désolation historique fait montre les effets dévastateurs de l’esclavagisation et de la colonialisation, prolongés sous de nouvelles formes et rapports de pouvoirs néocoloniaux et de colonialité. Les narratifs et mécanismes de réparations injustes, illégales et illégitimes imposées à Haïti ont non seulement brisé son économie naissante mais aussi entravé son développement des générations jusqu'alors. Ce fardeau financier, moral et politique reste un exemple criant de l’impact des inégalités internationales sur les pays du Sud en général.
Volker Turk, Haut-commissaire des Nations unies aux droits humains, a soutenu cette demande, soulignant la nécessité de "réparations" pour les injustices du passé.
Jusqu'à présent, les réponses françaises se limitent à des déclarations symboliques. Nicolas Sarkozy a évoqué une responsabilité historique, et François Hollande a parlé d'une "dette morale". Mais aucun remboursement concret n’a été engagé.
Cette initiative des ONGs relance le débat sur la justice historique et économique, appelant à des actions concrètes pour corriger des injustices qui continuent d’affecter Haïti aujourd’hui (Alterpresse : 23 avril 2024).
Perspectives et résolutions à l’interne
Le 20 octobre 2024, l’Université d’État d’Haïti a élaboré un document stratégique en français et en créole présentant la feuille de route du Comité National Haïtien des Restitutions et Réparations (CNHRR) pour l’année 2025. Cette date marque le bicentenaire de l’ordonnance de Charles X imposé à Haïti le 17 avril 1825 de payer 90 millions de francs or, ce qui a appauvri Haïti durant plus d’un siècle et demi (Jean Yves Despinas ; 2008).
Les principales recommandations formulées : Déclaration de l’année 2025 comme « Année de la Restitution Française à Haïti » ; Note Formelle du Gouvernement Haïtien au Gouvernement Français pour la « demande de restitution de la ‘’rançon de l’indépendance’’ et les intérêts et dommages composés, par voir diplomatique officiel ; Révision des documents et archives nécessaires, Organisation d’Ateliers de sensibilisation ; Organisation de rencontres avec les Professeurs et les Étudiants ; Organisation de colloques ; tout cela par le moyen d’une ‘’Commission Mixte pour la restitution de la rançon de l’indépendance’’.
La double répression financière, commerciale et économique débutée en 1825 complétée jusqu’à 1947, n’est pas seulement un épisode à la fois tragique et fragile du passé, mais également une cause majeure débouchant sur des inégalités structurelles qui continuent de ruiner les relations diplomatiques multilatérales d’Haïti avec les empires modernes comme l’Espagne, la France, l’Angleterre, les États-Unis, entre autres. Les appels à la justice, y compris la restitution de cette grosse somme escroquée versée durant des années et la reconnaissance des torts subis, restent des questions lamentables jusqu'alors sur la toile dans les débats contemporains sur la réparation des injustices historiques, financières, économiques, commerciales, écologiques et particulièrement humaines de la nation qui a su prendre la charge à deux bras pour donner à la Caraïbe, à l’Amérique latine, à l’Afrique, à la Grèce, à la Belgique et au reste de l'humanité le sens de la liberté des peuples, de l'équité, et le goût de l’égalité sans distinction de couleur, de race, de classe, ou d’origine ethnique.
Auteurs : Elmano Endara JOSEPH et Kenny THELUSMA
Bibliographique
B. Joachim (1971). La bourgeoisie d'affaires en Haïti : De l'indépendance à l'occupation américaine. Nouvelle Optique Montréal.
B. Joachim (1971). L'Indemnité coloniale de Saint-Domingue et la question des rapatriés, Revue historique, n° 500, oct.-déc. 1971, p. 359-376. Consulté le 2 janvier 2025, à 10h30. Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1977_num_64_236_4728_t1_0426_0000_2, Consulté 3 janvier 2025.
B. Joachim (1972). Commerce et décolonisation. L'expérience franco-haïtienne au XIXe siècle, Annales, économies, sociétés, civilisations, 1972, p. 1497-1525 [compte-rendu].
C. Fick, Haïti. Naissance d’une nation. La Révolution de Saint-Domingue vue d’en bas, traduit de l’anglais par Frantz Voltaire, préface à l’édition française par Marcel Dorigny, Paris, Les Perséides Éditions, 2014, pp. 507.
F. Marcelin (1896). Haïti et sa Banque Nationale, Paris, Impr. de Kugelmann.
F. Marcelin (1897). Haïti et l'indemnité française, Paris, Impr. de Kugelmann.
G. Corvington (1975). Port-au-Prince au cours des ans vol. 3. Henry Deschamps. Port- au- Prince.
G. Ghislain (1955). L'indépendance haïtienne devant la France, Port-au-Prince, imprimerie Deschamps.
G-K. Gaillard (2022). Haïti : Il y a 196 ans, la « dette de l’indépendance », https://www.cadtm.org/Haiti-Il-y-a-196-ans-la-dette-de-l-independance, Consulté 3 janvier 2025.
G-K. Gaillard, Dette de l’indépendance: 28 milliards de dollars à rembourser par la France à Haïti ?, https://lenouvelliste.com/article/211786/dette-de-lindependance-28-milliards-de-dollars-a-rembourser-par-la-france-a-haiti, Consulté 3 janvier 2025.
H. Pauléus Sannon (1905). Essai historique sur la révolution de 1843. Bonnefil. Cayes.
H. W. French (2021). Born in Blackness: Africa, Africans, and the Making of the Modern World, 1471 to the Second World War, New York, N.Y, 2021, p. 512.
J. Saint-Amand (1881). Le Code rural d'Haïti, publié avec commentaires et formulaire, notes et annexes. 3e édition. Guyot, Port-au-Prince.
J. Yves Despinas, (2008). La pauvreté en Haïti : Contexte historiques et politiques d’ajustement structurel, Port-au-Prince, Édition La Rebelle, pp. 19-223.
J.-P. Le Glaunec (2020). L’armée indigène. La défaite de Napoléon en Haïti, Québec, Lux Éditions, 219 p.
J-F. Regnard (1764). Le joueur, comédie en vers et en cinq actes, https://dn790003.ca.archive.org/0/items/lejoueurcomdieen00regn/lejoueurcomdieen00regn.pdf, Consulté 3 janvier 2025.
K. Thelusma (2024). Batistè Pwoklamasyon Endepandans Ayiti [1 janvye 1804], https://www.academia.edu/116590082/batist%c3%88_pwoklamasyon_endepandans_ayiti_1_janvye_1804_l_acte_de_l_independance_d_hayti_ha%c3%8fti_1_janvier_1804_the_haitian_declaration_of_independence_january_1_1804_la_declaraci%c3%93n_de_independencia_de_hait%c3%8d_1_de_enero_de_1804_?source=swp_share, Consulté le 3 janvier 2025.
Le 9 mai 1826, Ordonnance du Roi concernant l’exécution de la loi du 30 avril 1826.
Loi relative à la répartition de l’indemnité stipulée en faveur des colons de Saint-Domingue, 30 avril 1826.
Meryem Belkaïd, Mohamed Amer Meziane : une pensée écologique et décoloniale, https://www.collateral.media/post/mohamed-amer-meziane-une-pensée-écologique-et-décoloniale, Consulté 3 janvier 2025.