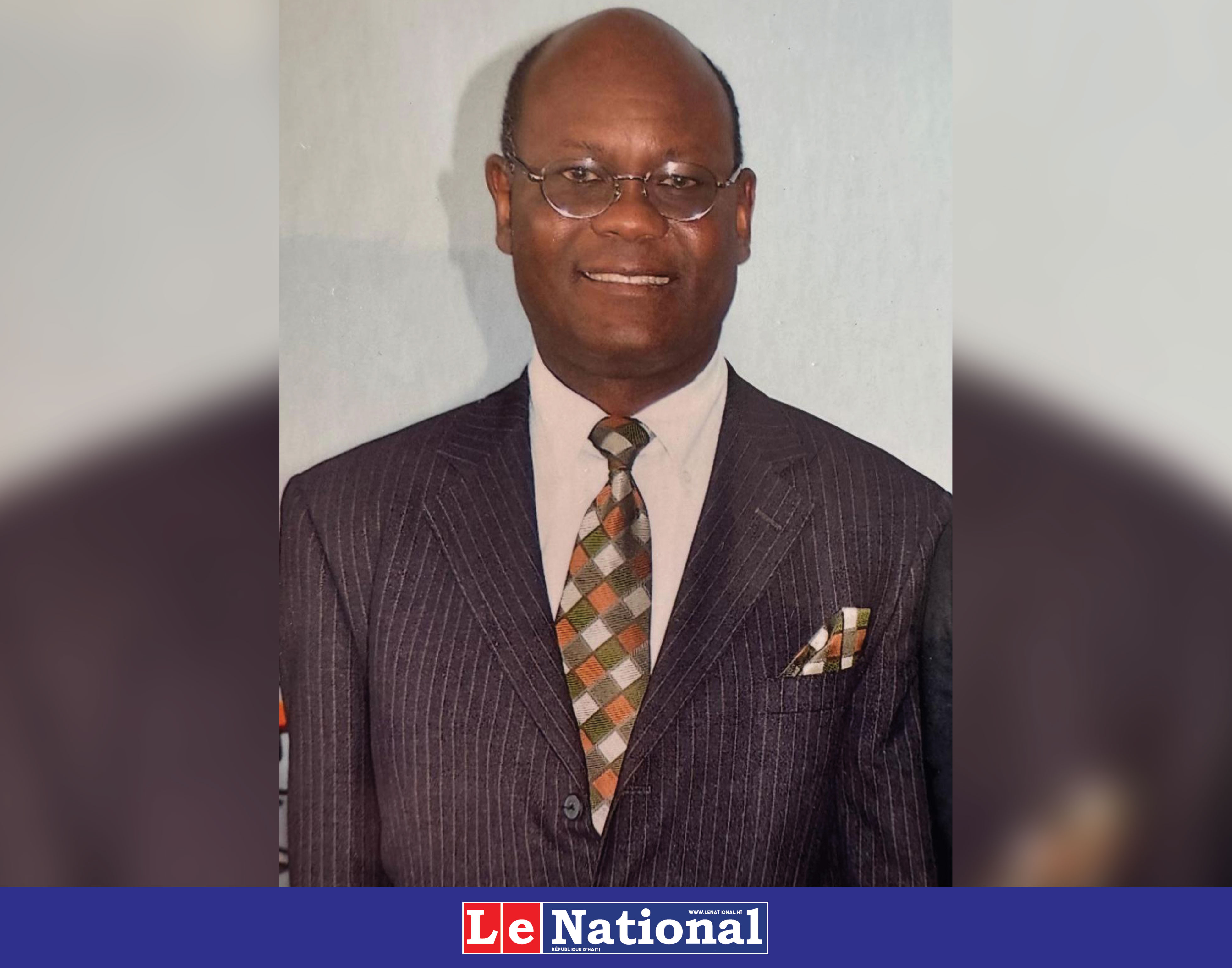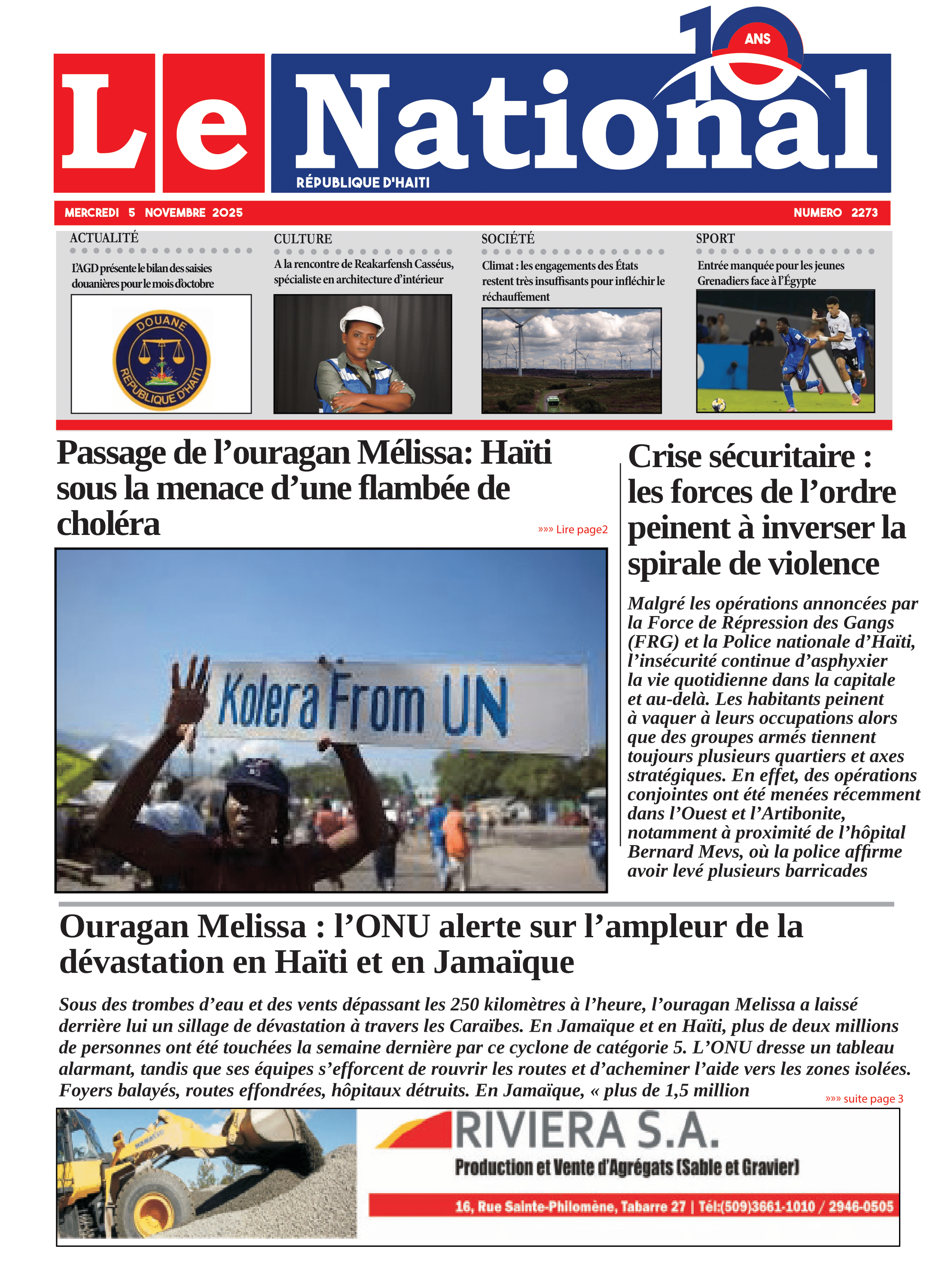En une seule semaine, les Haïtiens, qu’ils vivent dans la capitale assiégée ou ailleurs, réagissent avec spontanéité et désarroi face aux problèmes qui les étouffent. Parmi eux, le phénomène de l’insécurité, devenu un monstre incontrôlable, qui ronge chaque jour un peu plus le corps de la nation. On a un État démuni, impuissant, absent. Plus on en parle, plus les gangs se multiplient, comme si la parole publique ne faisait qu’alimenter leur prolifération.
Dans le même temps, on assiste au déchaînement de passions de notre malheureux peuple en matière politiques. Nous sommes tristes comme un cimetière abandonné, tant nous nous sommes éloignés, par nos paroles, nos faits et nos gestes, des normes les plus élémentaires de la démocratie. Entre le refus obstiné de permettre à un leader politique de s’exprimer et les intolérances crasses manifestées à l’endroit d’une compatriote influenceuse, aussi ridicule que détestée, se dévoile le drame d’une nation incapable de débattre sans s’entredéchirer.
Le culte de la force
Depuis quelques jours, le nom d’Ernest Muscadin s’est imposé avec fracas sur les réseaux sociaux haïtiens. Commissaire du gouvernement de Miragoane dans les Nippes, il s’est fait connaître par sa lutte farouche contre les gangs qui voulaient s’emparer du Grand Sud. Dans un pays épuisé par la peur et l’impuissance, il incarne pour beaucoup la figure du justicier, du « Robin des Bois » haïtien venu rétablir l’ordre là où l’État s’est effondré.
Mais cette explosion de popularité ne vient pas du hasard. Elle est née d’une mise en scène numérique orchestré par une influenceuse aussi spectaculaire que peu réfléchie. Et soudain, la « planète Facebook à l’haïtienne » s’est enflammée, élevant Muscadin au rang de prophète que le peuple semble attendre depuis toujours. Les Haïtiens, dans leur désarroi, se sont jetés sur cette figure d’autorité avec une ferveur quasi mystique, comme s’il suffisait d’un homme fort pour réparer les failles d’un État brisé.
Les réseaux sociaux, devenus le théâtre de nos illusions collectives, regorgent d’excès et de démesure. Il suffit de lire ce commentaire d’un internaute survolté affirmant, sans trembler, que Muscadin est déjà président. Il ajoute même qu’il n’a pas besoin d’aller aux élections : « Nous le proclamons président ! » Nous sommes dans un pays où le délire remplace le débat, et où la ferveur populaire tient lieu de légitimité.
Pourtant, à lire ce que dit l’homme lui-même, on mesure à quel point il révèle l’irrationalité d’une grande partie de notre peuple. Ses paroles font froid dans le dos. Il l’a dit, redit, et même théorisé dans ses mémoires de licencié en droit : il est non seulement favorable à la peine capitale, mais il souhaite la « judiciariser ». En clair, tuer celui qui tue un autre devrait, selon lui, devenir la règle.
Évidemment, une telle position va à l’encontre des progrès accomplis dans le monde civilisé, où la peine de mort a été abolie comme une barbarie institutionnalisée. Faire de cette idée un slogan de campagne, c’est revenir à l’ordre ancien, celui où un régime pouvait ôter la vie impunément — dans les prisons, dans les rues, ou à huis clos, au nom d’une prétendue justice.
Pourtant, Muscadin n’est ni un miracle ni un monstre. Il est un pur produit de l’école haïtienne avec ce qu’elle a de meilleur et de pire : la discipline, le courage, mais aussi la rigidité et le culte de la force. En tant que fonctionnaire de la République, il mène un combat méritoire, souvent au péril de sa vie, contre les bandits qui terrorisent la population.
Mais dans ce pays où l’émotion l’emporte toujours sur la raison, le jugement public se brouille. Les réseaux sociaux transforment tout en spectacle : le vrai et le faux, le courage et l’abus, la justice et la vengeance. Et lorsque des influenceurs se permettent d’affirmer des contre-vérités sur un homme ou sur une cause, ils ne font que mêler les âneries aux mensonges les plus éhontés.
Au-delà de Muscadin
Le phénomène Muscadin en dit plus sur la société haïtienne que sur l’homme lui-même. Il révèle notre besoin désespéré de héros, notre incapacité à distinguer la foi en la justice de la fascination pour la brutalité. Nous cherchons un sauveur là où nous devrions bâtir des institutions, et nous confondons la ferveur avec la conscience.
Les Haïtiens, dans leur immense majorité, sont toujours à la recherche d’un messie, d’un prophète politique capable de leur redonner la fierté, la paix dans les cœurs et la sécurité dans les rues. Mais cette quête désespérée d’un sauveur empêche souvent de voir plus loin : le phénomène de l’insécurité n’est pas un simple désordre, il participe d’un véritable projet d’anéantissement du peuple haïtien.
Lorsque des groupes armés brûlent les récoltes de riz dans l’Artibonite, ils ne font pas que semer la terreur : ils exécutent un plan de destruction économique et sociale. Ces gangs ne sont plus seulement des bandits ; ils sont devenus des mercenaires, des instruments entre les mains d’intérêts obscurs, locaux et étrangers. Leur mission est claire : affaiblir, désarticuler, déshumaniser le pays.
Au-delà de Muscadin et des irrationalités politiques qui agitent notre imaginaire collectif, il faut comprendre que l’insécurité haïtienne est avant tout une politique — une stratégie de déstabilisation téléguidée par des tuteurs internationaux bien installés dans leurs privilèges. Et tant que nous continuerons à chercher des sauveurs au lieu de bâtir des institutions, tant que nous préférerons les héros aux idées, Haïti restera prisonnière de cette spirale tragique où la misère nourrit la peur, et la peur justifie la servitude.
Ce qui rend la situation plus tragique encore, c’est le silence de la gauche haïtienne. Celle qui aurait dû monter au créneau pour défendre le principe du droit à la vie, pour rappeler que la justice ne saurait se confondre avec la vengeance. Mais cette gauche, compromise, fatiguée, désorientée, a perdu son souffle et son créneau idéologique. Elle n’a plus la force ni le courage de défendre les valeurs qu’elle prétendait incarner.
Ainsi va Haïti : un pays en quête d’ordre, de dignité et de salut, mais qui, faute d’un vrai projet collectif, se condamne à adorer ses ombres au lieu de bâtir sa lumière.
Maguet Delva