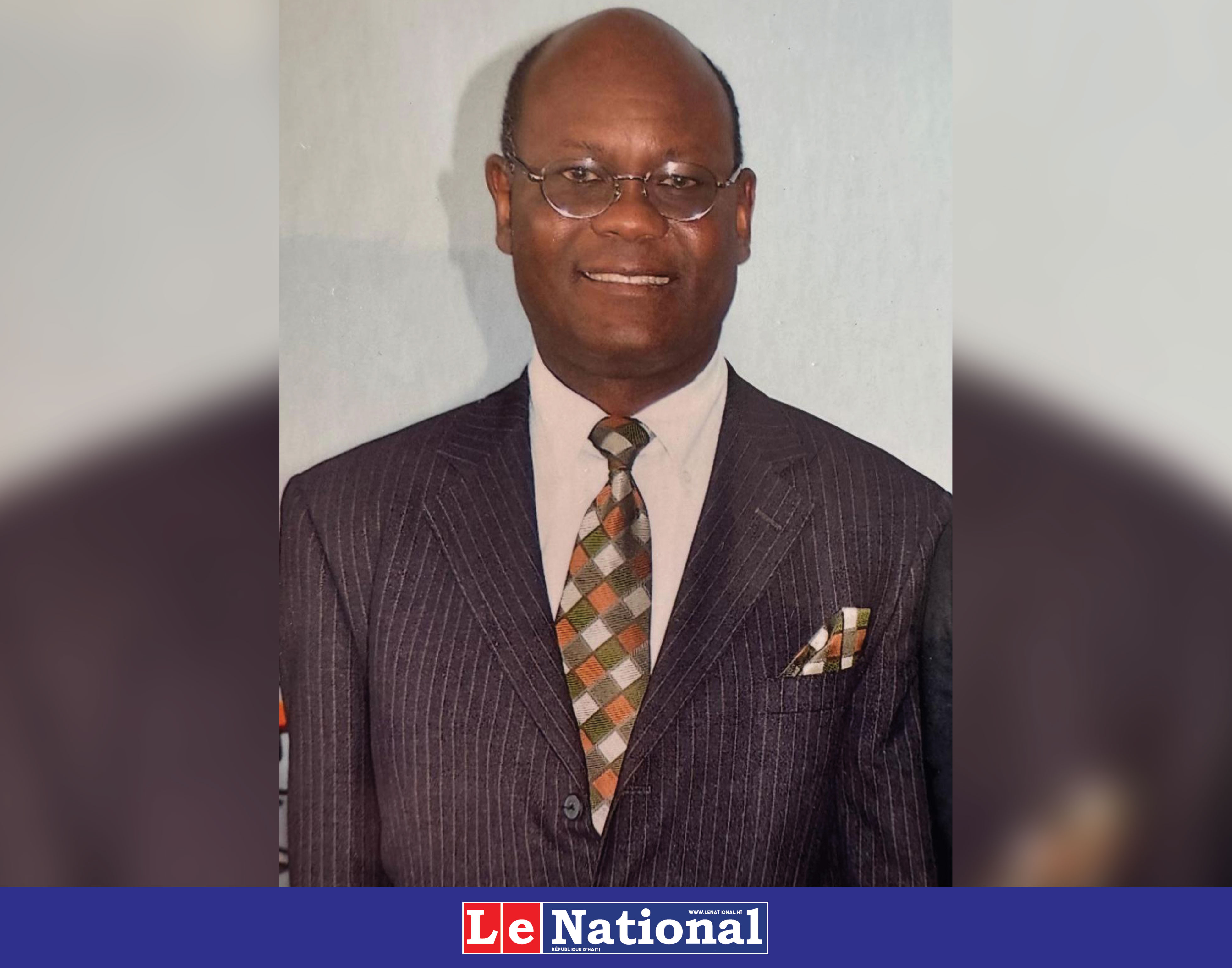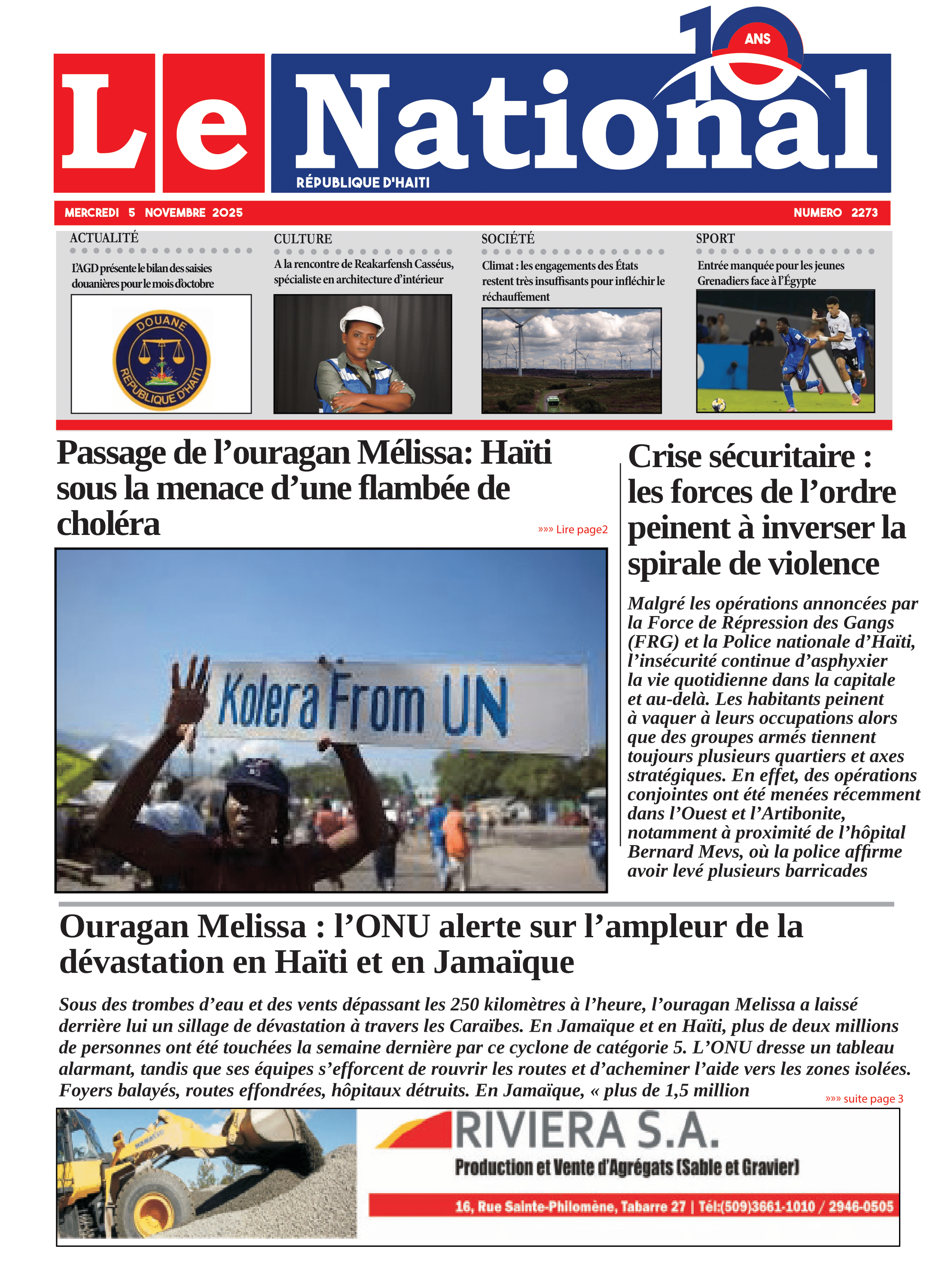Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016, l’ouragan Matthew ravageait la côte sud du pays : 500 morts, 400 blessés et plus de 175 000 sans-abris. Près d’une décennie plus tard, Mélissa met à son tour en péril les structures fragiles et les ressources techniques d’Haïti, affectant durement les départements, communes, sections communales et bidonvilles.
Une fois n’est pas coutume : le malheur du peuple n’a jamais été un palliatif durable dans le cadre d’une campagne électorale. Cependant, en 2015, les problèmes sociaux, politiques et économiques du pays avaient offert une opportunité inattendue à la candidature de Jovenel Moïse, lui permettant de mener une campagne largement déséquilibrée face à ses concurrents.
En pleine présidentielle, le passage du cyclone Matthew devint une double occasion : pour les partis, celle d’afficher leur solidarité envers les victimes tout en se rapprochant des électeurs ; pour Jovenel Moïse, celle de transformer la catastrophe en tremplin politique. Grâce à une campagne de proximité dans les zones sinistrées, il parvint à gagner le cœur d’une population meurtrie, perçue davantage comme victime que comme électorat.
Aujourd’hui, le cyclone Mélissa ne peut, pour l’instant, occuper le même rôle. Il aurait pourtant pu être un moment de reconnexion avec un électorat épuisé, dispersé par les gangs, accablé par la misère, et composé en grande partie de citoyens privés de vote depuis plus d’une décennie.
Le contraste est saisissant : hier, un candidat avait su tirer profit d’une catastrophe pour consolider sa légitimité ; aujourd’hui, aucun parti ne semble capable de transformer le chaos en projet politique. Mélissa n’a pas seulement balayé des maisons et des routes — elle a mis à nu l’effondrement du système partisan et la disparition du souffle démocratique.
Haïti est décidément un pays à part, car il parvient souvent à déjouer les règles établies : les mêmes circonstances n’y produisent pas toujours les mêmes effets. Ainsi, Melissa n’a pas eu l’impact qu’avait eu Matthew dans le contexte électoral. Si feu le président Jovenel Moïse avait bénéficié de la catastrophe naturelle de 2016, la situation actuelle est bien différente.
Le temps, la pauvreté et l’insécurité semblent avoir détruit toute capacité d’innovation politique. Les partis, désagrégés, sans ressources ni visibilité, peinent à se relever. L’inaction généralisée face aux conséquences du cyclone Mélissa révèle une scène politique en état de coma civique. On se demande comment organiser des élections d’ici deux ou trois mois, alors que ni les partis ni le CEP ne sont réellement opérationnels ? Tous deux envoient les mêmes signaux d’impuissance.
Quelques formations tentent, tant bien que mal, de maintenir une présence : réunions virtuelles, initiatives civiques, universités d’été. Quelques leaders progressistes exploitent leurs réseaux pour ne pas disparaître de la mémoire collective, mais le souffle politique s’est éteint.
« Plus d’argent sale »
Deux thèmes oubliés reviennent sur la scène en cette période préélectorale. D’une part, l’accent est de nouveau mis sur le lancement du programme de renforcement des capacités des partis politiques. Leur nombre pléthorique ne semble guère émouvoir les autorités, qui annoncent une enveloppe de trois milliards de gourdes destinée à les soutenir. On ignore encore selon quels critères ces fonds seront répartis entre autant de bénéficiaires potentiels.
D’autre part, le refus de l’« argent sale » s’impose désormais comme mot d’ordre. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a été catégorique sur ce point. C’est la deuxième fois dans l’histoire électorale récente qu’une telle alerte est lancée avec insistance. La première remonte à la présidence de Michel Martelly. De 1987 à 2010, le contrôle du financement des campagnes était quasi inexistant. Certes, la loi existait, mais elle restait inefficace.
Désormais, le processus électoral doit être transparent : l’argent issu de la drogue, du blanchiment ou de toute autre source illégale est strictement interdit. Le droit au financement des partis politiques doit aller de pair avec le respect du plafond légal et des règles établies.
Le premier grand scandale de financement douteux éclata entre 2010 et 2013, lors de la campagne de Michel Joseph Martelly et de la professeure Mirlande Manigat. Tous deux avaient reçu des fonds provenant d’entreprises dominicaines appartenant à des hommes politiques. Madame Manigat avait d’ailleurs reconnu publiquement avoir accepté ces financements.
Aujourd’hui, la vigilance de l’ULCC et des institutions concernées marque une avancée notable dans le contrôle du financement électoral, afin d’empêcher l’utilisation de fonds suspects et de limiter la prolifération des armes, de plus en plus utilisées par certains candidats pour influencer le résultat du scrutin, que ce soit dès le premier tour ou pour se placer en position favorable au second.
Peut-on rêver d’élections libérées de la corruption, de l’argent sale et de la violence armée ? Qu’on se souvienne des élections qui se jouaient selon la loi du plus fort, lorsque certains candidats faisaient appel à des bandits pour semer le désordre dans les bureaux de vote favorables à leurs adversaires.
Faut-il dès lors espérer, sinon un miracle, du moins une véritable reconstruction morale et politique du pays ? Comme l’écrivait Frankétienne : « Le rêve est incontestablement le premier des chemins qui conduisent à la liberté. Rêver, c’est déjà être libre. »
Et si, malgré tout, nous continuons à croire à la possibilité d’un scrutin, ne serait-ce que pour mai prochain, c’est peut-être parce que, comme le rappelait le professeur Grégoire Eugène, « le miracle haïtien est possible ».
Emmanuel Charles
Avocat et spécialiste des élections