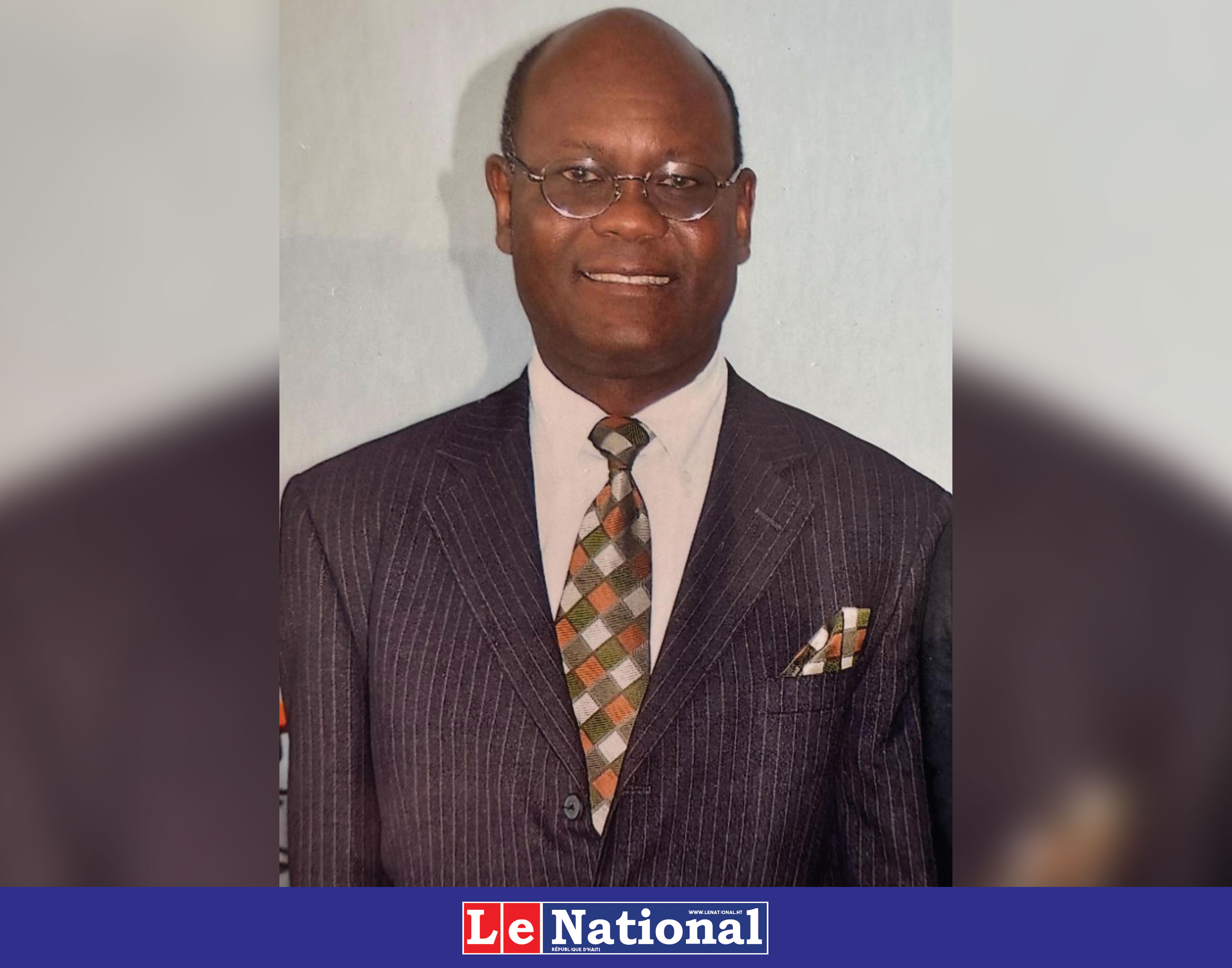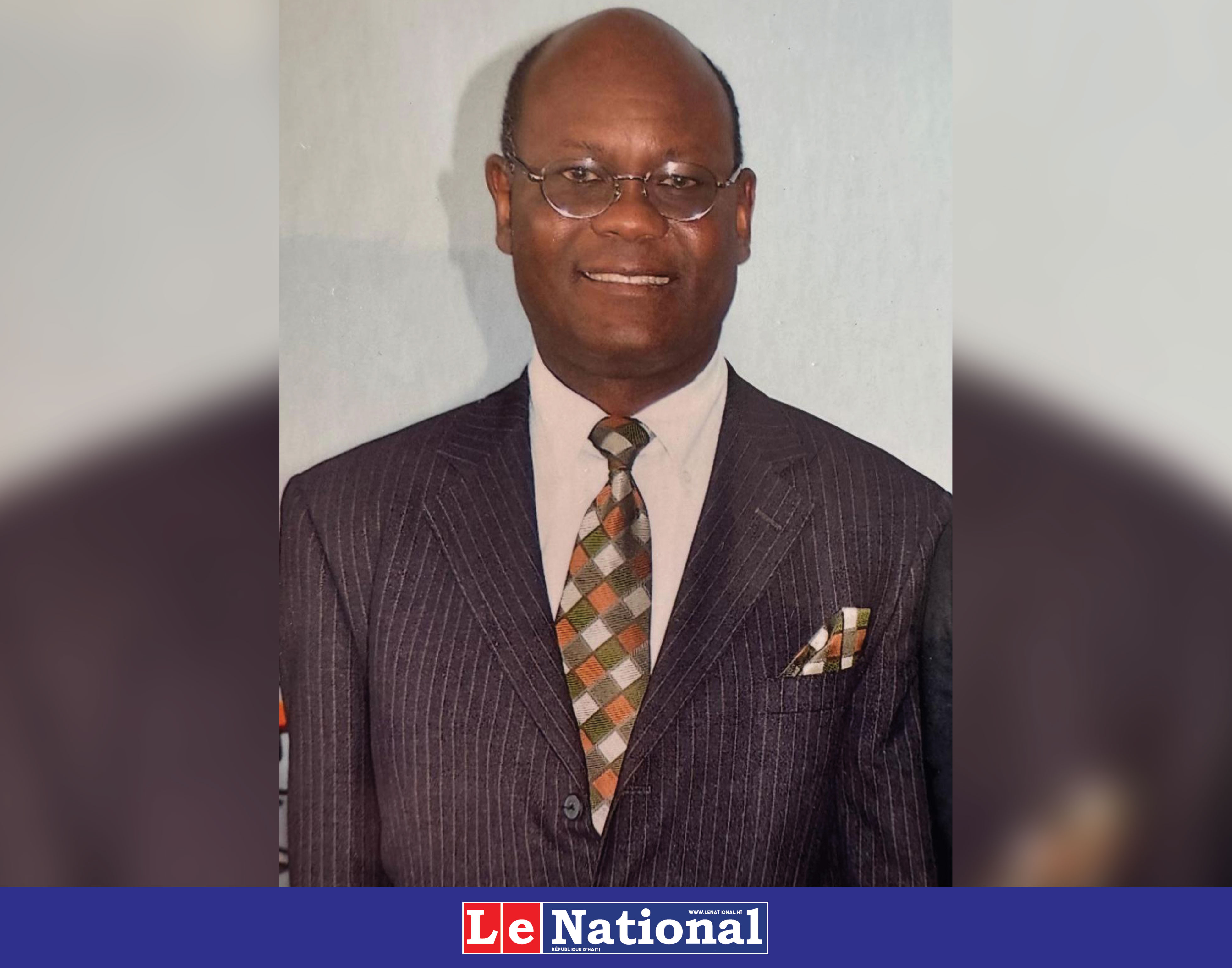Le Conseil électoral provisoire (CEP) s’est récemment adressé aux partis politiques, à la société civile et à d’autres acteurs concernés au sujet du projet de décret encadrant les prochaines élections. Il a ainsi lancé une consultation publique afin de recueillir leurs avis et contributions — un coup d’essai pour tâter un terrain miné par des circonstances indépendantes de sa volonté.
Cette initiative constitue un véritable test pour les formations politiques du pays, dont le « domicile » semble désormais se situer sur les réseaux sociaux. Car, à l’instar de nombreux électeurs, la plupart de leurs membres vivent aujourd’hui sous des tentes ou dans des abris de fortune.
Cependant, sur le plan administratif, il paraît inconcevable d’informer les hommes et femmes politiques que, s’ils souhaitent participer aux prochaines élections, ils sont invités à retirer une version imprimée du projet de décret au siège du CEP, situé au 72, rue Stephen Archer, à Pétion-Ville. D’ailleurs, la distribution a déjà débuté depuis vendredi dernier.
Selon les dernières statistiques publiées par le journal Le Nouvelliste, Haïti compte actuellement plus de 220 partis politiques enregistrés, dont la majorité demeure marginale dans le paysage électoral. Cette prolifération de partis politiques ne manquera sans doute pas de provoquer un conflit administratif entre les formations politiques et l’organisme électoral.
Sur le plan légal, indépendamment du nombre pléthorique de partis politiques, il revient au Conseil électoral provisoire (CEP) d’acheminer les invitations à leur siège social ou à leur adresse électronique. Cependant, compte tenu de l’urgence, cette procédure se heurte à plusieurs contraintes : l’insécurité généralisée, le changement forcé de domicile des institutions et des électeurs, ainsi que la désorganisation territoriale croissante.
Les deux plus grands départements, qui représentent plus de 60 % de l’électorat, sont aujourd’hui sous le contrôle des groupes armés : il s’agit de l’Ouest et de l’Artibonite, sans oublier le Centre et certaines communes du Nord également menacées.
Le CEP se dit prêt à 85 %, fort d’un budget de 65 millions de dollars américains pour les élections, auxquels s’ajoutent trois milliards de gourdes pour la formation des partis politiques. Des montants considérables, qui soulèvent pourtant la question de la transparence et de l’efficacité dans leur utilisation.
Mais le pire demeure : comment l’organisme électoral compte-t-il instaurer la confiance des partis politiques, de l’électorat et même de la communauté internationale, pour garantir le bon déroulement du scrutin dans un contexte d’insécurité infernale, aujourd’hui orchestrée par le groupe armé Viv Ansanm ?
Toutefois, je profite de l’occasion pour saluer l’initiative du CEP, qui a procédé au lancement du programme de renforcement des capacités des partis politiques, comme je l’ai d’ailleurs recommandé dans mon récent article intitulé « Lettre ouverte aux futurs candidats à la présidence et aux dirigeants de partis politiques », publié le 28 octobre 2025.
Je réitère ma proposition au CEP d’insister, au cours de ces séances de formation, sur la nécessité pour les partis politiques de même tendance idéologique de se regrouper sous la bannière d’une plateforme ou d’un bloc politique. Une telle démarche permettra, à coup sûr, d’éviter toute confusion chez l’électeur, appelé à choisir un candidat parmi plus de deux cents pour un même poste, et contribuera également à réduire les coûts financiers liés à la préparation des bulletins dans le budget électoral.
Le problème de domicile
Toute personne non astreinte à un domicile légal possède un domicile de fait. Lorsque la cause ayant fondé le domicile légal disparaît — comme c’est le cas pour plusieurs partis politiques, organisations de la société civile, électeurs et autres victimes du phénomène des gangs, de l’expropriation violente et du déplacement forcé —, le domicile de fait correspond généralement à l’ancien domicile légal.
Ainsi, on peut dire que le terme « domicile » revêt ici un sens large, désignant non seulement une adresse fixe, mais également la commune de rattachement.
La situation actuelle fait que, désormais, selon la logique liée aux difficultés rencontrées par le CEP, les partis politiques et la société civile élisent domicile auprès du CEP, ce qui est anormal pour une institution d’arbitrage censée assurer un fonctionnement impartial et efficace.
Il serait plus logique de parvenir, au préalable, à une entente avec les partis politiques afin que, pour les correspondances électorales, ils élisent domicile dans les mairies ou auprès d’autres institutions publiques, telles que l’Office de la protection du citoyen (OPC).
D’après moi, le risque de conflit d’intérêts est manifeste dans la mesure où le CEP, durant le processus électoral, devient de facto un tribunal chargé de trancher les litiges face aux réclamations des formations politiques. C’est la raison pour laquelle le siège de l’organisme électoral ne saurait être utilisé comme lieu de réception des courriers susceptibles d’intégrer, à tout moment, une procédure administrative ou judiciaire liée aux conflits électoraux. Les hommes et femmes de loi, les avocats militants, les juristes et les magistrats saisiront aisément la portée de ces remarques pertinentes, auxquelles ils seront nécessairement confrontés dans ce processus inédit. Le travail du CEP n’en sera que plus complexe.
Résidence et domicile
Pour l’heure, la loi haïtienne ne confond pas la résidence et le domicile. C’est le domicile, et non la résidence, qui conditionne l’exercice du droit de vote. Non seulement la loi distingue clairement ces deux notions, mais elle les applique différemment dans les actes judiciaires, les introductions d’instance, ainsi que dans les actes d’état civil et notariés, où l’on lit souvent : « demeurant à (…) » et « domicilié à (…) ».
Il convient donc de faire également la distinction entre “abri de fortune” et “domicile”, non seulement pour les électeurs, mais pourquoi pas aussi pour les candidats ?
Les tensions et conflits électoraux sont, pour la plupart, de nature pénale, à quelques exceptions près qui relèvent du droit civil, telles que les questions d’état civil, de nationalité, de domicile ou de résidence.
Les changements de domicile constituent souvent l’une des principales causes de contentieux électoraux — et ils le resteront. Ces rappels ont pour but de souligner aux responsables électoraux et aux partis politiques qu’en droit pénal, l’interprétation est stricte, à l’instar d’une radiographie : rien ne s’y lit librement.
Aujourd’hui, le paysage électoral a profondément changé sur la question du domicile. Aucune loi spécifique n’a encore été adoptée pour désigner exceptionnellement des lieux tels que les placements, abris de fortune ou zones de déplacement temporaire comme nouveaux domiciles électoraux. Pourtant, les conflits électoraux continueront d’être jugés selon la notion traditionnelle de domicile, telle que définie autrefois de manière péremptoire par le Code civil et le Code pénal.
Les cyclones anthropiques « à sec » (violences armées) et les cyclones pluvieux (catastrophes naturelles) frappent durement un électorat souvent vulnérable, incapable de conserver ses documents officiels dans des conditions sûres. Cette précarité ne fait qu’aggraver un état civil déjà fragile, miné par des problèmes structurels persistants. les cartes d’identification nationale « dermalog ». Ce document, très critiqué lors de son introduction, est devenu aujourd’hui indispensable et constitue une référence essentielle pour toute démarche administrative. Quel pays !
Mais il y a aussi la volonté des gangs
Cette carte contient des informations essentielles relatives à la justification de l’ancien ou du nouveau domicile. Mais, quelle que soit la mention qui y figure, elle restera peu fiable et toujours provisoire, car elle dépend, dans bien des cas, de la volonté des gangs, dont l’un des chefs a récemment déclaré sur les réseaux sociaux : « Nous n’avons pas donné l’autorisation pour l’organisation des élections. »
Puisqu’ils n’ont jamais démenti leurs propos, il y a de quoi craindre que de nombreux électeurs, qu’ils soient futurs votants ou non, soient contraints de changer constamment d’abris de fortune. Le contexte sécuritaire vient aggraver les difficultés déjà existantes. Le pays fait face à une prise de contrôle quasi totale de gangs armés sur de vastes zones urbaines et rurales, en particulier dans la capitale Port-au-Prince et ses environs. Les violences, les enlèvements et les blocages routiers entravent la libre circulation des citoyens et compliquent considérablement la logistique électorale, nourrissant un climat d’insécurité généralisé qui pèse lourdement sur la préparation et la tenue prochaine des élections, comme le rapporte le journal en ligne Capital Info.
À chaque tracasserie administrative ou pèlerinage forcé dicté par les circonstances, émerge un nouveau phénomène : celui de l’existence de plusieurs statuts précaires au sein d’un électorat livré à lui-même — ni véritablement gouverné, ni reconnu comme futur votant — alors même qu’il constitue l’un des moteurs centraux de la machine électorale.
Une chose que les politiques doivent savoir : la légitimité du personnel élu ne repose pas uniquement sur les articles de la Constitution, mais aussi sur le nombre réel et suffisant de votants. Or, en Haïti, le vote n’est pas obligatoire, ce qui crée une contradiction juridique entre la légalité et la légitimité. Cette question devra, à l’avenir, être approfondie, dans le cadre d’une intégration citoyenne plus inclusive, en faveur de la démocratie et du respect effectif des droits électoraux.
Dr. Emmanuel Charles,
Avocat et spécialiste des questions électorales