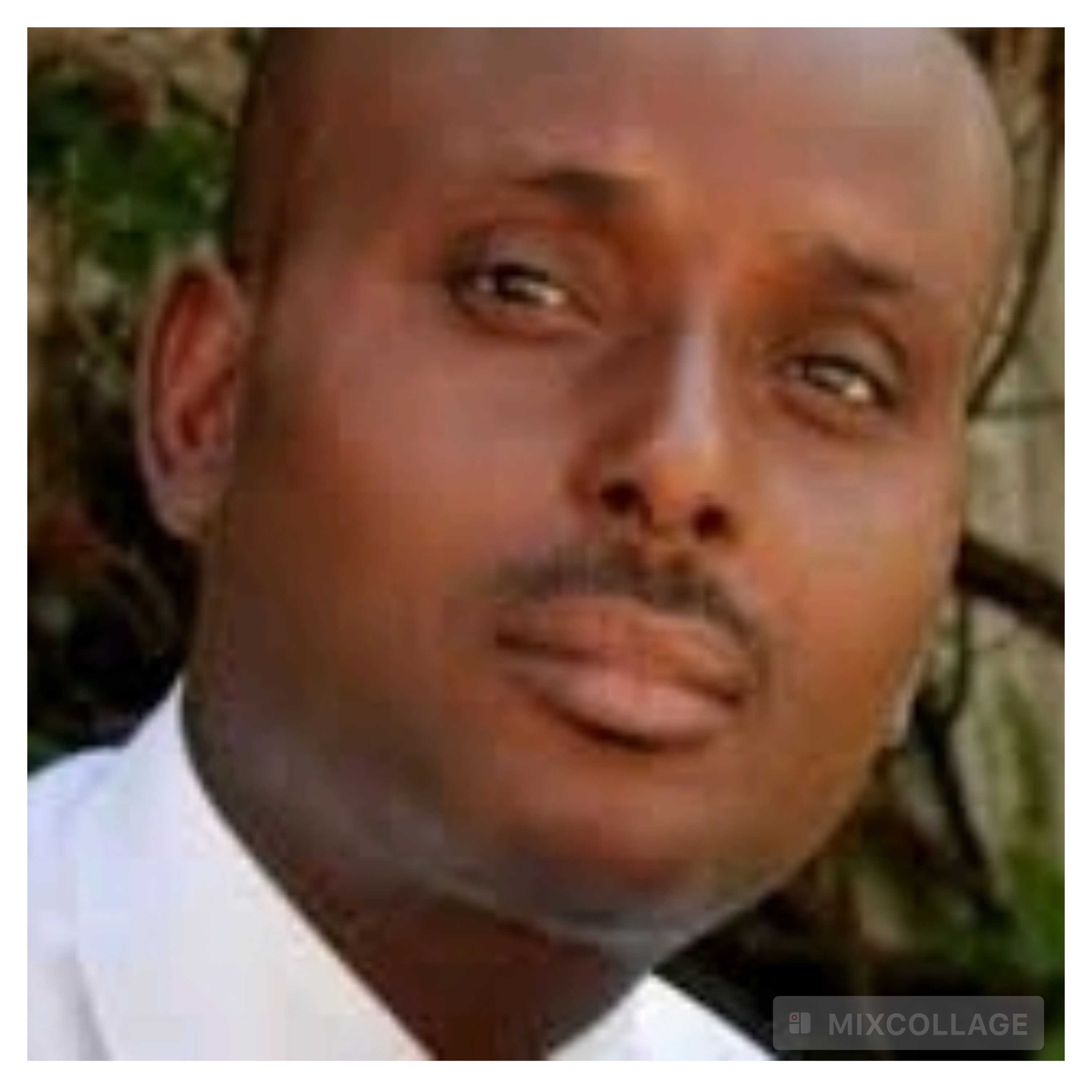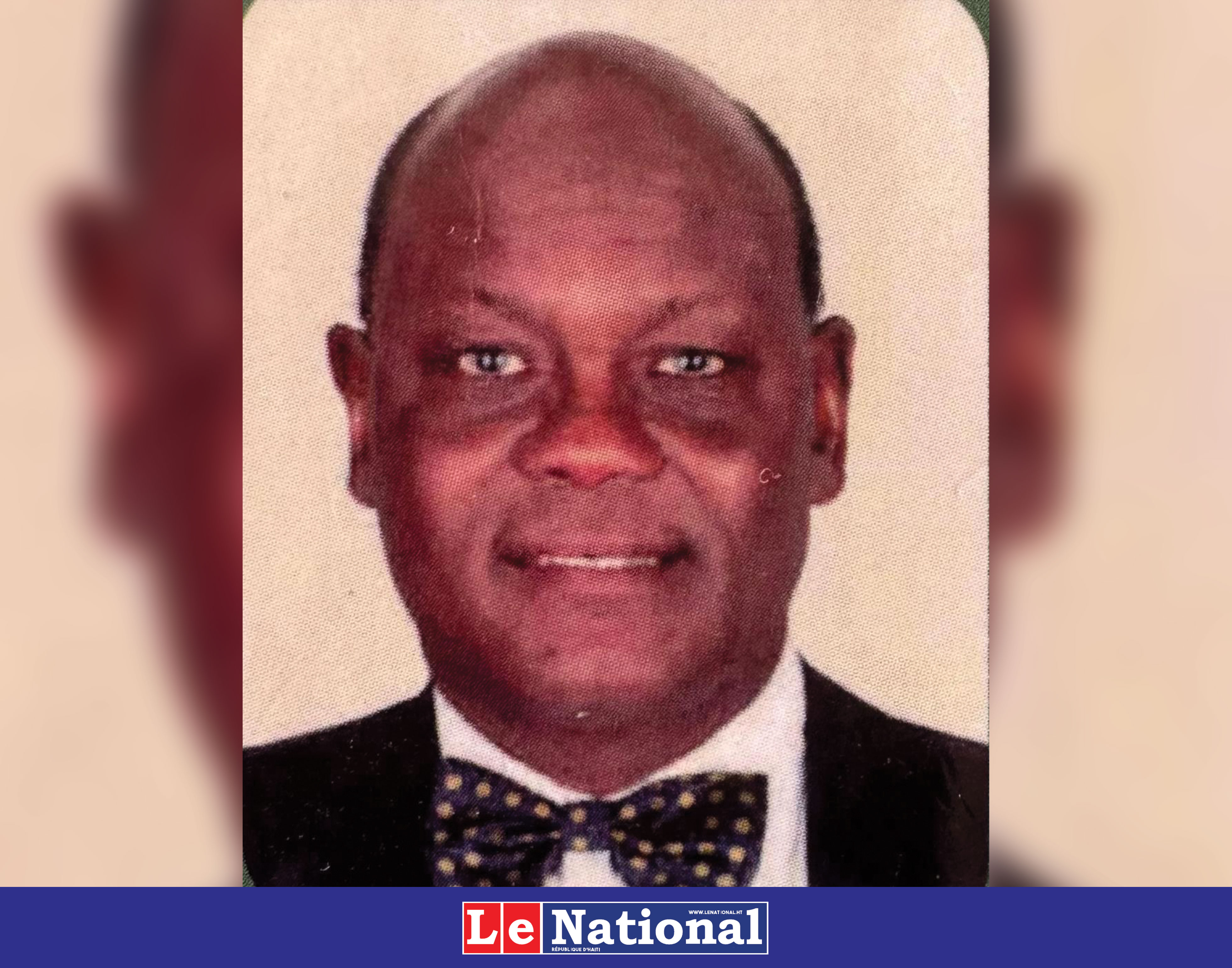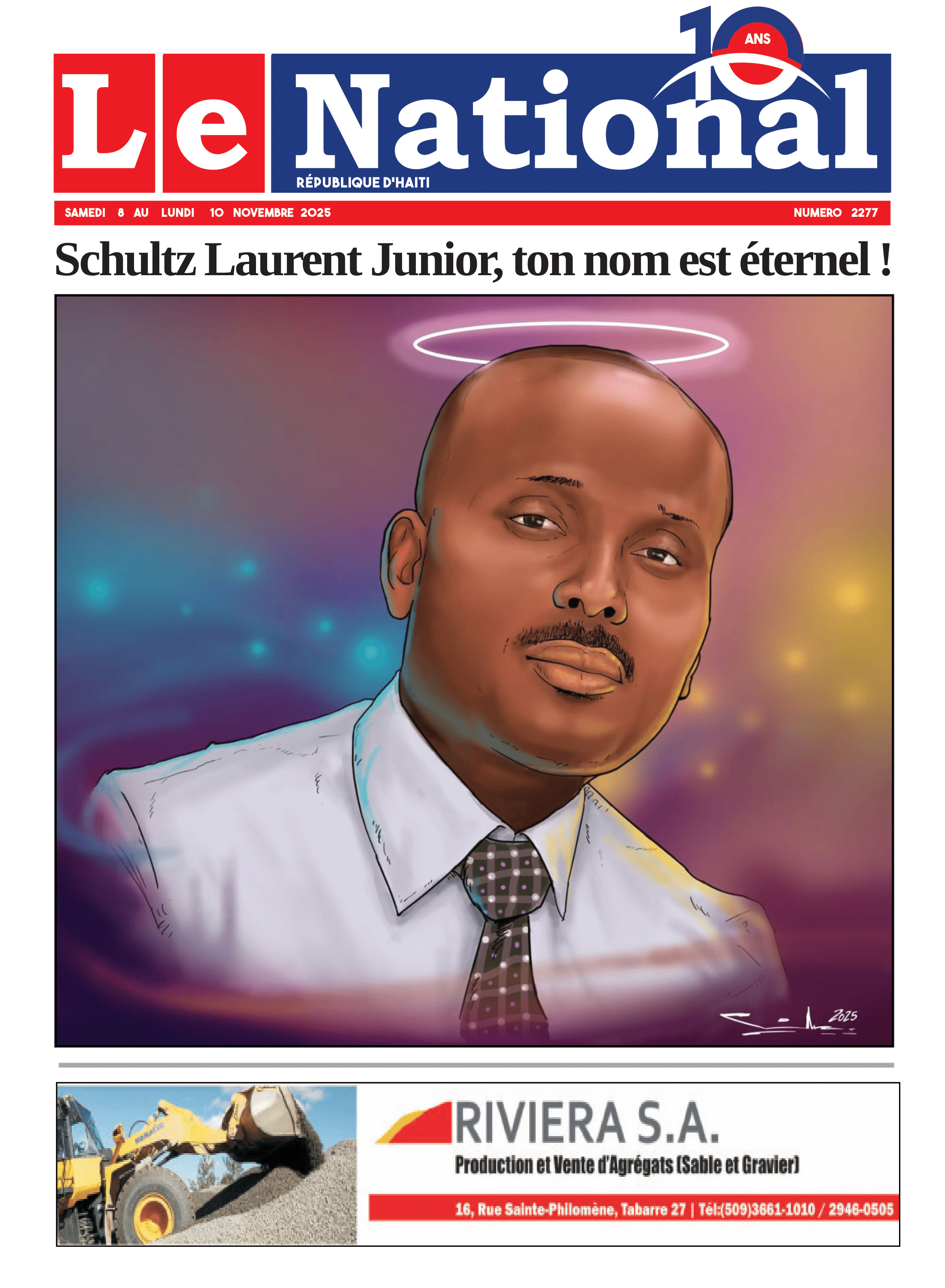Première partie
Résumé
L’objet central de cet article est de soulever une réflexion critique sur la Note #4 de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME), publié le 25 mars 2025. L’article aborde la Note comme une stratégie instrumentale de construction d’un ordre du discours et de cadrage de l’action néocoloniale, reflétant les arguments paternalistes et les tactiques de diversion pour liquider les demandes de restitution et réparation faites par les Haytien.n.e.s à l’État français pour les crimes liés à l’esclavagisation et au rançonnage de 90 millions de francs-or imposés au nouvel État anti-esclavagiste d’Hayti le 17 avril 1825. En inscrivant le contenu de la Note dans le cadre de la politique franco-française de l’histoire longue, il est clair que l’enjeu principal de cette Note est un étouffement de revendications légitimes de la restitution financière de 90 millions de francs, et ses conséquences, comptabilisées à 115 milliards de dollars US en mai 2022.
Introduction
À l’aube du bicentenaire de l’ordonnance d’indemnité de 150 millions de francs-or du 17 avril 1825 (ramenés à 90 millions de francs-or en 1838), faite par l’État français afin d’asphyxier la souveraineté d’Hayti — acte fondateur d’une spoliation économique auto-légalisée, donc qui a inauguré ce que Walner Osna (2019) appelle « la traduction de la colonialité dans les actions politiques » —, en France, la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME). C'est une institution créée à Paris (Hôtel de la Marine) en novembre 2019. Elle est réputée, selon Caraib Creole News, pour son quasi absence de représentativité de professionnel.l.e.s déscendant.e.s. des sociétés anciennement colonisées par la France. Ces dernières étudient et travaillent sur les questions de l’esclavagisation et de la commercialisation des personnes. Alors que cette institution vient de publier le 25 mars 2025, une Note de 32 pages présentée comme un pas vers un « avenir fondé sur la reconnaissance et la justice ».
Cependant, derrière les bonnes intentions affichées, l'on se demande pertinemment, qu'est-ce qui se cache derrière la performativité de cette Note ? L'on comprendrait qu’en évitant soigneusement les termes « rançon », « restitution financière », « formulation d’un cadre de restitution et de réparation, d’abord par les Haytien.n.e.s »; en substituant à la « rançon coloniale française sur Hayti » une « double dette », « proposée par Jean Pierre Boyer », la FME ne (re)produit-elle pas les mêmes mécanismes de déni des damnés et de la colonialité du pouvoir? Laquelle matrice coloniale, selon Aníbal Quijano, se fonde à ses origines sur des piliers comme la domination ethno-raciale, l’exploitation de la force du travail, le contrôle des formes de subjectivité ou l’imposition d’une orientation culturelle eurocentriste et le patriarcat (ici profondément française), de la colonialité de l’esprit et de l’action, et surtout de la colonialité du langage. Tout un processus de racialisation linguistique qui dépossède les populations des anciennes colonies de leur humanité en les assignant à une infériorité naturelle communicative et mentale, ou tout simplement ce que nous appelons, à notre manière la (re)construction-manipulation-stratégique, qui pourrait être considérée comme un processus proactive fait par des institutions et personnalités interposées. Ce, dans l’objectif de silencer des demandes de justices par des mécanismes performatifs et symboliques de normalisation et d’auto-légitimation de discours et d’actions possibles pour disqualifier les autres comme impossibles afin de protéger les biens mal acquis. Ou tout simplement, de déresponsabiliser des acteurs des crimes commises. Tout ceci afin de rendre ou d’assurer le Non-événement et donc de perpétuer les structures du pouvoir colonial silençant les faits et événements historiques qui ont étouffé des sociétés postcoloniales tel qu’Hayti depuis des siècles.
Cette analyse présente la thèse selon laquelle : La nouvelle et le contenu de la Note # 4 du FME en guise de constituer une avancée vers une justice morale, humaine, financière, écologique et matérielle globale est plutôt une tentative d'assassinat argumentatif. Celle-ci s'inscrit dans une dynamique de (re)construction instrumentale et stratégique de manipulation interposée d’institution néocoloniale de l’État français. Laquelle institution continue d’occulter et de délégitimer la principale question de la Restitution financière que la France doit à Hayti, dans un moment ô combien important, où les dépenses et remboursements des intérêts et déficits liés aux prêts pour acquitter cette rançon équivaudraient en mai 2022, à 115 milliards de dollars US, selon les calculs du New York Times.
En prenant l’attention et le recul face aux différentes catégories argumentatives de la Note, on constate et s’étonne de lire une institution franco-française comme la FME se prenne à la fois comme juge et partie qu’à chaque instant qu'il est question de réparation et de restitution pour les crimes de l’esclavagisation et de la commercialisation des personnes qui ont été l’apanage de l’ancien État colonial français. Autrement dit, la FME, une institution française crée par le Décret numéro 2019-1166 du 12 novembre 2019, afin de ne pas réparer et restituer les crimes coloniaux, mais de promouvoir Selon Caraib Creole News « la cohésion nationale française » sur « l’identité mondiale française issue de quatre siècles de relations entre la France, l’Afrique, l’Amérique, les Caraïbes et l’Océan Indien ». Ce fasaint, cette FME se place au-devant de la scène et évite de laisser à Hayti, aux Haytiennes et Haytiens le droit de décider que faire, comment faire et quelles formes que peuvent prendre la Restitution et la Réparation de ces 90 millions de francs-or imposé par la France pendant 63 ans (1825-1888). Ainsi, la partie de la FME se prenne-t-elle pour juge à travers cette Note et évite la possibilité aux victimes et descendant.e.s. de la colonisation et de l’esclavagisation française d’Hayti de décider quelles formes de justice envisageable permettant de réhabiliter les crimes contre l’humanité; non pas de l’esclavage mais de l’esclavagisation; et, non pas de la traite négrière, mais de la commercialisation des personnes humaines d’origines africaines, pour reprendre la perfornativité de catégories lexicales de Sebastien Lefévre (2021).
Cela étant, une thèse est posée, l’idée que la Note #4 de la FME remplace systématiquement le terme « rançon » (une seule occurrence sur 32 pages) par « dette » et/ou « double dette » (37 occurrences sur 32 pages). Si tant est que le vocable rançon, fasse référence au paiement exigé en échange de la libération d’une personne ou d’un bien ou le lexique d’extorsion, désignant : une situation où une personne ou un pays impose, par la force ou la menace, le versement d’une somme d’argent ou la réalisation d’une action; et que le vocable de dette renvoie quant à lui à une somme d'argent, un dû, un emprunt ou un passif, en son sens premier, que l'on doit à quelqu'un à qui on l'a empruntée (créancier), qu'il devra en retour rembourser (débiteur); en ce sens, cet acte consenti juridiquement devient un devoir hautement qualifié d’intérêt capital qui est fait au débiteur de se sentir lié à une exigence d’une forme d’obligation morale. Alors, l'on comprend que les 37 occurrences du vocable de dette et/ou double dette vers une seule occurrence pour le vocable de rançon témoigne déjà comment la performativité de la Note de la FME tente de diluer ainsi la responsabilité unilatérale de la France. Ce glissement sémantique transforme la signature forcée de l’ordonnance de la France par Hayti en 1825, un acte de coercition militaire : 14 navires de guerre, armées de 530 canons dans la rade de Port-au-Prince en 1825, en une transaction économique d’abord voulue et proposée par Hayti.
Il est crucial de se demander alors pourquoi la FME occulte-t-elle ce que Marcel Dorigny (2021) appelle De l’arrogance coloniale à la tentative d’intégration post-coloniale (1804-1825) ? L'auteur essaie de décrire les « différents projets français de destruction de l’indépendance d’Hayti, soit par une armée de 40 000 hommes et une guerre d’extermination totale, retracés dans des lettres, pamphlets », soit par « les trois missions envoyées par le roi Louis XVIII de France aux autorités haytiennes pour réinstaurer les lois coloniales et esclavagisantes pré-révolutionnaires de 1791 ». Ou encore, soit « la décision unilatérale de la France, par la mains du roi Charles X d’imposer de lourde indemnité et privilèges aux commerces français afin de reconnaitre l’indépendance d’Hayti » .
En revanche, cet arrogance coloniale à la tentative d’intégration post-coloniale (1804-1825) est très documentés surtout par des chercheur.e.s historien.ne.s et journalistes scientifiques comme dans la série d’articles de Catherine Porter, Constant Meheut, Selam Gebrekidan, et Matt Apuzzo, publiée dans le Journal The New-York Times titré : The Ransom Project, en mai 2022, et François Blancpain, dans le livre intitulé : Un siècle de relations financières entre Haiti et la France (1825-1922), publié en 2001 ou Marcel Dorigny, Jean-Claude Bruffaerts, Gusti-Klara Gaillard, et Jean Marie Théodat (dir.), nommé : Haïti-France. Les chaînes de la dette. Le rapport Mackau (1825), en 2021 etc.
En qualifiant cette extorsion de « dette », et de « double dette », de proposition de l’État haytien par Jean Pierre Boyer, en lieu et place, de « rançon » et de « volonté délibérée de l’État français de boycotter par le moyen du rançonnage toute possibilité de souveraineté haytienne » et « d’emprise sur la finance et le commerce extérieur haytien », « d’agression de guerre militaire en cas de refus de l’ordonnance d’indemnité par la nation haytienne, avec la flotte navale française, présentée dans la rade de Port-au-Prince et composée de 14 navires de 530 canons » la Note de la FME ne légitime-t-elle pas, a posteriori, un crime financier sur Hayti ? Lequel crime, en revanche, selon Pierre-Yves Bocquet (2025), Directeur adjoint de la FME, a forcé à cette jeune nation de verser 112 millions entre 1825 et 1888 à l’État français et aux banquiers français sous la pression des armes et dans la droite ligne de l’idéologie de la négation des valeurs de la liberté générale de la Révolution haytienne dans ce contexte du bicentenaire l’ordonnance de l’ordonnance de Charles X en date du 17 avril 1825.
- Réparations sans Restitution financière : une diversion franco-française
1.1. Paternalisme et esquive diplomatique
La Note est sciemment élaborée pour liquider la question de la Réparation et Restitution sur des termes farfelus et purement franco-français, donc néocoloniaux. Des arguments paternalistes comme les réparations culturelle, scientifique, patrimoniale, politique et diplomatique, lesquelles argumentaires ne donnent aucunement préséance aux demandes Haytiennes de restitution et réparation financière et les conséquences de crimes de la France sur Hayti leurs places méritées, bien que ces crimes ne sauraient réparer que par la question financière ou par une approche purement comptable. Ainsi, la colonialité de l’esprit et de l’action, qui peut être considérée comme l’ensemble de structures de domination et de subalternisation épistémique, pratique propre à la modernité-colonialité, particulièrement de l’État et institutions publiques françaises, n’est-elle pas l’aune avec laquelle faudrait-il mesurer cette Note ?
Car, la vraie question de la Réparation et Restitution pour les crimes de l’esclavagisation et de la commercialisation sur le territoire haytien ne saurait se résumer à la question financière de 90 millions de francs-or de rançon que la France (ou, au 112 millions de francs-or lorsque l’on ajoute les versements d’Hayti aux banquiers français) doit au peuple haytien, si tant qu’en signe de respect et de justice. Toutefois, à plusieurs reprises, cette question fondamentale a été boycottée par une stratégie de déresponsabilisation globale et surtout financière de la France et de l’État français ou de ses banquiers. La Note de la FME précise, si tant est que, ce soit la classe politique et de la bourgeoisie française qui aie proposé et bénéficié les rentres de la rançon que l’État français a imposé sur Hayti. Mais au lieu d’inciter l’État français à Réparer et Restituer globalement ses dûs aux Haytien.n.es et aussi cette somme « exorbitante » et d’assumer ses conséquences financières qui sont évaluées en mai 2022 par des spécialistes du New York Times à 115 milliards de dollars US (susmentionnés), et bien, la FME a préféré d’écrire : « la France pourrait proposer la mise en place d’un fond universel auquel plusieurs pays, organisations internationales et fondations pourraient contribuer, pour rebâtir Haïti. » (FME, p. 25). (C’est nous qui le soulignons)
Dès lors, l’on comprend rapidement pourquoi le comité de rédaction de la Note de la FME (composé de neuf personnalités pour la plupart français.e.s), n’a aucunement intégré ni la présence ni la contribution d’un groupe de chercheur.e.s haytien.ne.s. Pourtant ce dernier, travaille professionnellement sur cette question depuis des années. Bien que le nom d’un géographe haytien soit dans la liste, ceci est bien entendu une exception, non la norme. Ne s’agit-il pas d’une « injonction à la réconciliation » où la France définit seule, ou majoritairement les termes des réparations, tout en silençant la question fondamentale de la « restitution financière de 90 millions de francs-or de la rançon dont ce 17 avril 2025 marquera les 200 ans » ? En proposant un fonds universel alimenté par des acteurs multiples (FME, p. 25), la FME ne décharge-t-elle pas subtilement l’État français de sa dette exclusive (au sens globale), comme l’avait déjà fait le Rapport Régis Debray en janvier 2004 pour enterrer les demandes du dû de 21.685.135.571, 48 dollars US (sensiblement 21.7 milliards) que la France devait au peuple haytien, telle que comptabilisée pour l’année 2003 ?
Pour comprendre cette opération d’universalisation et d’abstraction dans les termes de cette Note, donc de boycottage de la responsabilité publique et personnellement de l’État français dans la prise en charge de ses propres responsabilités face aux demandes répétées d’Hayti auprès de l’État français de faire justice aux crimes du passé mais surtout de réparation et restitution de 90 millions francs dû au peuple haytien, il faut songer au Rapport de Régis Debray de 2003-2004, élaboré pour boycotter les demandes officielles d'Hayti.
Demandes qui ont été clairement formulées par le gouvernement de Jean Bertrand Aristide pour que la France puisse enfin en 2003, réparer et restituer les 21.7 milliards US. L’équivalent de dépenses que l’État français a rançonné par la force des armes à Hayti, par son ordonnance du 17 avril 1825, malgré les précédents crimes de la période de la traite des noirs et de l’esclavagisation de personnes noires et de réparer les crimes moraux, humains, économiques, financiers, commerciaux, écologiques, culturels, linguistiques, épistémiques et philosophiques. Si tant est que, le principal responsable, auteur de ces crimes soit encore existant, partant du principe de la continuation de l’État, donc l’État français doit répondre à ses crimes. Alors qu'il préfère utilisé des arguments farfelus qui ont été déjà évoqué dans le Rapport de Régis Debray. Lequels arguments ont été reconduit par la FME dans sa Note pour faire obstacle à la légitimé de principales demandes de restitution et réparation venant d’Hayti depuis plus de deux décennies. Lesquelles demandes l’État Haytien continue d’adresser particulièrement à la France surtout ces dernières années, tant par les écrits de Fritz Alphonse Jean (2021), aussi dans les allocutions d’Edgard Leblanc à l’ONU en (2024), de Leslie Voltaire, à l’occasion de la 221ème anniversaire de l’indépendance d’Hayti, le premier janvier (2025) et des organisation et personnalités tant nationales, régionales, et internationales.
Ainsi, cette Note de la FME est une continuité du Rapport de Régis Debray de 2003-2004, un ordre du discours qui s’inscrit au sens foucaldien, dans un dispositif ou :
Un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques etc., bref du dit aussi bien que du non-dit […].
Lequel ordre du discours justifie d'autres discours possibles et rend les autres discours impossibles. Autrement dit, la Note de la FME, est un discours ordonné, une construction-manipulation stratégique larguée dans les couloirs de la politique étrangère de la France. Plus encore, un cadre décidant tout pour Hayti, donc déjà planifié. Pour pouvoir être le moins choquant possible, il est baptisé « La double dette d’Haïti (1825-2025). Une question actuelle », même si les termes utilisés pour dresser le diagnostic, trahissent son intention hégémonique, donc son intention néocoloniale, pour paraphraser un article de Le Nouvelliste où le journaliste Baptista B. Beaucicot a repris la conclusion de Odile Drice David, étudiante de la Faculté des Sciences Humaines (FASCH) qui a analysé le Rapport de Régis Debray en mai 2005.
1.2. Le Rapport de Régis Debray et la Note de la FME : condescendance et paternalisme
Nick Nesbitt ainsi que d’autres chercheur.e.s ont analysé le Rapport de Régis Debray et continuent encore à le faire. Étant établi collectivement sous la direction de Régis Debray à l’intention de Dominique de Villepin, dès lors ministre des Affaires étrangères de la France. Ce rapport est publié en janvier 2004, sous le titre : Haïti et la France, (H-F). Il est organisé en trois grandes parties : Constats (H-F, p. 5-42) ; Propositions (H-F, p. 51-75) ; Annexes (H-F, p. 84-97). En contenu, ce Rapport présente selon Nick Nesbitt, « une vue d’ensemble des relations franco-haïtiennes depuis 1804, ainsi qu’une série de recommandations à l’usage du gouvernement français ». Oui, destiné d’abord au gouvernement français. Mais, dès le début même du Rapport, Nick Nesbitt précise :
Le texte dégénère rapidement pour tomber dans le reproche condescendant. Rendu public dans les mois qui précédèrent l’invasion dirigée par la France pour renverser Aristide à force ouverte. Le rapport appelle les Haïtiens, avec des accents paternalistes, à « assumer leur part de responsabilités dans l’invraisemblable dégringolade qui a fait passer en deux siècles la “Perle des Antilles”, la colonie la plus riche du monde, qui assurait le tiers du commerce extérieur de la France – le Koweit du siècle de Voltaire – à un niveau de malédiction sahélien », (HF, p. 20).
De plus, publié dans le mois de janvier qui marque le bicentenaire de la Révolution haytienne, le texte de ce Rapport rappelle Nick Nesbitt :
Réduit ensuite le problème de la restitution de quatre-vingt-dix millions de francs extorqués en 1825 par Charles X aux Haïtiens en échange de la reconnaissance de leur indépendance – cause majeure et peut-être principale du sous-développement économique –, à une “campagne de propagande” sans fondement juridique (HF, pp. 21-23).
Cela étant, Nick Nesbitt argue :
Que l’affaire puisse aussi refléter l’inadéquation des normes juridiques internationales n’effleure pas les auteurs du rapport, qui ne voient dans cette revendication qu’une effrayante “boîte de Pandore” – effrayante parce que point si illégitime ? Le rapport, sur un ton de plus protecteurs, s’étend ensuite sur la “bonne volonté” apparemment sans bornes de la France et de ses projets d’assistance, face aux “échecs” au “gaspillage” et à l’“égoïsme” haïtiens (HF, pp. 28-29) et se répand en lamentations sur le “point douloureux pour l’ancienne métropole” que reste le massacre des derniers planteurs français en Haïti par Dessalines en 1804, (HF, p. 32).
En effet, 25 ans après le Rapport de Debray, la Note de la FME (re)précise, (re)persiste et (re)signe en ce qui concerne Hayti :
Etat le plus pauvre du continent américain (avec un PIB/habitant inférieur de près de moitié à celui du deuxième État le plus pauvre du continent, le Nicaragua), Haïti est aujourd’hui victime de l’emprise croissante de gangs ultraviolents contre lesquels la police et la justice sont impuissantes. De plus, le gouvernement haïtien ne fonctionne plus conformément à la constitution de 1987 : faute de pouvoir organiser des élections dans tout le pays, la présidence de la République est vacante depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, les assemblées n’ont pas pu être renouvelées, et le pays est aujourd’hui gouverné par un conseil présidentiel de transition à la composition instable et pour une durée incertaine.
Alors que Hayti, plongée dans une crise multidimensionnelle, cumule pauvreté extrême, insécurité généralisée et effondrement de ses institutions républicaines. Ainsi :
(…) les indicateurs de développement d’Haïti ne cessent de se dégrader, l’absence d’un Etat fonctionnel, la corruption rampante et l’insécurité endémique dans la capitale ont conduit de nombreuses ONG et de nombreuses ambassades à quitter le pays ; les choses pourraient encore s’aggraver après la décision des États-Unis d’Amérique de mettre brutalement fin à leur aide qui permet notamment de financer la mission multinationale de soutien à la sécurité dans le pays mise en place par l’ONU en 2024 (FME, pp. 21-22).
L’approche de la réparation dont il est question ici est ainsi collective, symbolique (au sens de : porteuse de sens), et prospective, car son objectif n’est pas tourné vers le passé, mais à la fois vers le présent, afin de réparer les inégalités injustes et les effets de domination d’aujourd’hui, et vers l’avenir; car, cet effort vise, en premier lieu, les générations futures, qu’elle veut libérer du poids de ce passé et de ses héritages négatifs (FME, p. 17).
Si tant est que Hayti ne soit pas un pays pauvre comme le prétendre le Rapport de Régis Debray et la Note de la FME, mais plutôt un pays structurellement appauvri par les conséquences des politiques coloniales et néocoloniale propre à la modernité-coloniale-capitaliste et extractiviste, notamment la domination coloniale et néocoloniale française et des politiques de tutelle de l’internationale communautaire pour reprendre Jean Anil Louis Juste (2003), dès lors on comprend bien pourquoi la Note de la FME n’arrive pas à poser les contradictions de la politique étrangère des puissances néocoloniales contre toute action d’autonomie et de souveraineté du peuple haytien.
1.3. Une lecture critique de (re)construction des structures de la colonialité de l’esprit et de l’action
Dans cette dernière citation prise dans le texte même de la Note de la FME à la page 17, des marqueurs de la (re)construction-manipulation stratégique donc de la colonialité de l’esprit et de l’action qui ont déjà marqué le Rapport de Debray sont repris et mis sur la table de la discussion. Ce, afin de circonscrire l’ordre du discours possible et des discours rendus impossibles. Marqueurs qui permettent de comprendre que l’objectif principal de la FME à travers son approche de réparation sans restitution s’enracine dans la politique propre de l’État français, car l’approche proposée est avant tout et uniquement « collective ».
Ce qui explique que, la question de la responsabilité ne peut pas être portée seulement sur le dos du principal responsable historique à savoir l’État français. Ensuite, « symbolique », donc avant tout dans la construction d’actes qui met en sommeil toutes les formes de rapports de force de solidarité nationale, régionale et internationale de la part d’Hayti, des importantes et possibles actions avec les autres États caribéens aussi bien abya yala (amériques), africains et asiatiques et océaniques qui ont été aussi historiquement dominés et victimes par les structures de la colonialité et de la colonisation de l’appareil moderne esclavagiste de l’État français. Enfin, l’approche de la FME est « prospective ».
Cela veut dire que demain sera mieux même si aujourd’hui on tue le passé par l’oubli. À cela s'ajoute la non restitution de 90 millions francs et la négation de réparations matérielles en rapport avec des crimes financiers qui ont assujetti toute une nation sur plus de six générations.
La Note de la FME précise aussi les moyens de son approche de réparation sans restitution, ainsi pourront nous lire encore à la page 17 :
Elle articule pour ce faire plusieurs instruments : les mots (reconnaissance du passé, excuses), les gestes matériels, qui incluent nécessairement une dimension financière dont le montant atteste de l’importance qu’on leur attache (organisation d’événements, création d’institutions, financement de programmes au long cours) et les attitudes, la reconnaissance n’étant réellement sincère que si elle se traduit par un changement de posture matérialisant une intention d’en finir véritablement avec l’empreinte de ce passé sur les comportements présents (C’est nous qui le soulignons).
En cela, sur une question globale qui a longuement appauvri Hayti, la FME, cette institution franco-française, a été créée stratégiquement pour faire obstacle aux futures demandes de réparation et restitution pour les crimes de l’esclavagisation de l’État français s’inscrivant dans la lignée de la Loi anti-restitution et anti réparation dite Loi Taubira de 2001. Cette FME prend le devant par cette Note, afin de caser et rendre impossible toutes volontés et actions de demande. Dit autrement, de poursuite en justice contre l’État français, afin de rendre justice aux crimes de l’esclavagisation et de commercialisation des personnes captivées et esclavagisées.
Ainsi, de part cette Note, la FME décide-t-elle, aujourd’hui, après la traduction dans l’espace public international la question du rançonnage d’Hayti par la France, de tracer les cadres de pensée et d’action au président français, Emmanuel Macron ? En ce sens, lequel selon Leslie Voltaire (2025), membre du CTP Haytien, se dit prêt à aborder les questions de la réparation dans un discours officiel le jour même du 17 avril 2025. N’est-il pas un conditionnement épistémique que la Note de la FME essaie d’instituer en prenant le devant dans la définition du « comment de la réparation sans restitution et les moyens à mettre en place »?
D’abord dans le champ symbolique, mémorielle, par l’organisation d’événements, création d’institutions, financement de programmes au long cours, sans prendre le temps de mentionner où, par qui, et surtout en mettant les acteurs de l’État Haytien et de la société civile haytienne, africaine et de la diaspora dans le champ de décisions, et des actions à prescrire. Ce qui, comme instrument, le cas échéant, permettra à la FME et à l’État français, trouvant leur existence sur le sang des crimes de l’esclavagisation, d’avoir surement un énorme fonds et financement, et rouage institutionnel à piloter une parfaite occasion et assurance de pouvoir prendre le beurre et l’argent du beurre, comme cela a déjà été par le passé, surtout en 2010 après le tremblement de terre, où surgissait, selon Camille Calmers (2022) la mainmise de l’international communautaire sur les maigres ressources financières qui ont été octroyé comme don pour la reconstruction d’Hayti.
kennythelusss@gmail.com, + 509 39 18 92 18
Formation : Communication sociale/ Faculté des Sciences Humaines (FASCH)
joseph.elmanoendara@student.ueh.edu.ht, +509 32 32 83 83
Formation : Sciences Juridiques/FDSE, Communication sociale/ Faculté des Sciences Humaines (FASCH), Masterant en Fondements philosophiques et sociologiques de l’Éducation/ Cesun Universidad, California, Mexico.