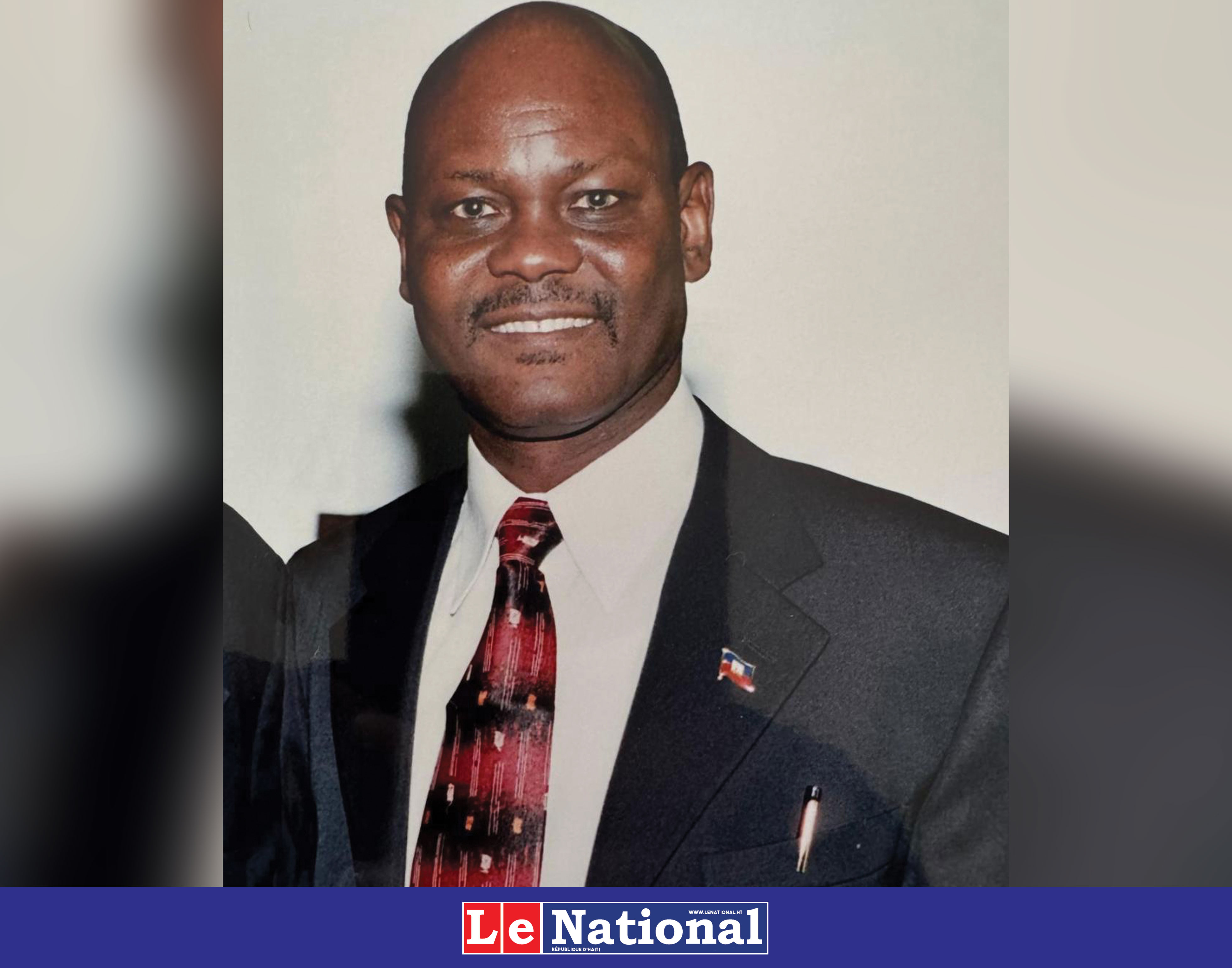« À chaque fois que j'y pense, j'ai envie d'ôter ma vie. Mais à qui laisserais-je mes enfants ? Mon premier-né, qui aurait eu 32 ans aujourd'hui, est mort dans le tremblement de terre de 2010. Mes parents et mes quatre sœurs, eux aussi, ont succombé dans d'autres conditions. Je suis seule », se lamente Junia, le souffle court, retenant avec peine ses larmes.
À 60 ans, cette jeune dame porte en elle un poids immense, pulvérisée par des tragédies successives, où la violence et la perte se sont érigées en funestes compagnes. En un cillement de regards, elle a tout perdu. Aujourd’hui, elle vie avec ses sept enfants sur la cour d’une amie, sous un abri. Vêtue d’un jeans bleu et d’un t-shirt marron, elle raconte son histoire.
L'irrémédiable bascule
Alors qu'elle commençait tout juste à s'adapter à une nouvelle vie imposée au sein de l’ancien camp du Lycée Marie Jeanne, à la rue Audain, Junia a été frappée par une épreuve qui anéantirait toute lueur d'espoir. Une attaque perpétrée au bas de la ville en mars 2024 a délogé plusieurs camps, dont le sien. Tentant de s'échapper, elle s'est retrouvée face à face avec la terreur la plus absolue, subissant des violences physiques et sexuelles d'une brutalité indicible. « J’ai été violée par sept inconnues », révèle-t-elle d'une voix à peine audible.
Elle prit une profonde inspiration, comme pour reprendre son souffle et ajoute : « Par leur voix, certains avéraient très jeunes, mais ils étaient cagoulés, je n'ai pas pu voir leur visage. Ils m'ont battue avec leurs armes, m'ont brûlée au poignet d'une main. J’ai un bras qui a été martyrisé et j'en ai aujourd'hui perdu la mobilité ».
Souvenirs d'une vie heureuse
Junia avait pourtant connu des jours meilleurs. Pendant dix ans, elle a été secrétaire de direction à la compagnie des Télécommunications d'Haïti SAM, TELECO. Un poste qu'elle avait décroché après des études prometteuses. Mariée à Alix, un technicien en communication dans la même entreprise, le couple incarnait une certaine réussite. En 2008, elle a été renvoyée, suivie par son mari en 2009. Loin de les abattre, ces revers les poussèrent à l'action. Ils mirent en commun leurs indemnités de licenciement pour lancer un petit commerce florissant à Carrefour Feuilles. « Ce n'était pas notre maison, mais nous l'avons louée quelques années après le tremblement de terre de 2010. Nous écoulions des vêtements et des chaussures que nous acquérions en gros auprès de marchandes revenant du Panama et de Malpasse. Je leur confiais le capital brut pour les nouvelles marchandises et les bénéfices nous revenaient. Alix, de son côté, s'approvisionnait aussi fréquemment en chaussures sur la piste de la capitale. Grâce à cette activité, nous vivions aisément. Nous étions heureux, ne manquant de rien ». Un sourire s'illumine inconsciemment sur le visage de Junia, le ton empreint de fierté.
La descente aux enfers
En août 2023, l'horreur s'est invitée dans leur quartier. Des hommes armés ont débarqué, semant la terreur. Junia a réussi à fuir avec deux de ses enfants. Les quatre autres étaient chez leur marraine, un peu plus loin. C'est plus tard, alors qu'elle s'était réfugiée au camp, que ses enfants lui furent ramenés. Et là, le couperet est tombé. « Mon mari a été mutilé et brûlé vif. Si les six enfants avaient été à mes côtés ce jour-là, j'aurais pu en perdre un ou plusieurs aussi », a-t-elle lâché, la voix étranglée. Junia, dorénavant, fait face seule aux aléas de la vie.
Analyse d’expert
« Le cas de Junia illustre tragiquement ce que nous observons chez la majorité des survivantes Ces femmes présentent des états psychologiques extrêmement préoccupants caractérisés par une triade symptomatique : dépression sévère, anxiété généralisée et état de stress post-traumatique (TPST) complexe. Beaucoup développent un sentiment d'effroi permanent accompagné de crises de panique et d'insomnies débilitantes. La reviviscence des traumatismes (ces pensées qui reviennent sans cesse), l'état de sidération psychique les empêche de fonctionner normalement. Le sentiment d'insécurité devient si envahissant qu'il paralyse toute capacité de projection dans l'avenir » explique le psychologue Robens DOLY.
Et de poursuivre : « Nous observons fréquemment des mécanismes de honte et de culpabilité qui isolent davantage les victimes, renforçant leur détresse. Le simple fait de quitter un lieu sécurisé peut déclencher des attaques de panique, ce qui explique pourquoi tant de survivantes restent confinées ».
Le spécialiste précise que la prise en charge de ces traumatismes complexes nécessite une approche spécialisée et graduelle. Selon lui, la priorité est de rétablir un sentiment de sécurité de base, puis de travailler sur la reconstruction de l'estime de soi. « Les thérapies doivent aider à dépasser l'état de sidération pour permettre une expression verbale de la souffrance. Malheureusement, sans un accompagnement psychologique adapté et durable, ces femmes risquent de développer des troubles chroniques qui hypothèqueront leur capacité à se reconstruire » a-t-il avancé.
Le poids du silence
Sur la recommandation de quelques personnes avec qui elle vivait dans le camp, Junia s'est rendue à Pran Menm, où le diagnostic fut un coup de massue supplémentaire : elle a été infectée par le VIH suite au viol. « Après avoir quitté le camp, je n'avais pas les moyens nécessaires pour me rendre à l'hôpital. Je me lamentais sur mon sort. Aujourd'hui, je prends des précautions extrêmes pour ne pas partager le virus avec mes enfants. Je n'ai pas le courage de leur en parler maintenant, surtout les jumeaux de 16 ans. J'invente des histoires pour justifier les mesures d'hygiène rigoureuses que je leur impose, comme l'usage strictement personnel de chaque assiette, gobelet, peigne ou autres », confie-t-elle.
L'urgence d'une réponse collective
Le cas de Junia n'est qu'un parmi des milliers. Hier, les femmes de Martissant et Carrefour ; aujourd'hui, celles de Kenscoff et de l'Artibonite. Demain, qui seront les prochaines victimes ? Chaque jour, un nouveau quartier tombe sous la brutalité des groupes armés. Alors que des vies s’éteignent, des biens sont détruits, des rêves se brisent, des innocences sont volées. D'après un rapport publié par le sous cluster VBG Haïti, en partenariat avec le Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes (MCFDF), allant de janvier à mai 2025, 3 804 incidents de VBG ont été rapportés. Parmi ces cas, 77% sont des femmes adultes et 6% des filles de moins de 18 ans. 49% d’entre elles ont été violées. 53% sont des viols collectifs dont la majorité est recensée dans le département de l’Ouest. Junia, dans sa résilience déchirante, implore l'État d'agir. Elle espère un jour trouver le courage de raconter son histoire à ses enfants, surtout à sa fille de 10 ans qui ne cesse de demander quand son père reviendra.
La question demeure : jusqu'à quand les femmes haïtiennes devront-elles survivre à la violence plutôt que simplement vivre ? Quand le respect de leurs droits fondamentaux cessera-t-il d'être une illusion ?
Marc-Kerley FONTAL