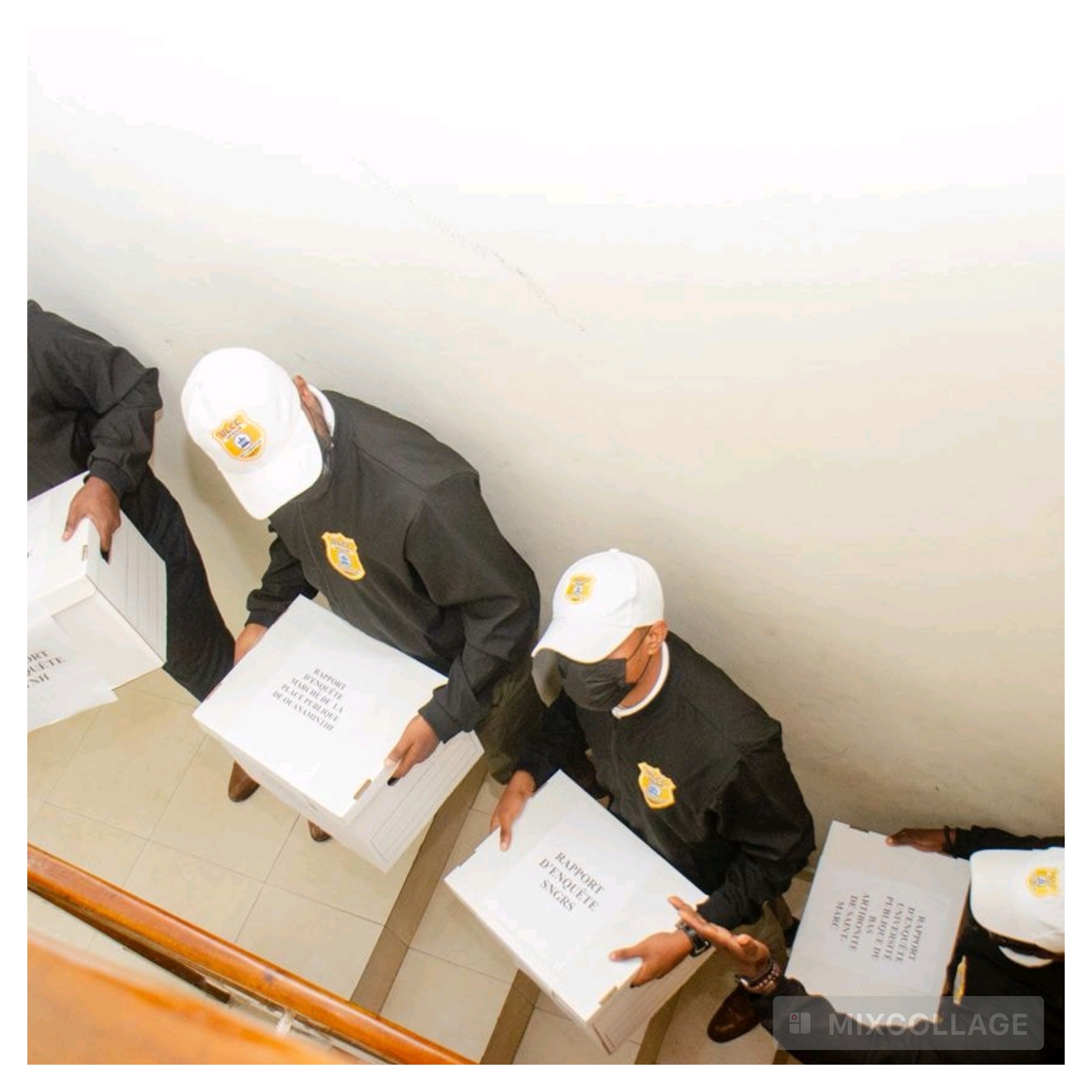Dans l’agenda de l’ONU, pour le 25 septembre 2025, marquant la Journée mondiale de la mer, le thème de cette année se précise en ces termes: « Notre océan, notre obligation, notre opportunité ». Pour l’institution, il reflète : “Le rôle vital de l'océan dans l'économie mondiale, plus de 80 % du commerce mondial étant transporté par voie maritime. L'océan est une source d'emplois et de nourriture pour des millions de personnes, un habitat pour d'innombrables espèces marines et un régulateur du climat de la planète, qui atténue les effets du changement climatique.”
Des enjeux majeurs : “En tant que plus grand secteur opérant dans l'espace océanique, le transport maritime a un rôle central à jouer dans la protection de l'environnement marin et la gestion des ressources océaniques.”, rappelle le texte de l’ONU tout en signalant : “L'engagement de longue date de l'OMI sur cette question est évident dans le cadre réglementaire mondial solide qui soutient des mers plus propres et plus sûres, et dans un portefeuille croissant d'initiatives d'assistance technique pour soutenir la protection des océans dans 176 États membres.”
Inscrire la journée mondiale de la mer dans l’agenda des médias, de l’administration publique, de la diplomatie, la DGI et des collectivités territoriales ?
Dans cette nouvelle livraison pour tenter de constituer une intelligence collective active autour de l’influence et de l’importance de la mer dans l’avenir d’Haïti, on ne peut que déplorer que notre pays qui partage une partie île d’Haïti est pourtant paradoxalement une nation qui tourne le dos à la mer. Même avec ses 1 700 km de littoral, son emplacement stratégique dans les Caraïbes, et sa biodiversité marine exceptionnelle, la mer représente l’un de ses derniers grands territoires de développement.
Dans l’imaginaire collectif haïtien, la mer reste souvent synonyme de fuite, de naufrage, de catastrophe naturelle. Et si l’on changeait de regard ? Et si, au lieu de fuir la mer, on apprenait à négocier avec elle ? C’est-à-dire à écouter ses signes, à respecter ses équilibres, à tirer parti de ses richesses de manière durable. Car la mer ne donne rien à celui qui ne la comprend pas. En consultant et en s’inspirant du riche répertoire composé des différentes créations et des productions à la fois artistiques, littéraires, musicales, théâtrale, cinématographiques, scientifiques entre autres produites en partie par des Haïtiens d’ici et d’ailleurs, comme le film d’Arnold Antonin parmi d’autres, les écoles et les médias trouveront beaucoup de matière à négocier contre l’ignorance populaire haïtienne envers la mer.
Pour une culture du dialogue avec la mer ?
Dialoguer avec la mer, discuter avec les vagues, descendre dans les fonds marins, dédiaboliser la mer sans la désacraliser. Tous les esprits avisés croient dur comme fer qu’il est temps pour qu’Haïti prenne enfin le large vers une économie maritime durable, il faut construire une culture du dialogue avec la mer. Cela commence par l’éducation, se poursuit dans l’économie bleue, et s’inscrit dans une gouvernance responsable. Cet article explore les voies concrètes pour réconcilier Haïti avec son espace maritime, dans un monde où les océans jouent un rôle central pour l’avenir des nations.
De la nécessité de repenser la mer comme partenaire de négociation. Les universités et écoles normales dans le pays doivent penser à la création d’une chaire de recherche sur la mer. Cette entité parmi d’autres instituts seraient invités à proposer de façon objective à poser un regard historique et culturel sur la relation entre Haïtiens et la mer. Faute d’éducation maritime et d’infrastructure, la mer a été soit ignorée. Il s’agit ici de réhabiliter la mer comme un espace de vie, de savoir et de potentiel, notamment à travers les traditions maritimes créoles, la pêche artisanale, ou encore la spiritualité liée à l’eau (lwa marins dans le vodou). La mer doit devenir inévitablement un interlocuteur avec lequel il faut apprendre à composer.
L’éducation maritime, premier langage pour négocier ?
Démanche classique, logique ou basique, on ne négocie pas avec ce qu’on ne connaît pas. Ce qui justifie l’importance de développer les fondements d’une éducation maritime populaire et académique pour le système éducatif haïtien, dont les objectifs et les stratégies de mise en œuvre ne doivent pas être noyé dans les longs chapitres des programmes en cours. Ces savoirs et agendas pour l’éducation à la mer doivent bénéficier d’une très large visibilité et vulgarisation dans les médias, les espaces éducatifs, économiques, entrepreneuriaux et écologiques du pays, et en particulier dans l’ensemble des villes côtières en Haïti.
De la nécessité d’intégrer la littératie maritime depuis l’école primaire, en dehors de l’obligation par l’État d’accompagner et d’investir dans la création des écoles techniques des métiers de la mer, et sans oublier l’inclusion des communautés de pêcheurs dans la formation continue, et initiale des nouvelles techniques.
Développer des programmes dans les universités haïtiennes (océanographie, droit maritime, ingénierie navale, etc.). Haïti devrait pouvoir mobiliser dans la diaspora de nombreuses ressources à la retraite, et des expertises confirmées, parmi les spécialistes des industries maritimes pour construire sa nouvelle machine civile et militaire pour explorer et exploiter la mer. L’objectif avant tout est de former le plus grand nombre d'Haïtiens capables de lire la mer, de l’expliquer, et de la valoriser intelligemment.
Vers la maîtrise de l’économie bleue: ou l’art de passer un contrat intelligent avec la mer ?
Développer la pêche durable (avec quotas, réglementations, et valorisation locale), quelles sont les villes du pays à disposer un tel cadre règlementaire, des ressources et la logistique pour gérer cette activité économique de façon responsable ? Il est temps pour l’État haïtien de reconnaître la mer comme un acteur économique avec lequel il est appelé à signer un “contrat” équilibré, écologique et équitable.
Diplomatie économique et commerciale autour de la mer, négocier avec et autour de la mer signifie dans ce texte, exploiter sans surexploiter, protéger tout en produisant. Quels sont les futurs candidats pour les postes de député, de sénateur et pour les collectivités qui vont inscrire de façon objective dans leur programme politique, des agendas visant à promouvoir le tourisme côtier communautaire, respectueux des écosystèmes ; Encourager les investissements dans les énergies marines renouvelables, l’aquaculture, la biotechnologie marine ; Créer des zones économiques maritimes bien gérées (port en eaux profondes, commerce maritime, etc.).
Haïti et les conventions maritimes : des négociations au niveau global ?
De la maîtrise des règles du jeu international. Haïti ne doit pas se limiter uniquement à ratifier les accords. Le pays doit se donner les moyens pour appliquer et faire respecter les conventions comme l’UNCLOS. Notre nation doit participer activement aux initiatives comme la Décennie de l’Océan (UNESCO), les COP Océans, tout en s'organisant pour créer une stratégie nationale d’économie bleue alignée sur les objectifs du développement durable (ODD 14). Haïti doit également se positionner sur le plan régional afin de profiter des opportunités que des alliances avec d'autres Petits États insulaires (Caribbean Blue Economy Initiative, etc.), peuvent offrir. De telles actions parmi d’autres permettraient finalement à Haïti de devenir officiellement et stratégiquement une voix confirmée dans les grandes négociations maritimes mondiales.
Une gouvernance éthique de la mer : transparence, inclusion, résilience
Des négociations avec la mer et autour de la mer ne serviront pas à grand-chose, si la mer n’est pas gérée par une gouvernance responsable et visionnaire, efficace et pragmatique, transparente et inclusive. Pour aboutir à une telle dynamique, les dirigeants actuels devraient commencer par renforcer les institutions maritimes haïtiennes, tout en actualisant le cadre juridique et réglementaire. On ne manquera pas de rappeler au passage l’importance d’associer les communautés côtières aux décisions, en particulier dans le cadre de la lutter contre la pêche illégale et la corruption.
Des passifs autant que des actifs à prendre en compte. Qu'il me soit permis de saluer les nombreuses initiatives antérieures portées par le système national de gestion des risques et des catastrophes naturelles en Haïti, qui ne rate pas l’occasion d’intégrer la mer dans la gestion des risques climatiques (montée des eaux, ouragans, érosion). Cela ne nous empêchera pas de rappeler à qui veut l’entendre, que la négociation avec la mer devrait être avant tout un véritable exercice collectif de démocratie, de justice et de durabilité.
Dans les familles comme dans les écoles, dans les secteurs économiques, les chambres de commerce, comme dans les hautes sphères politiques haïtiennes qui décident de l’avenir ou de l’orientation de la population, nous devons les apprendre à négocier avec la mer, c’est d’abord changer notre regard. C’est comprendre que l’avenir d’Haïti ne se joue pas uniquement sur ses terres appauvries, mais aussi sur ses eaux, riches et prometteuses.
Des gestes simples et utiles pour l’avenir. Il faudra commencer par enseigner aux enfants à aimer la mer, aux jeunes à en faire un métier, aux dirigeants à en faire une priorité, et aux communautés à en faire un allié. La mer peut être cruelle pour qui l’ignore, mais généreuse pour qui la comprend. Haïti a tout à gagner à sortir de la logique du déni pour entrer dans celle du dialogue. Il est temps d’apprendre à écouter la mer, et à lui répondre, non pas par la fuite, mais par le savoir, l’audace et le respect.
Dominique Domerçant