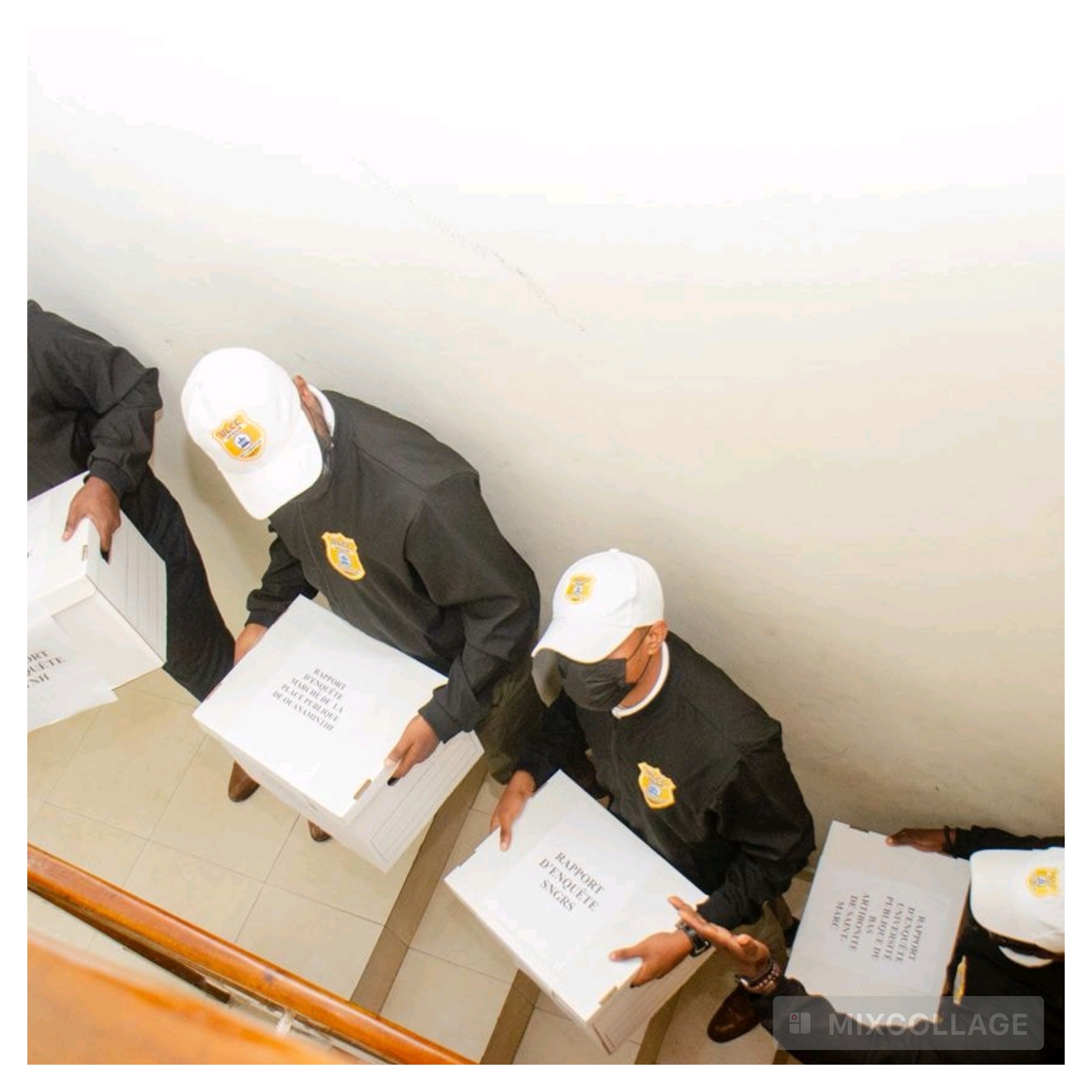Dans la tradition haïtienne, la notion de “place” est essentielle. On se bat pour une place à l’école, une place dans la société, une place dans un bus, une place dans l’administration publique, au parlement ou au sommet de l’État comme dans la diplomatie, ou même une place au cimetière, où dans la plupart des cas, des morts sont souvent délocalisés pour prendre service ou pour changer d’édifice, ne disposent pas d’une place éternelle.
Décrire les relations entre l’école et la mort, les ancêtres et l’éducation, le professeur et Bawon, la salle de classe et le cimetière en Haïti ne doit surtout pas choquer les parents et leurs enfants, encore moins les acteurs et mes amis les décideurs du système éducatif, à qui je continue de solliciter bien avant le séisme du 2010, l’inscription d’une journée nationale de réflexion obligatoire sur la mort dans les écoles en Haïti.
Deux des cas récents, à qui je profite pour rendre hommage une nouvelle fois, viennent justifier le sens de ma démarche et l’essence d’une réflexion profonde pour une éducation autour de la mort en Haïti. A sa place et dans sa salle de classe: l’étudiant Lebelt Massénat, a quand même été tué d’une balle à la tête au Centre d’Études diplomatiques internationales (CEDI), le mardi 11 février 2025, à Bourdon. Six mois et sept jours plus tard, dans la matinée, c’est au tour de l’écolier finissant Wanderson Zamy, de recevoir sa balle en passant devant le siège principal du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP). Un incident survenu lors des mouvements de protestation des enseignants stagiaires devant l’institution le 18 août 2025.
Dépasser la peur de mourir et sans surtout perdre son temps à maudire le pays, notre chère patrie du “Mourir est beau”, ce sont parmi les leçons à tirer dans cette réalité qui nous invite à repenser la mort non pas comme une fatalité, mais comme une opportunité pour apprendre à la fois, à se construire et/ou à se déconstruire de certaines vérités ou relativités qui nous échangent parfois, étant trop confortable, attaché ou à la recherche d’une meilleure place.
Depuis l’enfance, on apprend qu’il faut “gagner sa place” et surtout “ne pas la perdre”. Pourtant, une observation attentive de deux lieux aussi opposés que la salle de classe et le cimetière nous amène à une conclusion surprenante : aucune place n’est éternelle, même quand on pense qu’elle l’est.
Des jeunes issus des couches saines de la société haïtienne ont aussi grand besoin de dompter la mort et la peur de mourir, face aux autres jeunes qui sont prêts à tout pour tuer et détruire, et pire, ne craignent pas de mourir. La salle de classe, symbole de l’apprentissage, et le cimetière, symbole du repos éternel, sont deux espaces bien ancrés dans la vie haïtienne. Tous deux nous confrontent à une même vérité : dans la vie, rien n’est fixe, rien n’est garanti. S’attacher à une place de manière rigide peut même devenir un obstacle à l’apprentissage, à la croissance ou à la paix. Cette leçon, ancrée dans le vécu quotidien en Haïti, mérite d’être examinée.
La salle de classe : un espace temporaire, mouvant, stratégique
Dès le premier jour de classe, beaucoup d’élèves cherchent à s’installer quelque part et refusent ensuite d’en bouger. La salle de classe est souvent perçue comme un lieu ordonné, où chacun a “sa” place. Certains choisissent les premiers rangs pour mieux écouter, d’autres préfèrent l’arrière pour passer inaperçus. Peu importe la motivation, le réflexe est souvent le même : s’installer et ne plus changer.
Détrompez-vous ? Mais dans la réalité scolaire haïtienne, cette idée d’une place fixe est souvent une illusion. Les salles sont parfois surchargées, les bancs manquent, les professeurs peuvent redistribuer les élèves selon les activités. Parfois, on change même de salle en cours d’année. Même le professeur parfois ne dispose d’un fauteuil ou d’une place réservée. Dans certains cas, les raisons sont plus graves : éviter des tensions et les violences sur fond de confrontation et de destruction des meubles, fuir les moqueries, s’éloigner de la distraction ou se protéger.
Développer une approche flexible autour de l’appropriation d’une place pour se protéger. En particulier, suivant les constats réalisés dans les établissements publics, on peut conclure que le bon élève n’est pas celui qui garde “sa” place coûte que coûte, mais celui qui s’adapte, qui bouge quand il le faut, et qui sait rester concentré peu importe l’endroit. Dans une société où tout est instable, y compris l’infrastructure scolaire, l’agilité mentale est plus importante que la stabilité physique. Ce ne sont pas les anciennes écoles de référence et de prestige de la capitale haïtienne qui diront le contraire ?
Dans le temps, le cimetière haïtien entre tradition, précarité, mouvements sociaux et violences urbaines représentaient dans l’imaginaire collectif le repos éternel. On pouvait même parler de “dernière demeure”, de “place au cimetière” comme d’un point final. Hélas. Place à la mobilité des dépouilles pour les familles qui ne peuvent offrir les services d’incinération.
De tels rappels ou parallèles visent avant tout à interpeller la conscience et le réveil des élèves ou des jeunes haïtiens sur certains aspects pas toujours visibles dans la nouvelle guerre dans laquelle Haïti s’enlisent. Si les morts autant que les vivants sont contraints à se déplacer ou sont tout simplement délogés, étant pratiquement tous les deux sur le même bateau (le nouveau négrier), et parce que ces morts représentent avant tout vos parents et vos grands-parents. Vous n’aurez désormais nulle raison pour continuer à craindre ces morts, de vos morts de la mort.
Une même leçon pour tous : bouger, s’adapter, vivre mieux
Deux espaces géopolitiquement ciblés dans la guerre invisible dans laquelle la République d’Haïti fait face, les salles de classe et les cimetières, les morts qui représentent le passé et la jeunesse qui symbolisent l’avenir partagent bel et bien deux destins génétiquement inséparables.
Derrière la mort de ces deux jeunes, le premier assis sur une chaise (fixe) dans une salle de classe d’un centre diplomatique et l’autre en déplacement derrière une motocyclette (mobile) devant le plus haut lieu de l’éducation du pays, le traumatisme persistant de ces drames ne doit surtout décourager les parents, encore moins désorienter les jeunes du pays vers des chemins autres que l’éducation et la formation. Ces deux exemples partagés entre la salle de classe et le cimetière, nous apprennent une leçon fondamentale, trop souvent négligée dans l’éducation : il faut apprendre à lâcher prise. Rien ne nous est acquis pour toujours. Ni la réussite, ni le confort, ni même la reconnaissance.
Dans la vie, comme dans la classe, ceux qui s’accrochent à une place par orgueil, peur ou habitude se fragilisent. Ils deviennent incapables de gérer l’imprévu. En revanche, ceux qui comprennent que tout peut changer, et qu’ils doivent eux-mêmes évoluer, développent une force précieuse : la résilience. Être intelligent, ce n’est pas garder la même place chaque jour. C’est savoir où se mettre, quand changer, et comment rester efficace n’importe où. C’est aussi et surtout assumer sa mission et accepter que la mort nous efface de la liste des vivants à n’importe quel moment de la durée. Sachant que rien n’est éternel, autant que les épreuves et les tragédies actuelles d'Haïti, de Gaza, de l' Ukraine, ou de la Libye, entre autres, il en est autant pour les personnes qui pillent, tuent et traumatisent la population haïtienne.
D’une ville à une autre, en Haïti comme dans la diaspora, d’un pays à un autre, partout dans le monde, cette leçon ne s’applique pas qu’à l’école. Elle vaut aussi pour la vie professionnelle, familiale, sociale. Ceux qui pensent avoir une place garantie, un poste à vie ou un privilège éternel risquent un jour de tomber de haut. À travers ces deux lieux symboliques très présents dans le quotidien des Haïtiens, la salle de classe et le cimetière, la vie nous enseigne que rien ne dure éternellement, surtout pas une place. Ni dans la vie, ni dans la mort, nous ne pouvons prétendre à une stabilité absolue. Et ce n’est pas une mauvaise nouvelle.
Dieu merci, cette vérité nous invite à vivre avec souplesse, à apprendre avec humilité, et à nous adapter avec intelligence. C’est en acceptant que notre place peut changer que nous grandissons vraiment. Au fin, chaque jeune qui s’apprête à occuper une place dans la salle de classe devrait au moins se rappeler, et tenir compte que ce n’est pas la place que tu occupes qui compte, mais ce que tu fais, là où tu es, et comment tu avances, même quand tout bouge autour de toi.
Dominique Domerçant