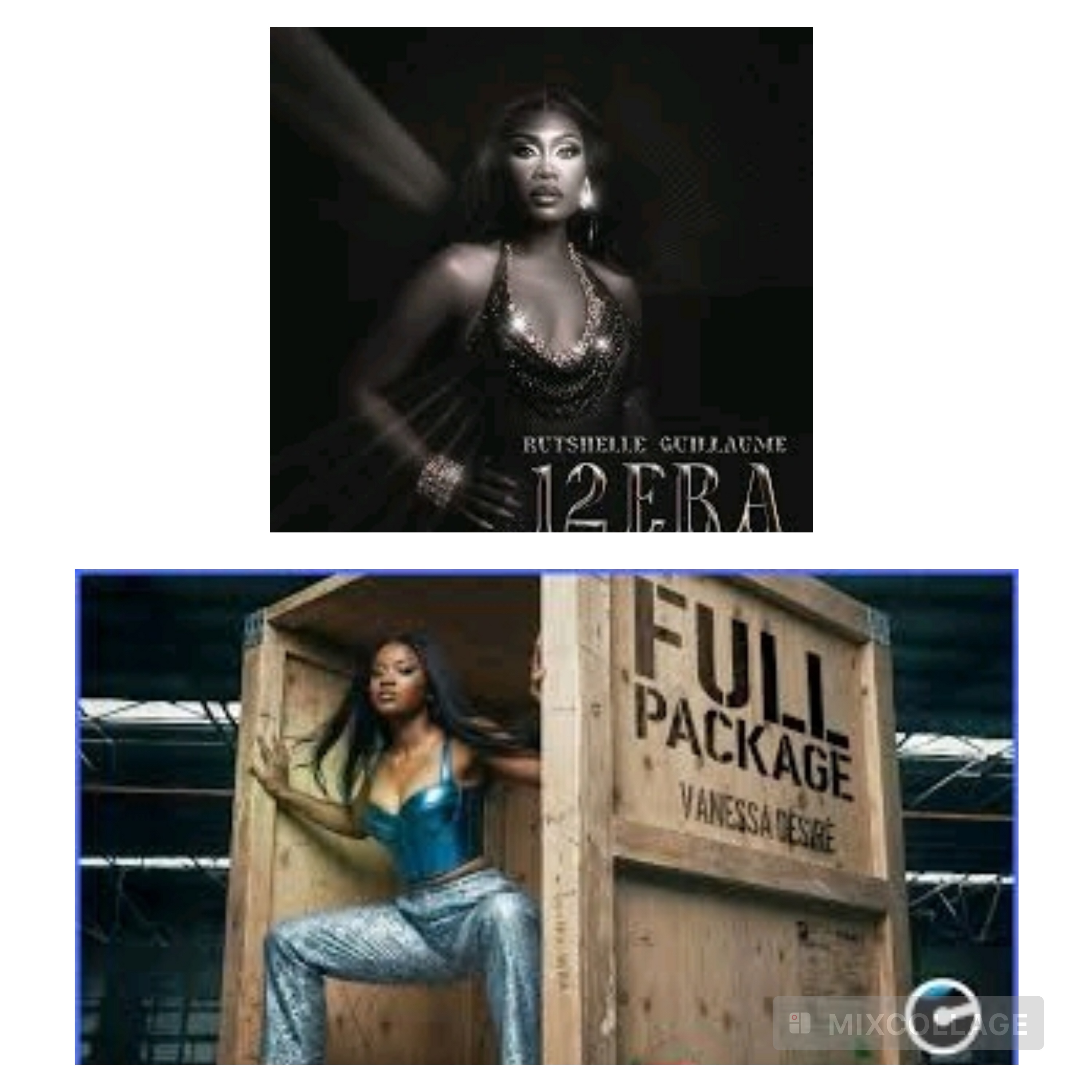déclare le juriste Josué Pierre-Louis
Josué Pierre-Louis (1) publie un nouvel ouvrage consacré au blocage institutionnel d’Haïti, « Ce que je sais de la Constitution haïtienne de 1987 ». Dans un entretien accordé à notre rédaction, il décrypte les ressorts de la paralysie de nos institutions et avance des pistes claires pour en sortir.
Haïti a connu, en 220 ans d’existence, vingt-trois constitutions et plusieurs types de régimes politiques. Pour Josué Pierre-Louis, cette succession de textes témoigne moins d’une créativité politique que d’une instabilité persistante, où les changements constitutionnels n’améliorent ni la gouvernance ni les conditions de vie de la population.
Selon lui, ce contexte fragile empêche l’État de bâtir des institutions durables et affaiblit sa capacité à protéger l’ordre et l’intérêt public. En période de crise, souligne-t-il, la démocratie haïtienne tend à glisser vers des formes de pouvoir personnel ou autoritaire, faute de véritable équilibre entre le Parlement et l’Exécutif.
Les causes de cette situation tiennent, d’après le juriste, à une démocratie mal enracinée, à des élections peu significatives et à des réformes inachevées. Il pointe également l’adoption de modèles politiques importés, mal adaptés au contexte haïtien, ainsi qu’un État trop faible pour garantir efficacement la sécurité, la justice et la bonne gouvernance. « La modernisation ne doit pas être une imitation de l’Occident : les institutions doivent s’ancrer dans les traditions locales. Le mimétisme juridique, notamment envers le modèle français, a créé des lois et des institutions déconnectées de la société haïtienne, fragilisant leur application et leur acceptation ».
L’expression « peuple de constitutions » vient, explique le professeur, du fait que les Haïtiens cherchent constamment la légitimité politique dans la réécriture de la loi, faute d’institutions solides et d’un État respecté.
Pierre-Louis souligne que cette succession de constitutions très diverses, dont aucune n’est parvenue à stabiliser durablement le pouvoir ni à prévenir les abus, n’exprime pas une évolution cohérente mais bien une série de ruptures, où chaque crise remet en cause l’ordre établi. Cette discontinuité institutionnelle révèle, poursuit-il, la difficulté à construire une légitimité politique durable. « Souvent, chaque nouvelle constitution sert à résoudre une crise immédiate ou à accompagner l’arrivée d’un nouveau pouvoir, plutôt qu’à définir un projet de société cohérent. »
« Un problème politique avant tout »
Si certaines constitutions haïtiennes ont tenté de refonder le système politique — comme celle de 1987 — leur impact est resté limité, faute d’application réelle et d’institutions capables d’en garantir le respect, relève Pierre-Louis avec justesse. D’autres textes n’ont servi qu’à renforcer l’autorité de certains dirigeants ou à répondre à des circonstances ponctuelles.
Le problème central ne réside donc pas uniquement dans les constitutions, mais dans leur interprétation et leur mise en œuvre, fait-il remarquer. Sans culture juridique partagée, sans institutions solides et sans dirigeants respectueux des règles, la Constitution demeure une lettre morte. « Celle de 1987, pourtant l’une des plus ambitieuses, reste inachevée : l’absence de Conseil constitutionnel et la persistance d’une tradition politique fondée sur la personnalisation du pouvoir en ont entravé la réalisation. »
L’échec de la dernière loi fondamentale illustre parfaitement le décalage entre un cadre juridique prometteur et une pratique politique incapable d’en assumer les exigences. Selon lui, les réformes juridiques soutenues par les partenaires internationaux ont échoué pour les mêmes raisons.
Cette véritable « machine à produire des constitutions » révèle à la fois une méfiance persistante envers le pouvoir central et la quête d’un ordre politique idéal jamais atteint. « Haïti ne manque pas de régimes constitutionnels : elle cherche une identité politique claire. », estime Pierre-Louis. « Depuis des décennies, chaque président veut marquer son passage en modifiant ou en réécrivant la Constitution, un geste qui devrait rester exceptionnel mais qui est devenu une routine du pouvoir, au détriment de l'équilibre institutionnel. »
À force de vouloir constamment remodeler la charte fondamentale, celle-ci perd son autorité et sa valeur symbolique, puisqu’elle n’apparaît plus que comme un texte malléable au gré des volontés présidentielles.
Cette dynamique répétée traduit en réalité « une mauvaise lecture des véritables faiblesses du pays ». Le problème ne vient pas du contenu de la Constitution, comme il le martèle mais de l’absence de légitimité politique nécessaire pour en assurer le respect. La crise haïtienne est d’abord politique, non constitutionnelle : ce qui échoue, ce n’est pas l’architecture institutionnelle, mais la manière dont les acteurs publics la contournent ou la détournent. « Imaginer qu’une réforme rapide puisse résoudre cette situation, c’est croire qu’on peut réparer un moteur en repeignant la carrosserie, dit-il. Le cœur du mal réside dans la gouvernance, non dans le texte. »
En résumé, la difficulté institutionnelle ne tient pas seulement aux textes : c’est la démocratie représentative elle-même qui est en crise. Les institutions existent, mais la pratique politique, la participation citoyenne et la gouvernance demeurent fragiles.
Ses solutions
Changer la Constitution ou changer de constitution ? Pour Pierre-Louis, un nouvel amendement ou un énième changement constitutionnel ne ferait que prolonger la crise actuelle. Avant toute décision, il estime indispensable d’évaluer le texte en vigueur et de dresser un bilan honnête de la démocratie haïtienne. Le problème de gouvernance, profondément ancré, doit être abordé avec « courage, maturité et lucidité ». Il appelle à examiner d’urgence notre culture politique, notre rapport aux normes et notre manière d’exercer le pouvoir.
Ce n’est qu’après ce travail préalable qu’il devient pertinent de repenser le modèle politique — non pour renoncer à la démocratie, mais pour imaginer des formes de gouvernance adaptées au contexte haïtien, plus équilibrées, stables et réalistes. « La crise actuelle de la démocratie représentative en Haïti nous oblige à interroger le sens même de la légitimité politique. Le pays ne cherche pas seulement un mode de gouvernement, mais une source d’ancrage légitime enracinée dans sa propre histoire. »
Dans cette perspective, il rejoint le constat de plusieurs penseurs et constitutionnalistes qui invitent à mobiliser l’imaginaire constituant : il ne s’agit pas de rejeter toute influence extérieure, mais de puiser à la fois dans les modèles occidentaux et dans les structures autochtones pour concevoir un système politique fidèle à notre réalité. Le juriste parle d’une « synthèse originale », ancrée dans l’histoire constitutionnelle d’Haïti depuis la Révolution, intégrant ses courants intellectuels et les luttes qui ont façonné notre trajectoire collective. Une nouvelle constitution, en somme, qui soit le reflet juridique et philosophique de notre expérience historique.
Comme dans de nombreux pays latino-américains, la relation entre le droit et la société haïtienne est complexe, comme il le relève si bien. Le non-respect des normes, parfois perçu comme culturellement ancré, appelle une meilleure intégration du droit coutumier et du droit international régional, tout en tenant compte des réalités locales.
Pour sortir de cette impasse séculaire, recommande le professeur, il est temps que les Haïtiens s’accordent sur la nécessité de bâtir un État capable de durer, de garantir les droits fondamentaux, d’exercer un contrôle effectif sur son territoire et de refonder le lien civique entre le citoyen et la Nation. C’est à cette condition qu’Haïti pourra retrouver les voies d’un fonctionnement consensuel de ses institutions et d’une régulation apaisée de la vie politique, acceptable pour tous les acteurs, propice à la paix sociale et créatrice des conditions indispensables au développement que le pays appelle, depuis des décennies, de tous ses vœux.
La tâche des élites
La vitalité du droit dépend d’abord de l’engagement réel des élites à respecter la loi et à en garantir l’application, rappelle l’auteur. Sans cet engagement, le fossé entre la norme et la pratique continuera de se creuser, nourrissant ce « divorce du fait et du droit » observé dans de nombreux pays en développement, pour reprendre l’expression de Carbonnier. Une justice authentique exige une approche sociologique et pragmatique, afin d’éviter qu’elle ne demeure un simple rituel dénué d’effet concret, comme c’est trop souvent le cas.
Aucun régime politique ne peut prospérer sans vision, institutions solides et dirigeants responsables. « Placide David souligne que les anciens contestataires, une fois au pouvoir, reproduisent fréquemment les abus qu’ils dénonçaient. Chateaubriand, lui, invitait à s’interroger sur la finalité du régime : l’important n’est pas son intitulé, mais son adéquation aux réalités du pays et sa capacité à servir le bien commun ». Un système politique n’a de valeur que s’il est stable, compris, appliqué et porté par des dirigeants compétents et intègres.
En somme, pour combler le déficit de légitimité institutionnelle, de stabilité politique et de culture démocratique, il ne suffit pas d’écrire une nouvelle constitution. L’expert insiste sur la nécessité de repenser l’État, d’instaurer une gouvernance efficace, de combattre la corruption, de renforcer la justice et la sécurité, et de bâtir une culture politique durable et responsable. Toute modernisation doit être pragmatique, enracinée dans l’histoire et les réalités haïtiennes, afin de construire enfin un véritable État de droit.
La démocratie naît de femmes et d’hommes qui donnent vie aux textes et aux institutions, et un régime ne vaut jamais davantage que ceux qui le façonnent, enseigne Pierre-Louis. Aucune République ne peut exister, conclut-il, sans le respect du pacte constitutionnel qui unit les citoyens entre eux et les relie à l’État. C’est vers cet horizon que le pays doit désormais avancer, et la responsabilité des élites dans cette marche est plus que jamais décisive.
Huguette Hérard
Notes :
(1) Ancien Garde des Sceaux et ministre de la Justice, ancien Secrétaire général de la Primature, Josué Pierre-Louis est également professeur des universités en droit public. Docteur en droit, il est l’auteur de La modernisation du droit haïtien : un défi pour l’avenir (2022) et Haïti et ses institutions (2005).