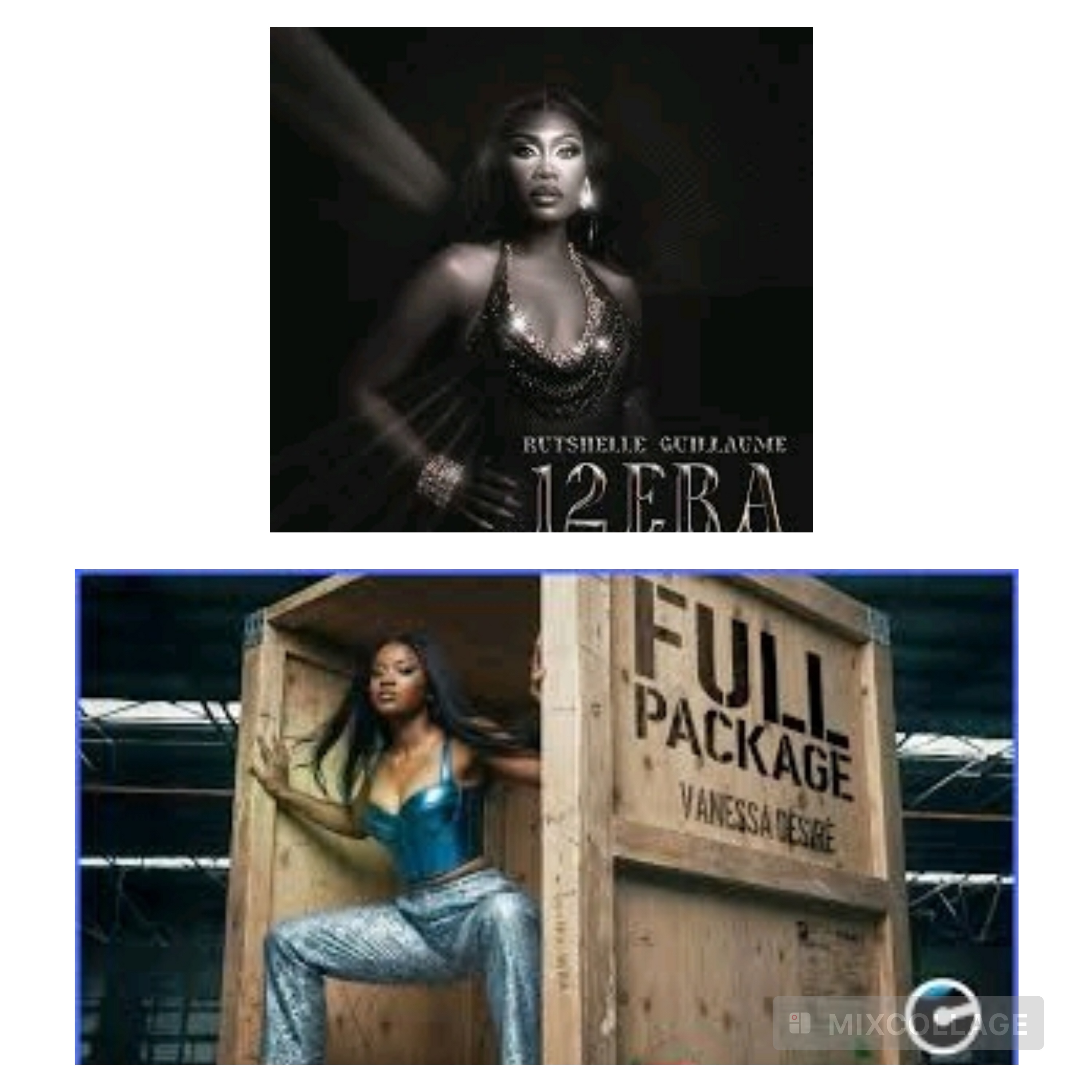Hier soir, à l’Ambassade de la République d’Haïti à Paris, s’est tenue une rencontre sur la manière d’utiliser la science de la communication pour transformer l’image d’un pays.
À une époque où les opinions se forgent à la vitesse d’un clic, où une rumeur peut passer pour une vérité et où un fait isolé peut engloutir une réalité plus vaste, la bataille de l’image n’est plus un choix : c’est une nécessité vitale, un pilier de la souveraineté extérieure.
Dans un salon illuminé par les couleurs du drapeau haïtien, diplomates, journalistes et professionnels de la communication se sont réunis autour d’un thème fondamental — l’ossature invisible mais indispensable de toute représentation à l’étranger : la communication.
L’Ambassadeur Louino Vocly, fidèle à son approche proactive, a convié plusieurs figures de la presse écrite et audiovisuelle françaises et haïtiennes. Son objectif : appeler à un changement de paradigme en soulignant l’urgence d’une diplomatie communicante capable de redonner voix, visage et profondeur au récit haïtien.
Autour de la grande table de discussion étaient présents plusieurs journalistes français : Omar Ouahmane (1), invité spécial, Anne Cantener, Romero Langlois, ainsi que des membres du personnel diplomatique. Du côté haïtien, des voix comme celle d’Édouard Gedems, correspondant de Télé Images à Paris, ont enrichi les échanges.
Avec la précision d’un stratège, l’Ambassadeur a présenté son projet inscrit dans l’initiative « Les Jeudis de l’Amitié franco-haïtienne ». Déjà à sa sixième édition, cette initiative se veut un chantier culturel et diplomatique destiné à bâtir des ponts là où le silence ou les préjugés ont trop souvent creusé des fossés.
Haïti partage avec la France une histoire que cette dernière a longtemps reléguée dans l’ombre, par honte de son propre échec, même si elle commence aujourd’hui à la reconnaître davantage. En témoignent les prises de position de l’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, et de l’ancien ministre de l’Éducation et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, qui estiment tous deux qu’il faut enseigner l’histoire d’Haïti dans les écoles françaises.
Déplorant que, malgré plus de deux siècles de liens historiques, intellectuels et humains, la majorité des Français ignore presque tout de la profondeur de cette relation, Louino souligne que cette méconnaissance crée un brouillard propice aux clichés, aux simplifications et aux récits tronqués.
Il exprime ainsi le souhait non seulement d’améliorer l’image d’Haïti, mais aussi d’installer une compréhension mutuelle durable : un espace de reconnaissance réciproque où les deux nations pourraient enfin se rencontrer sans déformation ni caricature. L’image d’un pays, rappelle-t-il, n’est jamais figée ; elle se construit au fil des faits, des récits, des gestes diplomatiques et des échanges humains.
Un dialogue sincère
L’ambiance, empreinte de respect mutuel, a permis un dialogue sincère et sans détour. Les journalistes français ont unanimement reconnu que, dans de nombreux médias hexagonaux, Haïti est trop souvent enfermée dans des représentations simplistes, parfois déformées, souvent injustes : un miroir brisé qui ne renvoie que les fragments sombres, jamais la lumière. Cette vision réductrice trouve sa source dans une profonde méconnaissance de l’histoire partagée entre la France et Haïti, conséquence d’un déséquilibre mémoriel persistant.
L’indépendance d’Haïti, issue d’une révolution antiesclavagiste unique au monde, demeure marginale — voire absente — dans le récit national français. Cet effacement n’est pas fortuit : la défaite d’une armée napoléonienne face à d’anciens esclaves, la complexité de la traite négrière et les débats encore sensibles autour de la colonisation rendent cette page d’histoire difficile à intégrer pleinement dans la mémoire officielle. À cela s’ajoute son absence quasi totale des programmes scolaires : une histoire que l’on n’enseigne pas devient inévitablement une histoire que l’on ignore. Faute de repères, beaucoup de Français ne peuvent saisir la profondeur des liens entre les deux pays, laissant le champ libre aux simplifications.
Cette méconnaissance s’explique aussi par des mécanismes médiatiques et culturels contemporains. Les médias privilégient les récits de crise ou de catastrophe, guidés par les logiques de l’actualité et du sensationnalisme. Haïti n’apparaît alors que comme un symbole de souffrance ou de chaos, une image qui occulte sa contribution historique, culturelle et intellectuelle. La rareté de correspondants spécialisés, la faible présence de la Caraïbe dans les rédactions et l’absence de récits nuancés renforcent cette vision fragmentaire. Par ailleurs, un imaginaire occidental encore marqué par l’exotisme ou la compassion humanitaire empêche parfois de percevoir Haïti comme une nation historique majeure, dotée d’un patrimoine exceptionnel.
Les échanges institutionnels, culturels et universitaires, trop peu soutenus, n’ont pas suffi à contrebalancer cette représentation partielle. Pour y remédier, plusieurs leviers doivent être activés simultanément. Renforcer la place d’Haïti dans l’enseignement français est essentiel : intégrer la Révolution haïtienne dans les programmes, encourager la production d’outils pédagogiques et soutenir la recherche universitaire permettraient de rééquilibrer un récit longtemps incomplet.
La diplomatie culturelle joue un rôle stratégique : expositions, festivals, cycles de conférences, saisons franco-haïtiennes, diffusion d’œuvres littéraires, cinématographiques et artistiques offriraient au public français un accès direct à la créativité haïtienne. Les médias, de leur côté, gagneraient à produire davantage de reportages de fond, capables de dépasser les représentations catastrophistes et de montrer la complexité du pays : ses innovations, sa culture, ses intellectuels, son rôle pionnier dans l’histoire mondiale des libertés.
Enfin, mettre en valeur les liens humains et historiques — par des commémorations, des échanges universitaires, des initiatives portées par les diasporas ou des partenariats institutionnels — permettrait de redonner chair à une histoire commune trop longtemps occultée.
L’objectif est clair : replacer Haïti dans son véritable contexte, non comme un pays périphérique réduit à ses difficultés, mais comme une nation fondatrice, porteuse d’une mémoire essentielle pour la France comme pour le reste du monde. Mieux faire connaître cette histoire partagée, c’est non seulement lutter contre les stéréotypes, mais aussi rétablir une vérité historique qui honore les deux peuples.
Maguet Delva,
Paris
* Omar Ouahmane, journaliste senior et grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, a séjourné pendant 10 jours en Haïti en septembre 2023 pour réaliser un reportage sur les conséquences directes de la crise sécuritaire sur la population haïtienne sous le titre « Haïti, un État en voie de disparition »