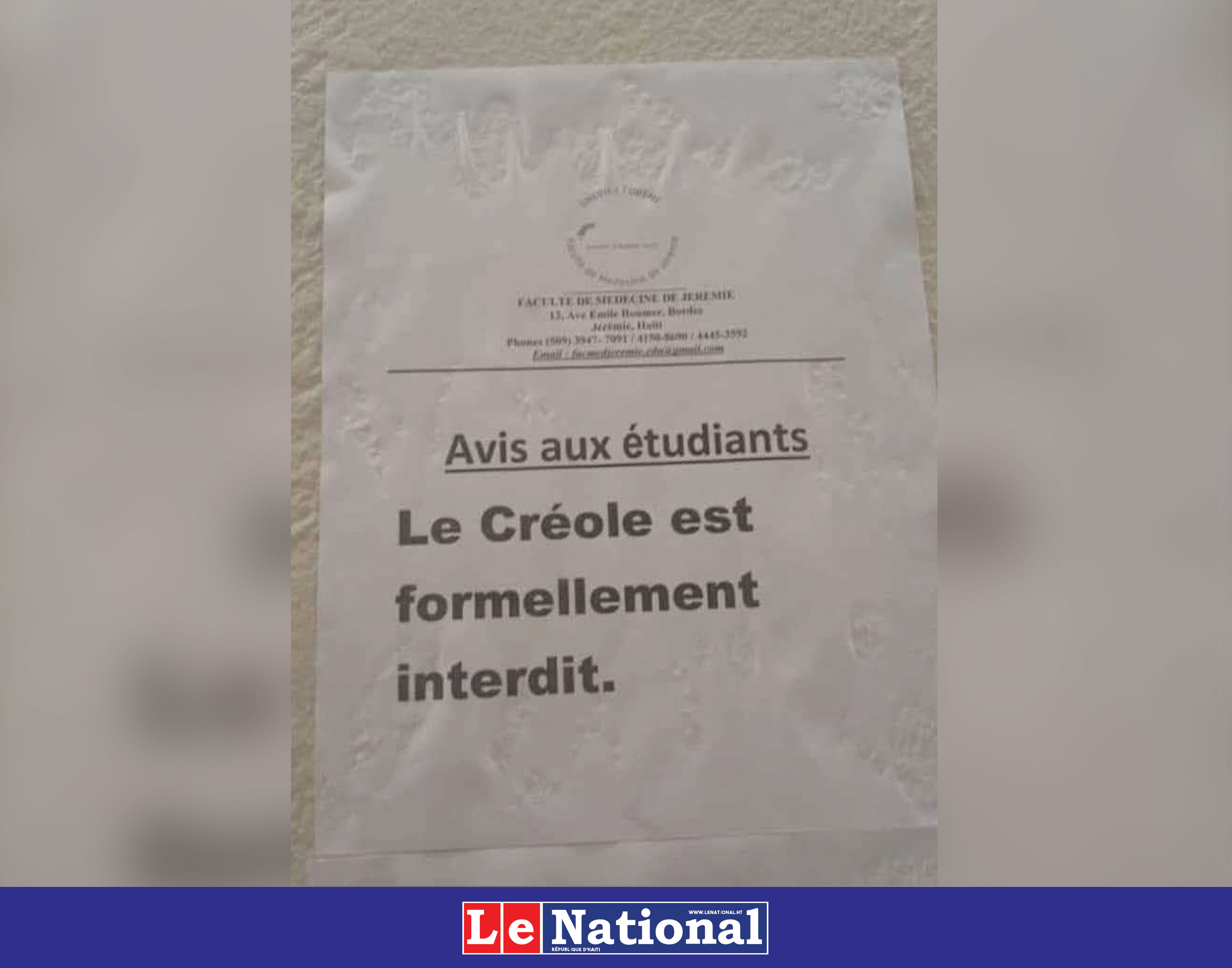Alexandra Emmanuel, Max François Millien et Evens Emmanuel
Introduction : Éducation, Vulnérabilité et JNHECC
Haïti se positionne, contrairement à toute attente, , comme l'un des territoires les plus vulnérables aux conséquences des changements climatiques, sans en être un émetteur historique majeur. Les événements extrêmes (cyclones, sécheresses, inondations) y sont amplifiés par une vulnérabilité socio-économique structurelle, faisant de la résilience non pas une option, mais un impératif de survie nationale. Face à cette réalité, l'éducation se révèle être le principal levier pour structurer une réponse collective et durable.
C’est dans cet esprit qu’a été instituée la Journée Nationale Haïtienne d'Éducation aux Changements Climatiques (JNHECC), formalisée par la Déclaration de Turgeau en septembre 2023. Cette initiative de la communauté scientifique, portée notamment par des institutions de recherche comme le LMI-CARIBACT, l'URGéo et l'ERC2, postule l'adoption officielle du 1er septembre comme date annuelle d’action climatique.
En 2025, la commémoration de la JNHECC a brillamment démontré son potentiel républicain en mobilisant la médiation scientifique (Emmanuel, 2025 ; Aubin & Débréus, 2025 ; Millien, 2025). Chercheurs et journalistes ont converti des travaux de haut niveau (incluant des thèses doctorales) en contenus accessibles, alimentant les débats publics à travers une série d’articles et d’émissions (Jérôme, 2025). Cet effort de vulgarisation va au-delà d’une simple sensibilisation ; il est la première étape concrète vers la constitution d’une masse critique nationale capable d’atténuer les impacts et de guider les politiques publiques. Cet article explore comment la JNHECC, en tant que plateforme de mobilisation scientifique, doit devenir le point de départ d’une Diplomatie Scientifique stratégique pour Haïti, capable de mobiliser l'État haïtien et les financements internationaux.
L'impératif républicain de l'éducation et la nécessité d'un cadre légal
La nécessité d'une éducation universelle et éclairée, socle d'une république solide, trouve un écho puissant chez le philosophe français Condorcet. Pour lui, le progrès social est indissociable des « lumières » de la science, diffusées sans entrave à tous les citoyens. Dans le contexte haïtien, l’éducation climatique est cette lumière publique essentielle qui permet à chaque citoyen, de l'agriculteur au décideur, de comprendre les mécanismes globaux (ODP, ENSO, Oscillation Multidécennale de l'Atlantique, etc.) qui modèlent son destin (Aubin & Millien, 2025 ; Emmanuel & Noncent, 2025).
Les productions scientifiques issues de la commémoration de 2025, portant sur la lutte des agriculteurs (Emmanuel, 2025a), la compréhension des inondations (Emmanuel, 2025d) ou l'enjeu du Parc National La Visite (Emmanuel, 2025b), ont démontré que la recherche haïtienne est prête à informer l’action.
Toutefois, pour que cette impulsion éducative devienne une force structurelle et républicaine pérenne, l’État haïtien doit transformer l'initiative de la JNHECC en une loi. L’adoption d’un cadre légal reconnaissant officiellement le 1er septembre est un acte politique fort qui institutionnaliserait l'éducation climatique comme mission républicaine, alignée sur l’ODD 4 (Éducation de qualité) et l’ODD 13 (Lutte contre les changements climatiques). Ce geste est un prérequis pour débloquer le soutien politique nécessaire à la lutte contre les maladies liées au climat (Emmanuel, 2025e) et pour ancrer la résilience dans la gouvernance nationale.
De la vulnérabilité locale à l'opportunité globale : La Chine et la Science sans Frontières
Alors qu'Haïti s'efforce de construire sa résilience, les grands émetteurs de gaz à effet de serre (GES) sont appelés à renforcer leurs engagements pour une réduction drastique de ces gaz. La déclaration de la Chine en septembre 2025, annonçant son objectif de réduire ses émissions de de gaz à effet de serre (GES) de 7 % à 10 % par rapport à leurs pics d'ici 2035 (You, 2025), offre une fenêtre stratégique pour des lendemains meilleurs. Ce geste, bien qu'encore attaché à l'Accord de Paris de 2015, rappelle que la trajectoire climatique mondiale dépend en grande partie des actions des pays industrialisés.
Cette dynamique globale appelle à une réflexion urgente sur la science sans frontières sur le climat. En effet, si la science révèle l'interdépendance des systèmes climatiques (impact des phénomènes du Pacifique et de l'Atlantique sur les Grandes Antilles – Emmanuel, 2025f), il est impératif que les réponses politiques et scientifiques soient tout aussi interconnectées.
Haïti, en légalisant la JNHECC et en s'appuyant sur ses travaux de recherche (du Lac Azuei aux pluies extrêmes – Emmanuel, 2025c, 2025f), peut saisir cette opportunité pour :
- Interpeller les grands émetteurs quant à leur rôle de soutien aux pays les plus vulnérables ;
- Mobiliser les institutions de recherche des pays signataires de l'Accord de Paris sur la base d’un partenariat scientifique durable pour la potentialisation de leurs efforts.
La Diplomatie scientifique : Levier de partenariat et de financement
La Diplomatie Scientifique, définie comme l'utilisation de la coopération scientifique pour atteindre des objectifs de politique étrangère, est la voie la plus prometteuse pour Haïti. Le pays a besoin d’une masse critique de jeunes, dans tous les domaines, formés aux enjeux climatiques.
Il semble pertinent de mobiliser la JNHECC comme plateforme de négociation scientifique internationale pour atteindre deux objectifs majeurs alignés sur l'ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs) :
- Création de bourses internationales dédiées à la résilience climatique : Haïti devrait s’associer à des pays industrialisés et à des universités de renom pour établir des programmes de bourses ciblés, visant à former un nombre significatif de jeunes Haïtiens (en ingénierie, agronomie, santé publique, aménagement du territoire, etc.) sur les questions climatiques. La diplomatie scientifique permettrait de sécuriser les fonds nécessaires auprès des institutions de financement bilatérales et multilatérales.
- Échange d'expertise et co-construction des modèles climatiques : La vulnérabilité d'Haïti est un laboratoire d'adaptation et de résilience. La Diplomatie Scientifique doit encourager les échanges d'experts pour co-construire des modèles climatiques et des stratégies d'adaptation locales, s'appuyant sur les travaux des centres de recherche haïtiens (LMI-CARIBACT, ERC2, URGéo).
En conclusion, la JNHECC est bien plus qu'une simple commémoration : elle est un actif stratégique national. En lui donnant un statut légal propre, l’État haïtien confirmera l'engagement républicain envers une éducation éclairée. En la considérant comme pivot de la Diplomatie Scientifique, il transformera la vulnérabilité du pays en un appel à la solidarité et à la co-action mondiale. Ceci nous paraît être le seul chemin viable pour attirer les financements durables, bâtir la masse critique et faire de la résilience climatique une réalité nationale.
Références Bibliographiques
Aubin, Q., & Débréus, N. (2025, 2 septembre). Haïti Face au Climat : La Journée nationale du 1er septembre, un appel à l’Éducation et à l’Action. Le National.
Aubin, Q., & Millien, M. F. (2025, 24 septembre). ENSO : Un géant du climat qui façonne le destin d’Haïti. Le National.
Emmanuel, A. (2025, 11 septembre). Le soutien politique de l'État haïtien, un impératif pour une lutte efficace contre les maladies liées au changement climatique. Le National.
Emmanuel, A., Aubin, Q., & Millien, M. F. (2025, 1er octobre). L'Oscillation Multidécennale de l'Atlantique : un géant silencieux qui façonne le destin d’Haïti. Le National.
Emmanuel, E. (2025a, 28 juillet). Nos champs, notre avenir : La lutte des agriculteurs de l’île d’Haïti face au changement climatique. Le Nouvelliste.
Emmanuel, E. (2025b, 8 août). Le Parc National La Visite : un cri d’alarme pour Haïti et au-delà. La destruction silencieuse d’un poumon écologique. Le National.
Emmanuel, E. (2025c, 11 août). Le lac Azuei raconte 1000 ans du climat haïtien : une aventure scientifique pour notre avenir. Le Nouvelliste.
Emmanuel, E. (2025d, 29 août). Comprendre les inondations en Haïti. Le Nouvelliste.
Emmanuel, E. (2025e, 16 septembre). Les Grandes Antilles sous l’emprise des pluies extrêmes. Que savons-nous pour mieux se préparer ? Le Nouvelliste.
Emmanuel, E., & Noncent, D. (2025, 10 octobre). L’Oscillation Décennale du Pacifique (ODP) : un phénomène climatique influençant Haïti. Le National.
Jérôme, J. P. (2025, 3 septembre). Journée nationale d’éducation aux changements climatiques, une initiative à consolider. Le Nouvelliste.
Millien, M. F. (2025, 9 septembre). L’éducation climatique, une urgence nationale : plaidoyer pour faire du 1er septembre la journée nationale haïtienne d’éducation aux changements climatiques. Le National.
Nations Unies. (2015). Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030. https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
You, X. (2025). China to cut emissions by 2035: What will this mean for the climate? Nature, 646, 266-267. China pledges to cut emissions by 2035. Nature, 646, 266-267. https://doi.org/10.1038/d41586-025-03166-6. https://www.nature.com/articles/d41586-025-03166-6
Alexandra Emmanuel
Équipe de Recherche sur les Changements Climatiques (ERC2), Université Quisqueya
Groupe Haïtien d’Etudes et de Recherche en Santé-Environnement (GHERES)
Pôle des Amériques, Haïti Sciences et Société (HaSci-So).
Max François Millien
Laboratoire de Zoonose et Innocuité Alimentaire
Université Quisqueya
Evens Emmanuel
Pôle Haïti-Antilles, Haïti Sciences et Société (HaSci-So)
Équipe des Partenaires Scientifiques pour la Communication de la Recherche (E-PSi-CoRe)
evens.emmanuel@uniq.edu