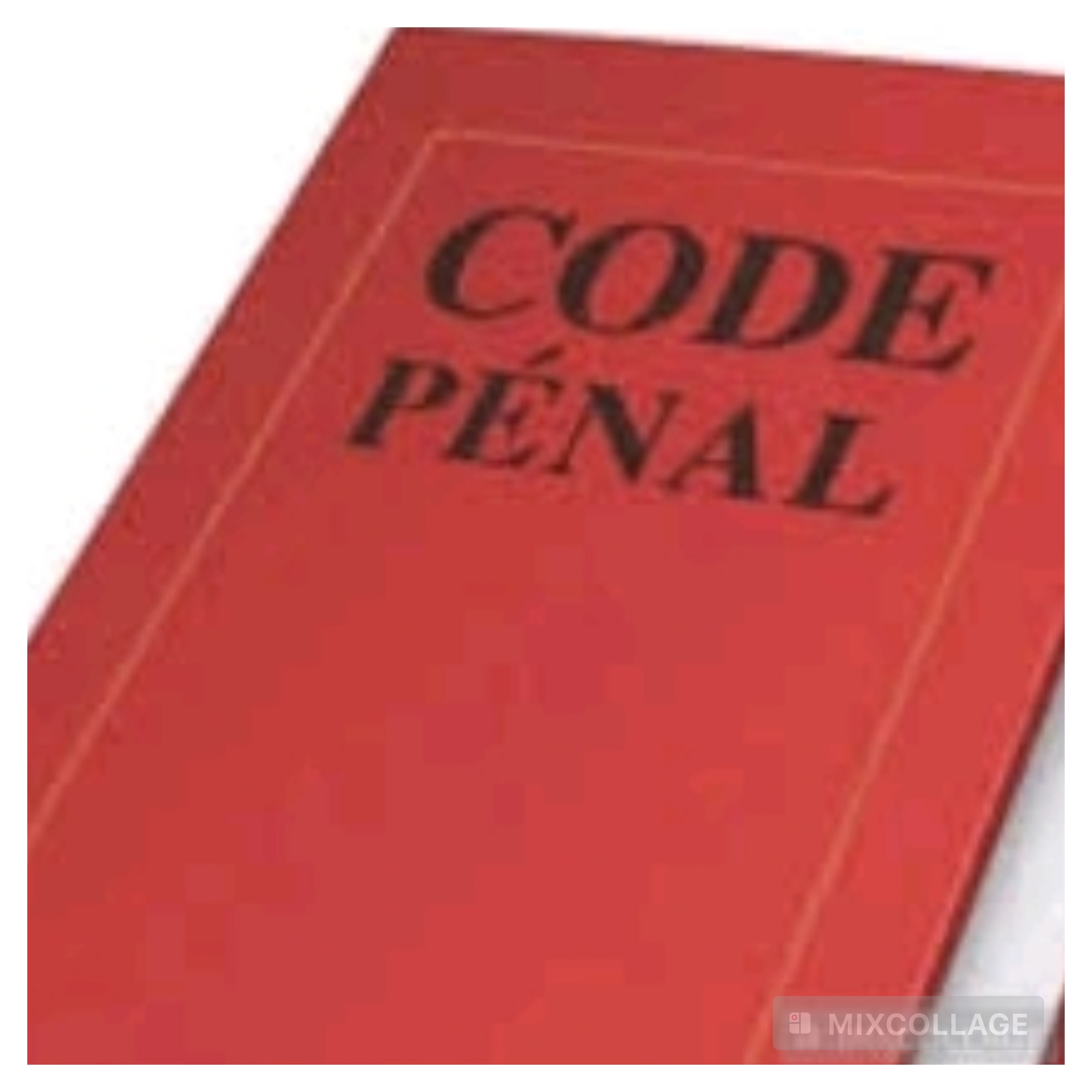Le grand enfant de la Maison-Blanche voulait un joujou éclatant, un trophée doré à poser sur son ventre comme un soleil artificiel. Il rêvait d’un monde à son image lisse, bruyant, soumis à son égo où chaque regard se tournerait vers lui, ébloui par sa propre lumière. Il voulait qu’on le nomme faiseur de paix, messie d’un empire d’illusions, distribuant les promesses comme des miettes de gloire sur la nappe du monde.
Mais la paix ne se coud pas avec des fils d’or. Elle se tisse de respect, de justice et de mémoire. Et cet enfant, trop vieux pour apprendre, trop riche pour comprendre, confondait le tonnerre de ses tweets avec la voix du destin.
Son sourire était une vitrine. Son discours, une foire. Derrière les mots mielleux, le marchand rôdait : il vendait la vérité à la découpe, au kilo, à la tête du client. Il croyait que la paix pouvait se signer sur un chèque, que la diplomatie n’était qu’un théâtre de miroirs. Sous ses dorures, il portait la misère de ceux qui n’ont jamais aimé que leur reflet. Et pourtant, il voulait qu’on l’applaudisse, qu’on lui déroule les tapis rouges de la reconnaissance, comme si les consciences s’achetaient à la bourse des vanités.
Mais voilà que l’Europe vieille dame aux mains ridées d’histoire refusa de s’incliner. Les nobélistes, les penseurs, les rêveurs, les juges de la paix ne marchèrent pas dans ses mensonges. Alors la colère prit feu sous ses cheveux jaunes, comme une torche d’orgueil. Il tonna, il tempêta, il accusa les sages de trahison, les peuples de faiblesse, les vérités de complot. À ses côtés, un colistier au sourire carnassier, dont le sang charrie les ombres du passé, savourait la chute du bon sens. L’un vendait la peur, l’autre la guerre et tous deux croyaient pouvoir repeindre le monde aux couleurs du profit et du mensonge.
Les faiseurs de Nobel ont bien failli trébucher sur une tête jaune, cette citrouille gonflée de vanité, pleine de bêtises et d’orage. Le voilà, l’homme qui se prend pour Dieu sur terre, frustré de ne pas avoir reçu la colombe de papier des sages de Suède ! Lui, le tonitruant prophète de la discorde, pensait que le monde entier allait dérouler un tapis d’or devant ses pas d’éléphant. Il croyait que le Prix Nobel de la paix n’était qu’une médaille de foire, qu’on offre à celui qui crie le plus fort ou signe les contrats les plus sonores.
L’homme aux cheveux jaunes
Les malveillants comme il les nomme ces « méchants Norvégiens » aux lunettes de sagesse, ne se sont pas laissé éblouir par ses lumières criardes. Ils ont regardé au-delà du vernis, au-delà du bruit, et n’y ont vu qu’un homme aux poches pleines de tempêtes et au cœur vide de compassion. Il est à plaindre, ce pauvre Donald ! Cet homme aux cheveux jaunes comme une botte de paille trempée dans la vanité, qui crache sur les faibles tout en quémandant l’amour des puissants. Il voulait sa place parmi les immortels, il voulait qu’on grave son nom dans le marbre de la paix, mais les Scandinaves lui ont opposé un simple sourire ce sourire froid du Nord qui dit tout sans un mot : le tonnerre ne mérite pas la colombe.
Un membre du comité, dit-on, aurait même murmuré avec l’élégance glaciale des sages que cet homme ne comprend rien à la philosophie du Nobel. Car le Nobel de la paix n’est pas un hochet pour rois capricieux, ni une médaille de vanité pour marchands de guerre. C’est un éclat de conscience, un fruit d’humilité, une étoile réservée à ceux qui se tiennent debout sans écraser les autres.
Il y a, dans les recoins de son orgueil, une blessure qu’il cache mal. L’homme aux cheveux jaunes ne supporte pas le fantôme élégant de son prédécesseur. Obama, le président noir, souriant, calme, cultivé lumière d’intelligence et de retenue est pour lui un miroir insupportable. Car dans ce miroir, il ne voit pas seulement un rival. Il y voit tout ce qu’il ne sera jamais : la grâce, la mesure, la dignité tranquille. Et ce reflet le brûle comme une vérité qu’il ne peut supporter.
Les psychologues diraient qu’il souffre d’un complexe d’infériorité ; le poète, lui, y verrait un gouffre où se débattent la haine et la jalousie, où l’homme blanc, prisonnier de son propre privilège, se sent nu face à la grandeur d’un autre. Alors il s’invente des murs pour se protéger, des ennemis pour se rassurer, et des mensonges pour se croire fort. Mais dans son regard, on lit la peur celle de n’avoir jamais été à la hauteur, celle d’être réduit, face à l’Histoire, au rôle du bouffon couronné que le vent des temps finira par renverser.
Et pourtant, il faut presque le consoler, ce faux blond : il ne pourra jamais prétendre être un homme, lui qui traîne derrière lui tant de parchemins inhumains et sanglants.
Mais le vent souffle encore sur les ruines, et les mots des poètes traversent les murs des palais. Le monde se souvient. On ne bâillonne pas la mémoire avec des millions, on ne rachète pas les consciences avec des statues dorées. Le grand enfant peut bien hurler sous ses néons, l’Histoire, elle, parle bas et sa voix ne ment pas.
Car il est des choses que ni l’or ni le pouvoir ne peuvent acheter : la dignité d’un peuple, le pardon d’une victime, et la lumière tranquille de ceux qui, sans trône ni fortune, gardent vivante la flamme de l’humanité.
Maguet Delva