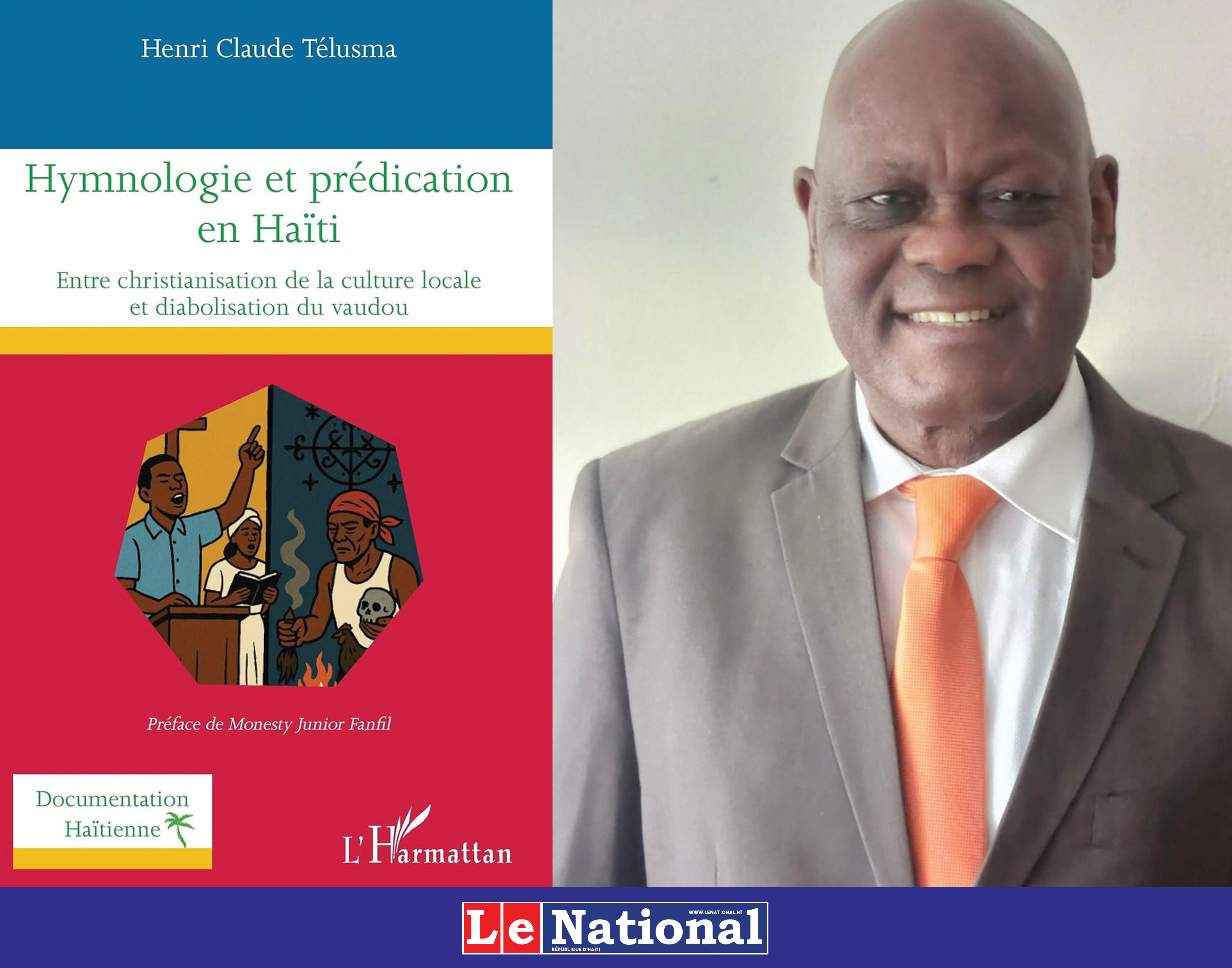Cent ans non pas comme une clôture, mais comme une persistance : celle d’une œuvre qui continue de brûler les certitudes, de troubler les corps et d’ouvrir les imaginaires. En portant Hadriana dans tous mes rêves sur la scène de l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, le 7 mars 2026, le théâtre devient l’espace privilégié de cette incandescence.
L’adaptation théâtrale proposée par Williamson Belfort s’inscrit dans cette lignée de l’excès maîtrisé. En assumant à la fois l’adaptation, la mise en scène et l’interprétation, Belfort ne cherche pas à illustrer le roman, mais à en réveiller les forces souterraines. Le théâtre devient alors un rituel : la parole se fait incantation, le corps devient texte, et la scène, un territoire de possession symbolique.
L’image de l’affiche est éloquente. Une figure solitaire, voilée, bras ouverts, comme offerte à une lumière venue d’ailleurs. Est-ce Hadriana ? Est-ce le narrateur ? Est-ce Haïti elle-même, suspendue entre l’ombre de son histoire et la promesse de ses rêves ? Cette ambiguïté est au cœur de l’esthétique de Depestre, où le réel et le mythique se confondent, où le vaudou n’est pas folklore mais vision du monde, poétique de la résistance et de la joie.
En célébrant René Depestre, cette pièce rappelle que l’écrivain fut toujours un passeur : entre continents, entre idéologies, entre langues. Exilé, révolutionnaire, poète du désir, il n’a jamais cessé de défendre une littérature de la vie contre toutes les formes de mort symbolique. À cent ans, son œuvre refuse la muséification. Elle réclame le mouvement, la chair, la scène.
À Paris, ce soir de mars, Hadriana ne sera pas seulement rejouée : elle sera réactivée. Elle surgira à nouveau, insolente et lumineuse, pour rappeler que la liberté — comme le rêve — ne se raconte pas seulement. Elle se danse, elle se crie, elle se met en scène.
Et c’est peut-être là, dans cet entre-deux du texte et du corps, que René Depestre continue de nous parler avec le plus de force.
Godson MOULITE