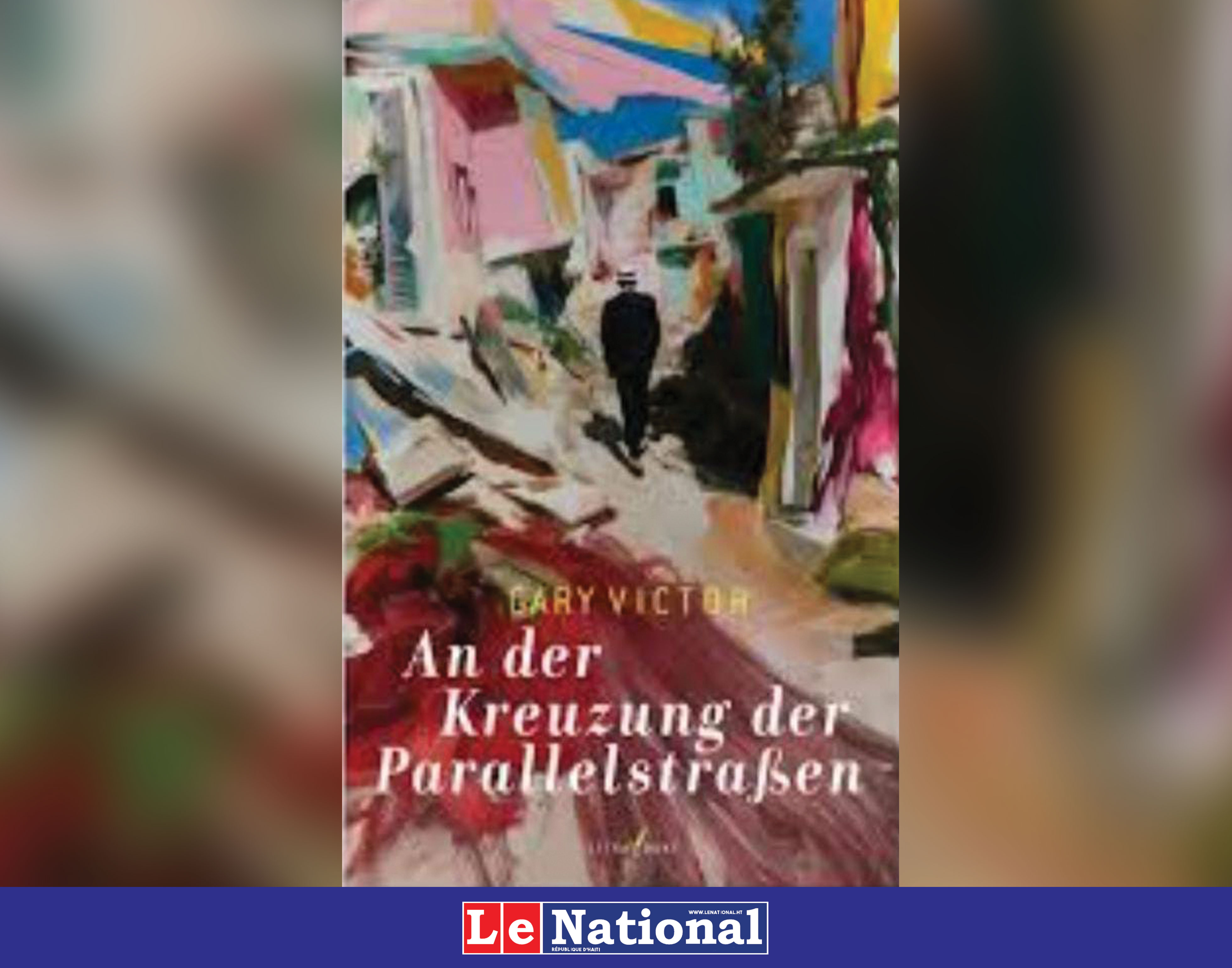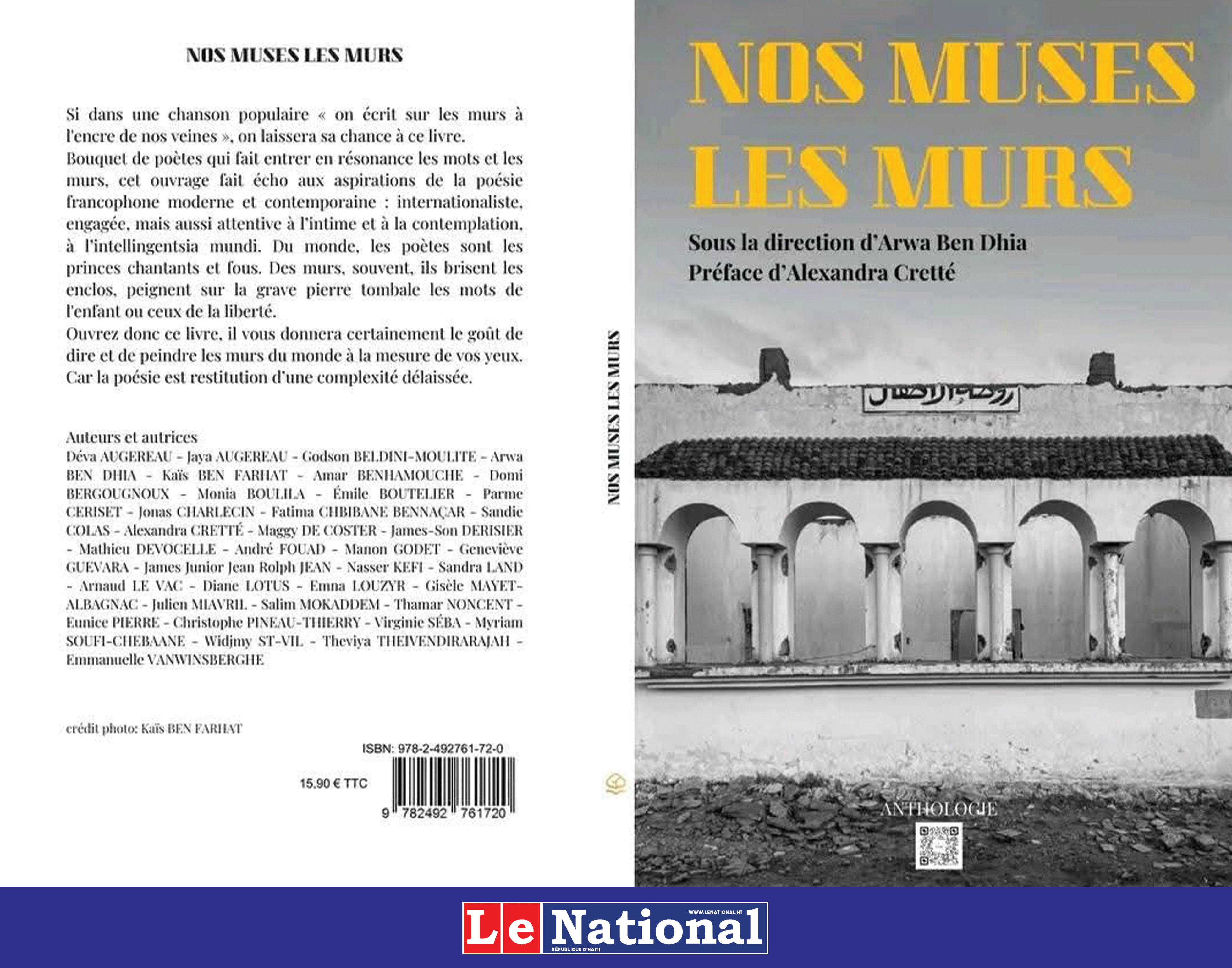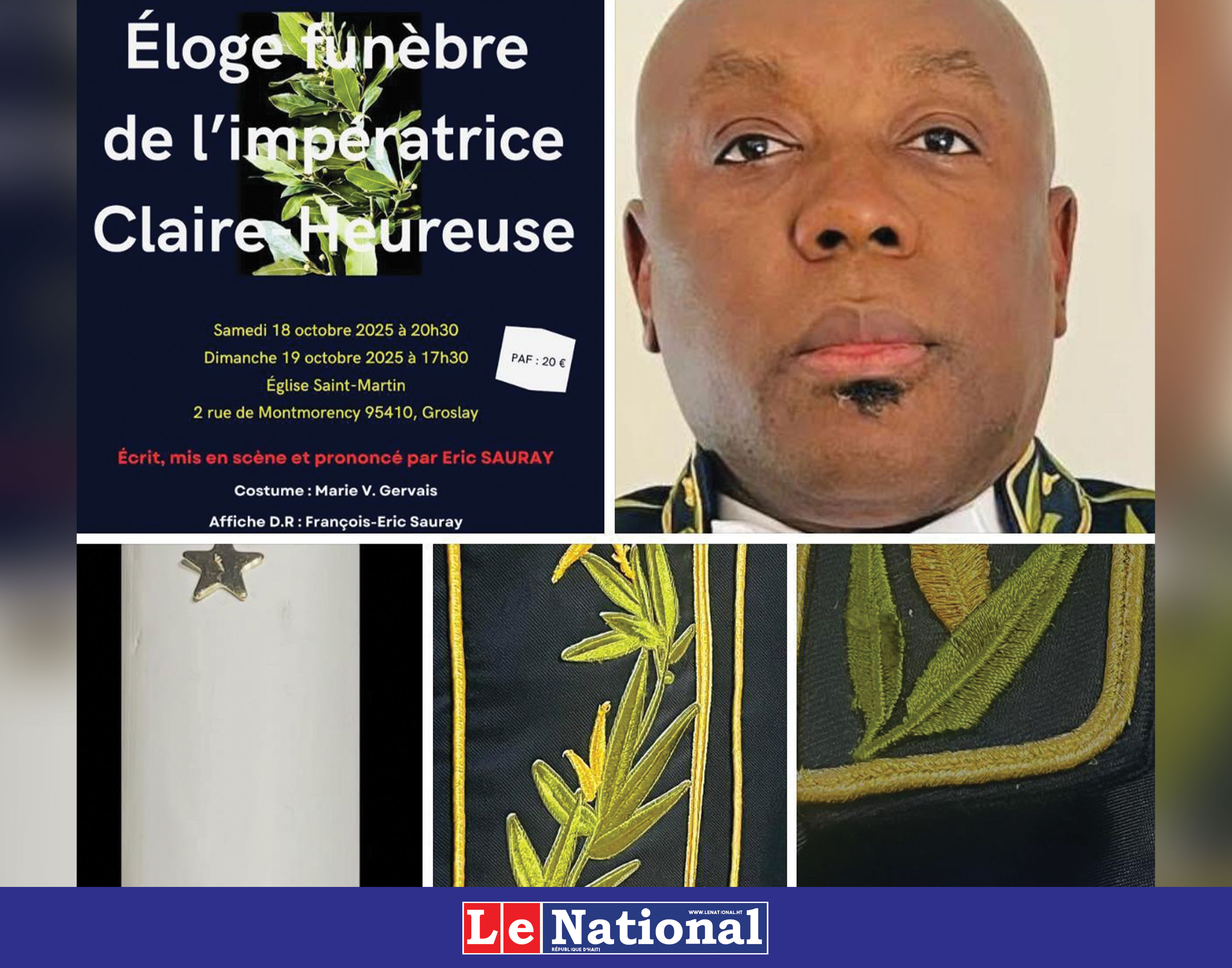La magie de l’internet, mariée aux sortilèges du numérique, a fait surgir sur le fil des réseaux sociaux une image inattendue, un éclat d’archives arraché à l’oubli par le mouvement invisible des algorithmes. Cette fois, la surprise fut totale : mon frère Gaëtan Mentor a partagé une photographie qui, à elle seule, raconte un pan entier de notre histoire diplomatique.
Car dans le domaine des relations internationales, une photo vaut mille archives. Elle ne fige pas seulement des visages ; elle révèle une atmosphère, une époque, une manière d’être au monde. Et sur celle-ci, neuf hommes, silhouettes impeccables, se tiennent droits, dignes, souverains. Leur simple posture parle plus fort qu’un discours : elle dit la fierté d’appartenir à une nation qui savait encore tenir son rang parmi les nations.
Cette image est plus qu’un souvenir : elle est une apparition, une révélation. Elle respire l’élégance, la confiance, la grandeur. Elle fait renaître une Haïti dont nous sommes orphelins depuis si longtemps, une Haïti disparue qui nous revient comme une plaie ouverte. Neuf figures, neuf colonnes d’un temple aujourd’hui effondré. Leurs costumes étaient des armures d’élégance, leurs visages des miroirs d’intelligence, leurs postures des proclamations silencieuses de dignité. Jadis, nos diplomates portaient la patrie comme un manteau de lumière ; désormais, nous traînons son nom comme une loque de honte. Jadis, ils étaient les colonnes d’un sanctuaire ; aujourd’hui, nous errons parmi les ruines de ce temple brisé.
L’Haïti d’hier, pleine de fierté
Ces hommes — Vieux, Dorsinville, Charles, Grimard, Domond, Roy et tant d’autres — ne sont plus que des fantômes photographiques. Mais dans leur silence figé, ils semblent nous interroger, nous accuser : qu’avez-vous fait du pays que nous avons servi avec droiture, que nous avons élevé au rang des nations respectées ? Et nous, héritiers indignes, baissons les yeux. Car cette photo n’est pas seulement une archive, elle est un miroir. Et dans ce miroir, l’Haïti d’hier, pleine de fierté, contemple l’Haïti d’aujourd’hui, réduite à la pitié.
Parmi ces figures, Antonio Vieux se détache. Avocat érudit, poète au verbe fin, critique redouté, ministre plénipotentiaire à Paris, il incarnait l’idéal du diplomate haïtien. Sa plume contribua à l’acte fondateur de l’ONU, lors de la conférence de San Francisco, où son discours résonna comme un éclat de jeunesse cultivée et idéaliste. Humaniste, « prince de la jeunesse », il sema des poèmes comme des pierres précieuses dans les revues de son temps. Face à Duvalier, cynique apôtre du noirisme, il resta debout, droit, inflexible. Mais cette verticalité devint sa condamnation : arrêté, humilié par les sbires du régime macoute, Antonio Vieux fut conduit au Fort Dimanche, où il mourut, victime de la barbarie politique.
Max Dorsinville, lui, avait fait des rayonnages d’une bibliothèque paternelle des marches vers la grandeur. Académicien, militaire, patriote, écrivain, ministre, chef de cabinet du président Estimé, il porta la ferveur nationale jusqu’au bout de ses ongles. Diplomate en Afrique et en Amérique du Sud, il connut ensuite le chemin de l’exil. Revenu au pays, il y termina sa vie, comme si le retour au sol natal avait été à la fois sa blessure et son apaisement.
Joseph D. Charles, diplomate raffiné, poète, écrivain, ministre des Relations extérieures, ambassadeur à Washington, conjuguait rigueur et élégance. Aux Nations Unies, il participa à l’un des votes les plus cruciaux du XXe siècle : la création de l’État d’Israël. Ce jour-là, Haïti, « petit pays aux grandes espérances », fut courtisée comme jamais dans son histoire. Et Joseph D. Charles, par son intelligence et sa stature, rappela que l’élégance diplomatique haïtienne avait le pouvoir de peser sur le destin des nations.
Luc Grimard, enfin, poète et consul général au Havre, incarna la dernière flamme de cette lignée qui mariait littérature et diplomatie, beauté du verbe et service de l’État.
Et puis, sur cette photographie intemporelle, se tiennent aussi deux autres figures de premier plan : Jules Domond, ministre du Commerce et de l’Industrie du 1er avril 1953 au 31 juillet 1954, homme aux multiples fonctions, et Hérard Roy, ministre de l’Économie et des Finances du 17 janvier 1900 au 12 mai 1902.
Ces beaux messieurs impeccablement alignés avaient pris la pose aux côtés d’André, leur chauffeur, silhouette discrète mais bien présente, le dernier à l’extrême droite de la photo. Comme pour rappeler que derrière la grandeur des élites, se tiennent toujours, en retrait, ceux qui portent silencieusement le poids des routes et de l’histoire.
Aujourd’hui, alors que le nom d’Haïti se traîne dans la boue des crises, cette photo demeure comme une métaphore : un miroir suspendu entre hier et aujourd’hui, où nos élégances passées éclairent nos décadences présentes. Ces diplomates, statues vivantes du patriotisme et de la culture, semblent murmurer encore : Que reste-t-il de cette élégance ? De cette unité ? De cette grandeur perdue ?
Maguet Delva