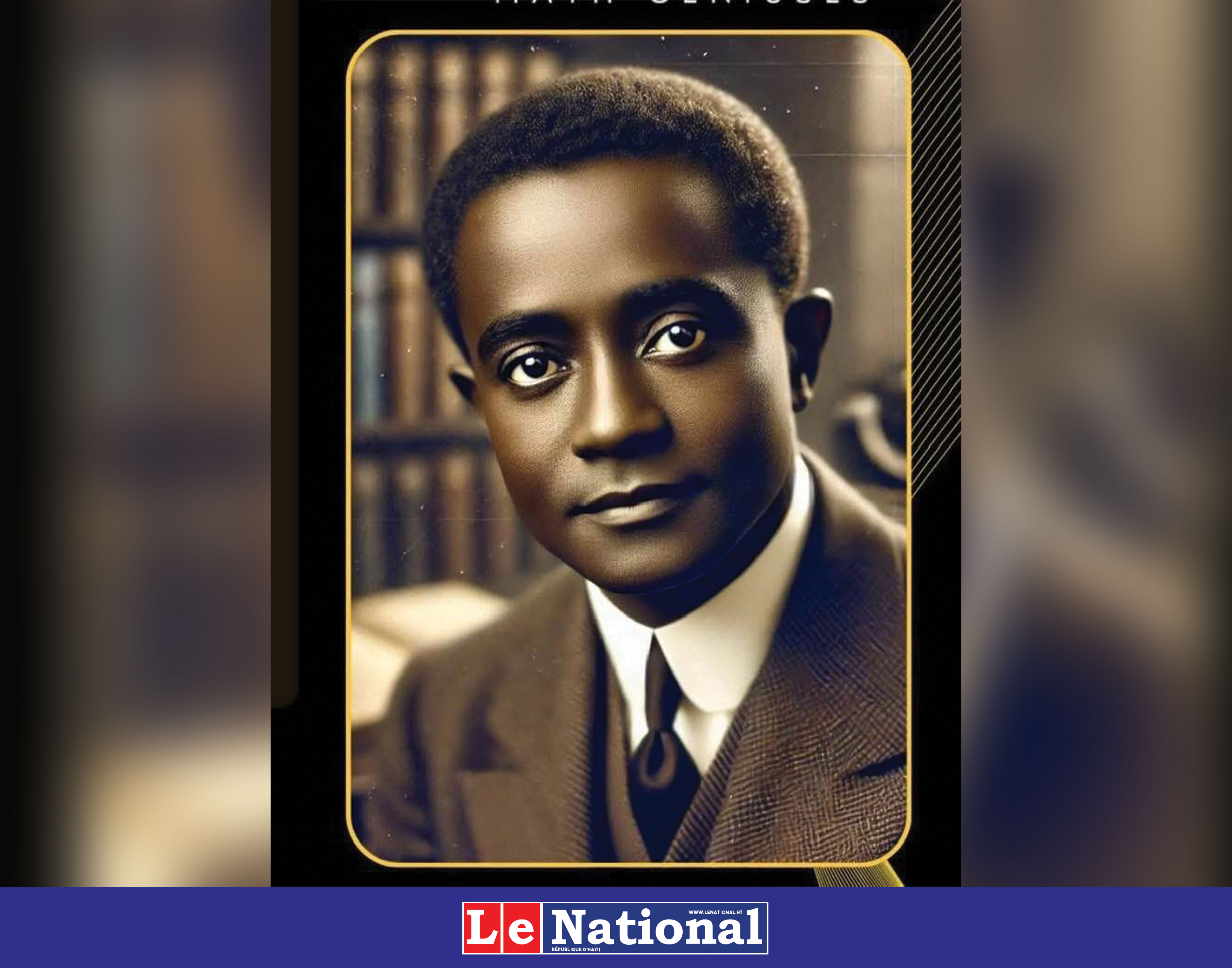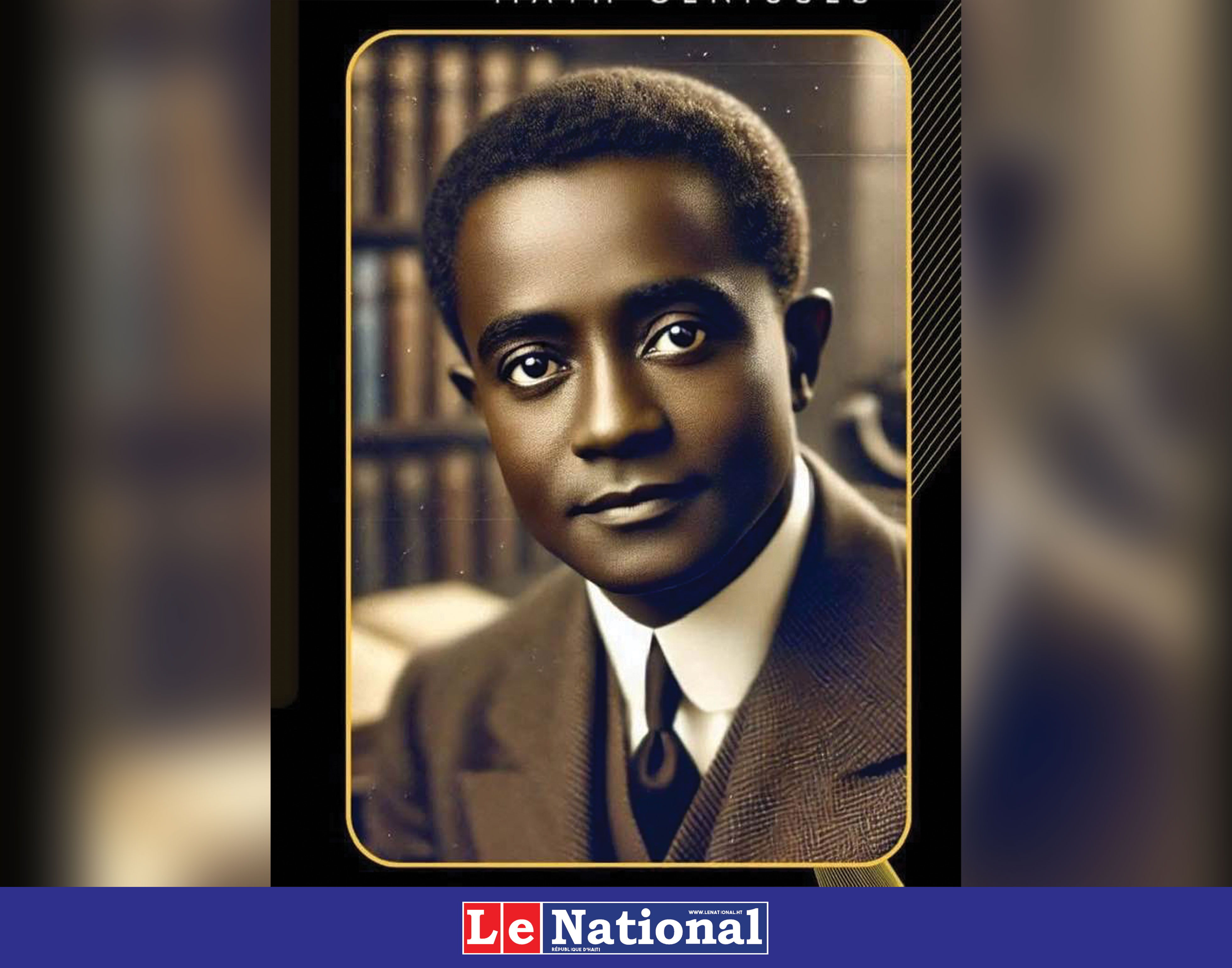Ce week-end, le Rassemblement et Regroupement des Archives Diplomatiques d’Haïti a poursuivi son cycle consacré aux grandes figures de la diplomatie nationale. Après avoir rendu hommage, la semaine dernière, à Fernand Hibbert – écrivain, diplomate et esprit brillant qui fit rayonner Haïti sur la scène internationale –, c’est aujourd’hui à son fils, Lucien Hibbert, que revient la lumière.
Évoquer Lucien Hibbert, c’est feuilleter l’une des pages les plus éclatantes de notre histoire diplomatique, un chapitre dont l’éclat continue d’illuminer notre mémoire collective. Héritier d’un nom déjà prestigieux, il sut lui donner une résonance propre. Docteur en mathématiques formé à la Sorbonne, homme de culture et de discipline, il a marqué durablement la diplomatie haïtienne.
Ambassadeur auprès de l’OEA à Washington, il fut la voix d’Haïti aussi bien dans le dialogue bilatéral que dans les grandes instances multilatérales. À deux reprises, il occupa le poste de ministre des Relations extérieures, s’imposant comme l’un de ces rares serviteurs de l’État dont la rigueur et la constance inspirent encore le respect.
Il fut une voix inébranlable, ferme et claire, au sein de l’Organisation des États Américains cette même institution régionale qui, ironie de l’histoire, devait plus tard peser lourdement sur le destin de notre pays. Là où d’autres vacillaient, Lucien Hibbert, tel un roc battu par les vagues, resta debout. Sa parole, nourrie de culture et de rigueur, résonnait comme une cloche lointaine rappelant à tous que la diplomatie haïtienne n’était pas une ombre, mais une présence digne, pensante et vibrante.
Évoquer Lucien Hibbert aujourd’hui, ce n’est donc pas s’enfermer dans la nostalgie mais plutôt brandir un miroir tendu à notre époque : un miroir qui nous dit que la grandeur n’est pas un rêve impossible, mais une page que nous avons déjà écrite, et que nous pouvons écrire encore.
Lucien Hibbert, c’était l’équilibre rare entre la précision du mathématicien et l’élégance du lettré, entre la fermeté de l’homme d’État et la souplesse du diplomate. On peut dire qu’avec lui, la diplomatie haïtienne trouvait à la fois un phare pour s’orienter et un chêne pour s’ancrer. Après le père Fernand, voici le fils Lucien : deux générations, deux trajectoires, une même vocation servir Haïti par la plume, par la parole et par la dignité.
Il faut poursuivre contre vents et marées
Dans ces longues nuits d’Haïti, faites de ténèbres épaisses et de cris assourdissants qui ébranlent notre raison de vivre, certains s’interrogent : à quoi bon continuer d’évoquer les belles pages de notre histoire ? L’un de ceux qui me suivent sur la vaste planète numérique, où Facebook devient une agora moderne, m’a récemment interpellé. Avec une voix à la fois lasse et révoltée, il m’a lancé : « Delva, tu n’en as pas assez de nous aligner ces belles pages de l’histoire d’Haïti et de sa diplomatie ? Regarde autour de toi, contemple notre indigence contemporaine ! »
Que répondre à un tel désenchantement ? Et pourtant, c’est précisément dans ces moments de désespoir qu’il faut raviver les flambeaux du passé, comme on rallume une lampe dans la nuit pour ne pas se perdre. Se souvenir de nos grandeurs n’est pas fuir la réalité : c’est rappeler que nous avons déjà su nous tenir debout, que nous avons déjà incarné la dignité et la lumière.
Nous allons continuer, malgré vents et marées, à faire l’inventaire de notre histoire, et particulièrement de notre diplomatie. Il ne s’agit pas seulement de ressasser des souvenirs, mais de comprendre où nous étions et où nous sommes aujourd’hui. C’est un exercice pédagogique, structurant, une école de lucidité qui nous oblige à regarder le chemin parcouru et à mesurer nos dérives.
Il faut bien qu’un jour nous fassions quelque chose de positif pour ce pays que nous aimons tous. Mais comment agir sans mémoire ? Comment bâtir sans fondations ? L’histoire la grande histoire de ce pays m’impose de rester à bord du navire fragile mais résistant qu’est notre mémoire collective. Quitter ce bateau serait abandonner le gouvernail et laisser les flots nous engloutir dans l’oubli.
Je choisis donc de continuer le voyage, au milieu de ces pages historiques qui sont comme des archipels de lumière dans la mer agitée de notre présent. Oui, nous avons une très belle histoire, oui, nous avons un beau pays. Certes, nos temps sont rudes et la houle de nos crises contemporaines est violente. Mais un peuple qui sait d’où il vient possède toujours une boussole pour se diriger.
Car l’histoire n’est pas un musée poussiéreux, elle est une lanterne. Elle n’est pas une nostalgie, elle est une carte. Et si nous continuons ensemble à la lire, à la partager, à la comprendre, alors peut-être pourrons-nous, un jour, transformer cette mémoire en force d’action et en projet de renaissance.
Maguet Delva