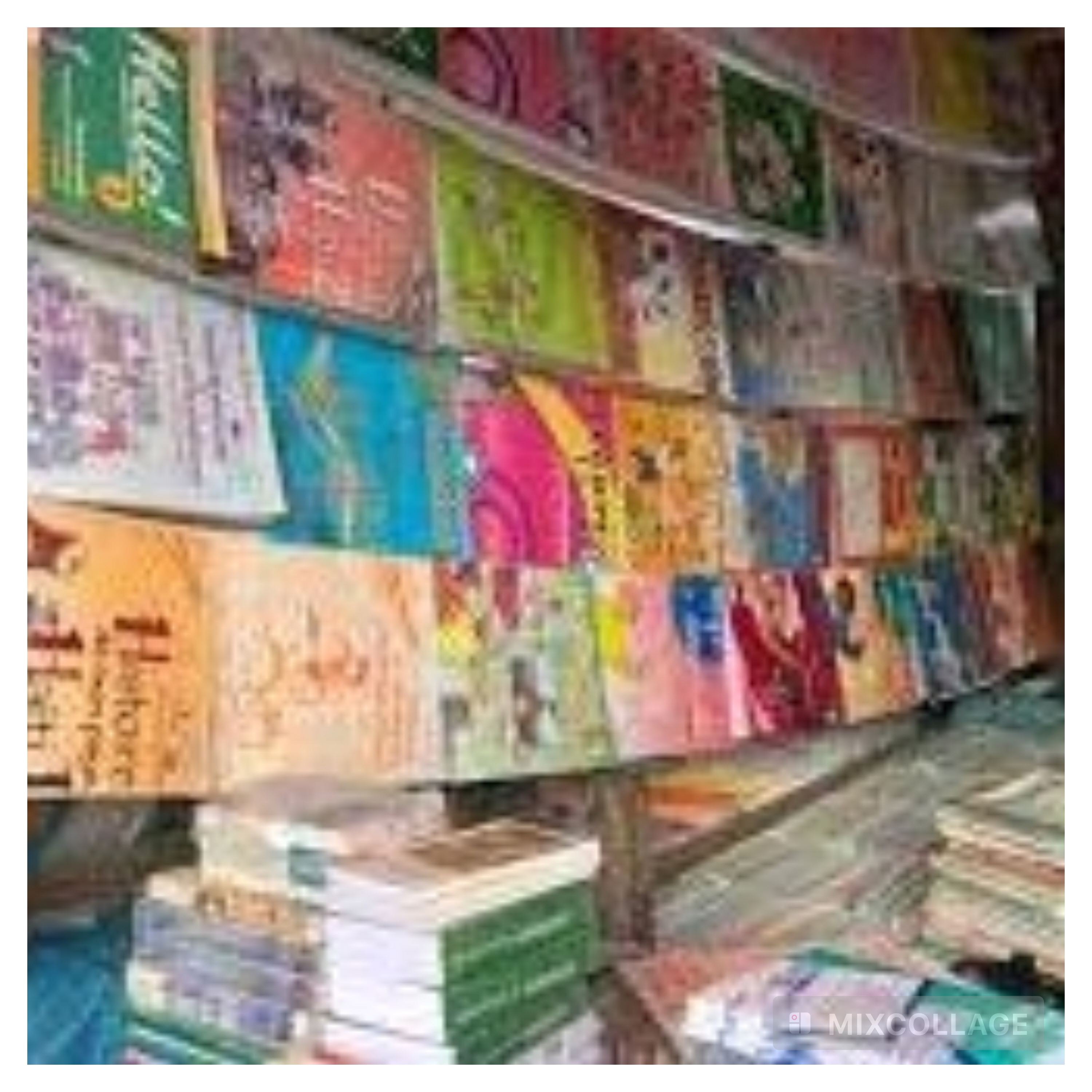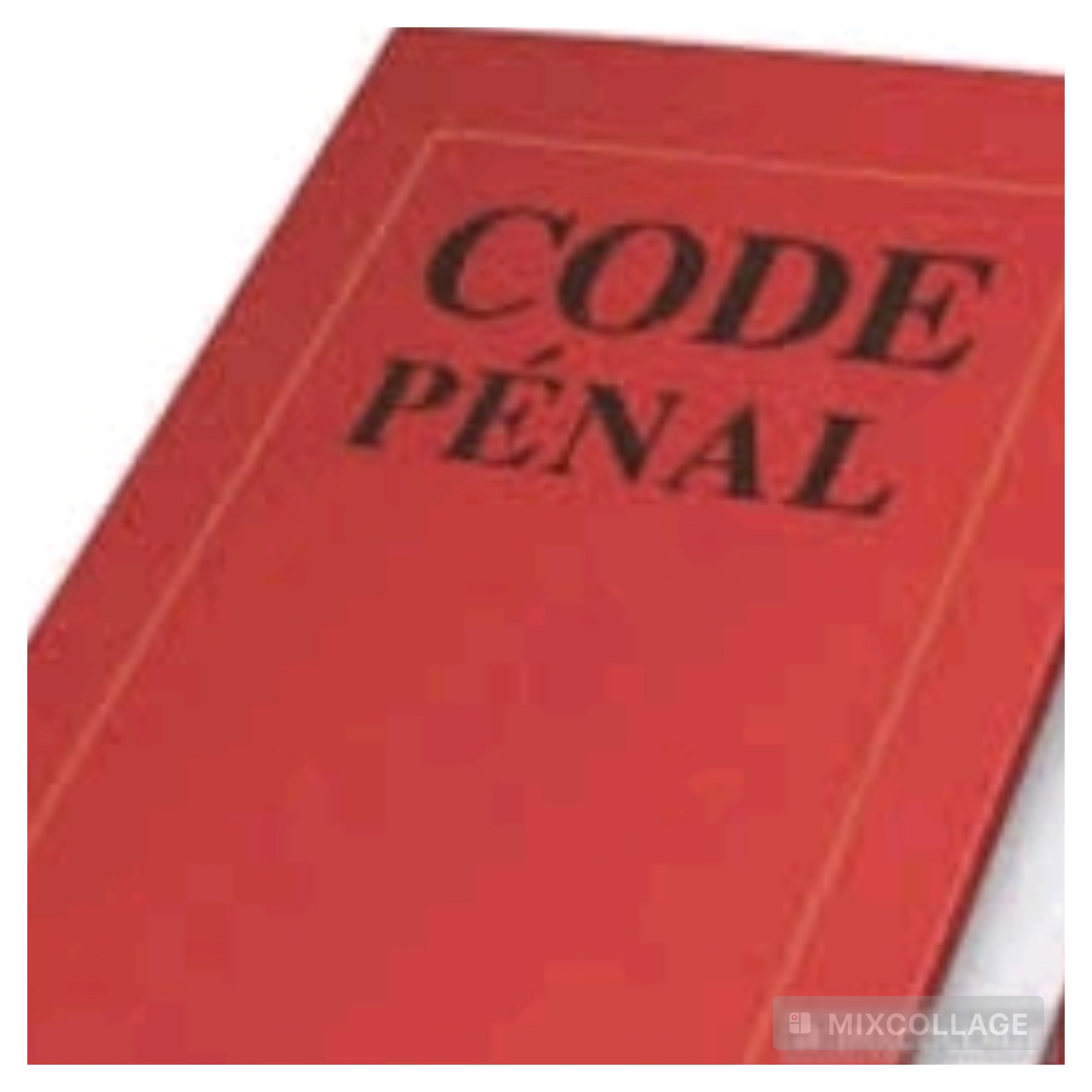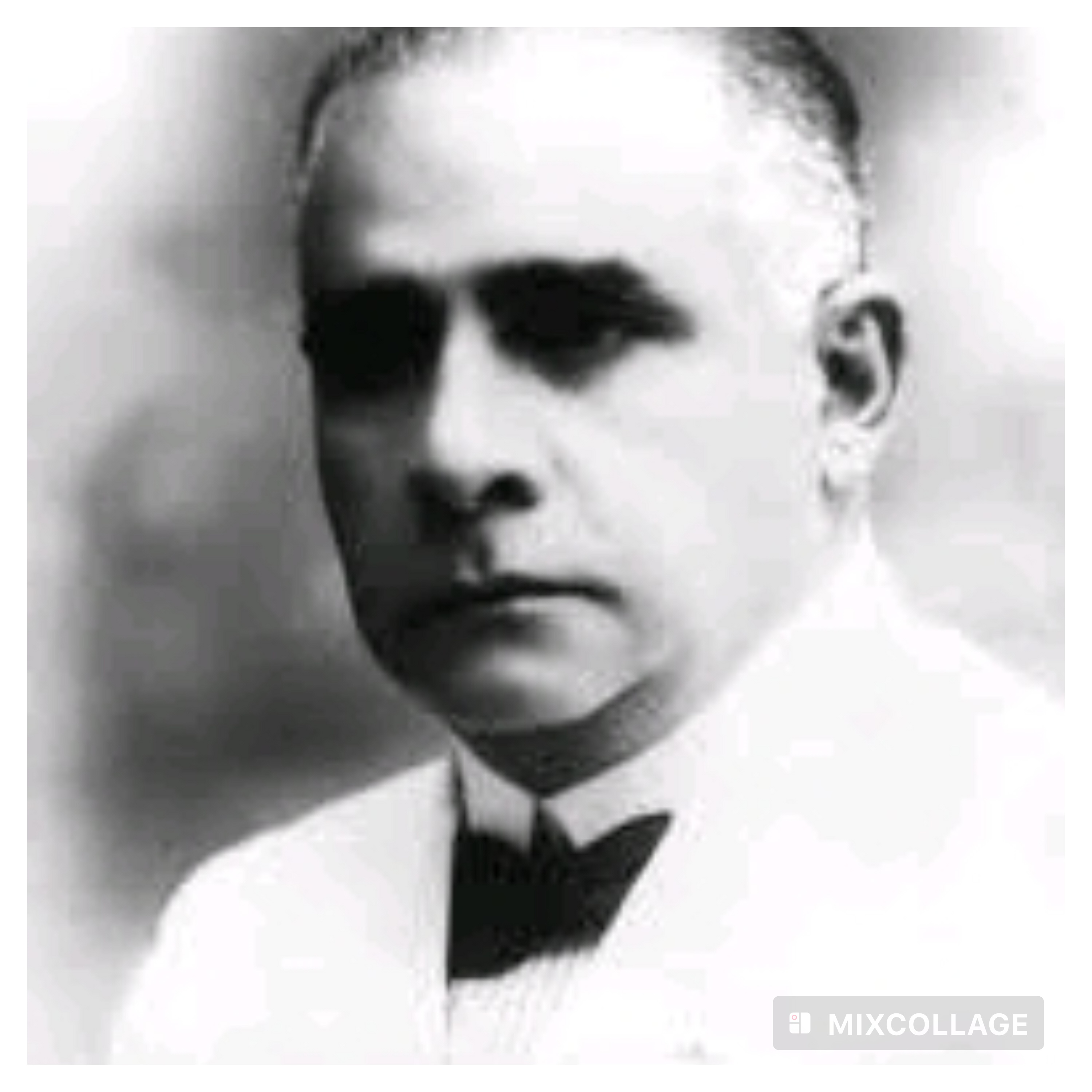Dans notre quête de mémoire, nous traquons les traces de celles et ceux qui ont façonné l’histoire diplomatique d’Haïti. Chaque archive retrouvée est une pépite, chaque bibliothèque consultée un sanctuaire. Nous explorons les fonds poussiéreux, les catalogues oubliés, les papiers jaunis par le temps, avec l’ardeur d’archéologues de l’esprit.
Le numérique rend désormais les recherches plus accessibles, comme si les murs opaques du temps s’étaient entrouverts pour laisser filtrer la lumière. Pourtant, rien ne remplace le frisson d’une découverte dans une salle silencieuse, au détour d’un rayon ou d’un manuscrit oublié.
C’est ainsi qu’à la grande bibliothèque de La Havane, richement achalandée, nous avons eu la chance de tomber sur un « miracle de papier » : la trace d’un ancien ambassadeur extraordinaire et envoyé spécial d’Haïti à Cuba. Une trouvaille rare, presque inespérée, qui témoigne de la vitalité de la diplomatie haïtienne malgré les blessures et les silences imposés par l’histoire.
Aujourd’hui, notre attention se tourne vers une famille emblématique de cette tradition : les Hibbert. Nous commençons avec Fernand Hibbert, écrivain et diplomate, figure flamboyante et intransigeante, avant d’évoquer deux autres membres de cette lignée que nous mettrons en lumière grâce au travail du RADRH (Rassemblement et Regroupement des Archives Diplomatiques de la République d’Haïti).
Le nom de Fernand Hibbert évoque à lui seul la noblesse et la force : un homme à la croisée des chemins entre diplomatie et littérature, entre action politique et création esthétique. Il inaugure une série qui entend restituer à la mémoire nationale ces diplomates de plume, ces écrivains de devoir, qui furent les visages lumineux d’Haïti sur la scène internationale.
Mettre Fernand Hibbert sous le scalpel du RADRH est une aubaine, non seulement pour les chercheurs et passionnés d’histoire, mais aussi pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre les fibres profondes de notre pays. C’est un voyage dans la mémoire d’une diplomatie jadis respectée, où chaque geste diplomatique haïtien relevait d’un acte de souveraineté, et non d’une concession.
Notre mission reste inchangée : redonner vie aux itinéraires de ces diplomates de haute stature. Leurs trajectoires rappellent un temps où Haïti, malgré ses épreuves, possédait une ligne claire, ferme et digne, portée par des élites qui adhéraient avec rigueur et fierté à un projet national guidé par l’indépendance et la mémoire dessalinienne.
Cette semaine, nous ouvrons donc le dossier de l’un de ces géants : Fernand Hibbert. Son parcours est une ascension, une marche d’alpiniste accroché aux roches abruptes de l’Histoire. Écrivain, diplomate plénipotentiaire, homme de culture et de conviction, il fut avant tout un patriote intraitable. Dès l’entrée des forces américaines en Haïti, il s’enrôla dans la résistance morale et intellectuelle. Sa plume devint baïonnette, sa parole bouclier, sa diplomatie combat.
L'étude de Fernand Hibbert n’est pas une simple biographie : c’est une leçon. Une leçon de dignité, de courage et de constance, à l’heure où nos institutions chancellent et où notre diplomatie, autrefois flamboyante, semble réduite à l’ombre d’elle-même.
Rédorer le blason de la diplomatie haïtienne à travers le RADRH est l’un de nos objectifs majeurs. Il ne s’agit pas seulement de collecter des documents jaunis, mais de mettre en lumière les vérités de chaque époque, de restituer les prises de position courageuses de nos diplomates, et de montrer comment, par leurs choix et leurs combats, ils ont écrit l’histoire.
En exhumant ces trajectoires, nous ne cherchons pas uniquement à ressusciter des noms oubliés : nous rappelons qu’il fut un temps où la diplomatie haïtienne avait une ligne claire, fière et indépendante. Une époque où chaque ambassadeur ou envoyé extraordinaire portait non pas un discours de soumission, mais une voix souveraine, forgée par la mémoire de 1804 et l’exigence dessalinienne.
Aujourd’hui, il faut le dire sans détour : nous sommes loin de ce modèle. Le fanion diplomatique haïtien, autrefois brandi avec fierté, est désormais en berne. Les causes sont multiples : faiblesse institutionnelle, fragmentation politique, dépendance économique, mais surtout une diplomatie vassalisée, trop souvent réduite à répéter les mots dictés par d’autres.
C’est pourquoi ce travail de mémoire est aussi un travail de réarmement moral. Les archives diplomatiques ne sont pas seulement des témoins muets du passé : elles sont des armes de dignité, des sources de légitimité, et des leçons pour l’avenir. À travers elles, nous pouvons non seulement comprendre ce que fut notre diplomatie, mais aussi réapprendre à rêver d’une diplomatie haïtienne digne, fière et souveraine.
Maguet Delva