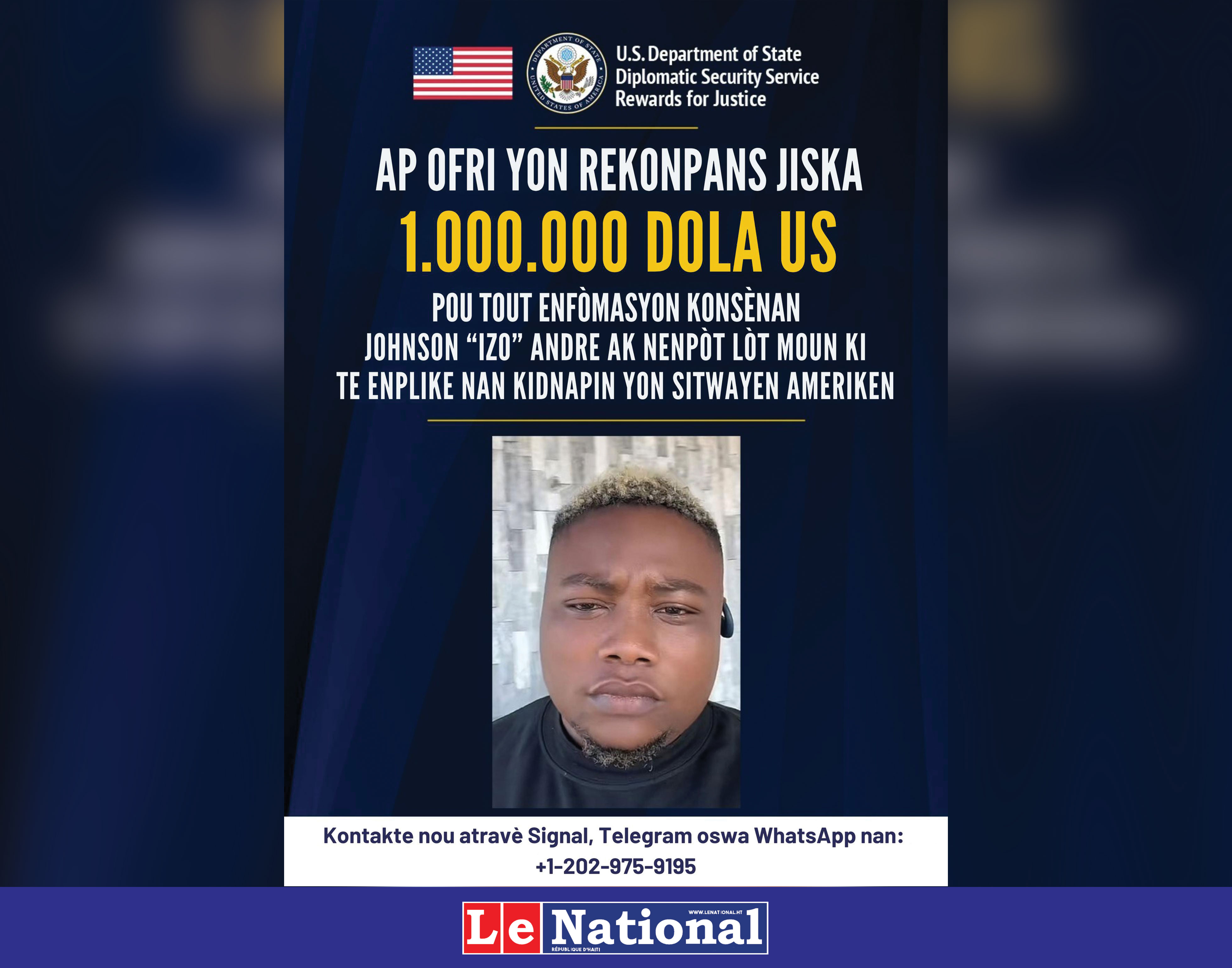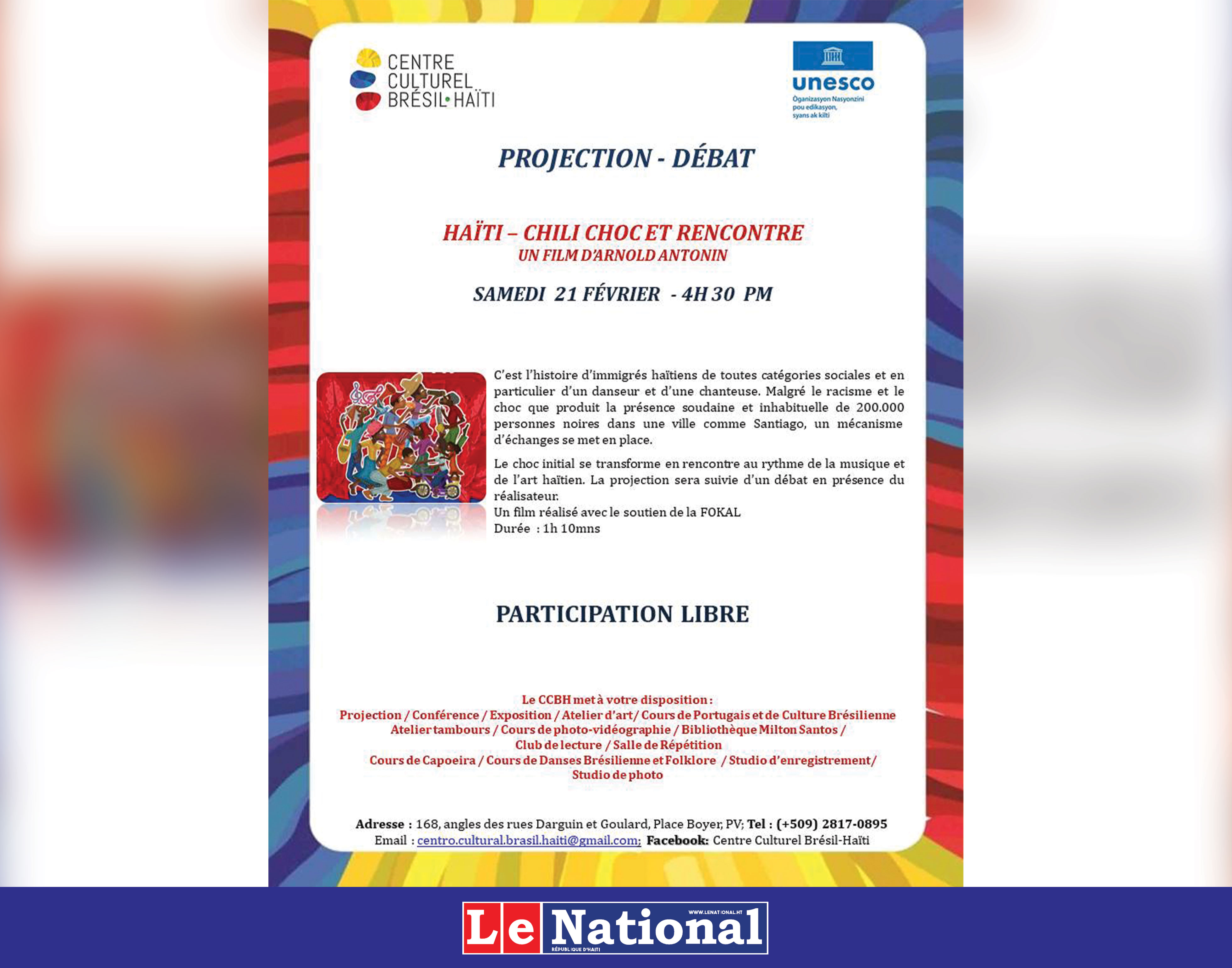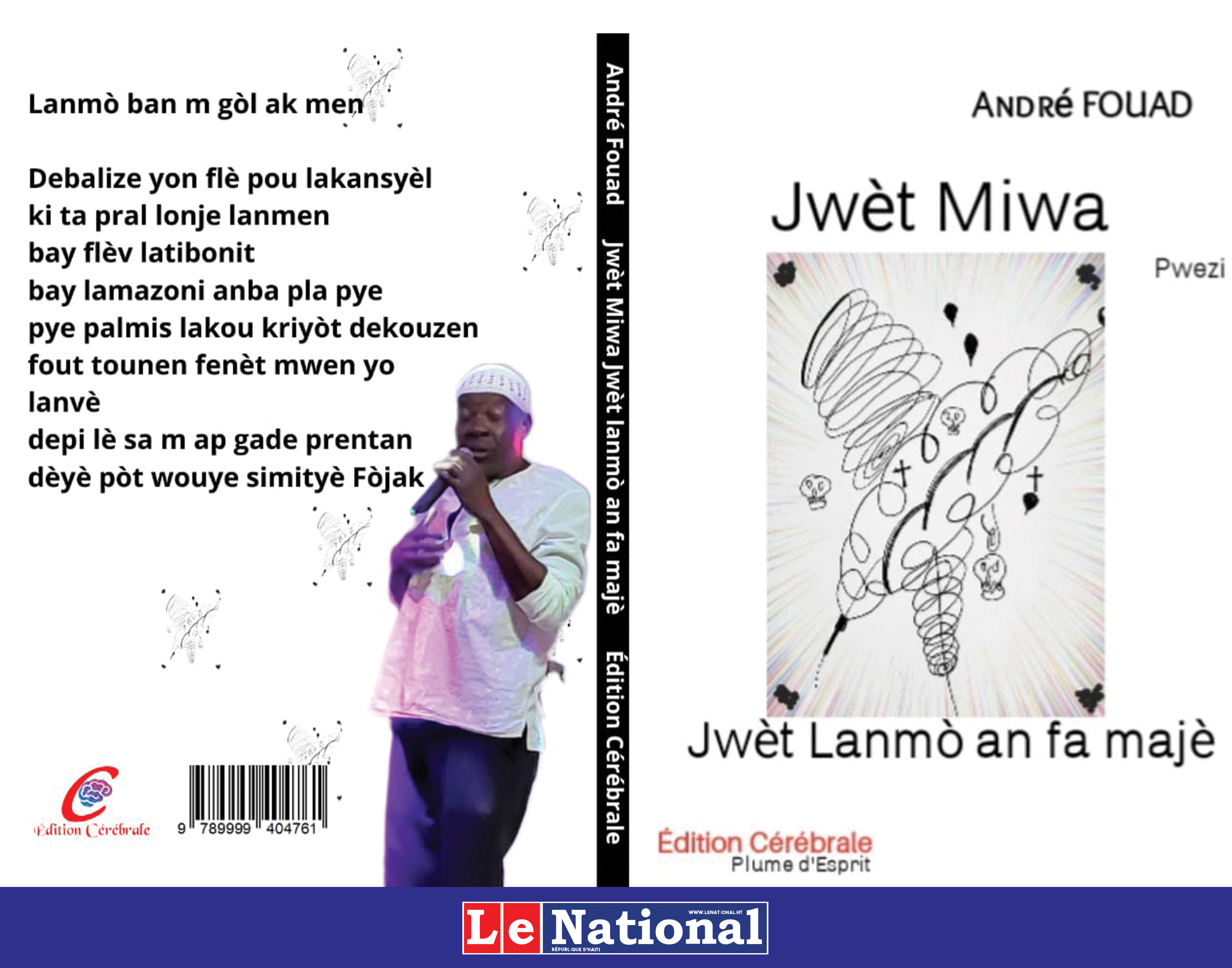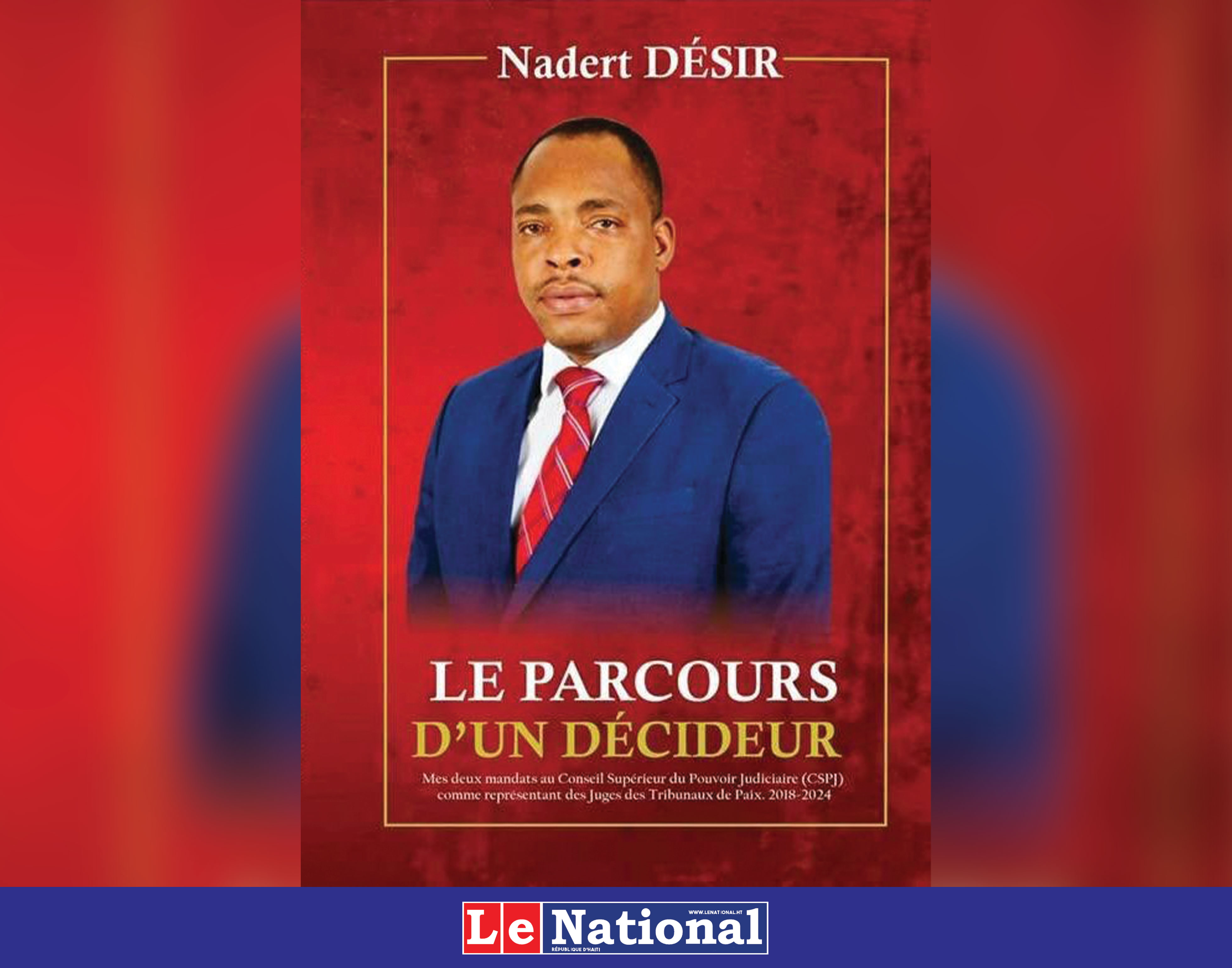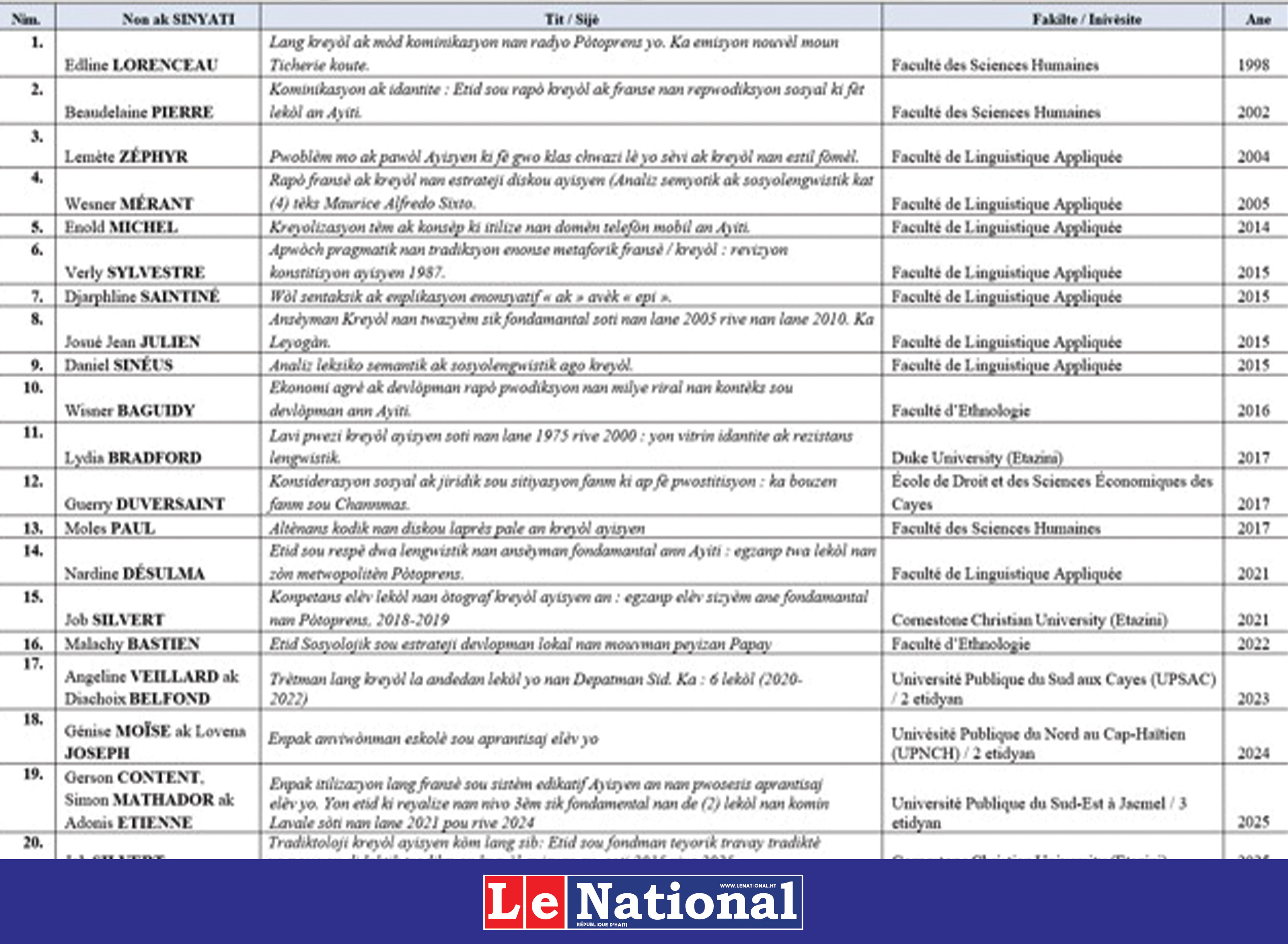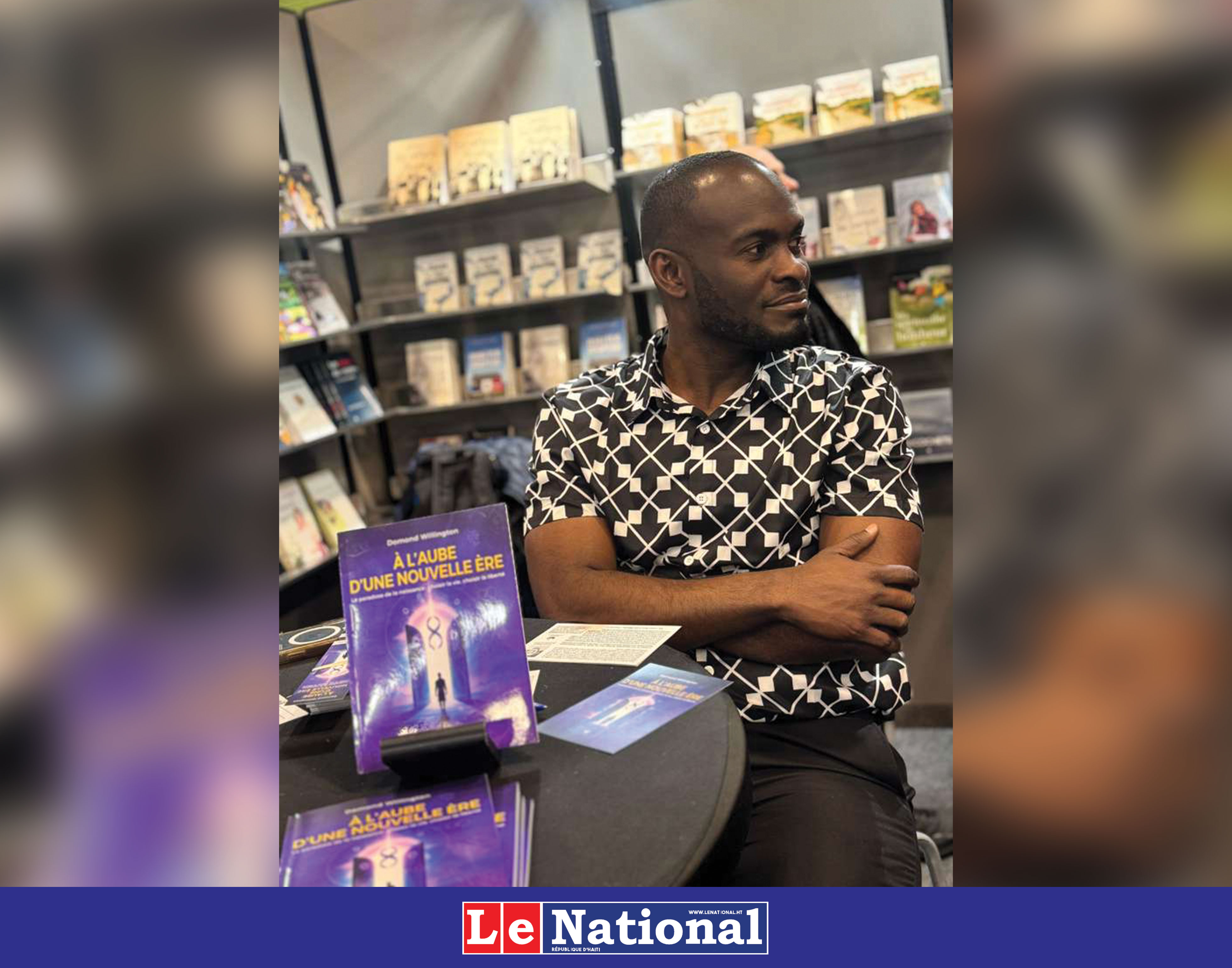Dans le cadre de la première édition du Festival de photographie et d’art contemporain de Montréal, le National s’est entretenu avec sa directrice artistique, Phalonne Pierre Louis, afin d’évoquer les grandes lignes de l’événement et les ambitions portées par l’équipe.
Le National : Qu’est-ce que TOKAY ? Comment est née l’idée de ce festival de photographie et d’art contemporain de Montréal ?
PPL: TOKAY est une association à but non lucratif née d’un constat fait il y a deux ans: le manque d’espaces et d’opportunités pour les artistes immigrant·e·s, exilé·e·s, réfugié·e·s et issu·e·s de la diversité sur la scène culturelle montréalaise et québécoise. Cette réalité, partagée par de nombreux artistes, dont les membres de l’équipe, a conduit à la création de l’association à l’automne 2024, dans une approche à la fois décoloniale, intersectionnelle et écoresponsable.
L’idée d’un festival de photographie s’inscrit dans cette démarche de créer des ponts entre les communautés, mettre en valeur la pluralité des récits et encourager le dialogue, à travers la photographie et le cinéma.
Le National : Comment avez-vous pensé la programmation pour rendre visibles ces métiers souvent de l’ombre (chef opérateur, cadreur, assistant caméra) qui, paradoxalement, façonnent l’expérience du spectateur sans jamais être reconnus à leur juste valeur ?
PPL : J’évolue moi-même dans le cinéma comme directrice de la photographie, cadreuse ou assistante caméra sur certains projets. Le choix d’intégrer ces métiers à la programmation s’est donc imposé naturellement. En tant que technicienne de l’image, il me semblait essentiel de participer à la reconnaissance de ces professions qui font vivre le cinéma. Les chefs opérateurs, cadreurs, assistants caméra, machinistes et tant d’autres sont de véritables artisans de l’image. Sans eux, l’expérience du spectateur ne serait jamais la même. La programmation a donc été pensée pour mettre en lumière leur contribution fondamentale et leur donner une occasion de partager leur récit.
Le National : En quoi le regard d’un chef opérateur ou d’un cadreur enrichit-il la discussion sur l’éducation à l’image, comparé à un discours plus classique centré sur l’auteur-réalisateur ?
PPL : Le regard d’un chef opérateur ou d’un cadreur apporte une autre dimension au discours sur l’éducation à l’image. Là où l’auteur-réalisateur va parler en termes de récit, de vision ou de mise en scène, le technicien de l’image dévoile la matérialité de l’image : la lumière, le cadre, le mouvement de la caméra. Ces choix qui peuvent être invisibles pour le spectateur, façonnent pourtant sa perception et ses émotions. Intégrer leur voix dans la discussion, c’est permettre de comprendre le cinéma de l’intérieur, comme un langage collectif, et montrer que l’éducation à l’image ne se limite pas à l’analyse du récit, mais englobe aussi la construction sensible de l’image elle-même.
Le National : Pensez-vous que le festival peut contribuer à faire évoluer la perception des techniciens de l’image, en les faisant reconnaître non pas seulement comme exécutants mais comme créateurs à part entière ?
PPL : Je ne dirais pas que le festival, à lui seul, peut transformer cette perception. Par contre, on essaie d’ouvrir des pistes, de proposer des alternatives, et surtout de rejoindre d’autres communautés qui partagent la même vision que nous. L’idée, c’est de réfléchir ensemble et de trouver des solutions communes qui puissent nous convenir à tous.
Le National : L’éducation à l’image est souvent pensée pour les enfants ou les étudiants. Ici, vous la proposez à un public large : comment construisez-vous un discours qui parle autant aux initiés qu’aux novices ?
PPL : Je pars du principe qu’il n’est jamais trop tard pour se construire une culture cinématographique. Cela me fait penser à Agnès Varda, réalisatrice française, qui disait un jour : “C’est comme cela… que j’atteignis l’âge de faire mon premier film à vingt-cinq ans, sans avoir vu vingt-cinq films, ni même dix !” (Varda, 1994, p. 22). Je pense aussi à Ava DuVernay, réalisatrice américaine, qui s’est officiellement lancée dans le cinéma à 32 ans.
Bien sûr, il serait idéal de commencer le plus tôt possible si on en a les moyens, mais l’important reste de se mettre en chemin. J’espère vivement qu’à travers des activités accessibles et enrichissantes, cette quête contribuera à éveiller et éclairer les esprits
Le National : Comment réintroduire des images anciennes dans un débat contemporain sans les figer comme simples archives, mais en les rendant actives et productrices de sens aujourd’hui ?
PPL : Pour moi, les archives ne sont jamais figées, elles traversent le temps. Elles peuvent être réutilisées et réinterprétées par des artistes ou des chercheurs, et c’est justement cette capacité qui leur donne une vitalité contemporaine. Elles deviennent à la fois des témoins de l’histoire et des matières de création, capables de produire du sens aujourd’hui.
Le National : Pensez-vous que ce festival peut devenir un lieu où le public apprend non seulement à « voir des images », mais aussi à réfléchir sur ce que signifie « voir » dans une société saturée d’images ?
PPL : Il est de ces choses qu’on ne peut pas prévoir. Je crois que ce festival sera avant tout un lieu de rencontre avec l’humain, la vie et le monde.