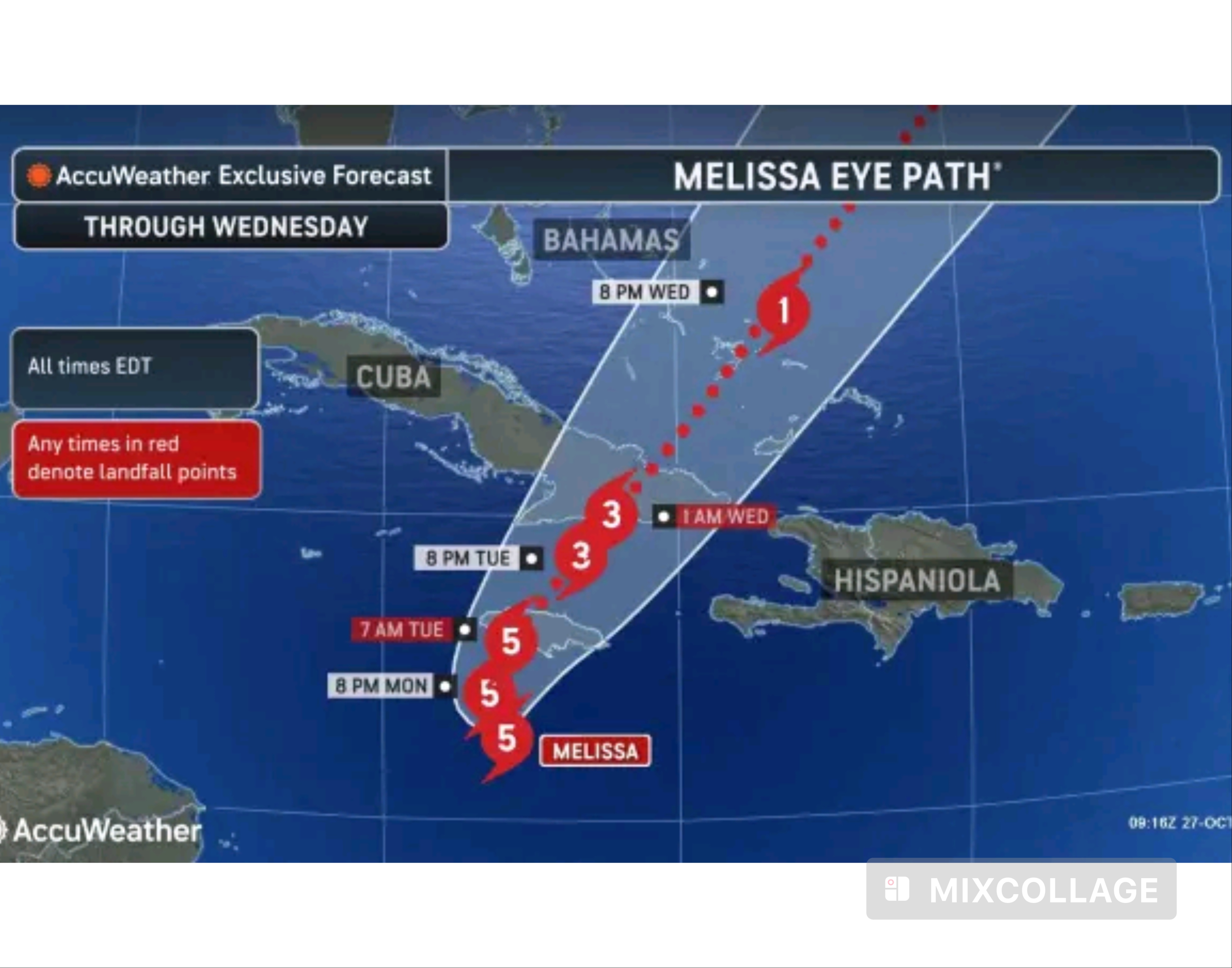A-t-on le droit d’empêcher un homme de parler sous prétexte qu’on le soupçonne d’avoir commis des fautes ? Cette question n’est pas seulement politique ; elle mesure notre maturité démocratique. Car la démocratie n’est pas qu’un ensemble d’institutions : c’est une attitude. Elle se juge à notre capacité d’écouter même ce qui dérange.
Dans une démocratie réelle, le droit de parole n’est pas une faveur, c’est la liberté première, celle qui fonde toutes les autres. Empêcher quelqu’un de s’exprimer parce qu’on ne partage pas ses idées, c’est vouloir éteindre une lampe parce que sa lumière nous gêne. Le désaccord n’est pas une menace : c’est le souffle du pluralisme. Une société qui fait taire ses contradicteurs ne construit pas la paix, elle enterre sa liberté.
Ce qu’ont subi certains hommes politiques haïtiens, comme un ancien premier ministre récemment de passage à Paris, montre combien notre culture démocratique reste fragile. S’il existe des preuves contre quelqu’un, la justice est là. Mais priver un citoyen de parole sur la base d’un soupçon, c’est confondre la justice avec la foule, la preuve avec la rumeur. Tant qu’aucun verdict n’a été rendu, nul n’a le droit moral de condamner par avance. Là où le soupçon remplace la loi, la démocratie devient un prétexte.
Le plus inquiétant, c’est que cette intolérance vient souvent de ceux qui se disent démocrates. Persuadés d’avoir raison, ils veulent faire taire leurs adversaires au nom de la pureté politique. Mais on ne défend pas la démocratie en réduisant les autres au silence : on la détruit. Être démocrate, c’est accepter que la vérité puisse aussi venir d’une voix qu’on n’aime pas.
La démocratie commence dans la conscience de chacun : écouter sans interrompre, accepter le désaccord sans haine. Chaque refus d’entendre l’autre nous rapproche de la tyrannie intérieure, celle qui précède toujours la tyrannie d’État. Empêcher un homme de parler, c’est fermer une fenêtre ; et un pays qui ferme trop de fenêtres finit par vivre dans la nuit.
Notre immaturité se manifeste surtout sur les réseaux sociaux, devenus des tribunaux de la colère. Là où le débat devrait éclairer, la haine incendie. Les mots deviennent des armes et le désaccord une exécution symbolique. Le passage d’une autre personnalité contestée - un ancien leader de l’opposition - en France l’été dernier l’a montré : au lieu de dialoguer, on a refusé la parole. Tant que nous confondrons émotion et raison, vengeance et justice, nous tournerons en rond dans le cycle de la haine.
Nous, de la gauche haïtienne, savons ce que signifie être bâillonné. Sous la dictature, nous avons été battus, emprisonnés, exilés pour avoir parlé. Il est donc douloureux de voir aujourd’hui certains de nos compatriotes, au nom de la liberté, appeler à faire taire leurs adversaires. Ce réflexe du bannissement traverse toute notre histoire : Fabre Geffrard condamnant Lysius Salomon à l’exil, symbole d’un pays où l’adversaire devient l’ennemi. Ainsi Haïti s’est construite dans la rivalité et la haine, jusqu’à s’effriter pierre après pierre.
L’ennemi véritable n’est pas celui qui pense autrement, mais celui qui refuse de voir en l’autre un frère. Nous ne serons libres que le jour où nous cesserons d’assassiner nos semblables, moralement ou symboliquement, pour leurs idées.
Je ne connais ni l’un ni l’autre personnellement. Ce sont des personnalités publiques, contestées par certains et sans doute admirées par d’autres. Mais je refuse qu’on empêche quiconque de parler. La liberté d’expression ne se mesure pas à l’amour qu’on porte à celui qui s’exprime, mais à la capacité d’écouter même ce qui dérange. Si quelqu’un a fauté, qu’il soit jugé ; mais ne transformons ni la rue ni les réseaux en tribunaux. Nous avons combattu l’arbitraire hier : ne le ressuscitons pas aujourd’hui sous d’autres couleurs.
Enfin, cessons de demander aux puissances étrangères de régler nos différends. Chaque fois que nous appelons Washington, Paris ou Ottawa à la rescousse, nous avouons notre incapacité à dialoguer entre nous. La démocratie ne se délègue pas : elle se pratique. Nos blessures doivent être soignées par nos propres mains.
La démocratie n’est pas un drapeau qu’on brandit contre ses adversaires, mais un art d’écouter, de débattre sans se haïr. Elle n’a de sens que si elle unit plus qu’elle ne divise, si elle éclaire au lieu de brûler.
Haïti n’a plus besoin de querelles : elle a besoin de fraternité et de courage. Le vrai ennemi n’est pas celui qui pense autrement, mais notre incapacité à vivre la différence. Si nous laissons enfin la parole circuler librement, peut-être que la lumière reviendra dans nos maisons et dans nos cœurs.
Maguet Delva