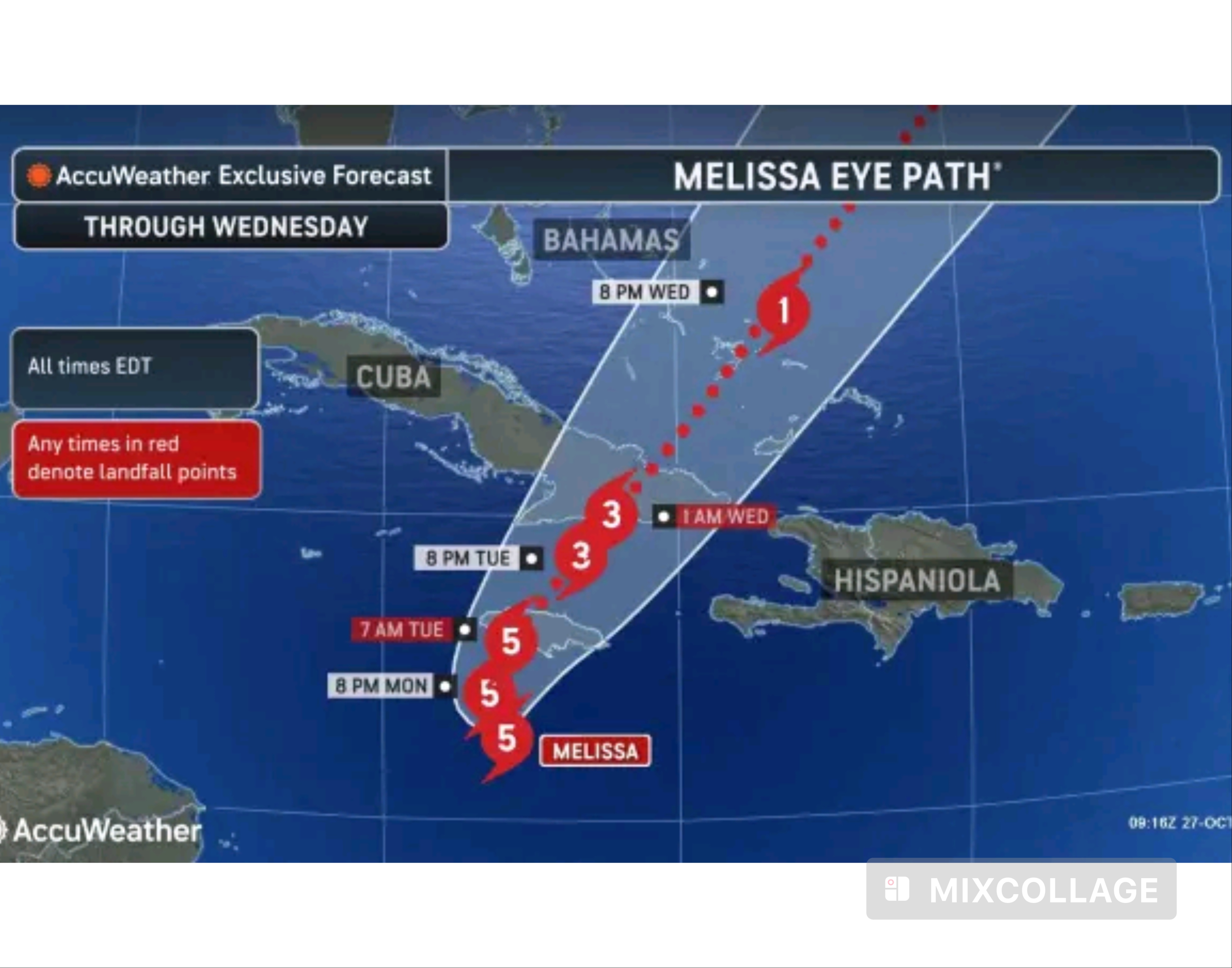Dans le journal matinal de Radio Caraïbes de ce lundi 27 octobre, un journaliste a posé la question suivante : « Les trois braqueurs de la BNC ont-ils lâché le Premier ministre de facto Alix Didier Fils-Aimé ? »
Il faisait bien sûr référence à Gérald Gilles, Emmanuel Vertillaire et Smith Augustin. Dans l’opinion publique nationale, cette interrogation traduit le fait que la décision de la Cour d’appel de Port-au-Prince, conférant le statut de président de la République à ces trois conseillers du Conseil présidentiel de transition (CPT), inculpés par un juge d’instruction, n’a pas modifié la perception des citoyens, y compris celle de certains médias. Le dossier reste entier.
Ce n’est ni un décret ni une décision de justice qui peut conférer le statut de président à un citoyen. Dans notre régime démocratique, régi par la Constitution de 1987, le statut du président est défini par un mandat, sa durée et les compétences que lui attribue la Constitution. Autrement dit, en démocratie, nul ne peut exercer le pouvoir sans mandat populaire, sans légitimité, sans avoir été consacré par le suffrage universel.
Comment des hommes arrivés au pouvoir par un consensus politique décidé par la communauté internationale peuvent-ils se prévaloir du droit d’être jugés par la Haute Cour de justice, une instance constitutionnelle réservée aux dirigeants élus ou nommés démocratiquement pour des crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions ?
Ignorance ou perversion de la Cour d’appel ? Cette juridiction devra, le moment venu, s’expliquer devant la nation.
Un juge à la Cour d’appel ou à la Cour de cassation doit incarner l’honneur, l’intégrité et la maîtrise du droit. Il existe deux lieux où le droit se construit officiellement : le Parlement, par la loi, et les Cours, par la jurisprudence. L’état déplorable de notre droit national résulte de l’insuffisance de nos institutions chargées de son élaboration.
Le CPT n’a aucun lien avec la Constitution
Comment expliquer que des juges des plus hautes juridictions d’un pays ne comprennent pas que c’est la Constitution qui détermine les modalités d’accession au pouvoir et en fixe l’organisation ? Notre Loi fondamentale établit les règles permettant de désigner les gouvernants, notamment par le biais d’élections organisées au suffrage universel direct ou indirect.
Il n’existe aucun lien constitutionnel entre le CPT et la Loi fondamentale de 1987. Comment des dirigeants de facto, étrangers à cet ordre juridique, peuvent-ils se prévaloir d’un mécanisme aussi solennel que celui de la Haute Cour de justice ? Devant quel Parlement le Conseil présidentiel de transition (CPT) a-t-il prêté serment ?
Comment la Cour d’appel de Port-au-Prince a-t-elle réfléchi ou raisonné pour en arriver à une décision attribuant le statut de président à ces conseillers, dont la mission, rappelons-le, prendra fin le 7 février 2026, date à laquelle cet exécutif de facto devrait remettre le pouvoir à des élus légitimes ?
Comment expliquer que ce CPT ait supprimé la Constitution de 1987 par un décret référendaire, alors même que ses membres, en prêtant serment sur elle, avaient juré de l’observer et de la faire observer ? On apprend qu’il n’y aura plus de référendum constitutionnel avant la fin du mandat du CPT, fixée au 7 février 2026. Les menteurs sont démasqués.
Sous quelle loi fondamentale seront donc organisées les élections promises sous pression internationale ? Quel texte encadrera les pouvoirs des futurs élus ? Le texte de 1987, qu’ils ont pourtant accusé d’être responsable de la mauvaise gouvernance du pays ? Et si cette Charte était réellement la cause principale de l’instabilité politique et institutionnelle en Haïti, pourquoi ce pouvoir de facto, après l’avoir supprimée, l’a-t-il rétablie pour organiser des élections sous son égide ?
Le silence honteux de la Cour de cassation
Au milieu de cette sécheresse de la pensée et de l’action positive dans la sphère publique, on s’interroge également sur le silence de la Cour de cassation face aux agissements de ce pouvoir de facto contre la Constitution. Pourquoi n’a-t-elle pas réagi en tant que gardienne suprême de la Constitution, pour protéger son autorité et préserver son intégrité contre les dérives autoritaires d’un pouvoir qui n’est pas issu du consentement du peuple ?
À mon humble avis, notre Cour de cassation, véritable Cour suprême, n’a pas seulement un rôle judiciaire. La Constitution lui confère également un rôle dans la souveraineté, en tant que gardienne du texte fondamental et arbitre du processus démocratique, qu’aucun pouvoir ne saurait remettre en cause.
Dès lors, est-il concevable qu’à la barbe de la Cour de cassation, un pouvoir de facto puisse décider, selon son bon vouloir, de l’existence ou non de notre Loi mère ? Il y a donc là un dysfonctionnement profond dans notre pays, qu’il importe de souligner et de comprendre.
La Constitution n’est pas la cause de notre échec. Le respect de celle-ci ne dépend pas seulement de sa valeur juridique ou politique, mais aussi de la volonté des dirigeants et des citoyens de l’appliquer. L’observance des lois est, en grande partie, une question d’éducation.
Comment enfin convaincre cette élite, aux commandes d’Haïti depuis des décennies, que le respect des institutions et des règles qui fondent la vie en société est la meilleure politique, la véritable garantie de la stabilité nationale ?
Dans ce contexte, les manœuvres du CPT visant à remplacer le Premier ministre de facto ne changeront rien à la situation chaotique dans laquelle s’enlise cette instance de l’État. L’échec avéré d’Alix Didier Fils-Aimé est aussi celui du CPT, dont il tire son autorité.
Les manipulations du Conseil présidentiel de transition, destinées à se maintenir au pouvoir au-delà du 7 février, ne trouveront d’écho que chez certains partis politiques et intellectuels frappés d’anémie morale et intellectuelle. Non : il n’y aura pas de prolongation : ils devront partir tous ensemble.
Une indigence intellectuelle
Au-delà de la manipulation politique, cette conjoncture révèle surtout le niveau intellectuel décevant — voire affligeant — de notre élite, caractérisée par une absence de rigueur dans la réflexion comme dans l’action. Cette réalité mérite d’être mise en lumière.
Nous sommes plongés dans une stratégie de manipulation fondée sur le mensonge.
La philosophe Hannah Arendt, connue pour ses travaux sur le totalitarisme et sur la nature du mensonge politique, l’a justement expliqué : « Le mensonge n’entre jamais en conflit avec la raison. » Les politiciens et intellectuels qui s’y adonnent se trouvent aujourd’hui confrontés à leurs propres contradictions.
Les actions du Conseil présidentiel de transition, dépourvues de fondement, de logique et de bon sens, illustrent l’indigence intellectuelle d’une classe politique et de ses partisans incapables de comprendre les véritables enjeux du moment.
Or, notre époque exige des compétences réelles, une vision claire, et la capacité de saisir la complexité des réalités contemporaines afin de prendre des décisions éclairées et responsables.
Notre défaite est avant tout d’ordre intellectuel. Elle traduit la faillite d’une élite figée dans ses erreurs, incapable de se remettre en question et qui, par son aveuglement, a conduit le pays à la déchéance morale, politique et institutionnelle.
Ce drame national ne se résume pas à l’échec d’un gouvernement ou d’un conseil de transition : il témoigne d’une crise profonde de la pensée et de la culture politique haïtienne.
Tant que notre élite refusera de reconnaître sa responsabilité historique et de renouveler sa manière de concevoir le pouvoir, Haïti restera prisonnière d’un cycle sans fin de manipulation, d’improvisation et de mensonge. Il est temps de réhabiliter l’intelligence, l’honnêteté et la compétence comme fondements du leadership public, si nous voulons espérer reconstruire une République digne et durable.
Sonet Saint-Louis av
Professeur de droit constitutionnel à l'université d'État
Université du Québec à Montréal.
Montréal, 27 octobre 2025.
Email : sonet.saintlouis@gmail.com
Tel : +509-44 073580.