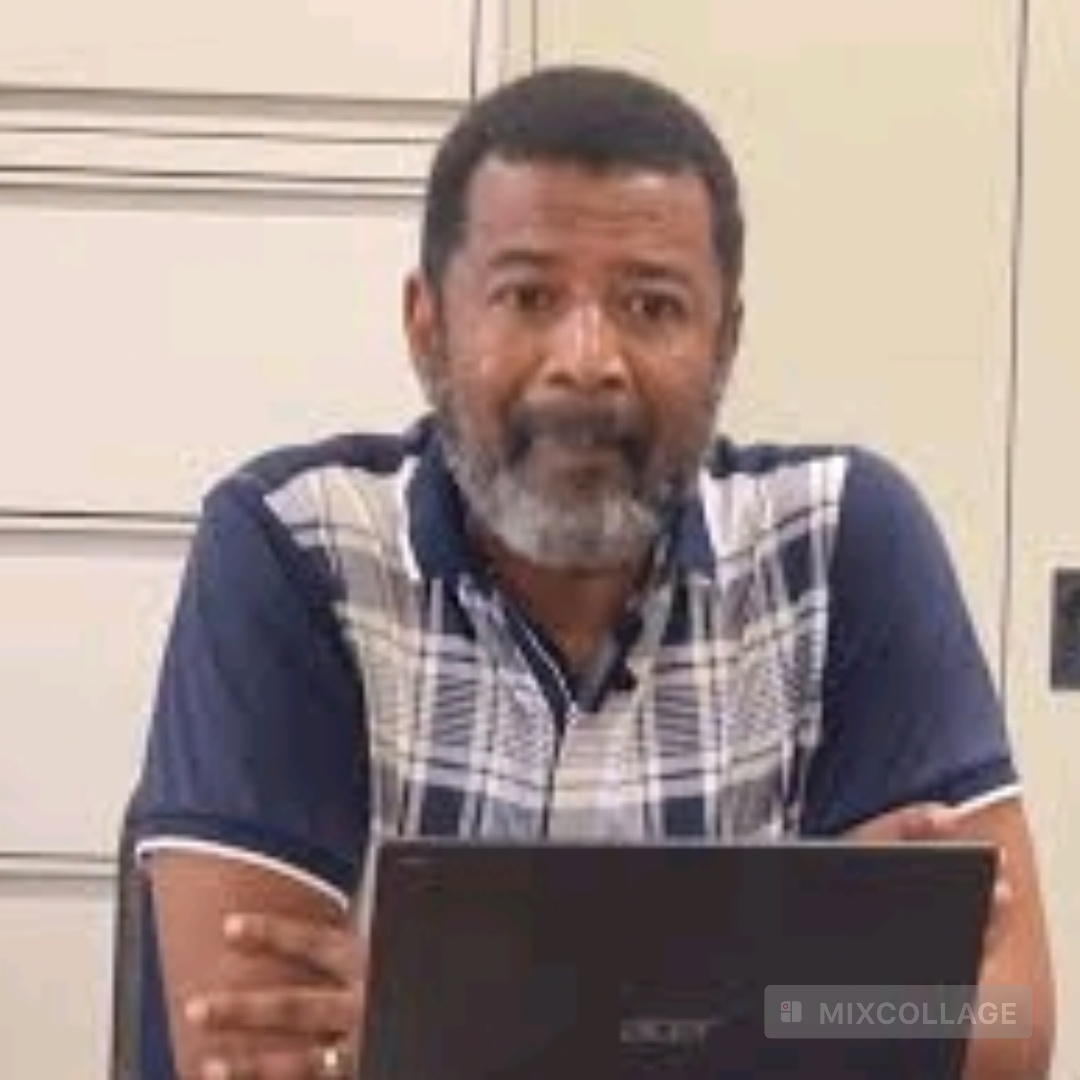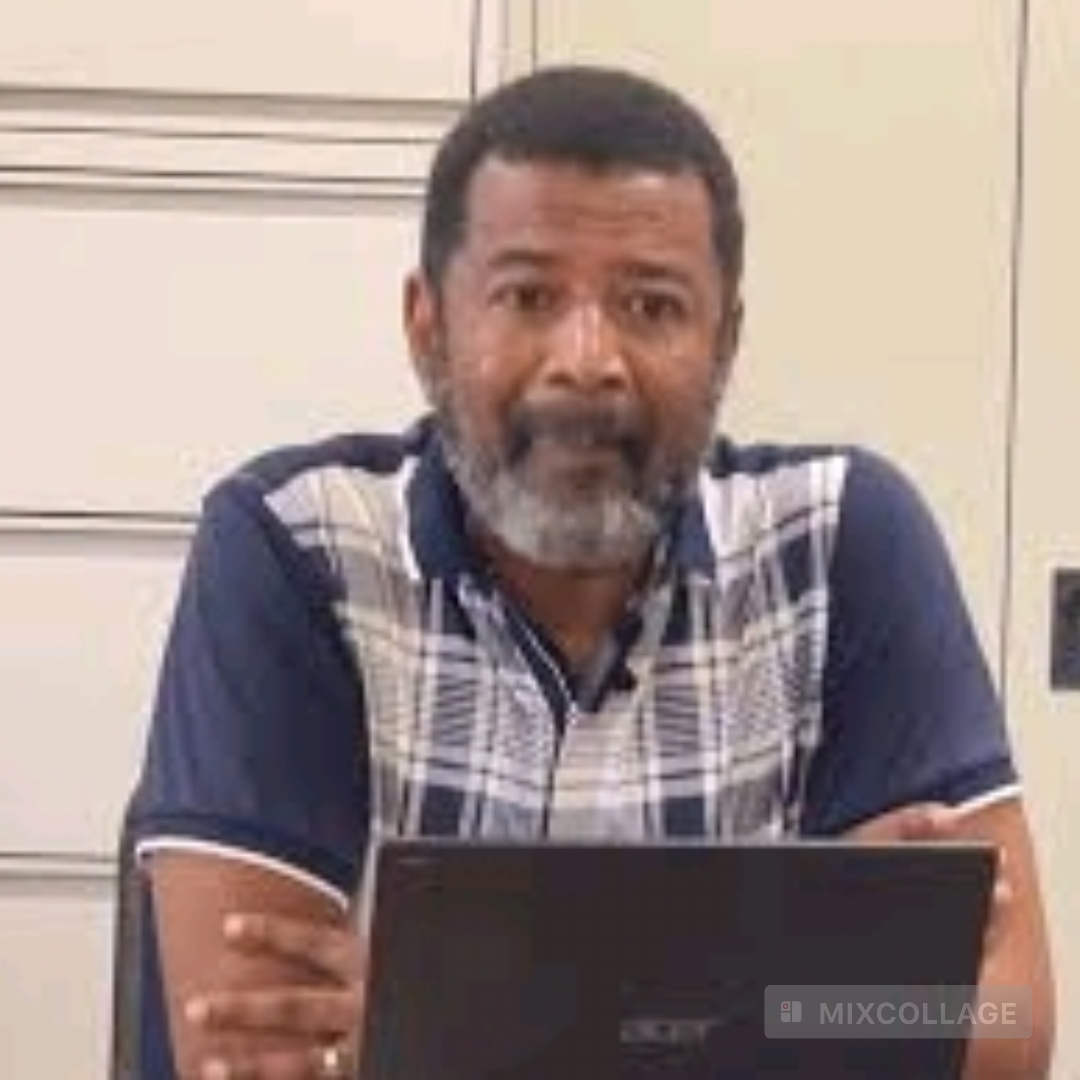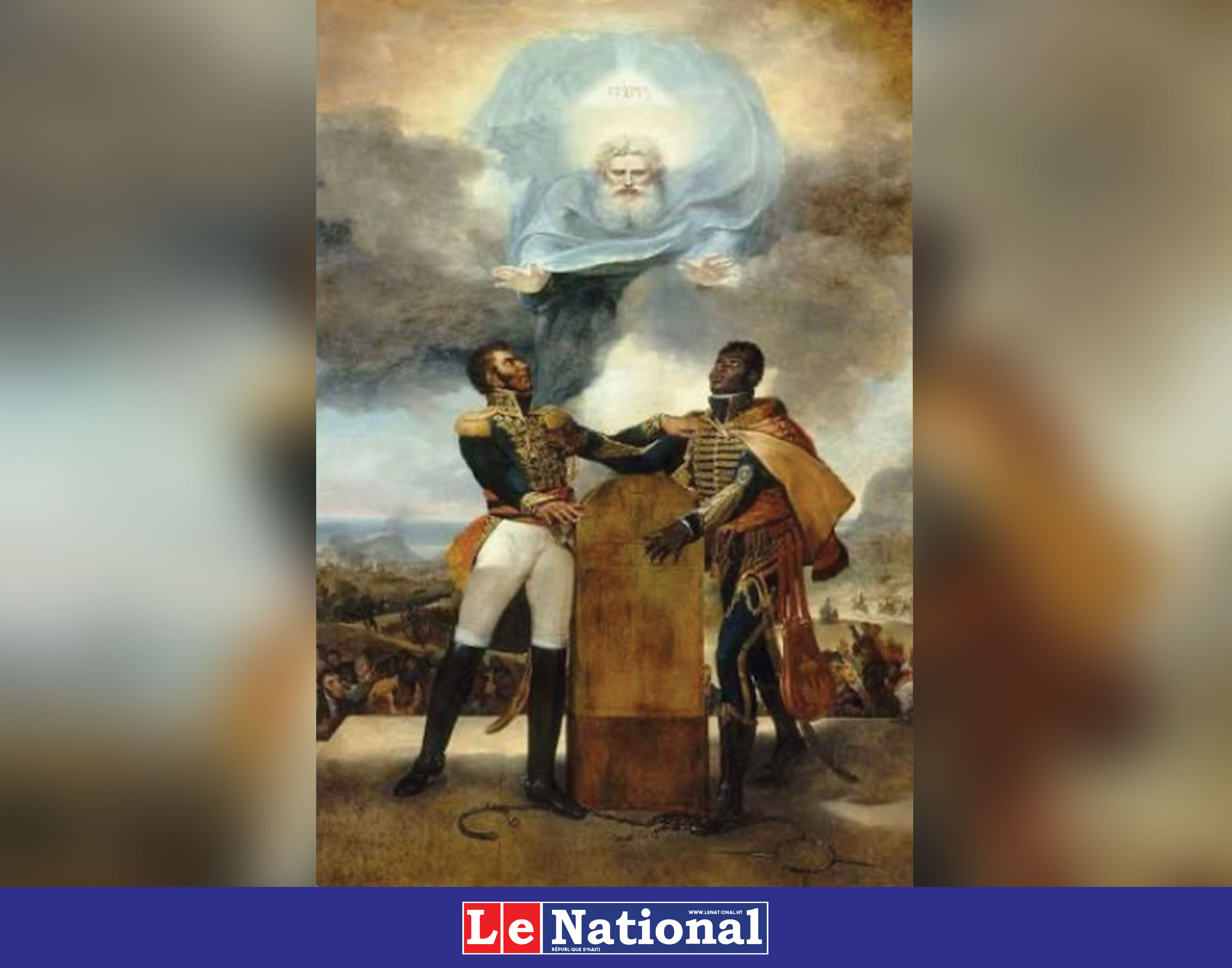Le quartier de Solino se distingue comme un patrimoine socio-affectif et économique. Il tient lieu de prolongement de la personnalité de chacun de ses habitants qui se construit un milieu de vie au-delà de l’habiter. Le panorama du collectif voile des histoires personnelles liées à des relations intimes au quartier. L’accès à la terre est partie prenante de l’identité sociale des gens. Les populations ne sauraient se déposséder alors de leur identité. La culture du risque s’entremêle avec l’attachement à son milieu de vie.
En effet, le retour des déplacés forcés de Solino dans leur quartier d’appartenance est l’objet de maints commentaires des uns ou des autres. La stigmatisation prévaut en qualifiant les sujets de résignés, de proches des gangs, de naifs ou courageux.Dans d’autres cas,les situations économiques précaires limitent ces déplacés forcés à regagner l’ emplacement de leur habitat vandalisé, endommagé ou détruit. Le besoin de faire le deuil dans le milieu dévasté importe beaucoup en dépit des risques et menaces de représailles des gangs armés. Ils s’emmènent à l’aveuglette pour choisir entre l’attachement insatiable à leur milieu de vie et le deuil de ce milieu dévasté pour se reprendre , continuer à résister et reconstruire au prix de risques imminents.
Il y a lieu de constater si les déplacés forcés tiennent à faire le deuil ou animer leur vie sur les ruines de la violence dont ils ont été victimes. Les dommages sont flagrants qu’ils ne peuvent les nier. Car l’une des phases du deuil c’est le refus de la perte du fait d’être destabilisé. Cependant les constats des dégâts suite à l’appel des caïds aux déplacés à retourner dans leur quartier se réveillent des émotions. Ils sont choqués, abattus déboussolés , désespérés et mécontents des forfaits des caids et leurs sujets contre leurs biens et leur projet de vie. Ils en cherchent les causes jusqu’à se culpabiliser ou se développer des sentiments de dévalorisation de soi pour avoir cohabitéé avec d’autres qu’ils diabolisent.
Ils accusent les autorités de leur démission face à l’obligation de protéger les vies et les biens des marginaux qui ont moins d’importance par rapport aux classes aisées. Le fatalisme ne manque pas en confrontant le réel et évaluer les dégats.
Des stratagèmes sont en cours pour se compenser devant des pertes. Les déplacés visitent les lieux du désastre durant la journée pour regagner les camps dans la soirée. Ils font la garde pour préserver le patrimoine même dévasté. Il s’agit de garantir une présence pour faire prévaloir des droits d’usufruit, de propriétaire, co-propriétaires, locataires, fermiers ou d’occupants dans un contexte d’insécurité foncière. Le mythe d’habiter est fort chez les habitants des bidonvilles pour se définir une existence malgré les conditions de précarités qui pourraient défier Les normes minima de reproduction de la population.
Les stratégies sont aléatoires pour ce qui concerne la préservation du statut social ante qu’il est impossible de recouvrir même en étant conscient de ce fait.Il convient de négocier avec son entourage aussi et c’est le cas de renouer avec des proches et constituer des réseaux sociaux éclatés après les attaques des gangs qui causent les déplacements forcés de la population du quartier.La victime se réfère à un capital social ayant existé qui tient lieu d’achalandage comme les activités de débrouillardise, les pratiques de production, de commerce ou de services.
Les déplacés forcés de Solino luttent pour ne pas être totalement dépossédés du moins disputer un retour à l’occupation de leurs biens et sur les ruines du milieu de vie qui a construit beaucoup d’aspects de la personnalité.
La phase de dépression vient marquer les déplacés forcés de Solino quand ils se rendent compte de l’immensité des moyens pour un nouveau départ face aux pertes énormes qu’ils ont connues , des blessures et traumatismes insurmontables à défaut des services de santé mentale et de réhabilitation économique.
La tristesse et la déception sont manifestes de telle sorte qu’on a le sentiment que tout deuil reste bloqué. Ce qui tend à court-circuiter tout processus psychologique d’adaptation après ces pertes, pour dépasser ce moment et retourner à la vie quotidienne. Cette trajectoire est douloureuse et peut exiger un long terme pour lequel les déplacés forcés ne sont pas encore habilités à accepter la réalité du fait que les pertes étaient inévitables mais il y a lieu de reconstituer la mémoire vivante.
Hancy PIERRE