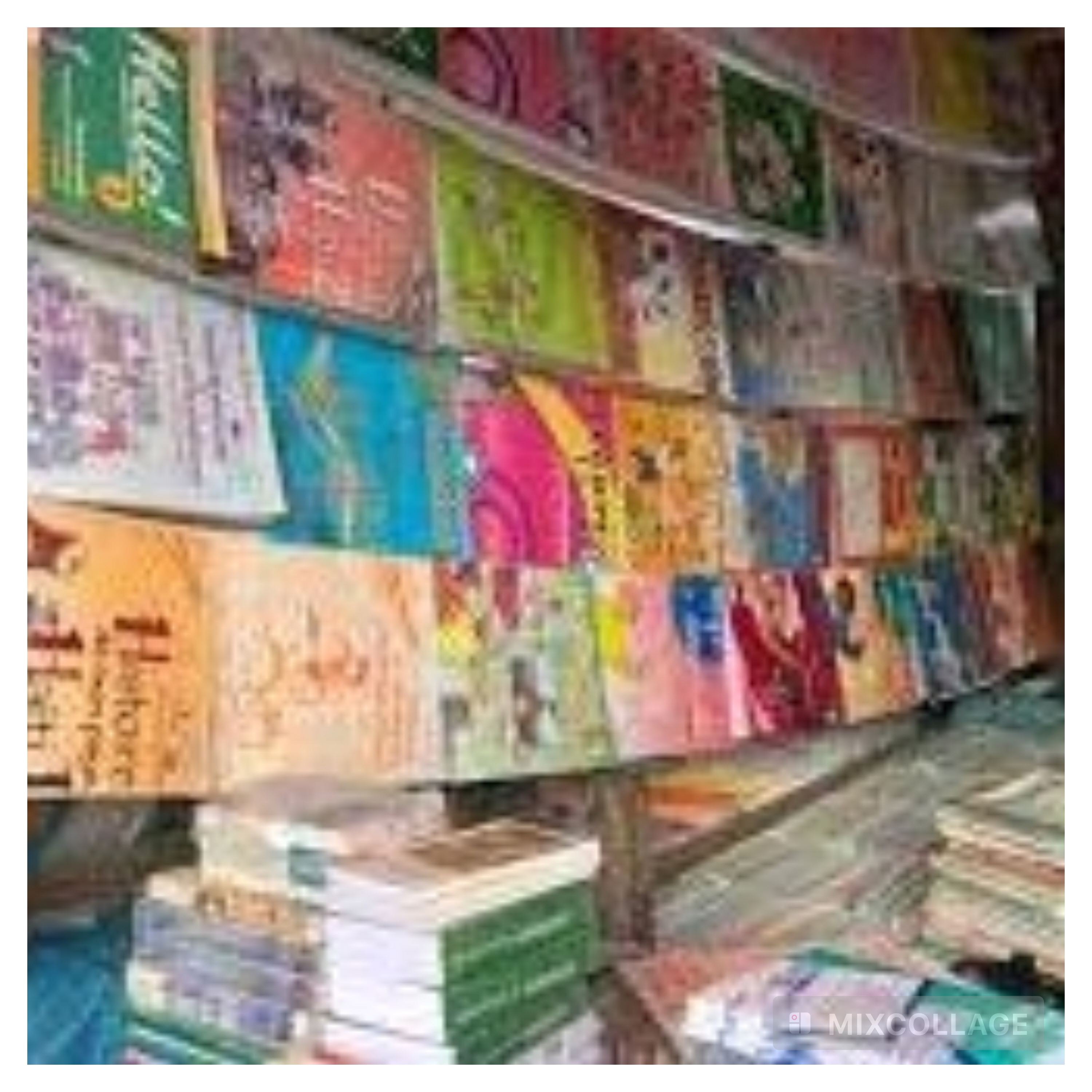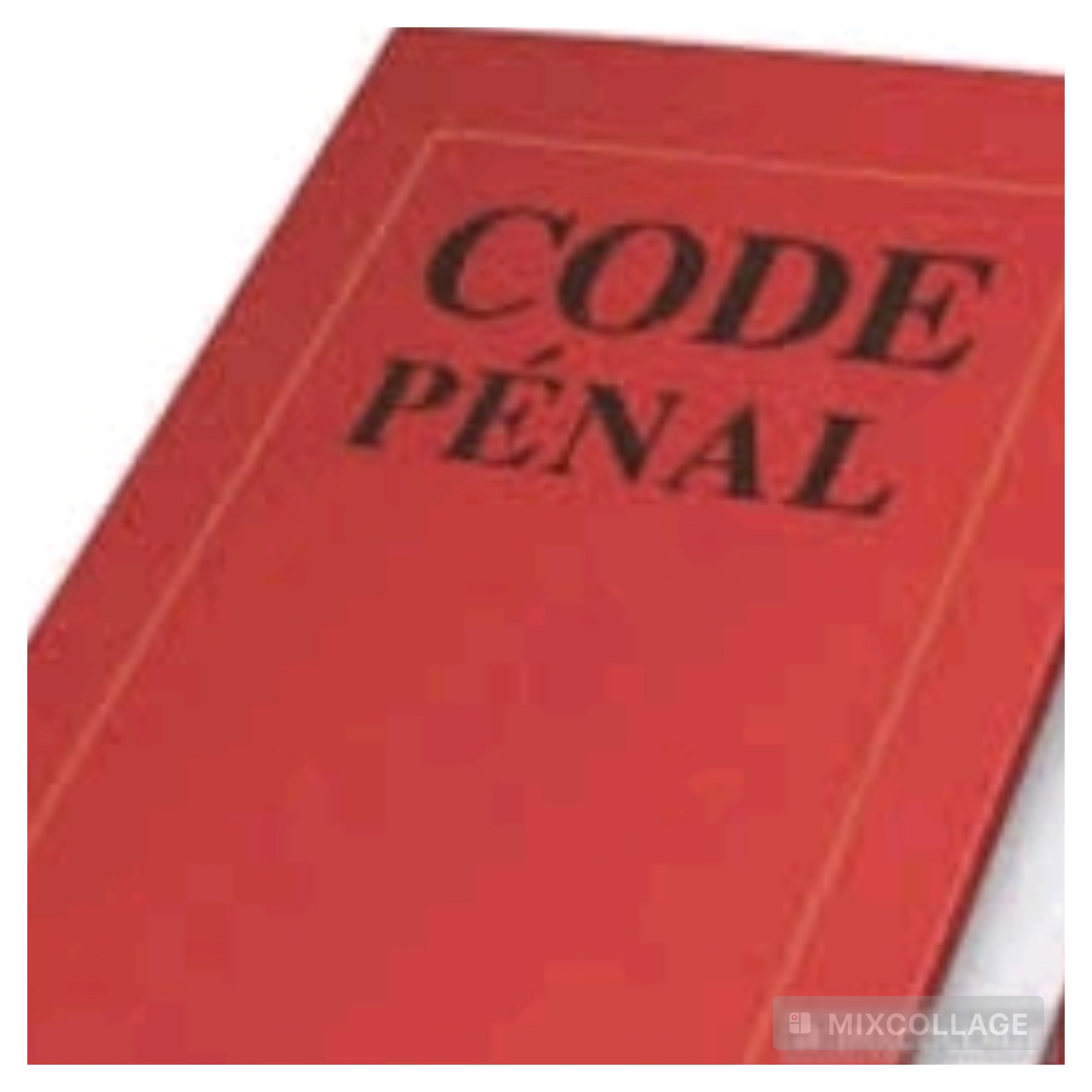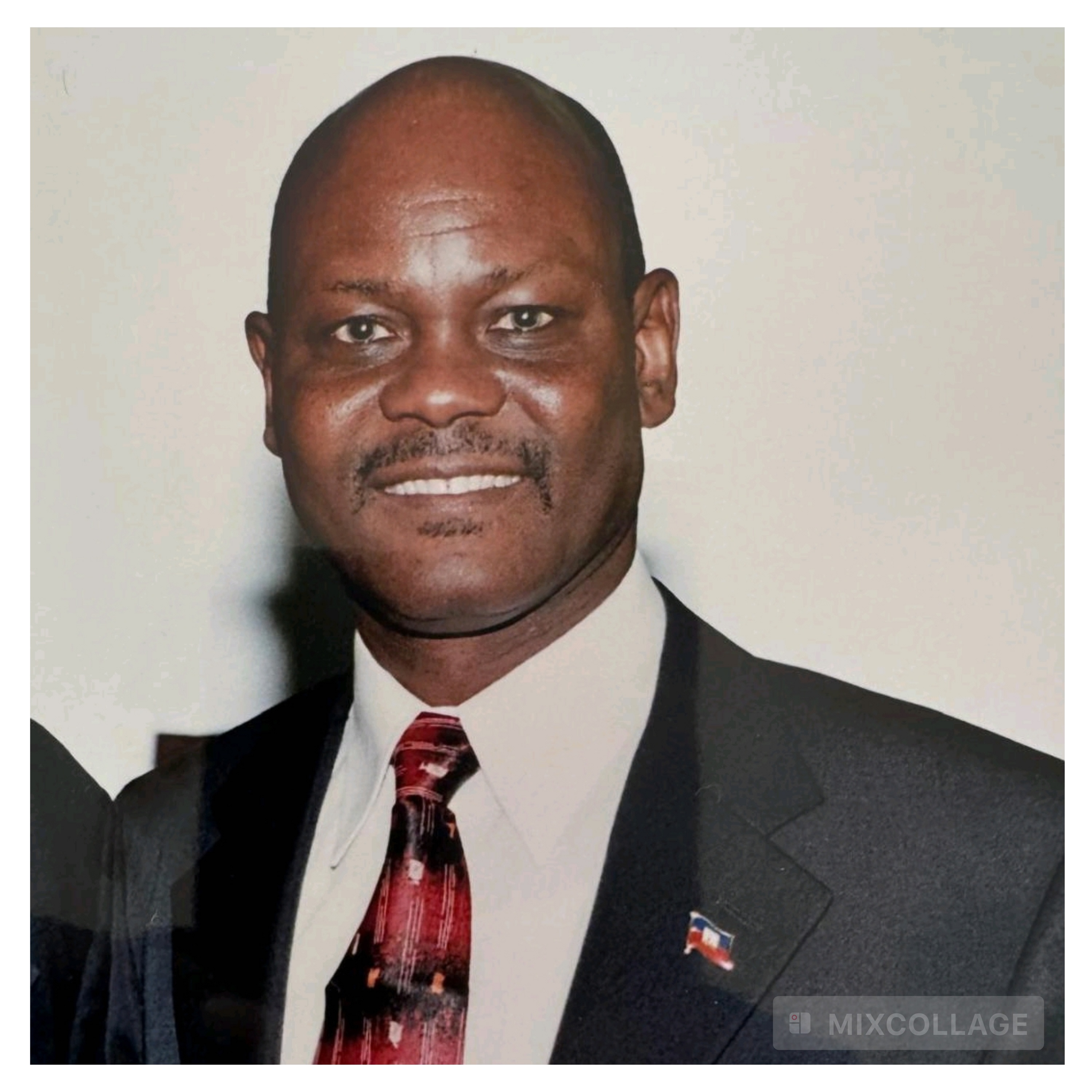Une bascule discrète mais décisive vient de s’opérer au siège de l’ONU, à New York. Vendredi, le traité sur la protection de la biodiversité en haute mer a atteint le nombre de ratifications requis pour entrer en vigueur, deux ans après son adoption formelle.
Dans une déclaration, le Secrétaire général de l’ONU a salué « cette avancée historique pour l’océan et pour le multilatéralisme ».
Le plus souvent désigné par son acronyme anglais BBNJ, ce traité au nom à rallonge – « Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale » – devait atteindre le seuil des 60 ratifications de pays signataires pour entrer en vigueur. C’est désormais chose faite. L'accord deviendra contraingant le 17 janvier 2026.
Tweet URL
Un saut juridique
Couvrant plus des deux tiers de l’océan mondial, la haute mer était jusqu’ici un espace fragmenté. Adopté en juin 2023, le BBNJ instaure un cadre unificateur : règles obligatoires de conservation et d’usage durable de la biodiversité, aires marines protégées en haute mer, partage plus équitable des bénéfices issus des ressources génétiques marines, évaluation d’impact environnemental, transfert de technologies et renforcement des capacités scientifiques. « En deux ans, les États ont transformé leurs engagements en actions, démontrant ce qu’il est possible d’accomplir lorsque les nations s’unissent pour le bien commun », a salué le Secrétaire général.
Cette entrée en vigueur couronne un été de tractations à New York, où s’est réuni au mois d'août une commission chargée de préparer la future mise en œuvre du traité. Au menu de ses travaux, les questions de financement, de choix des règles de procédure, d’esquisse d’un secrétariat et d’architecture du futur centre d’échange d’informations scientifiques appelé à devenir la plaque tournante du système. « Il n’y a sans doute pas de tâche plus urgente que celle-ci », avait alors insisté le coprésident de la commission, Adam McCarthy.
Ces détails techniques sont d’autant plus importants que la première conférence des États parties au traité devrait être convoquée courant 2026.
Un océan sous pression
L’entrée en vigueur du BBNJ arrive à un moment charnière. Selon l’ONU, moins d’un tiers des cibles de l’objectif de développement durable n° 14 sur la préservation des océans sont en bonne voie ou progressent modérément. À ce jour, 8 % seulement de la surface marine est protégée – loin de l’objectif des 30 % fixé d’ici 2030 – et moins de la moitié des zones cruciales pour la biodiversité bénéficient d’un statut effectif de protection.
Sous la surface, la fièvre monte : l’océan absorbe environ 90 % de l’excès de chaleur dû aux gaz à effet de serre et ses températures atteignent des niveaux record. L’ONU alerte sur un quatrième épisode mondial de blanchissement des coraux, le plus grave jamais observé.
Même en limitant le réchauffement à 1,5 °C, la quasi-totalité des récifs tropicaux pourraient disparaître d’ici 2050. Dans le même temps, l’acidification de l’océan liée à son absorption de près d’un quart du CO₂ émis ronge la base calcaire des écosystèmes.
Des îles en première ligne
Dans les salles de conférence de l’ONU, les petits États insulaires en développement – sentinelles avancées de la montée des eaux – souhaitent que la future gouvernance du traité tienne compte de leurs contraintes : modalités de participation, soutien financier, représentation au sein des organes. Les États fédérés de Micronésie ont ainsi appelé à reconnaître « le statut distinct des peuples autochtones en droit international, non pas comme de simples parties prenantes, mais comme titulaires de droits ».
Au-delà des sièges et des écrans, la revendication est claire : l’architecture BBNJ ne doit pas reproduire les asymétries qui ont fragilisé la haute mer.
De Nice à New York, de l’impulsion à la mise en œuvre
La Conférence des Nations unies sur l’océan tenue à Nice en juin a servi d’accélérateur politique : des centaines d’engagements volontaires ont été annoncés, la lutte contre la pollution plastique a gagné en visibilité et le chantier BBNJ a été propulsé au sommet des priorités.
À New York, cet élan se transforme en mode d’emploi sur les modalités d’inscription des aires protégées et le partage des données. Le futur centre d’échange prévu par le traité devra ainsi garantir l’accès équitable à l’information scientifique – condition sine qua non pour que les pays moins dotés participent pleinement au nouveau régime.
Côté pêches, plus d’un tiers des stocks marins reste surexploité. Des expériences de gestion rigoureuse – le thon en tête – montrent toutefois qu’il est possible d’inverser la tendance, notamment par la coopération régionale. La lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, qui pourrait représenter jusqu’à 26 millions de tonnes par an (environ 15 % des captures mondiales), s’appuie sur des outils qui montent en puissance, de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du Port (PSMA) aux mesures disciplinaires de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre les subventions à la surpêche.
Le test de réalité
Le BBNJ n’est pas un slogan : c’est un échéancier, des cartographies, des procédures d’évaluation, des mécanismes de financement. En bref, du droit contraignant. « Face à la triple crise planétaire – le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution –, cet accord constitue une bouée de sauvetage pour l’océan et pour l’humanité », a insisté le Secrétaire général.
Encore faut-il hisser la bouée jusqu’aux naufragés : renforcer les capacités des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, financer leur participation, garantir leur accès aux données, surveiller les contrevenants et les sanctionner.
Dans l’immédiat, Antonió Guterres appelle à élargir le cercle des parties. « Je rends hommage à tous ceux qui l’ont ratifié. J’appelle chaque État à y adhérer sans délai, et tous les partenaires à soutenir une mise en œuvre rapide et complète ». L’injonction vaut rappel : la protection des océans ne se décrète pas, elle s’administre par des aires protégées crédibles, des évaluations d’impact appliquées, des plans d’espace maritime adoptés.
La conclusion du chef de l’ONU tient en une phrase, que l’on aurait tort de prendre pour une image : « La santé de l’océan est celle de l’humanité ». Si le droit vient d’atteindre la côte, la traversée, elle, commence.