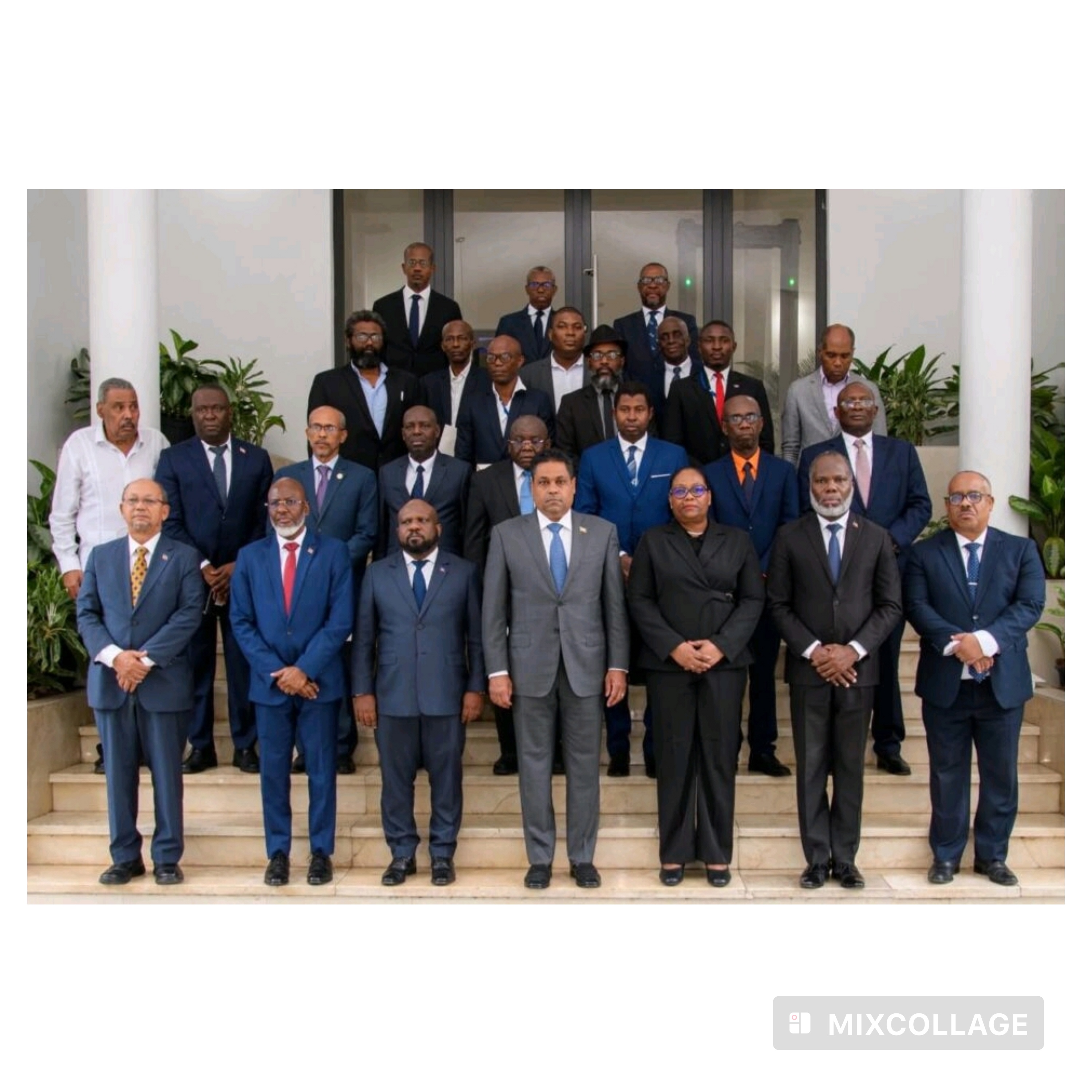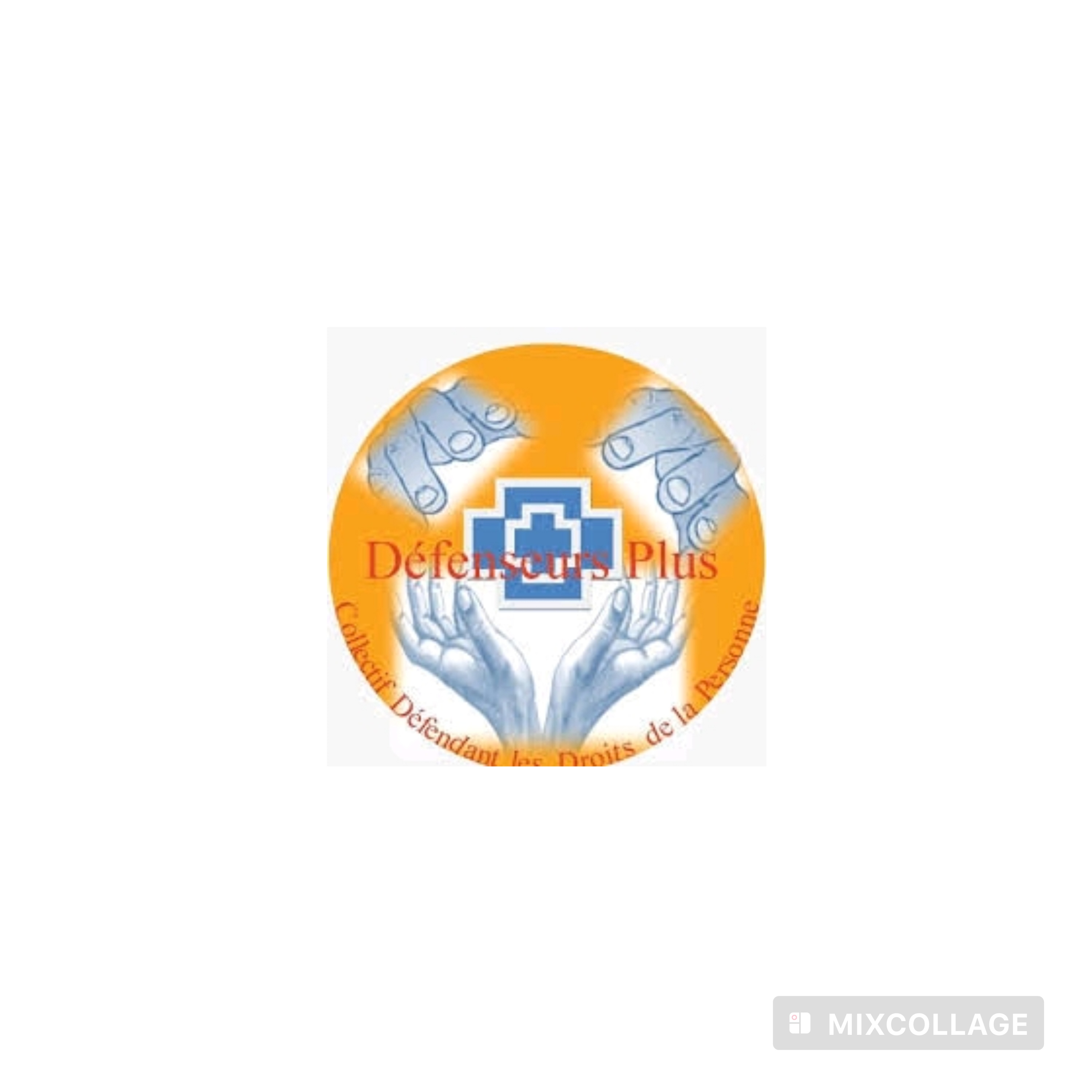Minée par des crises politiques récurrentes, Haïti reste enfermée dans une instabilité constitutionnelle qui compromet toute gouvernance durable. Dans cet entretien exclusif — dont nous présentons ici la seconde partie — Josué Pierre-Louis (1), auteur de Ce que je sais de la Constitution haïtienne de 1987, analyse les ressorts profonds de la paralysie institutionnelle et propose des pistes concrètes pour remettre le pays sur la voie de la stabilité.
Le National : Vous écrivez que depuis 1804, Haïti vit au rythme d’une « instabilité constitutionnelle chronique ». Selon vous, quelles en sont les causes profondes ?
Josué Pierre-Louis : Haïti a adopté vingt-trois constitutions et connu une grande variété de régimes politiques, signe d’une forte instabilité institutionnelle. Cette succession de textes et de systèmes — de la monarchie à la dictature, en passant par divers modèles républicains — témoigne de la difficulté du pays à établir un cadre politique durable. L’État s’en trouve fragilisé, incapable de construire des institutions stables préservant les valeurs et l’indépendance nationales. En période de crise, la vie politique bascule souvent vers des formes de pouvoir personnel ou autoritaire. Enfin, Haïti n’a jamais réussi à instaurer un véritable régime parlementaire ou présidentiel fondé sur un réel équilibre des pouvoirs, oscillant constamment entre la domination du Parlement et celle de l’Exécutif.
Le National : Quelles en sont les raisons ?
Josué Pierre-Louis : Haïti connaît une démocratie fragile et inachevée, marquée par plusieurs déficits : des élections sans véritable choix, une décentralisation jamais concrétisée, un mode de scrutin contesté et un pouvoir sacralisé mais mal défini. Comme beaucoup d’États sous-développés ayant importé des modèles libéraux sans les adapter, le pays subit la crise de la démocratie représentative, dont les promesses de développement ne se sont pas réalisées.
Cette fragilité se traduit par l’incapacité de l’État à assurer ses missions essentielles : contrôler la violence légitime, garantir un cadre juridique stable et fournir les biens publics nécessaires. Enfin, l’absence d’articulation solide entre sécurité, démocratie et développement — un triptyque considéré comme essentiel depuis les années 1990 — limite fortement la gouvernabilité du pays.
Le National : Peut-on parler d’échec collectif à construire un pacte national durable, ou au contraire une forme d’énergie politique mal canalisée ?
Josué Pierre-Louis : Haïti, avec ses vingt-trois constitutions successives, n’a jamais réussi à stabiliser son système politique : les crises persistent, les divisions s’approfondissent et le développement reste bloqué. Les élections et les changements de textes fondamentaux n’améliorent pas la situation, donnant à la démocratie haïtienne l’apparence d’une façade plutôt que d’un véritable processus participatif.
Face à cela, plusieurs chercheurs suggèrent d’explorer des formes de gouvernance plus efficaces et mieux adaptées aux réalités du pays : moins centrées sur la seule logique électorale, plus orientées vers la compétence, la transparence et la responsabilité. L’idée est de renforcer d’abord la gouvernance, puis la démocratie, en tenant compte des contraintes historiques d’arbitraire et de violence institutionnelle.
Une Constitution réformée devrait établir un nouvel ordre public respectueux des coutumes légitimes, garantir un réel équilibre des pouvoirs et prévenir à la fois l’autoritarisme exécutif et l’anarchie parlementaire. Haïti doit ainsi élaborer son propre modèle démocratique, enraciné dans son contexte social, et investir massivement dans l’éducation pour construire une citoyenneté capable de soutenir durablement cet ordre démocratique.
Le National : Parmi toutes les constitutions haïtiennes, certaines ont-elles, selon vous, représenté de véritables tentatives de refondation ? À l’inverse, lesquelles n’ont été, à vos yeux, que des instruments de pouvoir ou des réponses circonstancielles à des crises ? Voyez-vous dans cette succession de textes une continuité idéologique ou, au contraire, une suite de ruptures sans véritable fil conducteur ?
Josué Pierre-Louis : L’histoire constitutionnelle d’Haïti, marquée par de nombreux textes et régimes successifs, reflète une instabilité chronique : aucun modèle n’a réussi à instaurer un pouvoir légitime ni un État réellement fonctionnel. Le problème tient moins aux constitutions qu’à leur application, affaiblie par l’opportunisme politique, l’absence de culture juridique solide et la personnalisation du pouvoir.
La Constitution de 1987 illustre ce paradoxe : malgré sa modernité, elle reste inappliquée faute d’institutions clés, notamment le Conseil constitutionnel, jamais mis en place. Sans justice constitutionnelle, le texte demeure théorique.
Cette situation s’est aggravée avec les crises politiques récurrentes, l’instabilité depuis 1986 et la transposition insuffisamment adaptée du droit français. La consolidation démocratique exige de surmonter des obstacles culturels, sociaux et économiques profonds, en particulier la quête d’égalité et les réformes structurelles nécessaires pour renforcer la justice et l’efficacité de l’État.
Le National : Vous soulignez la nécessité de « gérer sélectivement les héritages de l’État importé ». En quoi la Constitution de 1987 reste-t-elle marquée par ce modèle d’État importé ? Josué Pierre-Louis : La modernité institutionnelle ne doit pas être confondue avec l’occidentalisation : elle n’implique pas de copier les modèles politiques de l’Occident. La modernité peut être multiple et doit s’enraciner dans les traditions et réalités propres à chaque société. Certaines nations, rompant avec leurs structures traditionnelles sans réussir à établir des institutions solides, se retrouvent dans une situation d’instabilité qui provoque des formes de résistance et complique le rôle des institutions dans le développement.
Le National : Vous avez écrit un ouvrage à ce sujet en 2022…
Josué Pierre-Louis : …Oui, La modernisation du droit haïtien est essentielle face à son obsolescence, mais elle ne peut passer par une simple imitation de l’Occident. Comme le rappelait Montesquieu, aucun modèle politique n’est universel ni mécaniquement exportable. Haïti n’a jamais suivi la trajectoire des États-nations occidentaux, et l’imposition répétée de leurs modèles, notamment par la transposition du droit français, s’est révélée inadaptée et inefficace.
Depuis l’indépendance, le pays n’a presque jamais produit une pensée juridique propre, se limitant à copier des textes étrangers sans les adapter aux réalités locales. La Constitution de 1987 illustre ce mimétisme, incapable de se traduire en pratiques institutionnelles cohérentes.
Ce décalage entre un droit importé et la culture politique réelle alimente la crise de l’État. Les institutions ne fonctionnent pas parce qu’elles ne correspondent ni aux représentations collectives ni aux conditions socio-économiques du pays — particulièrement perceptibles dans les zones rurales, où ces modèles sont vécus comme étrangers. D’où la nécessité d’un constitutionnalisme enraciné dans l’histoire, l’anthropologie et les pratiques sociales haïtiennes plutôt qu’imposé de l’extérieur.
Le National : Quelles sont, selon vous, les forces et les limites majeures de la Constitution de 1987 ? Cette constitution est parfois perçue comme très démocratique dans son esprit, mais paralysante dans sa pratique. Partagez-vous cette analyse ?
Josué Pierre-Louis : La Constitution de 1987, adoptée après la dictature des Duvalier, visait à instaurer un État de droit moderne fondé sur le pluralisme démocratique et la protection des libertés. Malgré de nombreuses réformes juridiques et judiciaires menées avec l’appui international, celles-ci ont souvent échoué parce qu’elles étaient trop complexes, mal adaptées ou freinées par les lourdeurs institutionnelles haïtiennes.
L’écart entre la théorie constitutionnelle et la pratique reste profond, avec de graves impacts sur le développement. La croissance économique exige stabilité politique, cadre légal fiable, justice efficace et choix stratégiques adaptés — autant de domaines où Haïti demeure fragile, notamment en ce qui concerne la régulation bancaire et financière.
La modernisation du droit ne sera efficace que si elle soutient réellement le développement économique, en reposant sur un système judiciaire fonctionnel, un environnement sécurisé et un ordre juridique équitable. Sans ces bases, l’investissement, la création de richesse et le progrès national resteront limités.
Le National : Pas de développement sans stabilité politique ?
Josué Pierre-Louis : C’est exact ! La stabilité politique est indispensable au développement d’Haïti, mais le pays reste marqué par une instabilité historique et une gouvernance défaillante. Pour sortir de cette fragilité, il faut construire un droit réellement enraciné dans la société haïtienne, accompagné de réformes profondes de l’État, d’une gouvernance démocratique rigoureuse et de politiques adaptées aux réalités locales.
La modernisation du droit doit s’appuyer sur l’efficacité, la lutte contre la corruption et une culture administrative renouvelée. Elle ne doit ni imiter aveuglément l’Occident ni rejeter ses apports utiles, mais proposer un cadre juridique pluraliste et pragmatique, tenant compte des contraintes historiques et sociologiques du pays.
Ce chantier, exigeant constance et vision à long terme, est essentiel pour bâtir un véritable État de droit, capable d’assurer la cohésion sociale, de relever les défis contemporains et de soutenir un développement durable pour tous.
(Propos recueillis par Huguette Hérard)
(1) Ancien Garde des Sceaux et ministre de la Justice, ancien Secrétaire général de la Primature, Josué Pierre-Louis est également professeur des universités en droit public. Docteur en droit, il est l’auteur de La modernisation du droit haïtien : un défi pour l’avenir (2022) et Haïti et ses institutions (2005).