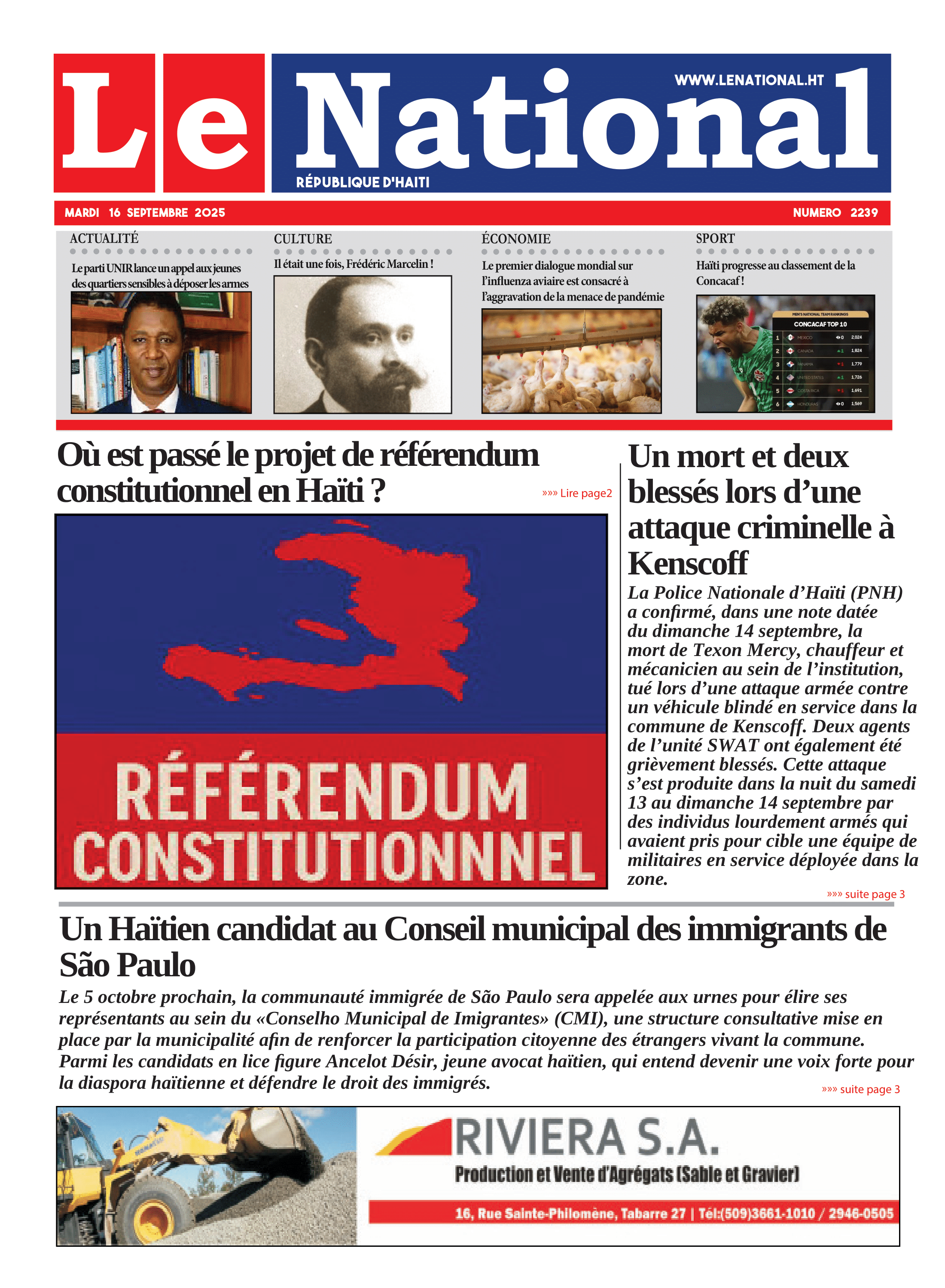Faut-il nommer, pour des besoins de particularité, cette période allant du 16 janvier au 7 février 2017 ? Dans moins d’un mois, le cours de notre histoire ne peut changer drastiquement. Tout laisse croire que nous allons vivre encore une interminable continuité. Ce n’est pas celle d’un camp et de ses hommes qui, depuis le quinquennat passé, a géré les affaires du pays à sa manière, épicurisme et matérialismes se sont engagés dans un mouvement de conjoncture marqué par l’opportunisme, au temps de la mort des idéologies. Le gouvernement qui en est résulté, a laissé des ouvrages inachevés et des oeuvres en esquisses dans notre paysage urbain, sketches de l’improvisation, défiant toute authenticité. La Transition n’a, désormais, pour mission courte que de transmettre des dossiers stratégiques. À ce niveau, on n’a pas trop grand-chose à attendre que des formalismes usuels, comme pour inaugurer des chrysanthèmes.
Faut-il nommer, pour des besoins de particularité, cette période allant du 16 janvier au 7 février 2017 ? Dans moins d’un mois, le cours de notre histoire ne peut changer drastiquement. Tout laisse croire que nous allons vivre encore une interminable continuité. Ce n’est pas celle d’un camp et de ses hommes qui, depuis le quinquennat passé, a géré les affaires du pays à sa manière, épicurisme et matérialismes se sont engagés dans un mouvement de conjoncture marqué par l’opportunisme, au temps de la mort des idéologies. Le gouvernement qui en est résulté, a laissé des ouvrages inachevés et des oeuvres en esquisses dans notre paysage urbain, sketches de l’improvisation, défiant toute authenticité. La Transition n’a, désormais, pour mission courte que de transmettre des dossiers stratégiques. À ce niveau, on n’a pas trop grand-chose à attendre que des formalismes usuels, comme pour inaugurer des chrysanthèmes.
La continuité dont nous parlons est plutôt au sujet des problèmes structurels du pays. Cela fait un moment que nous attendons des résultats. Les enjeux politiques ont pris le dessus. Et c’est, en ce lieu de rituel monotone, à qui peut jouer, entre la finance imposante et la roublardise des promesses, pour maintenir les intérêts internationaux alliés aux classes sociales prêtes à tout faire, dans ce qu’il faut appeler la « civilisation du profit ». Cette continuité, donc, ce n’est pas seulement cette chaise musicale, « kilès ki te la avan », qui nous est donnée en spectacle depuis notre entrée bancale en démocratie. C’est bien le statu quo qui, avec des replâtrages de ministères, consolide une dépendance systémique dont la belle vertu est l’immobilité.
Le portrait de pied qu’on se fait de ceux qui entrent au palais peut avoir quelques détails particuliers et des nuances spécifiques. On est sorti de la démystification des protocoles pour revenir aux postures traditionnelles d’intelligences provinciales moins portées vers la pompe moderne. Mais, la réalité de l’administration et le « degraba » de l’État n’ont pas bougé d’un pouce. Des personnalités qui paraissaient avoir pris la poudre d’escampette reviennent pour les procédures du provisoire au permanent ! Le mécanisme funéraire de l’immobilité se met en place au grand dam des laissés pour compte. Faudra encore se serrer les reins pour les cinq prochaines années !
La mince marge de manoeuvre serait dans l’expérience acquise dans le domaine entrepreneurial. Louis Déjoie s’était fait un nom dans la production du Vétiver. Sa « politique de la terre » n’a pourtant pas fait long feu devant le coup bas des militaires qui avaient joué sur l’affect des « classes moyennes noires ». Kébreau nous a filé l’ombrageux médecin de campagne qui avait soigné des paysans de la maladie du pian. Est-ce un héritage de François Papa Doc Duvalier d’assister aujourd’hui à la percée d’un investisseur du paysannat dont on attend que le succès dans la banane soit à la hauteur de son vigoureux leadership dans la gestion de la Res publica ?
Il n’y a pas de nom à donner à cette période de transition. Comme notre très authentique Pè Toma, assis sur sa dodine, l’air scrutateur : « Nap siv… »
Pierre Clitandre
À quelques semaines de cet important rendez-vous, nous sommes en droit d’espérer que la réduction de la vulnérabilité sera un préalable aux besoins de mise en oeuvre de projets de développement portés par la nouvelle équipe. Plus qu’un serment politique, ce préalable doit être une lutte consciente et engagée pour réparer des siècles de mauvaise gestion d’un territoire. Comme la conspiration précède logiquement l’acte meurtrier, la vulnérabilité d’Haïti n’est que le résultat d’une construction politique et sociale voulue et pensée.
Chaque pluie de saison est assortie de son jour de congé. L’impact d’un cyclone moyen impose une semaine, au moins, d’arrêt des activités. Un tremblement de terre, et tout est à recommencer, s’il ne provoque pas la fin du monde. Irréversible.
Avec ce catalogue de douleurs, il sera difficile d’attirer les investisseurs, développer nos capacités de production, protéger notre patrimoine historique unique dans la région et garantir une paix sociale durable.
Un signal fort, prémices d’un plan de redressement, est attendu tant il est vrai qu’on ne peut pas se contenter de survivre avec le danger ; au risque de sacrifier les générations futures.
Prier au Palais national, même avec les mystiques combinés de toutes les religions du monde, en présence des gestionnaires de la charité et des grandes multinationales de l’humanitaire, ne sauvera de rien du tout. Ne rendra pas le pays plus sûr.
Il faut sortir du Palais pour aller dans les temples, dans les églises, dans les écoles, dans les marchés publics pour entretenir la mémoire de nos morts et de leurs bourreaux !
Jean Euphèle Milcé