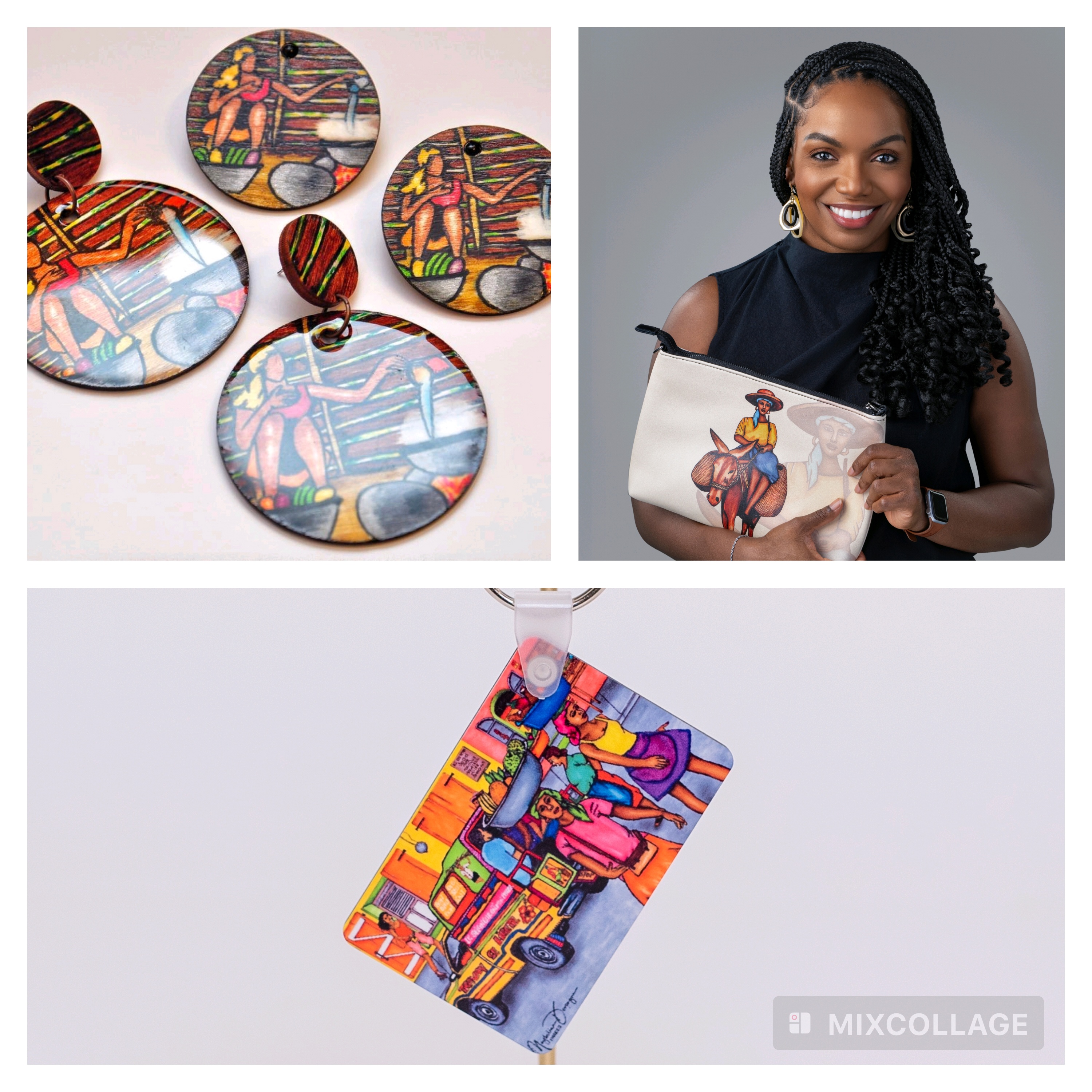Il y a des écrivains dont la parole finit par s’imposer, dont la voix appelle la rencontre. Et Robert Philomé est de ceux-là — une voix forte, libre, et profondément humaine.
Journaliste, écrivain, essayiste, homme d’engagement, Robert Philomé incarne une parole lucide et courageuse. Sur la télévision française, France 24, il est une voix familière : celle qui décrypte l’actualité internationale avec rigueur, clarté et une élégance rare. Mais derrière le journaliste se cache un romancier habité par la quête de sens, par l’histoire des peuples et par les trajectoires humaines qui relient le Nord et le Sud, l’ici et l’ailleurs.
En 2025, il publie son deuxième roman, Port-au-Prince Cotonou, une fresque vibrante qui fait dialoguer les mémoires et les destins entre Haïti et le Bénin, entre les blessures du passé et les espérances du présent.
Ce roman prolonge l’élan amorcé avec Vagabondages éphémères (2022), son premier ouvrage, salué pour sa sensibilité et sa plume poétique. Mais ce texte n’est pas qu’un roman d’amour ou d’exil, c’est une œuvre traversée par la politique, qui puise ses racines dans les tumultes d’Haïti, ce pays passé d’une dictature à l’autre, d’un espoir à un désenchantement. Sous ses accents poétiques, le livre porte la mémoire d’une nation meurtrie, les cicatrices d’un peuple en quête de dignité et de lumière.
Philomé y mêle la tendresse du verbe et la lucidité du regard, offrant un récit à la fois intime et collectif, où la fiction devient miroir de l’histoire.
Le thème de l’exil
Avant le romancier, il y a eu l’essayiste. Son livre Exil au crépuscule au titre mélancolique résonne comme une méditation sur la condition humaine, sur ce que signifie partir, rester, se souvenir, ou recommencer ailleurs.
Sa plume devient refuge, territoire d’expression, espace de résistance où se rencontrent la beauté du verbe et la profondeur du vécu. Un texte essentiel, qu’il faut inscrire au cœur de notre littérature contemporaine.
C’est en relisant ce livre, en explorant ses romans et ses éditoriaux, que j’ai mesuré à quel point le thème de l’exil demeure une constante dans la littérature haïtienne.
Depuis plus de deux siècles, il hante nos récits, irrigue nos imaginaires, nourrit notre mémoire collective. Motif littéraire, l’exil est aussi une respiration, une condition de l’écriture. Il traverse les poèmes, les romans, les essais, comme un fil reliant les générations d’auteurs dispersés entre Port-au-Prince, Montréal, New York ou Paris.
Certains en ont fait la matrice même de leur œuvre. Émile Ollivier, par exemple, résumait magnifiquement sa double appartenance en déclarant : « Je suis Québécois le jour et Haïtien la nuit. ». Tandis que Jean-Claude Charles, exilé à Paris, forgeait son propre syllogisme pour dire ce sentiment d’entre-deux : ni d’ici ni de là-bas, mais toujours en mouvement.
Chez eux, comme chez Marie Chauvet, la distance n’efface pas la patrie : ils la réinventent à chaque page, dans une langue nourrie de mémoire, de blessure et de désir.
C’est dire que Robert Philomé s’inscrit pleinement dans cette lignée. Il en est aujourd’hui l’un des héritiers les plus singuliers. Son écriture, à la croisée du reportage et de la fiction, puise à la fois dans le réel et dans la poésie. Elle témoigne d’une expérience de l’exil non pas subie, mais transformée en matière de création. Chez lui, partir devient une manière de continuer à appartenir.
Engagé dans la cité, Robert Philomé ne fait qu’écrire : il agit. Au sein de l’association Correcof, il milite pour la parole citoyenne, la liberté d’expression et la solidarité. Dans le journal de cette association, il signe des éditoriaux incisifs et inspirés, où se mêlent conviction, lucidité et humanisme.
Ces textes, rassemblés dans un recueil, composent une sorte de journal de bord du monde contemporain — entre désenchantement et espérance, entre colère et tendresse.
Robert Philomé s’impose aujourd’hui comme une voix majeure de la littérature haïtienne contemporaine, un témoin attentif de notre époque, un homme qui croit encore au pouvoir des mots. Chez lui, le verbe est acte, le récit est mémoire, et la mémoire, une forme de résistance.
Il nous rappelle que la littérature, comme le journalisme, n’est pas seulement une affaire de style, mais une manière d’habiter le monde avec conscience, émotion et exigence.
Maguet Delva
Paris, France