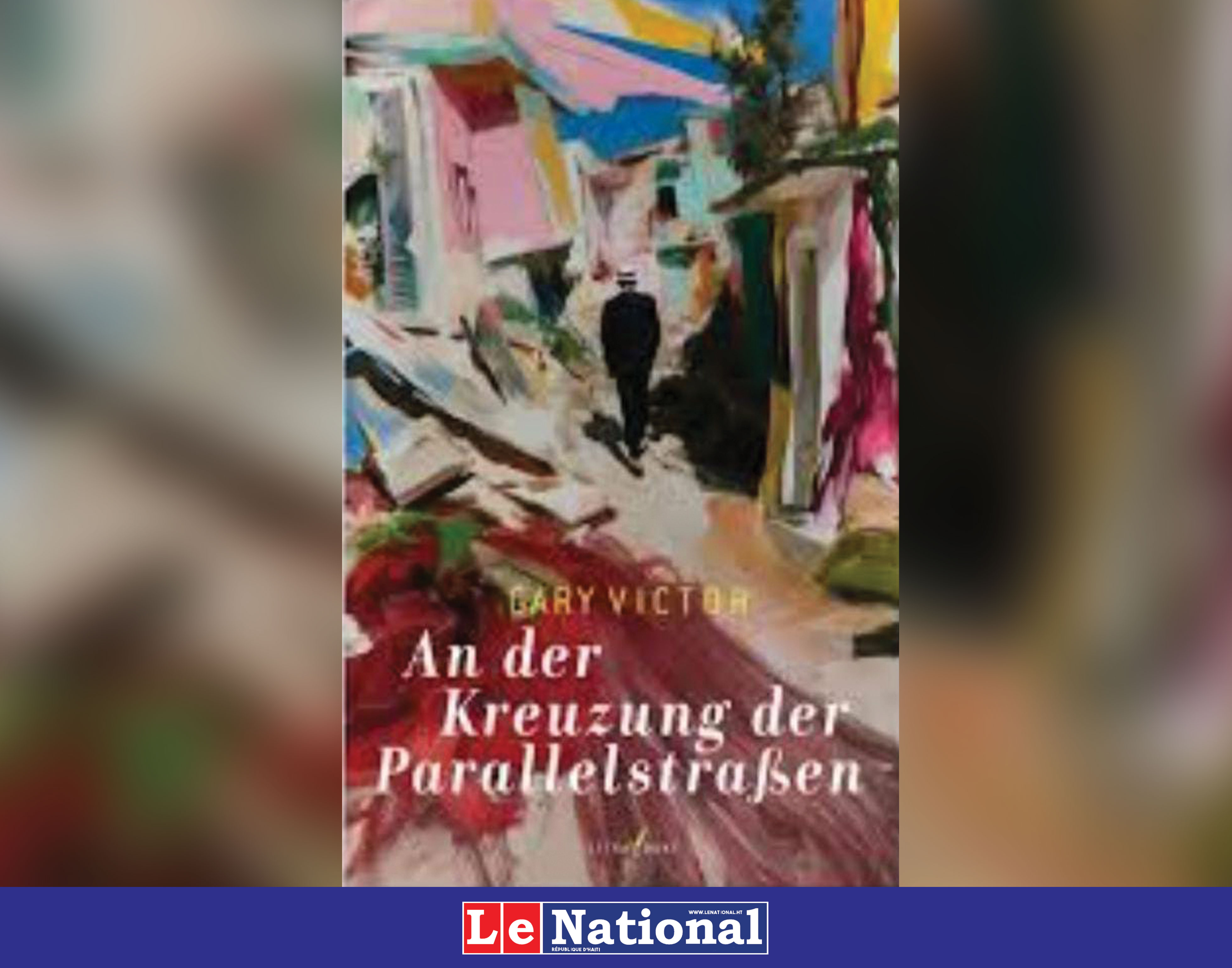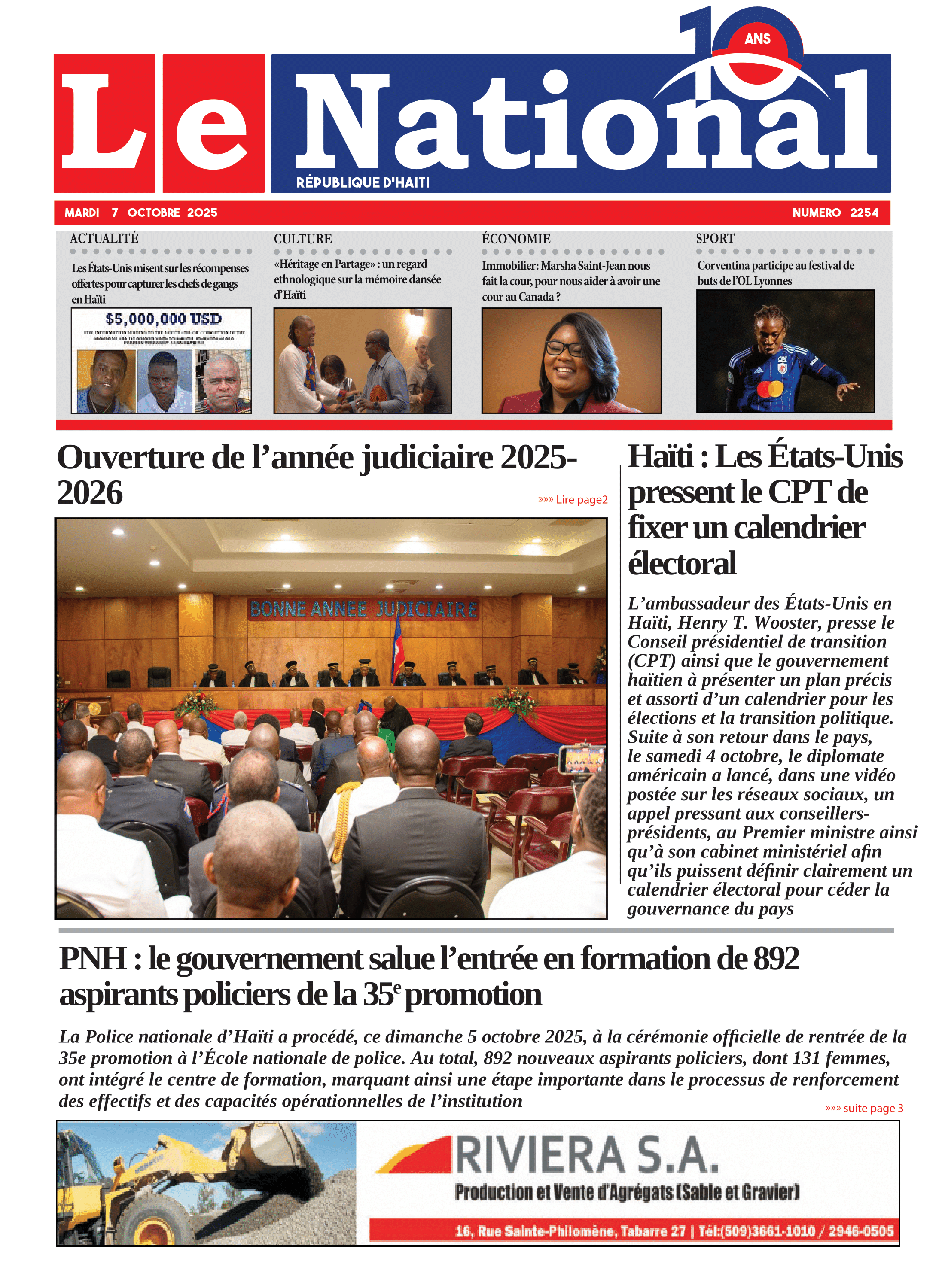Lors d’une soirée culturelle organisée par l’Institut Haïtien du Patrimoine et du Tourisme (INAPAT) et sous le haut patronage du ministère de la Culture et de la Communication ,le professeur Kenrick Demesvar, Ph.D., coordonnateur et titulaire de la Chaire UNESCO en Histoire et Patrimoine de l’Université d’État d’Haïti (CUHP-UEH), a livré un résumé analytique d’une grande profondeur autour du film “Héritage en Partage” du réalisateur Kesler Bien-Aimé. Croisant l’ethnologie et l’histoire, il met en lumière la force symbolique et la dimension patrimoniale des danses traditionnelles haïtiennes, reflets d’une mémoire collective, d’une résistance culturelle et d’une identité toujours vibrante. Le National a le plaisir de publier ci-après le texte intégral de cette intervention, empreinte de rigueur et de sensibilité.
Samedi 20 septembre 2025
Propos de résumé analytique et entretien autour du film “Héritage en Partage”
Par Kenrick Demesvar, Ph.D.
Coordonnateur / Titulaire de la Chaire UNESCO en Histoire et Patrimoine de l’Université d’État d’Haïti (CUHP-UEH).
Medames, Messieurs,
Distinguès invités,
Bonsoir,
J’ai l’immense honneur et la lourde responsabilité de vous présenter un résumé analytique sur le film intitulé” Heritage en Partage” réalisé par mon ami et collègue Kesler Bien-Aimé et l’équipe de l'Institut Haïtien du Patrimoine et du Tourisme (INAPAT) avant d’aboutir à un entretien sur le film lui même. Je profite de l’occasion pour féliciter tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réalisation de ce film et à l’organisation de l’événement de ce soir. Franchement, chapeau!
En tant qu’ethnologue et historien à la base, spécialisé en interprétation et mise en valeur du patrimoine, ma réflexion ici sera inspirée d’une démarche ethno historique c’est-à-dire, une approche de recherche qui combine les outils de l’ethnologie (l’étude des cultures et des pratiques sociales à travers l’observation, l’entretien, l’analyse des rites, des représentations, des langues, les danses, etc.) avec ceux de l’histoire (l’analyse critique des sources écrites, orales, matérielles et iconographiques dans une perspective diachronique). Cette démarche interdisciplinaire est essentielle car elle permet d’analyser comment des sociétés se sont construites dans le temps, en articulant la mémoire et les pratiques actuelles avec les documents historiques. Je ferai également appel à l’analyse de contenu, ultilisée ici comme technique et comme méthode qui permet d’examiner de manière systématique le contenu de messages textuels, audios, visuels, vidéos ou filmiques.
Appliquant donc cette marche à suivre, je dirais d’entrée de jeu, que si le nom du film “ Héritage en partage” est déjà en lui-même très évocateur, dans l'ensemble, il constitue avant tout d’un film ethnologique c’est-à-dire une production audiovisuelle réalisée dans le cadre d’une recherche scientifique en ethnologie (ou anthropologie culturelle). Il s’agit d’un outil de recherche mais aussi de diffusion des connaissances sur les sociétés humaines, dans ce cas précis la société haïtienne.
Je rappelle qu’un film ethnologique observe, décrit et analyse les pratiques culturelles, sociales, religieuses, économiques ou artistiques d’un groupe humain, d’une ou de plusieurs communautés. Il ne se limite pas au divertissement : il a une visée scientifique et pédagogique. Le film ethnologique répond à une démarche scientifique rigoureuse, où l’observation participante et l’analyse anthropologique sont centrales.
C’est d’ailleurs ce que fait ce court métrage de 45 minutes qui a été réalisé à la suite d’un inventaire dans 7 départements géographiques d’Haïti (lesquels???. Quand???). Dans l’ensemble, son contenu, ses sources (écrites, orales, matérielles et iconographiques), son corpus documentaire et sa qualité technique sont étonnamment de grande facture et n’ont rien à envier aux meilleurs films ethnologiques réalisés dans le monde et en Haïti tels Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain.
Le film s’est centré sur les danses traditionnelles en Haïti en tant que pratique vivante, témoignage du patrimoine culturel immatériel.
Il commence avec une intrigue, on entend une musique, un son doux. On est dans le noir total, une pénombre. Il s’agit d’un choix technique, difficile mais mesuré. Pourquoi? Parce que le film veut faire sortir les danses traditionnelles haïtiennes dans le noir pour faire apparaitre leurs lumières. Il nous aide à apprendre mais aussi à comprendre.
Le narratif d’introduction retrace quelques-uns des travaux réalisés sur la musique et surtout les danses traditionnelles haïtiennes. Il cite les travaux de recherche de Michel Lamartinière Honorat, Katherine Dunham, Emmanuel C. Paul, Alfred Métraux, Jean Fouchard et Claude Carré sur les différentes formes de danses traditionnelles en Haïti. L’assise théorique du film fait référence à Roger Bastide qui définit le concept de “danser” comme expression du comportement humain devant une ambiance quelconque et qui fait appel à son savoir et savoir-faire technique.
Mais l’aspect le plus significatif du film c’est qu’il traite des origines lointaines des danses traditionnelles haïtiennes associées à la colonisation à partir du XVe siècle, conditionnée par la traite des personnes misent en esclavage, importées d’Afrique traversant des océans dans des cales de bateaux, de nêgriers dis-je. En provenance de tribus différentes, ces personnes sont arrivées avec leurs cultures, leurs croyances et leurs traditions dans les Amériques, principalement dans les Antilles où elles se sont entremêlées avec ceux des amérindiens mais aussi des européens. Depuis. Les danses ont évolué. Ce qui crée aujourd’hui une richesse.
Le film part à la recherche de cette diversité. Il présente une catégorisation des danses haïtiennes :
Danses sacrées dans le vodou
Danses de divertissement social dans le milieu rural et urbain
Danses de spectacle telles folkloriques, classiques, jazz, modernes.
Danses de travailleurs
Danses de carnaval
Danses rara
Danses la ronde d’enfants dans les cours d’écoles, etc.
Le film fait parler l’ethnologue, sociologue, photographe et à présent vidéaste Kesler Bien Aimé qui nous informe, entre autres, que les danses traditionnelles ont un ancrage historique. Elles ne se limitent pas à Haïti, elles ne se limitent pas spécifiquement à ce territoire. Elles ont leur ancrage dans l’unité culturelle et historique de la Caraïbe. Ce qui les étend. Nous pouvons aussi les étendre aux Amériques. Nous les inscrivons ainsi car nous avons remarqué qu’elles ont beaucoup de contenus, d’ingrédients, de mouvements, de gestes. Elles ont même hérité d’attributs des danses européennes, comme leurs noms.
Tout le long du film, on voit des images de différentes prestations de danses traditionnelles don’t certaines sont de meilleures qualités que d’autres (sons, lumières/éclairage, décors, costumes, sous titrages, etc.). Cela se comprend car on n’est pas dans une logique cinématographique pure, mais plutôt dans un terrain ethnologique (je dirais même ethnographique) où les acteurs sont filmés et questionnés du lieu de leurs pratiques, en pleine réalité avec immersion des chercheurs et techniciens impliqués dans une logique de recherche action et d’observation participante.
Le film traite des danses telles :
- Petwo,
- Kongo,
- Banda,
- Ibo qui sont basés sur 4 temps fondamentaux, tandis que des rythmes comme Rada et Nago en comptent 12.
En ce qui concerne les gestes, les manifestations, les comportements, les danses Petwo, Kongo, Banda et Ibo ressemblent à des gestes brusques, plus agités, donc plus « djougan », nous dit le narrateur. Les aspects musicaux (instruments, coutumes, savoir et savoir-faire liés aux danses) sont aussi présentés dans une certaine mesure.
Le film nous apprend qu’il existe de nombreuses variantes de danses Petwo, comme par exemple le Kita. Il parle auusi d’une variante appelée Bamboula. Il explique l’origine kongo des danses Kita et Kalenda. Il présente quelques variétés de danses pratiquées dans différents départements du pays. Par exemple,
Menwat que l’on retrouve dans le département du Sud;
Le Sira dans la Grande-Anse;
Le Krapo, An avan kat » ou encore Kontredans dans le Sud-Est:
La danse An Avan kat avec des variantes telles An avan de, mereng à la chaine, Pòlka repoze, Pòlka senp, Mazouk, Lè uit annile (ou Lè Koup annile), Kwaze le uit;
La contredanse française appelée Valse de Musset, pratiquée par plusieurs personnes, y compris des femmes appelées cavalières et des hommes appelés cavaliers.
On parle du Yanvalou, du Calypso et du Compas.
C’est dommage que le film ne présente pas certaines danses traditionnelles telles Menet, pingué ou le Carabinier associé à Dessalines. Mais bon, on comprend bien que le film ne pourra pas tout présenter en quelques minutes, contraintes des temps oblige. C’est un film à voir et à revoir indiscutablement.
Pour terminer mon résumé et analyse critique, je reprends en partie la pensée de Laurent Julier dans son livre Qu’est ce qu’un bon film? (Éditions : La Dispute, 2001) dans lequel l’auteur présente les critères de qualité d”un bon film. Pour lui, un bon film c’est :
1) un film qui a du succès,
2) c’est un film qui a une réussite technique,
3) c’est un film qui apprend quelque chose de nouveau, fondé sur le réel et le vécu,
4) c’est un film qui émeut, c’est-à-dire qui porte l’intrigue, provoque une réaction de l’esprit et aide à réfléchir,
5) c’est un film qui est original,
Et 6) c’est aussi un film qui est cohérent.
Dans le fond, on peut dire que ce film ethnologiique répond à tous ses critères.
Le livre étudie également deux critères de type contextuel, plutôt centrés donc sur l’expérience du film :
A) l’adéquation avec les attentes, qui mesure l’écart entre ce que nous attendions du film et ce qui nous est donné
b) l’adéquation avec la situation, qui évalue les retombées des investissements consentis en temps, en argent et en sociabilité.
Ce qui m’amène à inviter le professeur Kesler Bien Aimé pour lui poser deux petites questions :
Qu’est ce qui vous a poussé à réaliser un film pareil, sur un thème aussi original?
Quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées durant les enquêtes et même durant la réalisation du film?
Merci de votre attention.
Kenrick Demesvar, Ph.D.