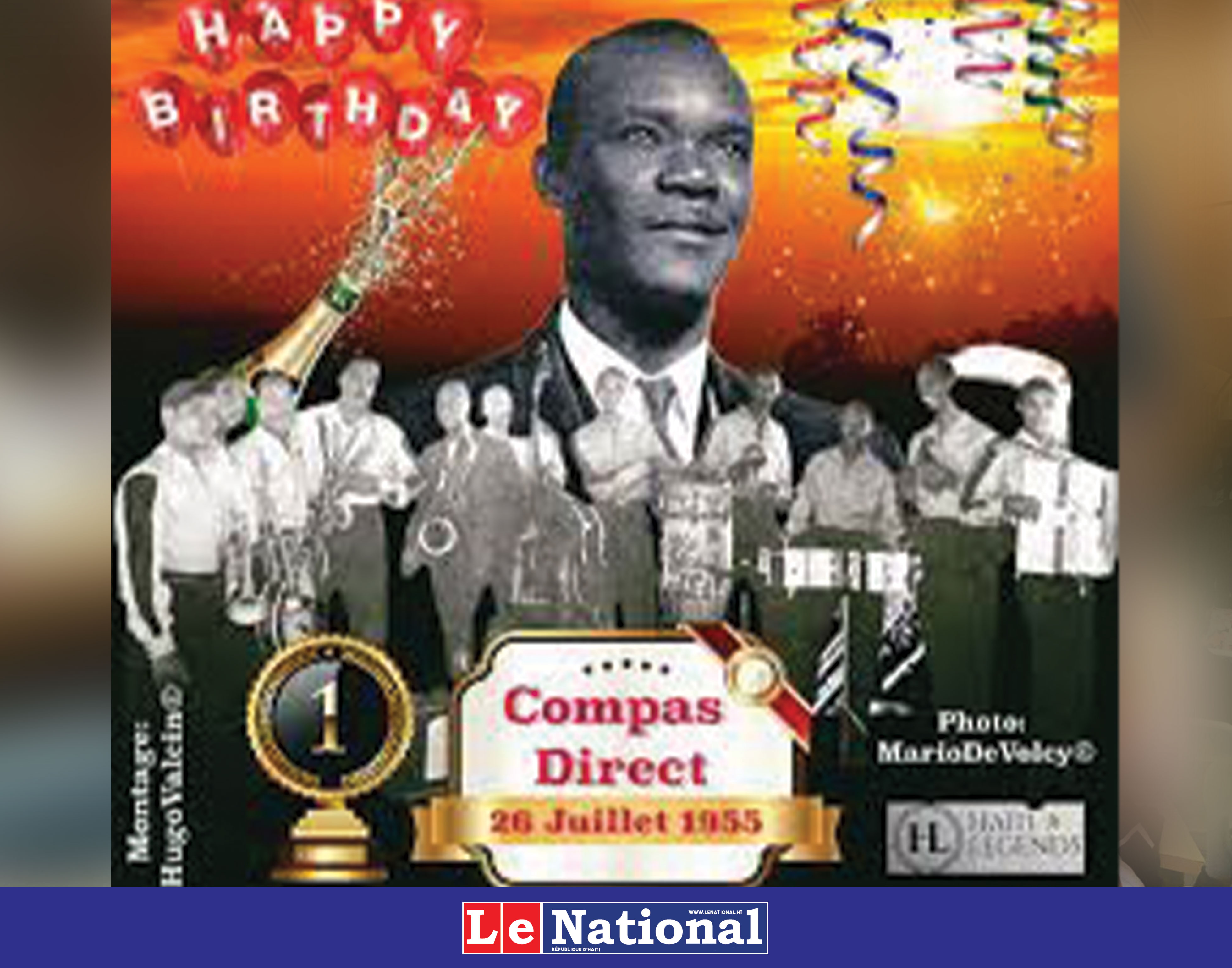La pratique musicale constitue un vecteur fondamental de reconnaissance culturelle et d’affirmation identitaire pour un peuple. Elle permet non seulement de transmettre des valeurs, des récits collectifs et des mémoires historiques, mais aussi de forger un sentiment d’appartenance. Selon l’ethnomusicologue Gilbert Rouget (1980), la musique, au-delà de sa dimension esthétique, est un véritable langage social et culturel qui structure les rapports au monde et à l’autre. De son côté, Simon Frith (1996), spécialiste en sociologie de la musique, affirme que « l’identité n’est pas seulement exprimée par la musique, elle est aussi formée par elle ». En ce sens, la pratique de la musique Compas n’est pas seulement une activité de divertissement c’est aussi un instrument de construction identitaire, de résistance culturelle et de dialogue avec les autres musiques du monde face à la mondialisation des formes artistiques.
Selon Dauphin (2014), le Compas est une musique qui a été utilisée pour désigner un style particulier de la meringue, et qui symbolise une dimension concrète de la typologie culturelle haïtienne. Plus qu’un simple genre musical, il s’agit d’un marqueur fort de l’identité haïtienne. Le 25 juillet 2025 marquera ainsi un moment hautement symbolique : les 70 ans du Compas Direct, une musique qui, depuis sa création par Nemours Jean-Baptiste en 1955, n’a cessé de nourrir la mémoire collective, de porter les voix populaires et de refléter l’âme du peuple haïtien.
Le Compas occupe une place centrale dans le patrimoine culturel immatériel d’Haïti. Cette musique, profondément enracinée dans l’histoire et les pratiques sociales du pays, est largement reconnue comme une expression authentique de l’identité haïtienne et des habitudes d’écoute de la population. Inscrit au registre national du patrimoine culturel immatériel haïtien depuis 2019, le Compas fait aujourd’hui l’objet d’un processus de reconnaissance à l’échelle internationale. À l’occasion du 70e anniversaire de sa création, des démarches importantes ont été engagées en vue de son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. C’est ainsi que, le 26 mars 2024, l’État haïtien, par l’intermédiaire de sa délégation permanente auprès de l’UNESCO, a officiellement soumis la candidature du Compas à cette fin.
La musique Compas incarne l’expression authentique du vécu du peuple haïtien. Elle représente le goût musical collectif de la société et constitue un espace de rencontre avec d’autres musiques du monde, mettant en valeur la richesse de notre danse et le rythme distinctif de cette tradition musicale lorsqu’elle est pratiquée. Le Compas joue ainsi un rôle fondamental dans la construction de notre identité musicale et artistique. Selon Fernando (2007), trois facultés humaines contribuent à l’élaboration de cette identité : la capacité de catégorisation, la faculté de construction de sens et les fonctions cognitives. Ces dimensions se manifestent à travers l’appropriation, l’interprétation et la transmission du Compas au sein de la société haïtienne.
Le Compas demeure une musique autonome et résistante face aux influences des musiques occidentales d’héritage colonial encore présentes dans la société haïtienne. Bien plus qu’un simple genre musical, il s’agit d’une véritable expression artistique qui raconte notre tradition et offre un regard renouvelé sur notre culture.
Depuis 1955, le Compas est reconnu comme l’expression d’un attachement fort qui consolide l’existence de notre identité musicale. Cet attachement, selon Hennion (Floux et Schinz, 2003), se manifeste tant dans la confrontation avec d’autres amateurs que dans la jouissance de la musique elle-même et dans la démarche qui y conduit. Richemond (2009) souligne également la présence marquante des chansons « Compas » dans les autobus de transport en commun, principal vecteur de diffusion musicale en Haïti. Les discussions et parfois disputes observées quotidiennement dans les rues autour des choix d’écoute et des groupes ou orchestres préférés illustrent à quel point ce genre musical est ancré dans l’âme haïtienne.
Par ailleurs, le Compas connaît aujourd’hui un développement important dans sa diffusion grâce aux technologies numériques. Il bénéficie d’une présence significative sur plus d’une dizaine de sites internet, tels que kompamagazine.com, konpaevent.com, basekompa.com, Radio Métro Compas, Kompalive, entre autres. Ces plateformes offrent diverses fonctionnalités : écoute de fichiers mp3, radiodiffusion en ligne, vidéoclips, actualités sur les principaux groupes, forums de débat, et bien plus encore.
Selon le document publié en 2017 sur la coordination de l’ONG « Ayiti Mizik » et l’UNESCO intitulé « Cartographie de l’industrie haïtienne de la musique » (Jaunay, Marcelin, Bécoulet, 2017), avec 1520 enquêtés, entre 14 % des professionnels de la musique se consacre uniquement au genre Compas . Aussi 17 % des professionnels questionnés se consacre au « Konpa » et aussi d’autres genres musicaux.
Le Compas est une musique d’affirmation, caractérisée par un rythme dansé et joué de manière particulière. Ce genre musical se distingue notamment par le jeu spécifique des cymbales, du floor tom et du tambour, qui forment une séquence rythmique à quatre temps, où le troisième temps est accentué. À cette base rythmique s’ajoute le son distinctif de la cowbell (cloche), contribuant à la signature unique du Compas. Une création qui est en général accordée à Nemours Jean Baptiste, où en 1955, il va fonder son propre orchestre Aux Calebasses. Selon Jean-Pierre (2002), Nemours a permis à Haïti de retrouver sa meringue déjà adoptée par la République Dominicaine. Il a souligné que Nemours a changé le style tambour en se basant sur la musique le point de la rivière kwit (Croyte) jouée par les soldats en parades, tout en ajoutant un accent sur la contrebasse et le tambour. C’est ainsi que fut créé le Compas direct.
Boncy (1987) décrit d’une manière très explicite la présence de chaque instrument qui forme la structure du Compas direct. Il mentionne le gong qui consiste à faire résonner une cloche à vache avec une baguette avant de taper sur une caisse tom au troisième temps. Ensuite, il y a le tambour, qu’il décrit comme immuable, répétant la même figure rythmique au cours du morceau ou de la chanson. Le jeu de batterie se caractérise par une accentuation sur les cymbales et des roulements occasionnels sur les caisses claires.
Au cours des années 1960, selon Jean –Pierre , la musique Compas a connu quatre phases : La première phase c’est le Compas direct du maestro Nemour Jean Baptiste ; la deuxième c’est la Cadence Rampas du maestro Webert Sicot , la troisième , les Mini-Jazz avec les Shleu-Shleu et la quatrième phase c’est encore les Mini-Jazz avec les Fantaisistes de Carrefour et les Ambassadeurs. Le Compas, véritable pilier de l’identité musicale haïtienne, ne cesse d’évoluer depuis sa création dans les années 1950. Au fil du temps, ce genre a donné naissance à une diversité de sous-genres qui témoignent à la fois de sa richesse rythmique et de sa capacité d’adaptation aux goûts et aux époques avec des générations différentes.
À côté du Compas traditionnel, plusieurs styles dérivés ont diversifié ce genre musical, chacun apportant une couleur particulière à la musique. Parmi les plus marquants, on peut citer : Compas Manba (Coupé Cloué), Compas Kè kal (Bossa Combo), Compas Matchavèl(Système Band),Compas Hounsi (Tropicana). Il y a aussi le siwèl de travailleurs coupeurs de canne revenus de Cuba qui se joue avec une guitare ou banjo, des maracas ou tchatcha, un manoumba, une basse faite d’une caisse en bois ou cymbale et un accordéon, une flûte et une cymbale, (Hancy , 2024). Dans le contexte contemporain, cette dynamique d’innovation se poursuit avec l’émergence de courants tels que : L’Afro Compas, porté par des artistes comme Roody Roodboy, qui marie les percussions africaines aux fondations du Compas ; Le Trap Compas, incarné en 2022 par Hantz Mercier Jr, dit T-Ansyto, qui fusionne les sonorités trap et urbaines aux codes classiques du Compas.
La musique Compas demeure l’un des symboles les plus forts de notre identité culturelle. Elle incarne à la fois notre histoire, nos traditions et notre manière unique de ressentir et de transmettre les émotions à travers le rythme et les pas de danse. Une musique qui est ancrée dans la mémoire collective haïtienne. Cette musique constitue un vecteur central de notre identité culturelle. Son évolution à travers les générations témoigne de sa capacité à représenter la diversité et la richesse de notre société. C’est aussi l’expression vivante de notre patrimoine culturel . C’est une musique qui reflète l’âme du peuple haïtien, ses luttes, ses espoirs, ses désenchantements, mais aussi et surtout, sa créativité inépuisable. Une musique qui incarne la résilience, la fierté et la capacité du peuple haïtien à conserver l’autonomie de son expression artistique.
Bien que le Compas représente une expression authentique de notre identité culturelle, il souffre malheureusement d’un manque criant de politiques publiques capables de soutenir sa valorisation et sa préservation. En l’absence d’une véritable stratégie culturelle de la part des autorités haïtiennes, cette musique emblématique se retrouve fragilisée face à l’invasion massive de musiques étrangères qui pénètrent librement le marché musical haïtien, sans régulation de la part des institutions étatiques, notamment les ministères de la Culture et de la Communication.
Ces courants musicaux exotiques, bien souvent soutenus par des industries musicales très puissantes exercent une influence croissante sur la musique haïtienne reléguant progressivement le Compas à l’arrière-plan. C’est le cas avec le mouvement musical yéyé en France qui a influencé les mini- Jazz en 1970 , plus tard, en 1985 , on va trouver l’influence de la musique zouk sur le Compas , en 2000 , le R& B, ragga Muffin et la musique double machine venant vont aussi influencer ce genre musical.
Il devient donc urgent d’agir pour protéger, promouvoir et renouveler ce patrimoine vivant, qui demeure l’un des piliers de notre mémoire collective et de notre souveraineté culturelle.
Frandy Jasmin
Communicateur Social
Anthropologue
Repère Bibliographiques
Dauphin Claude (2014). « Histoire du style musical d’Haïti ». Québec, Mémoire d’encrier.
Frith Simon(1996). « Performing Rites»: On the Value of Popular Music Harvard University Press
Hancy Pierre (2024) , «Une brève histoire du « Konpa dirèk », journal le national , https://www.lenational.org/post_article.php?cul=1560
Jean-Pierre, Jean Sylvio(2002). « 30 ans de musique populaire haïtienne : Les moments de turbulence (1960-1990) ». Port-au-Prince, Communication Plus.
Nathalie Fernando (2007). «La construction paramétrique de l’identité musicale ». Cahiers d’ethnomusicologie, 20, pp. 39-66. http://ethnomusicologie.revues.org/250
Pascale Jaunay, Marcelin Iasaac ,Bécoulet, PhilippeMarcelin (2017). « Cartographie de l’industrie haïtienne de la musique »:. Port-au-Prince Ayiti Mizik/UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/search/N-EXPLORE-10df913a-1cc2-4a4d-a7cd-eeaed8f0f8d9 Pierre Floux, Olivier Schinz (2003). « Engager son propre goût », entretien autour de la sociologie pragmatique d’Antoine Hennion, ethnographiques.org, Numéro 3 - avril 2003 [en ligne]. http://www.ethnographiques.org/2003/Floux,Schinz.html
Ralph Boncy (1987). « La nouvelle musique haïtienne ». Conjonction revue franco haïtienne, 176, 162-170.
Richemond, E., Richard (2009). « Présence de la musique haïtienne dans la radio locale en Haïti : enjeux et perspectives Montréal »: Université de Montreal.
Rouget Gilbert (1980). « La musique et la transe », Paris : Presses universitaires de France.