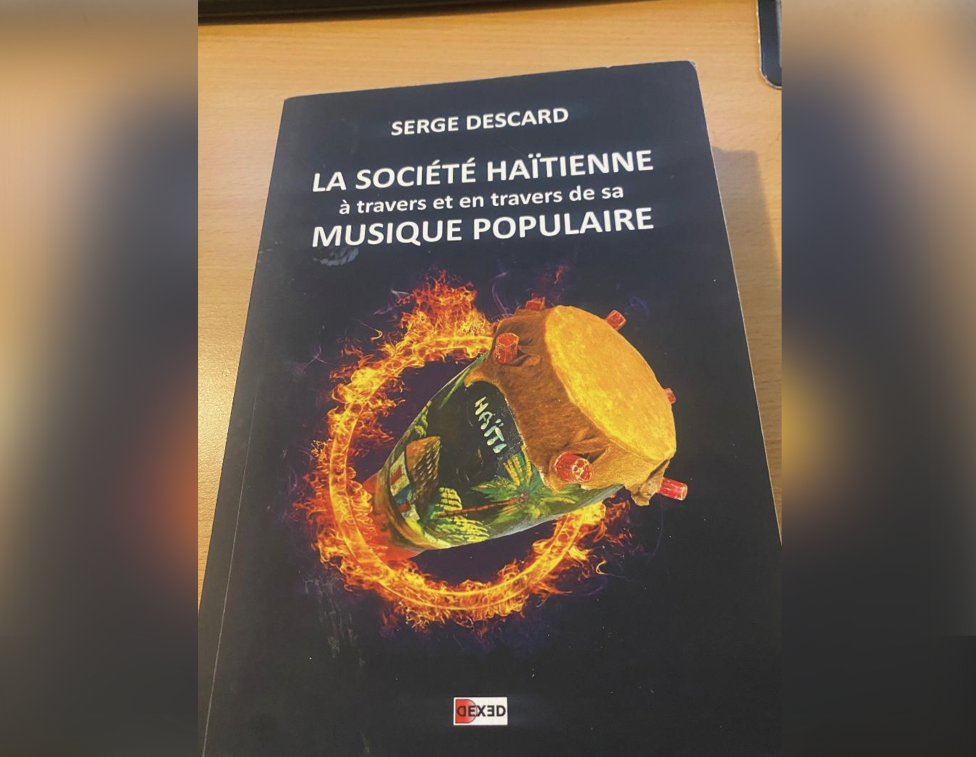« La société haïtienne à travers et en travers de sa musique populaire » est le dernier livre de Serge Descard, critique musical qui porte aussi la casquette de musicien, de journaliste culturel, d’homme d’affaires avisé et de passeur de mots.
Observateur hors pair de la société haïtienne et de la musique populaire, Serge Descard sait mettre en lumière l'âme d'Haïti à travers les mélodies qu'il compose. Ce dernier ouvrage est une immersion profonde dans l'essence même de la culture haïtienne, qu'il décortique, analyse et sublime. Ce faisant, il met en lumière les réalités sociales et culturelles de son peuple, rendant ainsi justice à son génie créatif.
Visionnaire, il a marqué l’univers musical haïtien en inventant le concept emblématique de la « compalogie », une fusion ambitieuse et novatrice de talents. Largement salué, ce thème a réuni des figures majeures de la scène musicale dans un élan collaboratif inédit. Parmi les artistes ayant contribué à ce projet visionnaire figurent des légendes comme Gracia Delva, connu pour sa voix puissante, André Déjean, maître incontesté des cuivres, et Richie, icône de la batterie et de la production. D’autres talents tels que Jackito, avec son interprétation charismatique, Daan Junior, étoile montante, Tuco Bouzi, aux rythmes envoûtants, et Ralph Condé, guitariste virtuose, complètent cette constellation artistique.
La compalogie a également bénéficié de la contribution de Pipo, au timbre vocal inimitable, d’Amstrong Jeune, ambassadeur de la musique traditionnelle, et de Nickenson Prudhomme, compositeur prolifique. Shedly Abraham, Yves Abel et Nestor Azero ont enrichi ce projet, chacun apportant sa singularité à une initiative profondément enracinée dans l’identité haïtienne. Devenue un phénomène culturel sur les plateformes modernes comme Facebook, la compalogie incarne l’unité par la musique et témoigne de la richesse de la culture haïtienne.
Corruption et indifférence de nos gouvernants
Descard, avec ce concept, démontre que la force musicale d’Haïti réside autant dans son passé glorieux que dans son avenir prometteur, porté par des collaborations audacieuses. Son regard perçant, symbolisé par ses grosses lunettes, évoque sa capacité à saisir l’essence des choses. Il établit un pont entre la douleur du séisme de 2010 et la résilience culturelle qui en a émergé, montrant que, même dans l’adversité, les Haïtiens trouvent la force de créer : « Malgré tout son pouvoir dévastateur, le séisme n’a pas réussi à annihiler l’espoir dans la chanson et la poésie haïtienne. Il n’a pas terni l’éclat du rire haïtien. Dans le bruit de tonnerre comme dans le silence qui a suivi, l’Haïtien, artiste dans l’âme, recrée, avec les débris de lui-même, la chanson de l’espoir et féconde sa culture sans se soucier de récompense ou de gloire.»
Cet ouvrage est à la fois un cri d’alarme et un chant d’espoir, une invitation à reconnaître la valeur inestimable de la culture haïtienne et à l’utiliser comme levier pour le progrès social. Il révèle comment les luttes, les espoirs et les désillusions se mêlent dans la musique populaire haïtienne, rendant chaque note et chaque parole porteuses d’une charge émotionnelle et intellectuelle qui traduit l’âme d’un peuple.
Avec une plume incisive, Descard analyse les œuvres d’orchestres légendaires tels que Tropicana, Tabou Combo et Septentrional, qui transcendent l’art pour devenir des phares culturels et des catalyseurs de changement social. Leurs chansons, profondément ancrées dans les réalités locales, dénoncent les inégalités tout en célébrant la richesse culturelle du pays.
En examinant aussi les conséquences des dysfonctionnements politiques sur l’industrie musicale, Descard dénonce une gouvernance marquée par la corruption et l’indifférence. Il appelle à une réforme structurelle pour permettre à la musique haïtienne de devenir un moteur de développement économique et social. Le livre met en évidence une crise profonde d’identité culturelle, exacerbée par les influences de la mondialisation et de la numérisation.
La jeunesse haitienne à l’heure de la mondialisation
La jeunesse haïtienne, exposée aux images et standards mondiaux via Internet, tend à vouloir s'éloigner d'une image d’elle-même qu’elle juge inférieure ou dépassée. Cependant, cette fuite se fait souvent sans réflexion critique, dans une quête d’imitation plutôt que de réinvention basée sur ses propres valeurs. L’ouvrage critique une jeunesse qui, faute de formation adéquate et de conscience culturelle, abandonne ses racines.
Les termes comme recentrage sur ses valeurs et consolidation de ses racines pointent vers un impératif de retour à une identité forte pour contrer les vents de l’arrachement, symbolisant la force destructrice de l’uniformisation mondiale. La comparaison avec une herbe folle évoque l’idée d’un mouvement désordonné, sans direction ni contrôle. Cette image renforce la critique d’une jeunesse déracinée, à la merci des courants de la mondialisation, incapable de s’ancrer dans une base culturelle solide.
Le texte oppose le passé séculaire d’Haïti, marqué par des honneurs désormais endormis, à un avenir incertain dominé par un présent inefficace. Cette tension entre héritage et modernité traduit l’incapacité de transformer un passé glorieux en un avenir prometteur. L’océan de la mondialisation est présenté comme un lieu où l’identité haïtienne se noie. Cette critique invite à réfléchir aux effets délétères d’une mondialisation non maîtrisée, qui tend à effacer les spécificités culturelles au profit d’une uniformisation globale : « Notre jeunesse haïtienne, à l'heure de la numérisation et de la mondialisation, veut se défaire de cette image qu'elle peut comparer sur internet avec celles des autres pays, peut-on lire dans son essai. Malheureusement, sans bagage ou très mal formée, elle se contente d'imiter ceux-là mêmes qui ont réalisé le cliché. Elle ne s'applique pas à un recentrage sur ses valeurs, à la consolidation de ses racines pour résister aux vents de l'arrachement dévastant le pays. Elle se retrouve aux prises avec un passé séculaire où dorment d'un sommeil lourd et profond ses derniers honneurs, et un avenir des plus incertains, sur lequel le présent ne semble avoir aucun contrôle. Elle se laisse, comme une herbe folle, emporter par les flots, vers l'océan de la mondialisation où se noie l'Haïtien »
Ces propos offrent une réflexion profonde sur les défis auxquels fait face la jeunesse haïtienne dans un contexte mondialisé. Elle souligne la nécessité de s’approprier les outils modernes, non pour s’effacer ou s’aligner sur des standards étrangers, mais pour renforcer et promouvoir l’identité haïtienne. La solution proposée en filigrane réside dans une éducation de qualité, une mise en valeur des racines culturelles, et une prise de conscience collective pour éviter que l’Haïtien ne se perde dans la marée de la mondialisation.
Bien au-delà d’une simple étude musicale, ce livre est une véritable plongée dans l’âme d’un peuple. Il consacre la musique haïtienne parmi les formes d’expression les plus marquantes de l’humanité. Descard nous invite à redécouvrir de quelle manière la musique populaire accompagne le quotidien des Haïtiens : à la fois comme un baume apaisant pour panser leurs blessures et comme un outil puissant pour dénoncer les injustices.
L’œuvre de Descard se présente comme une exploration magistrale de la culture et de l’identité haïtiennes, où chaque note, chaque rythme et chaque parole incarne les luttes et les aspirations d’un peuple en quête de justice, de dignité et de reconnaissance.
Maguet Delva