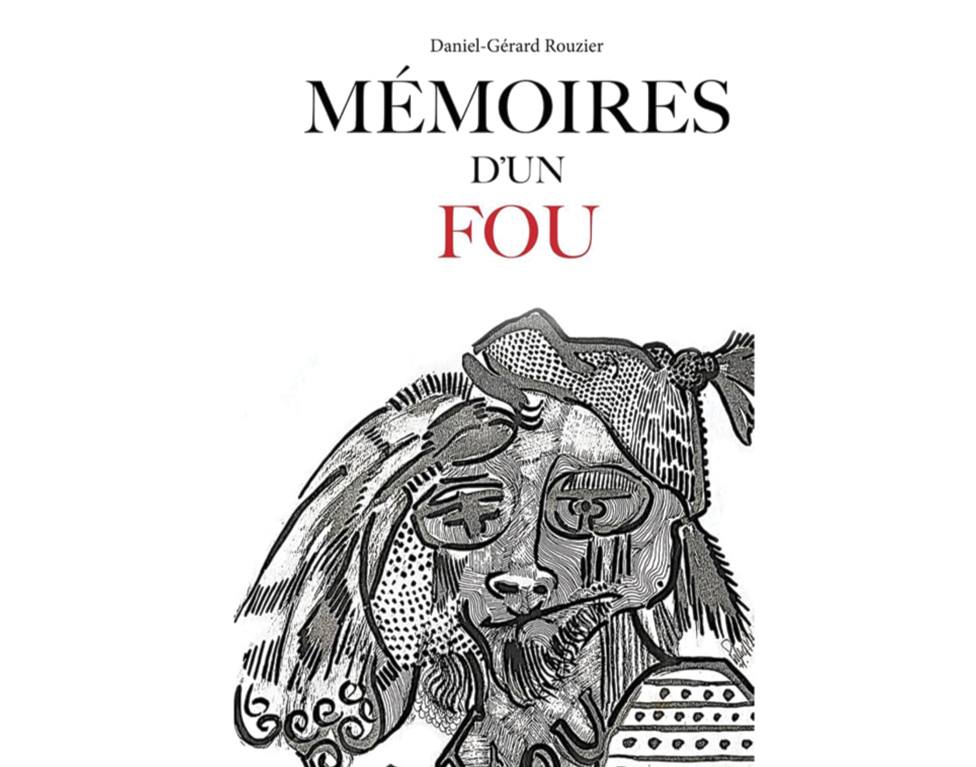« Les Mémoires d’un fou » de Daniel Gérard Rouzier propose une immersion profonde dans l’histoire d’Haïti, grâce à la richesse de ses personnages historiques et aux épisodes marquants qu’il revisite, tels que les épopées de 1803.
Sous la plume de Daniel Gérard Rouzier, l’Histoire n’est pas figée. Didactique, elle peut être réinterprétée, revivifiée, remodelée, devenant ainsi un espace de réflexion et d’émotions sur notre histoire nationale si singulière. D’où ce roman à puzzle interrogeant notre histoire nationale qu’il nous sert.
D’ailleurs, l’auteur ne cache pas son objectif. En se mettant dans la peau d’un historien, il fait dérouler les événements historiques mais sans se limiter à une simple narration. Il les a revisités avec une telle intensité que le lecteur va ressentir toute l’ampleur des moments fondateurs de notre malheureux pays. Chaque page est évoquée d’une manière si dense et engagée qu’elle suscite la réflexion chez lecteur. Un véritable travail de mémoire qui ne peut que nous marquer. Pour aborder pleinement cet ouvrage, le lecteur doit se doter d’une méthode de lecture rigoureuse et d’un cœur bien accroché, tant l’auteur nous inonde de références historiques et romanesques à assimiler. Cette approche singulière des problématiques historiques met en lumière l’intensité narrative du texte. Il faut être prêt à affronter la complexité des époques et des destins décrits pour percer les mystères de l’écriture de cet homme d’affaires haïtien.
Le portrait en creux de Jean-Jacques Dessalines, fondateur de la nation, est particulièrement intrigant. Rouzier le dépeint avec nuance et subtilité, permettant au lecteur de reconstruire cette figure emblématique à travers ses actions, ses interactions et les événements qui lui sont associés. Dessalines apparaît à la fois comme un héros et un envoyé du ciel, reflet de la vision catholique de l’auteur. Cette approche témoigne de la capacité de Rouzier à humaniser les figures historiques de son pays, tout en leur conférant une dimension mythique.
En explorant les épopées de 1803 et les moments cruciaux de l’indépendance, Rouzier propose une réflexion profonde sur le lien entre passé et présent. Dans son œuvre, l’Histoire d’Haïti n’est pas une simple suite d’événements : elle devient un miroir permettant de comprendre l’identité collective et les défis contemporains.
Ce livre est bien plus qu’une fiction ; c’est un hommage à la richesse de l’histoire haïtienne en même temps, il nous force de nous interroger sur la manière dont nous pouvons l’intégrer dans un processus de développement. Reprendre le fil de notre histoire si belle.
La plume vivante et engageante de l’écrivain joue un rôle clé dans cette célébration, rendant accessibles et émouvants des pans souvent méconnus ou simplifiés de notre héritage national. « Les Mémoires d’un fou » est un roman où l’histoire se mêle à la fiction romanesque, c’est ce qui fait sa force, et sa beauté littéraire.
En dépassant le simple cadre historique, Rouzier emprunte les codes du roman à puzzle. Le choix d’un narrateur fou, patient d’un hôpital psychiatrique, affirmant des choses invérifiables, perturbe les conventions narratives habituelles d’un roman historique comme on le voit par exemple avec Michel Soukar dans Cora Geffrard. Cette incertitude permanente place le lecteur dans une position critique : les récits du narrateur sont-ils de purs délires, des vérités cryptées ou un mélange des deux ?
Des voix subjectives
Ce procédé littéraire nous pousse à une réflexion plus large sur l’Histoire elle-même : est-elle totalement vérifiable, ou est-elle un récit fragmentaire et biaisé, façonné par des voix subjectives ? En mettant en scène un narrateur jugé fou, Rouzier interroge la légitimité des récits historiques officiels et la manière dont les institutions définissent ce qui est rationnel ou acceptable. C’est comme dans ce passage où le narrateur décrit la fuite et la protection de Français par diverses familles et officiers indigènes, tels que Madame Dessalines, Capois, Pétion, Christophe et Geffrard, qui cherchaient à les soustraire à la violence des troupes. Malgré leurs efforts, ces Français étaient souvent capturés et tués. Le gouverneur général, quittant l'Ouest pour Marchand, poursuivit sa marche à travers les villes, où les massacres de Français se poursuivaient. À son arrivée au Cap, avec des troupes d'élite, il obtint la soumission de chefs marrons comme Petit Noël Prieur, ancien allié des Français, qu'il nomma général de brigade tout en prétendant lui pardonner sa trahison.
Un passage met en lumière les tensions de la période postindépendance d’Haïti où le peuple était partagé entre la quête de vengeance face aux atrocités commises par les colons, et le désir de restaurer une certaine stabilité sociale. L’attitude des familles indigènes, qui risquèrent tout pour sauver des Français, révèle une dimension humaine souvent occultée par les historiens qui, souvent, mettent l’accent sur la brutalité des représailles. Les gestes de compassion contrastent fortement avec l'ampleur des massacres orchestrés, soulignant les dilemmes moraux qui ont marqué cette période, voire n'importe quelle autre situation similaire. Dessalines apparaît ici dans toute sa complexité : un chef impitoyable dans sa volonté d’éradiquer les vestiges du colonialisme, tout en étant stratégique dans sa gestion des traîtres. Sa décision de gracier Petit Noël Prieur, tout en l’intégrant à sa hiérarchie militaire, illustre un pragmatisme politique : utiliser la réconciliation comme levier de contrôle, tout en rappelant que sa clémence était toujours conditionnelle et pouvait se transformer en punition à tout moment. Rouzier souligne également le génie diplomatique de Toussaint Louverture, notamment à travers l’accord tripartite négocié grâce aux bons offices de Maitland. Une autre facette de la diplomatie haïtienne souvent ignorée, tandis que certains préfèrent glorifier un Henri Kissinger, dont les mains étaient couvertes du sang des militants de gauche.
Ce roman audacieux allie profondeur historique, intensité émotionnelle et narration exigeante. Il s’impose comme une œuvre incontournable pour comprendre les racines d’Haïti tout en offrant une écriture vibrante et incarnée. Rouzier raconte l’histoire tout en la faisant revivre et en en faisant un puissant outil de réflexion sur notre identité collective et nos défis contemporains.
Maguet Delva