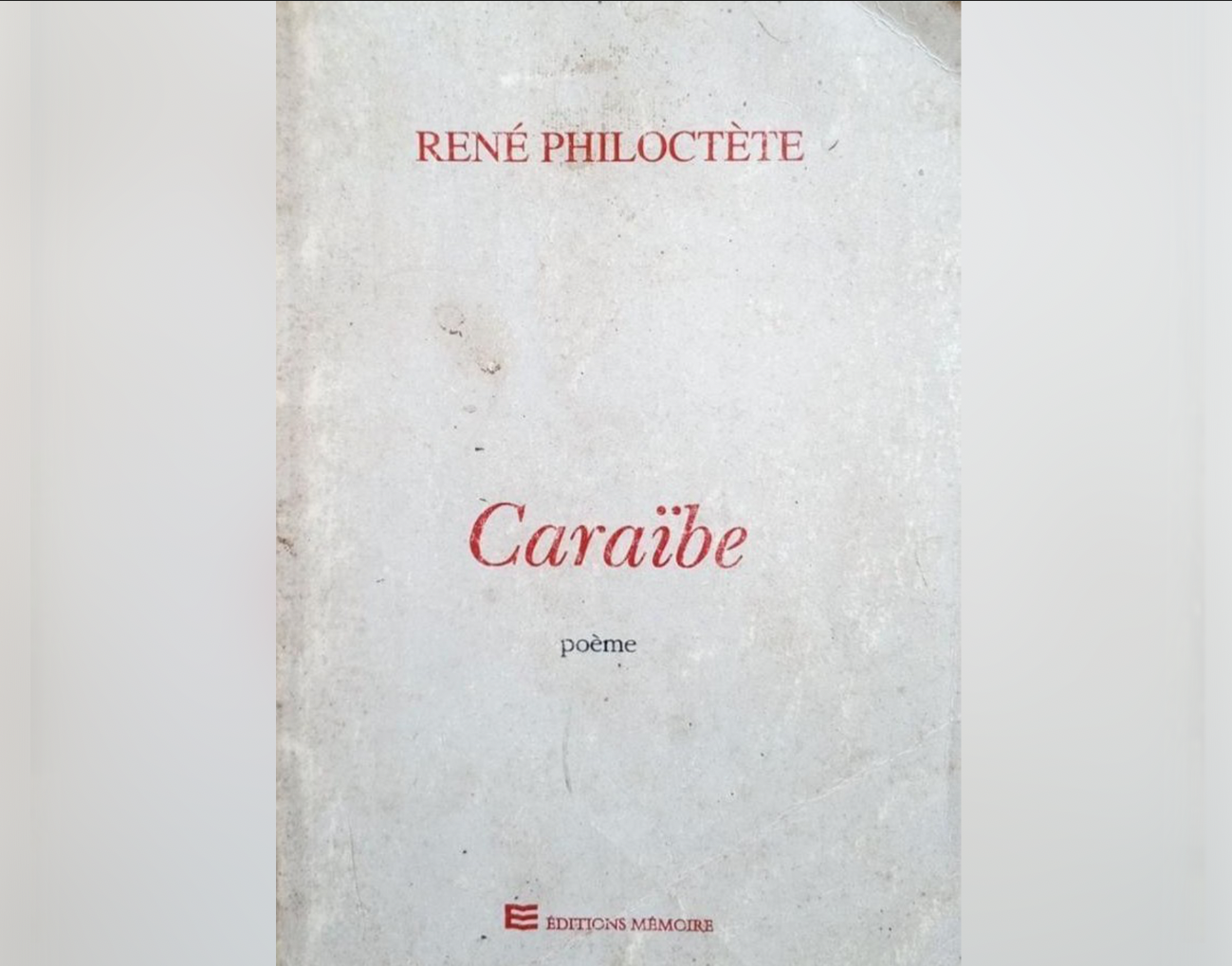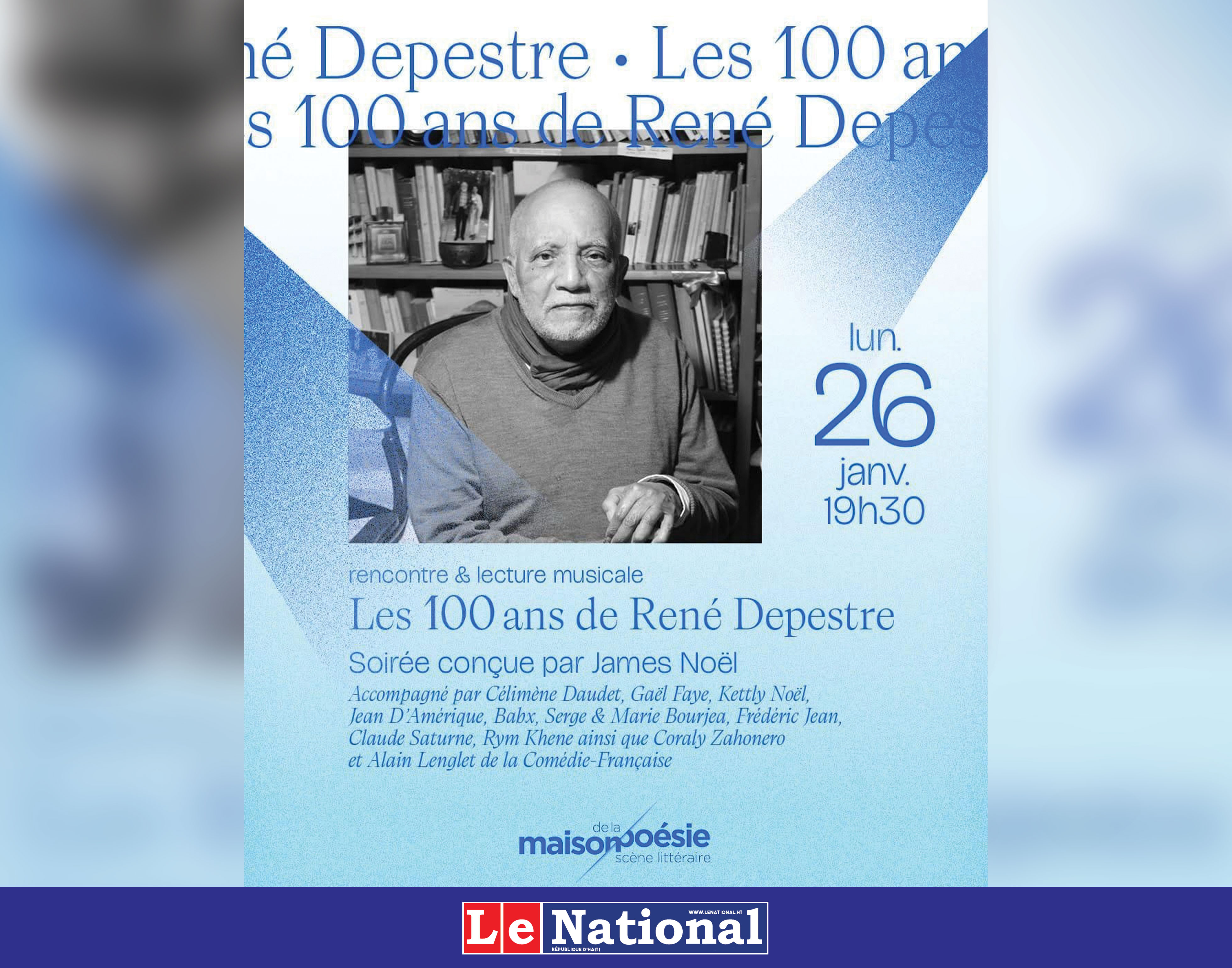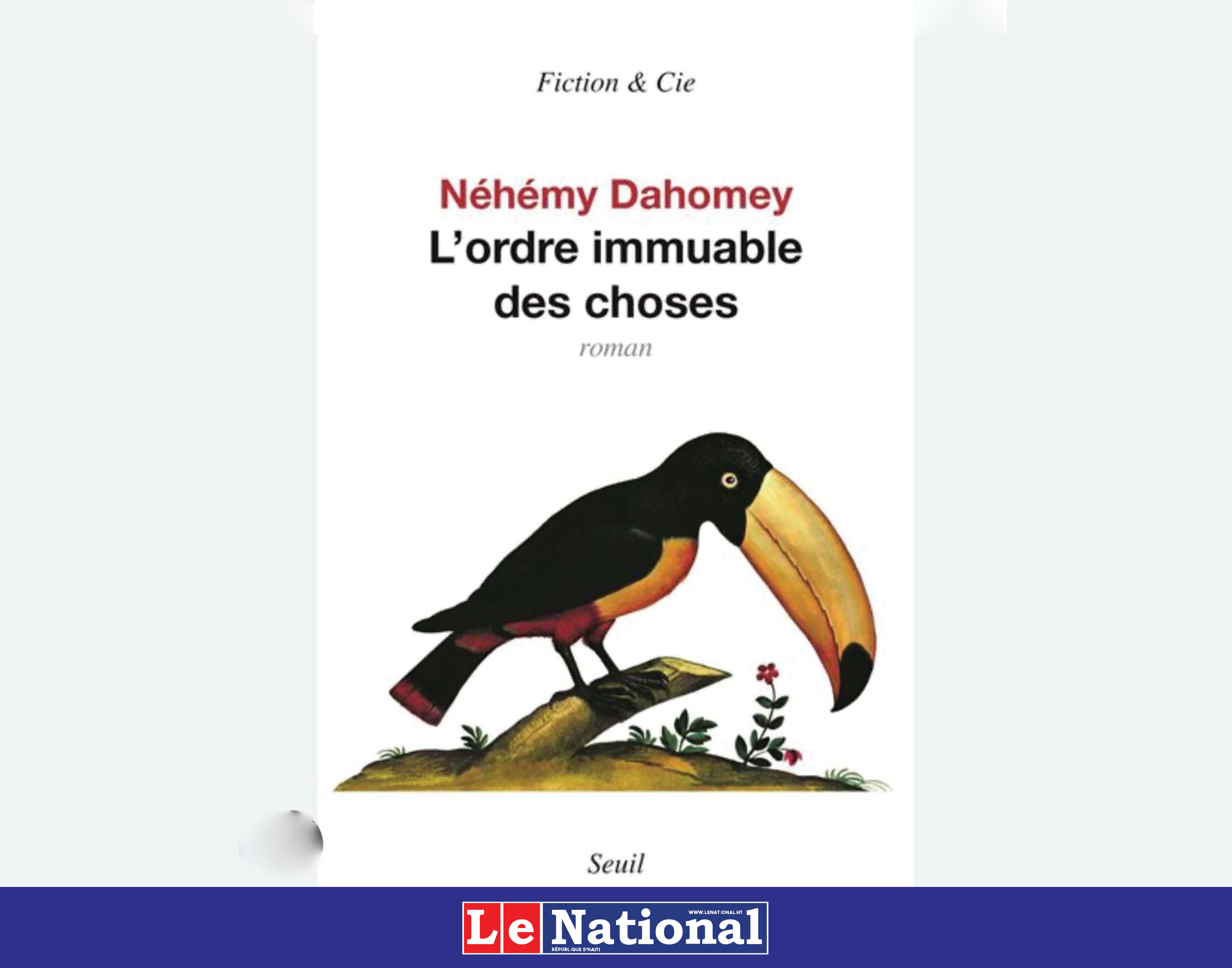Depuis quelque temps, j'ai pris l'habitude de lire un poème chaque matin. C'est devenu un rituel, une manière d'entrer dans la journée avec une pensée plus large, plus humaine. Car la poésie, nous dit Victor Hugo, est tout ce qu'il y a d'intime dans tout. Et ce matin, en partant à la recherche d'intimité, je suis tombé sur un recueil dont on parle trop peu. Et pourtant, il mériterait d'être lu, discuté, offert à ceux qui cherchent à comprendre cette partie du monde que l'on appelle les Caraïbes. C'est d'ailleurs le titre du recueil : « Caraïbe ». Écrit par René Philoctète, publié à compte d’auteur en 1982 et réédité en 1995 aux éditions Mémoire, ce livre est un témoignage unique, un regard subtil sur l'histoire de la Caraïbe.
Quand on parle de Philoctète, on pense souvent à un humaniste, un homme amoureux de la vie et des mots, celui qui met son cœur en partage et revient « des giboulées du nord pour rester au pays parce qu'un arbre lui tient ou du moins parce que le Soleil d'ici c'est pas froid comme la mort ». « Caraïbe » un recueil hybride, où prose poétique et poésie versifiée se rencontrent pour dessiner une fresque sublime. La prose est la gravité de l'histoire. Elle revient sur les premiers habitants de ces îles, sur leur effacement, et sur ce qui a suivi, jusqu'à la Révolution haïtienne. Chaque page est comme un clin d'œil à l'histoire collective, mais aussi un hommage. Philoctète nomme des figures comme Bob Marley, Aimé Césaire, des noms qui résonnent comme des éclats de mémoire.
Puis viennent les poèmes en vers. Ici, la voix change. La prose portait le poids du passé, presqu’avec froideur. Mais dans les vers, on sent autre chose : une intimité, un désespoir voilé. Philoctète y questionne ce qu'il a décrit plus tôt. Ces questions sont douloureuses, personnelles, presque trop grandes pour un homme seul. On a envoyé le regard du poète vaciller, comme s'il ne pouvait plus soutenir la folie et la misère qu'il a vues. La répétition d'une formule dans la prose donne un rythme, une sorte d'objectivité. Mais dans les vers, tout devient fragile. Une autre répétition apparaît, différente, plus hésitante, comme si la poésie elle-même cherchait un chemin dans le chaos.
En lisant « Caraïbe », je suis tombé sur un poème qui m’a arrêté. Quelques mots suffisent pour qu’une voix me revienne en mémoire. Celle de Pierre Brisson. Le poème commence ainsi :
« Qui donc ira jeter des fleurs
au Pont Rouge
à Vertières
au Champ de Mars
Les offrandes coulées dans la honte blessent. »
Ces mots, je ne pouvais les lire sans entendre sa voix. Grave, posée, comme une promesse tenue. Une voix qui savait porter les poèmes jusqu’à ce qu’ils deviennent une part de nous-mêmes. Une voix qui ne trahissait rien, ni la douleur, ni l’espoir. Brisson disait les poèmes comme on marche sur une terre brûlée : avec respect, avec la conscience que chaque mot pèse. Je lis ce poème et, presque malgré moi, d’autres reviennent. Margha, Marabout de mon cœur, et tant d’autres. Ces poèmes que nous avons aimés, que nous avons écoutés ensemble à travers les deux volumes intitulés « À voix basse ». Pierre Brisson, le diseur, leur avait donné une vie nouvelle.
Si aujourd’hui je peux lire un recueil comme « Caraïbe » de René Philoctète, il faut dire que tout a commencé par une voix. La voix de Pierre Brisson. Brisson a été celui qui, pour moi, a dit presque tous les grands poètes du XXᵉ siècle. Il ne lisait pas : il habitait les mots. Il les portait avec une gravité qui forçait le silence, une douceur qui laissait entendre l’écho de ce qu’il ne disait pas. Brisson n’était pas seulement une voix. Il était une mémoire vivante, un passeur. À travers lui, ces textes, ces poèmes, devenaient des ponts, des chemins vers quelque chose de plus grand. Aujourd’hui, sa voix s’est tue, mais elle reste là, dans nos cœurs. Et quand je lis un poème, je l’entends encore, comme une rumeur fidèle.
Revenons au recueil. Ce n’est pas un livre facile. Ce n’est pas un livre que l’on referme sans y revenir. Il pousse à regarder en face ce que l’on préfère souvent fuir : l’histoire, la souffrance, et l’espoir qui survit malgré tout. C’est une œuvre qui, comme les îles qu’elle chante, porte à la fois la lumière et l’ombre. Et c’est pour cela qu’elle mérite d’être lue.
Évens Dossous