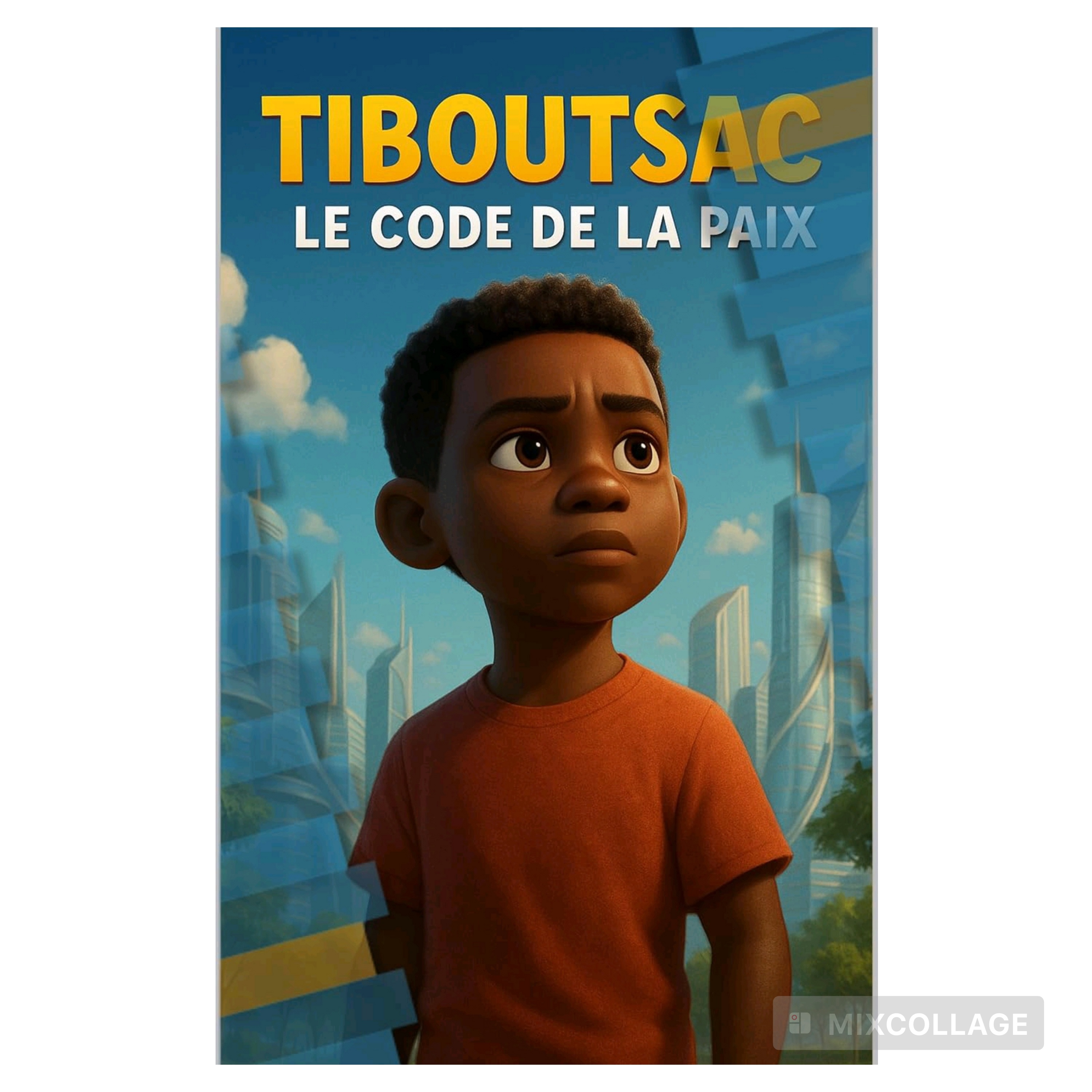Il est des spectacles qui ne se contentent pas de représenter une situation dramatique, mais qui opèrent une véritable chirurgie émotionnelle. Vwa Moun, adaptation créole par Guy Régis Jr du monologue de Jean Cocteau, en est un exemple magistral. Portée par une Stéphanie Saint-Louis habitée, vulnérable, traversée d’éclats et de ruptures, la pièce prend la forme d’une descente lente, méthodique, vers la noyade de la voix. Ce spectacle, joué le 26 novembre dans le cadre de la 22e édition du Festival Quatre Chemins, au Patio Sœur Marie-Paule à Delmas 75, ancienne locale du centre Pen, ne raconte pas seulement une rupture amoureuse : il expose le vertige d’une parole qui se consume, l’effritement d’un être qui se raccroche à un fil, au propre comme au figuré.
La mise en scène déploie une géographie du vacillement. Dans la tradition de La Voix humaine, le décor est minimal, presque ascétique, mais Guy Régis Jr en fait un espace dynamique, traversé par la trajectoire de la chute. La pièce commence à l’étage, dans un espace presque trop clair, trop vaste, que la comédienne occupe comme un corps encore entier. Elle porte une robe blanche, couleur de fragilité mais aussi de passage, et c’est bien de passage qu’il s’agit : passage d’un état à l’autre, d’un monde à l’autre, d’une femme debout à une femme brisée. Elle parait ensuite sur le balcon, espace de suspension entre le dedans et le dehors, entre le privé et le regard social. Là, sa voix perd déjà de sa solidité. Les phrases deviennent plus courtes, le souffle plus incertain. Enfin, elle rejoint la terrasse, dernier territoire, celui du dépouillement total. Au centre, une simple table. Dessus : un téléphone à fil. Le fil devient métaphore : lien trompeur, corde d’attache, instrument de mort symbolique. Cette circulation verticale construit un arc narratif silencieux : plus elle descend, plus elle s’effondre.
Adapter Cocteau en créole n’est pas une simple traduction ; c’est une transposition sensible, un déplacement du centre de gravité émotionnel du texte. Le créole, langue du souffle, du rythme, du tremblement, donne aux phrases une densité presque organique. Là où le texte français de Cocteau cultive la politesse, les hésitations, les failles délicates, la version créole offre une parole plus directe, plus dénudée, plus dangereuse. La phrase : « Nou tande men nou youn pa ka tande lòt. » résume parfaitement la tragédie majeure du texte : la communication est une illusion, l’écoute une fiction. Dans la bouche de Saint-Louis, le créole devient matière brûlante, fragmentée, mouvante. Les mots trébuchent, se heurtent, s’arrachent. Ce n’est plus la langue d’une femme abandonnée : c’est la langue d’une femme en train de perdre prise sur elle-même.
Dans La Voix humaine, le téléphone est le partenaire invisible, tout-puissant. Ici, sous la direction de Guy Régis Jr, il devient un instrument létal. Son immobilité en fait un objet rituel, presque sacré. Il n’est plus seulement un moyen de communication : c’est le miroir noir dans lequel la femme se contemple en train de disparaître. Chaque coupure de ligne est une coupure du corps. Chaque interférence est une blessure. Cocteau voulait montrer une femme qui « s’accroche à un fil ». Régis Jr pousse cette métaphore jusqu’au vertige : il transforme ce fil en corde adressée au public, qui devient témoin non pas de la rupture, mais du suicide symbolique d’une voix.
L’un des apports majeurs de cette mise en scène réside dans la manière dont elle orchestre les silences. Le silence, chez Cocteau, est une respiration. Chez Régis Jr, il devient une violence. Entre deux phrases, il installe des abîmes. Par moments, trois secondes deviennent un gouffre. La comédienne, immobile, le téléphone dans une main, la cigarette dans l’autre, fait sentir que ce qui ne se dit pas tue plus que ce qui se dit. Ces silences ne sont pas des pauses : ce sont des vérités. Ils comblent ce que l’homme n’entend pas, ce que la femme ne peut plus dire, ce que le public comprend malgré lui.
Son interprétation est une étude clinique de la fragilité. Au début, elle sourit. Elle espère. Elle s’accroche. Puis sa voix se casse. Ses gestes deviennent mécaniques. Son souffle raccourcit. On la voit littéralement se décomposer, comme si chaque phrase l’emportait un peu plus loin de son propre corps. L’une des grandes forces de son jeu réside dans cette capacité à ne pas surjouer la douleur, mais à la laisser apparaître par infiltration. Sa tristesse progresse comme une maladie lente. Lorsqu’elle prononce les dernières phrases, elle n’est plus seulement un personnage : elle est un corps vidé, traversé par les mots d’un autre, par une absence qui la dévore. Cette performance donne chair à une idée chère à Cocteau :
« La tragédie, c’est quand la voix survit au corps. »
La mise en scène de Régis Jr n’explique rien, n’ajoute rien, ne comble aucun vide.
Elle déshabille. Fidèle à son esthétique minimaliste, il construit un théâtre où chaque élément possède une charge symbolique immense. Le mouvement vertical du spectacle, de l’étage vers le sol, est un geste dramaturgique puissant : la femme descend comme on descend en soi-même, comme on descend dans l’abîme. Régis Jr fait aussi un choix rare : rompre le quatrième mur.
La comédienne regarde parfois le public, comme si chacun devenait un témoin gênant de sa détresse. Ce regard crée un malaise fécond : nous ne sommes plus simples spectateurs, nous sommes responsables de ce qui arrive. Cette stratégie place Vwa Moun dans la lignée des théâtres de la confession (Artaud, Sarah Kane, Koltès), où le spectateur ne peut plus se réfugier dans la distance.
Le moment le plus bouleversant du spectacle est sans doute la fin. Tout se resserre. La voix s’épuise. La cigarette. Le fil du téléphone. Et dans un dernier souffle, presque ingrat, presque silencieux, la femme dit : « Mwen renmen w. » Ce n’est pas une déclaration.
C’est un testament. Une ultime tentative de subsister dans la mémoire de l’autre.
Vwa Moun est bien plus qu’une adaptation de Cocteau : c’est une appropriation créole, une reconquête émotionnelle, une réécriture du désespoir amoureux. Le spectacle offre une plongée d’une intensité rare dans la vulnérabilité humaine et les déchirures de la parole. Par le jeu saisissant de Stéphanie Saint-Louis, d’une précision déchirante, et la direction sobre, frontale, implacable de Guy Régis Jr, cette version renouvelle profondément la signification du monologue. La pièce atteint ce point où le théâtre devient un acte de vérité : rien n’y est décoratif, rien n’y est gratuit. Tout brûle. Et lorsque la voix se tait, ce n’est pas la fin : c’est une brûlure qui continue de parler longtemps dans la mémoire du spectateur.
Saint Pierre John Stanley