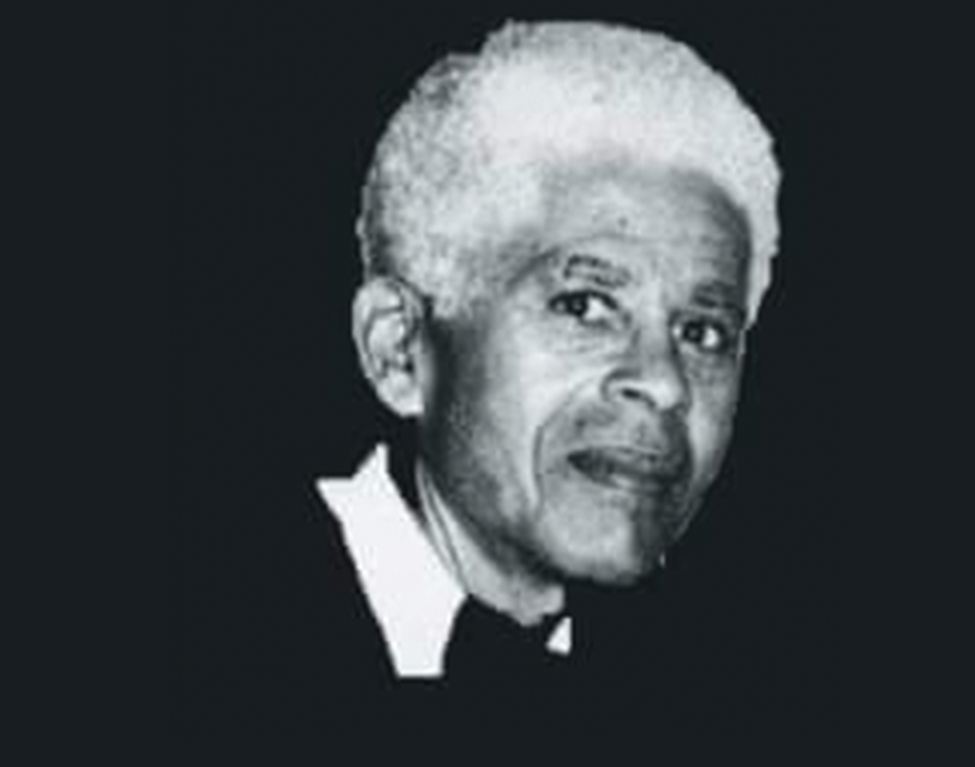C’était au cours de l’année 1983. Nous étions en scolarité des études terminales du secondaire quand nous prîmes connaissance de l’ouvrage de M. Alain Turnier, Avec Mérisier Jeannis : Une tranche de vie jacmélienne et locale. L’ouvrage avait alors paru une année auparavant, en 1982, sous les presses des éditions Le Natal. Dans une conjoncture d’apprentissage marquée par la lecture passionnée des ouvrages de l’historien Roger Gaillard de la série Les blancs débarquent, particulièrement du volume La Guérilla de Batraville 1919-1934 publié la même année[1], nous avons lu, à jets continus, le texte volumineux de l’historien Turnier, à partir des tables de lecture de la Bibliothèque Nationale d’Haïti (BNH) qui venait de connaitre au début des années 1980 une sérieuse réorganisation sous la conduite de la Directrice d’alors, Mme Françoise B. Thybulle. Une lecture fiévreuse, découpant une tranche de vie de notre histoire mettant en scène des personnages hauts en couleur durant la période précédant l’occupation américaine de 1915. Nous avons pris des notes et commenté le texte avec des camarades de promotion pendant les cours de sciences sociales sous la férule de Professeurs de valeur comme Pierre-Marie Victor, Marc-Antoine Brisson, Rémy Zamor et Carltz Docteur. L’historien Alain Turnier nous a quittés en mars 1991, au début d’une période particulièrement troublée et difficile de notre vie de peuple. Entretemps, nous nous sommes familiarisés avec d’autres ouvrages de M. Turnier comme Les Etats-Unis et le marché haïtien publié originellement à Washington en 1955, La société des baïonnettes, un regard nouveau édité dans le même volume que le texte Haïti un cas, de M. Alix Mathon en 1985, et surtout, cette œuvre qui a eu une réception décisive l’année même de sa parution en 1989, Quand la nation demande des comptes. Nous avons là, la fameuse trilogie de l’historien qui devrait être éditée par la Société Haïtienne d’Histoire de Géographie et de Géologie dans un coffret spécial en partenariat avec la Banque de la République d’Haïti (BRH) au cours de l’année 2015. Dans le premier ouvrage, l’auteur montre l’importance du marché haïtien pour les Etats-Unis depuis le gouvernement de Toussaint Louverture jusqu’au milieu du vingtième siècle sur la base d’une documentation sérieuse et intelligemment utilisée. Dans le second ouvrage, il rejette des clichés des écrivains étrangers sur Haïti, notamment certaines affirmations de M. Robert D. Heinl[2] concernant les soi-disant constantes sanglantes de l’histoire haïtienne. Mais il y a plus. Dans cet ouvrage, M. Turnier démontra, avec des arguments solides, que le grand capital étranger ne s’est jamais intéressé à s’implanter de façon sérieuse et durable dans le pays en dépit des garanties offerts par les autorités haïtiennes et des grands avantages comparatifs et naturels disponibles[3]. A méditer en profondeur. Dans le troisième ouvrage, l’accent est mis sur la gestion des administrateurs de la chose publique haïtienne, particulièrement sur les faits de corruption et les mises sous séquestre de biens des responsables suite aux changements de régime politique, avec la possibilité pour que la nation demande des comptes[4]. Un livre qui avait été beaucoup diffusé, ayant connu plusieurs éditions de nos jours pratiquement épuisées.
Mais dans notre carrière d’enseignant, de documentaliste et de chercheur, nous avons appris à connaitre davantage M. Turnier dans ses articles dans la Revue de la Société Haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie[5]. Nous avons toujours pris plaisir à lire ses articles rigoureusement documentés et citant toujours les sources bibliographiques suivant les règles de l’art. Lire M. Alain Turnier est à la fois un plaisir et un acte d’apprentissage. Dans les différents numéros de la Revue de la Société, nous avons appris à apprécier le styliste, l’écrivain soucieux de la construction de ses phrases, simple et discret dans son expression et présentant les faits historiques en s’appuyant sur des documents d’archives et une solide argumentation. Nous avons là toute une méthodologie d’écriture de l’histoire alliant recherche documentaire, honnêteté, éthique, sens de la mesure, recherche de la vérité historique et surtout art d’écrire. Et de nos jours, la somme de ces articles, publiés dans des jours particulièrement difficiles de la Revue et de la vie même de la Société d’Histoire et de Géographie, représente un héritage bibliographique de premier plan pour nos étudiants et nos chercheurs dans les différents domaines des sciences humaines et sociales.
Au cours de l’année 2019, le Prix d’Histoire de la Société haïtienne de Géographie et de Géologie (SHHGG), en partenariat avec la Fondation Roger Gaillard (FORG), a été attribuée, à titre posthume, à l’étude de l’historien Alain Turnier Avec Mérisier Jeannis, une tranche de vie jacmélienne et locale, parue initialement, comme nous l’avons vu, en 1982. Il s’agit bien d’une œuvre connue parmi les familiers de l’histoire tant en Haïti qu’à l’étranger, mais qui n’était plus disponible dans nos librairies et sur les étagères de nombreuses bibliothèques publiques et universitaires du pays. Selon les règlements du concours, le texte primé doit faire l’objet d’une publication aux soins de la Société. Cela demandait un grand travail et surtout de la patience pour cette réalisation. Il fallait revoir tout le texte qui, rappelons-le, est très dense avec le système des citations et des références bibliographiques, établir une édition correcte selon les exigences académiques de base en la matière, rédiger une préface et une postface, transcrire les citations en créole dans la graphie officielle, réaliser une maquette de couverture en redessinant le portrait de Mérisier Jeannis de l’édition originale de 1982, gratifier le lecteur d’une iconographie de qualité avec des photographies d’époque et présenter correctement la bibliographie finale. Enfin, nous avons un index des noms d’auteurs aussi efficace qu’utile pour la consultation. Le tout sur un papier de choix, bien relié avec mors, un excellent travail typographique et une mise en page réalisée par les presses de l’imprimerie Henri Deschamps. L’ouvrage est publié avec le support de la Fondasyon Konesans ak Libète (FOKAL), de la Fondation Unibank, du Journal Le Nouvelliste et de la Maison Henri Deschamps. Un vrai régal à la fois pour les amateurs d’histoire et des beaux livres procurant du plaisir à leur consultation. Car le Livre, dans son abstraction et sa forme concrète la plus achevée de production de l’esprit humain, en plus d’être un support de l’information et de la connaissance, est également un être animé, doté d’une personnalité et d’une intention propre. C’est la fameuse intentio operis (intention de l’œuvre) développée par M. Umberto Eco[6]. Le Livre dialogue d’abord avec les autres livres et ensuite, avec le lecteur, suivant les dispositions d’esprit et l’intention de celui-ci (intentio lectoris) et la démarche intellectuelle de l’auteur (intentio auctoris)[7]. Le Livre est aussi une œuvre d’art, dans sa composition, sa mise en page et sa présentation. Ce, depuis les fameuses enluminures des manuscrits du Moyen-Age jusqu’aux procédés techniques modernes de mise en page en passant par les illustrations et les gravures. Et nous avions eu les célèbres livres d’heures, dont celui du duc de Berry, les incunables, les gravures et dessins de Gustave Doré accompagnant, entre autres, les œuvres de Rabelais et de Cervantès.
Avec cette réédition de l’ouvrage de M. Turnier, nous avons en première de couverture un dessin à l’encre forte de l’artiste de grande renommée Philippe Dodard représentant le personnage central du livre, en l’occurrence M. Mérisier Jeannis lui-même avec en arrière-plan la ville de Jacmel. Dessin réalisé à partir de la première édition de 1982. Nous avons des informations pertinentes présentant l’ouvrage et l’auteur en quatrième de couverture et les mentions d’auteur et de titre tant en première de couverture qu’au dos du livre, avec en plus l’ex-libris du centenaire de la Société Haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie et le colophon. Le tout, conformément aux normes en la matière. Quant à l’établissement de l’édition, réalisé par le Professeur Watson Denis, docteur en Histoire et Secrétaire Général de la Société Haïtienne d’Histoire de Géographie et de Géologie, c’est un travail minutieux au possible avec des notes en bas de page de grande pertinence éclairant des points d’histoire pour le lecteur, des ajouts entre des crochets pour la compréhension de certains ponts du texte, la révision des références bibliographiques et les contrôles d’autorité, la table des illustrations, la reproduction en fac-similé des correspondances, les tableaux de statistique, la bibliographie finale et l’index des noms propres. Un vrai travail de bénédictin dont l’énormité de la tâche apparait du début à la fin du texte. C’est l’occasion pour nous de relever la pertinence des photographies de l’époque mises, en grande partie, à la disposition de l’édition de l’ouvrage par la Bibliothèque Haïtienne des Frères de l’Instruction Chrétienne (BHFIC) et le Centre d’Information et de Diffusion Haïtienne et Caribéenne (CIDIHCA). Ce sont certes des documents historiques, mais qui ont leur propre histoire. Et nous avons admiré la photo du panorama de Jacmel qui nous rappelle l’œuvre d’un grand peintre haïtien originaire de cette fière cité. Nous voulons parler des villes imaginaires de l’artiste Préfète Duffaut. Puis, nous avons les photographies de François Manigat, de Massillon Lauture, de Melcourt Poux, de Mathurin Lys, d’Alcibiade Pommayrac, du leader libéral Boyer Bazelais, du Président Salomon et de son épouse, du Président Florvil Hyppolite, de Rovigo Barjon (p. 267), du général Numa Rabel, de Normil Chicoye, d’Alcius Charmant, personnage particulièrement remuant et agité, du Marché en fer de Jacmel, de l’incendie de la ville en 1896 (p.356), de la maisons de Selden Rodman, journaliste et écrivain américain, de la maison de la famille Boucard (p.357), des photographies du journaliste Rodolphe Alexandre[8], de Charles Moravia, du général Philippe Argant, du Président Tirésias Simon Sam (p.361), du général Mérisier Jeannis, du Président Antoine Simon, du Président Boisrond Canal[9], de l’écrivain, penseur et homme politique Anténor Firmin[10], des Présidents Tancrède Auguste et Michel Domingue, du Président Lysius Félicité Salomon entouré des membres de son cabinet et du corps diplomatique, du général Sextus Berrouët[11] et du fameux journaliste de l’époque, Pierre Fréderique.
Dans sa préface, le Professeur Denis nous donne les précisions suivantes : « c’est un ouvrage de référence sur le cycle terminal du long XIXe siècle haïtien (1804-1915). L’auteur a campé un personnage politique, sorti de la matrice des gens du peuple et qui est parvenu à se tailler une place de choix, en intégrant l’Armée, dans les circuits politiques de son époque. Mérisier arriva à s’imposer par la force des armes dans la ville opulente de Jacmel et à causer des frayeurs dans les salons des bien-pensants de Port-au-Prince. Il devint un homme politique émergeant jusqu’à rêver de présider aux destinées du peuple haïtien ». L’on peut bien concevoir que la relation des actes d’un tel personnage au sein du jeu mouvant de la politique régionale et nationale de l’époque offre de précieux éclairages sur maints aspects de notre histoire et constitue et jette certains éclairages sur maints évènements de la seconde moitié du XIXe et du début du XXe siècle.
L’ouvrage comporte en tout dix-sept chapitres divisés en sections décrivant les différentes étapes et remous de cette carrière politique agitée au cours d’une conjoncture historique elle-même mouvementée depuis les luttes du Président Sylvain Salnave contre ses adversaires, les débuts de la présidence de Lysius-Félicité Salomon Jeune en 1879 jusqu’à la gouvernance du Président Pierre-Nord Alexis en passant par les actions de Florvil Hyppolite au pouvoir (1889-1896) et la période tumultueuse de fin de mandat du Président Tirésias Simon Sam en 1902 ayant conduit à « l’option dramatique de la guerre civile » selon l’expression de l’historien Roger Gaillard. Et nous avons « l’émergence de Mérisier Jeannis » dans le cadre de la répression de l’insurrection libérale de 1883, d’un véritable carnage des jeunes jacméliens opéré par le concerné dans le quartier dit de « derrière la Loge Maçonnique » de Jacmel, le 3 août 1883[12]. Bref, nous avons, dans l’ensemble, une grande fresque historique à la dimension des talents de narrateur de l’auteur. Selon les propres mots de M. Alain Turnier, « L’histoire de Mérisier Jeannis est simplement celle d’un paysan analphabète qui, habité par une ambition explosive et sans mesure, s’énervait dans la tranquillité monotone des champs, décidé à affronter n’importe quel péril pour s’évader de la geôle de la vie rurale irrémédiablement tissée de privations, de sacrifices et d’humiliations ». Et nous suivons la relation de l’ascension vertigineuse de ce personnage emblématique qui, des confins de l’environnement rural de la Plaine de Lafond, parvint à s’imposer, par la force des choses et de son ambition, à la bourgeoisie florissante et cultivée de Jacmel pour s’affirmer, ensuite, comme acteur déterminant dans les luttes pour le pouvoir suprême au niveau national[13]. L’ouvrage débute par une peinture réaliste au possible de la condition paysanne avec le crucial problème de l’accès à la terre et des dispositions des différents Codes ruraux visant à rétablir le régime des plantations et attacher les paysans à la terre en vue de produire des denrées d’exportations. Ce à quoi répondaient les masses paysannes par des mouvements de revendications dont celui de Jean-Jacques Acaau. Ensuite, nous retrouvons la participation de la ville de Jacmel à l’insurrection libérale de 1883 et de la répression féroce qui s’en était suivie sous la férule du Général François Saint-Surin Manigat exécutant les ordres du Président Salomon. Nous suivons les manœuvres de Boisrond Canal, ce grand stratège de la politique haïtienne du XIXe siècle selon le Dr. Jean-Price Mars, manœuvres qui, suite à la chute du Président Salomon devant conduire, dans la capitale haïtienne, aux affrontements, entre les candidats François Denis Légitime et Séide Thélémaque. Ce dernier allait perdre la vie au cours de ces affrontements tandis que le premier accéda au pouvoir en vertu des élections traditionnelles au second degré alors en vigueur en Haïti, processus alors contrôlé par l’omniprésent Boisrond Canal. Ces élections furent alors rejetées par les protagonistes du Nord qui, en levant la bannière de la Révolution, sous la conduite du Général Florvil Hyppolite, allaient investir la capitale haïtienne pour installer leur candidat au pouvoir. Dans le cadre des rapports équivoques entre le Président Hyppolite et Mérisier Jeannis, ce dernier prit les armes contre le premier. Et l’on connait la suite. En dépit des conseils répétés de son ami et médecin personnel, le Dr. Léon Audain, le Président Florvil Hyppolite décida de prendre la route de Jacmel pour aller « mater » lui-même la rébellion dans le sillage de ce qu’il avait fait à Port-au-Prince le jour de la Fête-Dieu, le 28 mai 1891[14]. Selon M. Alain Turnier, Hyppolite « avait décidé de se rendre à cheval à Jacmel pour, selon sa propre expression, « chasser ce hardi de Mérisier, lui arracher sa tignasse et ensuite le faire fusiller pour lui apprendre à vivre »[15]. Mais, c’était sans compter avec les lois de la science médicale. Arrivé au Portail Léogane, le Président Hyppolite tomba de son cheval, emporté par une crise cardiaque. Et le leader Mérisier Jeannis entra triomphalement à Jacmel « à la tête d’une imposante colonne de «rasoirs», [sa base armée], pour recevoir les honneurs militaires devant le poste du commandant de l’arrondissement ». Le nouveau pouvoir dirigé par le Président Tirésias Simon Sam nomma le leader paysan comme Délégué extraordinaire. Et ce fut l’euphorie générale parmi ses partisans. Alors, selon l’historien Alain Turnier, « Dans la plaine de Lafond, durant des nuits entières baignées de tafia, le tambour éclata en strophes éloquentes et triomphales. Le paysan, pendant quelques jours, ignora sa houe et sa serpette comme si son destin avait pris un brusque virage. Dans le Houmfort de Mérisier, paré de ses plus vifs atours, la gratitude familiale s’éleva vers les divinités supérieures en touchantes invocations ». Dans une conjoncture de prospérité économique à cause des activités du port ouvert de Jacmel et de la culture florissante du café, Mérisier Jeannis présida avec prudence et modération aux destinées de la ville comme Délégué extraordinaire du Président Sam, dans la ligne de détente de ce gouvernement. Dans ce contexte de prospérité économique et de détente, la ville de Jacmel allait connaitre son électrification avant toutes les autres villes du pays. Il en est de même de l’érection du marché en fer, de l’installation du réseau téléphonique, du fonctionnement du service postal, d’une bibliothèque municipale et d’un journal local livrable par abonnement. Tout cela, avec une bourgeoisie d’affaires très impliquée dans vie de la communauté et soucieuse de son avancement. Et M. Turnier de préciser : « Tel était le patrimoine magnifique confié au bon sens, à la sagesse du pauvre paysan de Lafond et dont, à juste titre, il s’enorgueillissait à son tour»[16]. Bref, « un chef tolérant »[17] ayant connu son apothéose au cours de l’année 1898 avec le séjour de plusieurs jours à Jacmel du Président dominicain Ulises Heureaux. Cependant, les difficultés et malheurs ne vont pas tarder à se manifester. D’abord, il y eut ce terrible incendie du samedi 19 septembre 1896 qui, parti du quartier résidentiel du Bel-Air, ravagea pratiquement toute la ville de Jacmel (pages 317 à 319). D’après M. Turnier, « la ville ne fut qu’un monceau de cendres et […] l’effort de près d’un siècle était anéanti »[18]. En un mot, ce fut le début de la grande descente. Car « deux semaines après le désastre, le feu éclata à nouveau à Jacmel, détruisant 19 maisons des faubourgs »[19]. A cela s’ajoutaient les retombées d’une crise financière aigue suite au déficit commercial du budget national et la chute des prix du café au niveau international. Mais la crise économique était d’abord internationale. De nombreuses maisons commerciales allemandes qui achetaient le café des mains du producteur paysan haïtien par le biais des spéculateurs en denrées se retrouvaient même en situation de faillite. Une réaction en chaine se produisit. Selon M. Turnier, « le marasme s’aggravait dans un cercle vicieux. On craignait même un arrêt des importations et ainsi une crise de l’alimentation. Seule l’Armée était payée plus ou moins régulièrement. Les fonctionnaires publics et le clergé n’avaient reçu aucune allocation depuis onze mois ». Dans cette conjoncture de crise économique, « de nombreux paysans laissaient leurs sections rurales pour se soustraire aux poursuites de leurs créanciers, les spéculateurs en denrées, et se rendre à Port-au-Prince dans l’espoir de travailler comme portefaix. Les commerçants de la ville ne pouvaient pas davantage honorer leurs obligations »[20]. Cette crise allait coïncider au départ du Président Tirésias du pouvoir en mai 1902 et engendrer de grands tumultes sur le plan politique. Encore une fois, « les crises de succession » allaient peser lourd sur les destinées de la nation. Alors, M. Mérisier Jeannis, fort de ses succès sur le plan régional, ambitionnait tout simplement la présidence du pays. Ambition démesurée, dirait-on aujourd’hui. Mais, c’était alors chose courante dans cette « société des baïonnettes » que nous peignait l’auteur dans un autre ouvrage. D’ailleurs, l’exemple d’un autre leader paysan du Sud, M. Antoine Simon, qui avait eu presque le même parcours que M. Mérisier Jeannis, avec une carrière allant du poste de chef de section rurale jusqu’à celui de la présidence, devrait lui donner raison. Mais, les carrières politiques sont généralement fragiles, surtout en Haïti et suivent, souventes fois, la trajectoire d’une courbe mathématique. Les statisticiens parlent de la loi de distribution normale, en forme de cloche. Après les tâtonnements, la grande montée vertigineuse, il y a la descente et parfois, la grande descente. M. Mérisier Jeannis n’échappe pas à la règle. La bourgeoisie jacmélienne n’avait pas oublié le massacre de ses fils dans le carnage de « derrière la Loge maçonnique ». Et nous avons, des pages 379 à 412, « la fin dramatique de carrière » du leader rappelant le Crépuscule des dieux fermant l’œuvre de Richard Wagner. Et enfin, nous avons cet épilogue avec de profondes réflexions de M. Turnier lui-même[21] et la postface du Professeur Pierre Buteau analysant entre autres « la méthode » de l’auteur qui reste toujours, en dépit des formulations de titre, « l’historien des grands ensembles ». Ce que nous laissons au lecteur le soin d’apprécier…et de méditer.
Après cette relecture de l’ouvrage de M. Turnier, nous avons nos propres méditations et réflexions. Dès le début, l’auteur a esquissé la condition paysanne en proie à l’analphabétisme, à l’arbitraire des potentats militaires locaux, dépourvus des services sociaux de base et obligés d’utiliser tantôt la ruse tantôt la force et parfois les deux pour survivre. Pour nous, c’est la matrice de la question sociale haïtienne et, ces dernières décennies, cette question, par la suite, s’est élargie aux ouvriers, aux classes moyennes et même à certains secteurs de la petite bourgeoisie libérale et des moyens entrepreneurs. Le constat est navrant. Il n’y a jamais eu de politiques sociales, de réformes économiques sérieuses en Haïti à même d’intégrer les différentes composantes issues de la grande geste de 1804 contre le colonialisme, l’esclavagisme et le racisme. Le Professeur Watson Denis, dans la préface de l’ouvrage, note avec raison : « Oui, à cette époque, il existait un problème structurel, une question sociale de fond : comment gérer les exclus de la république ? C’est la grande question qui se posait au XIXe siècle, au XXe, et qui est encore d’actualité au XXIe. Cette question n’a jamais trouvé de réponse satisfaisante »[22]. Le Dr. Watson Denis souligne que face aux graves problèmes sociaux, face à « une fracture sociale béante, l’élite du pouvoir haïtien répond le plus souvent par une sorte de « continuité conservatrice ». […] Au cours des ans et malgré les revers et menaces grandissantes de l’effondrement de l’Etat, les autorités haïtiennes n’ont pas changé d’attitude, ni de comportement, ni adopté une nouvelle vision des choses »[23]. Pourtant, la conjoncture même que nous sommes en train de vivre devrait appeler à des redressements urgents. Mais, la lecture de l’ouvrage de M. Turnier montre assez comment les potentats locaux en Haïti faisaient peu de cas de la vie humaine et régnaient sans partage sur les communautés urbaines et rurales du pays. Une peinture d’arbitraire, de prise d’armes et des représailles mettant en cause tantôt des généraux tout-puissants, tantôt des « rasoirs ». Des pratiques qui ne sont pas révolues et que l’on retrouve encore, sous des formes différentes certes, dans les mœurs politiques haïtiennes d’aujourd’hui. Ce qui en appelle nécessairement à des redressements, avec une résolution pour les acteurs politiques haïtiens, de se décider, enfin, à être rationnels, « à faire la politique autrement », bref « à changer le cours de l’histoire »[24]. Car, les leçons de l’Histoire existent depuis Hérodote et Thucydide. Et il existe également des communautés humaines qui, dans des contextes extrêmement difficiles, ont compris ces leçons de l’Histoire et adopté des dispositions énergiques consistant en des stratégies de rupture et des programmes d’action pour assurer la survie et la permanence de leurs membres. Nous ne voulons pas citer des exemples de pays ayant connu de conjonctures historiques tragiques et qui ont fini par se relever de façon déterminante. L’Histoire, comme toutes les sciences humaines, possède ses leçons et enseignements. Que les acteurs politiques haïtiens lisent et relisent l’histoire d’Haïti et celles des autres peuples pour en retenir des leçons, et dégager du même coup des stratégies de rupture et un programme minimal d’action. C’est notre vœu le plus entier et le plus sincère.
Depuis plusieurs décennies les travaux des lauréats aux divers concours de la Société Haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie (SHHGG) qui travaille de nos jours en partenariat avec la Fondation Roger Gaillard, sont appelés à occuper une place de choix dans l’historiographie haïtienne. Sous ce rapport, l’on peut penser aux travaux de Marc Péan[25] Mme Suzy Castor en 1987[26], de M. Michel Hector[27] au cours de la même année, de M. Charles Tardieu-Dehoux[28] en 1989, de M. Jean-Alix René en 2017[29]. La réédition de l’ouvrage de l’historien Alain Turnier fait partie d’un ensemble d’initiatives et d’activités culturelles et académiques rentrant dans le cadre du centième anniversaire de fondation de cette illustre société savante. En effet, selon MM. Joseph Guerdy Lissade et Gaétan Mentor, « C’est le 8 décembre 1923, à l’initiative du Dr Ricot Brun, que des intellectuels, des hommes de lettres et des professeurs haïtiens de différents horizons, se réunissent à Port-au-Prince, au lycée Pétion, et forment la Société d’histoire et de géographie haïtienne. Le motif à l’appui de l’initiative vise «à faire mieux connaître aux Haïtiens eux-mêmes leur pays et son histoire… » Parmi les signataires des premiers statuts se distinguent : Sémexant Rouzier, Dantès Bellegarde, Horace Pauléus Sannon, François Denis Légitime, Jacques Catts Pressoir, Sténio Vincent, Justin Chrisostôme Dorsainvil, Placide David, Jean-Price Mars, Ulrick Duvivier, Alfred Nemours, Abel Nicolas Léger, pour ne citer que ceux-là »[30]. Bref, le fleuron de l’intelligentsia haïtienne de l’époque fortement affectée par « le choc » de l’occupation américaine de 1915. Dans des circonstances extrêmement difficiles, cette société savante a pu tenir et publier régulièrement sa revue. Celle-ci est aujourd’hui centenaire et représente, selon l’historien Jacques de Cauna, « la doyenne de toute la zone de la Caraïbe »[31]. Pendant plus de dix années, soit de 1981 jusqu’à son décès survenu en 1991, M. Alain Turnier avait assuré la présidence de cette noble entité. Une présidence, selon M. Gaétan Mentor, caractérisée par «la consolidation de la Société »[32] avec notamment l’adoption des règlements pour le prix de la Société. A la fin de l’année dernière, l’un des ouvrages de base de M. Turnier, Avec Mérisier Jeannis, une tranche de vie jacmélienne et locale vient d’être réédité avec toute une nouvelle conception. Nous recommandons vivement l’acquisition de ce volume par les chercheurs, les professionnels, professeurs et étudiants dans le domaine des sciences humaines et sociales et surtout par tout citoyen haïtien désireux de connaitre des aspects déterminants de notre histoire. Ils y trouveront matière pour leurs recherches, études et réflexions. Mais, nous voudrions aller plus loin. Nous recommandons sa lecture, sa relecture et sa consultation permanente sur des points d’histoire nationale et locale que M. Turnier a su éclaircir par sa sagacité et sa solide documentation puisée aux Archives Nationales d’Haïti (ANH), aux Archives du Département d’Etat des Etats-Unis, du Quai d’Orsay en France, dans les journaux de l’époque, dans les papiers du Président François Denis Légitime, les collections de la Bibliothèque haïtienne des Frères de l’Instruction Chrétienne (BHFIC), dans des collections de familles jacméliennes, dans les Annales des Frères de l’Instruction Chrétienne de Jacmel, dans les collections de M. Roger Gaillard, de M. Jean Fouchard et M. Edmond Mangonès[33]. Une œuvre à lire, ou encore, à relire et surtout, à méditer. L’ouvrage est maintenant disponible dans les librairies de la place et fera l’objet d’une vente spéciale au cours de la prochaine édition de Livres en Folie.
Nous voudrions, pour notre part, conclure cet article avec des propos pertinents tirés de la postface de l’ouvrage, elle-même rédigée par le Professeur Pierre Buteau, Président de la Société Haïtienne d’Histoire de Géographie et de Géologie : « Sans glisser dans l’outrance de l’anecdotique, Turnier réussit, avec une rare maitrise, à nous restituer ce passé lointain qui peut sans doute nous aider à mieux comprendre les soudaines mutations survenues dans le monde urbain haïtien d’aujourd’hui. Livre d’un grand intérêt et qui invite à la méditation, tant il y a de leçons à tirer. Merci à toi, cher Alain ».
Jérôme Paul Eddy Lacoste, Documentaliste,
Responsable académique de la Faculté des Sciences Humaines
Juillet 2024, babuzi2001@yahoo.fr
NOTES
[1] Les activités de vente signature des ouvrages de l’historien Roger Gaillard faisaient, à l’époque, salle comble à l’Institut Français d’Haïti (IFH) se trouvant alors dans la Cité de l’Exposition du Bicentenaire. En juillet 1984, lors de la vente signature du premier volume de la série de la République exterminatrice nous nous rappelons que le stock des ouvrages disponibles pour la vente signature était déjà épuisé au début des activités. Les organisateurs ont alors envoyé chercher un supplément de stock à l'Imprimerie Le Natal de M. Robert Malval situé dans la zone de l'Aéroport. Et le public a attendu patiemment, pendant près d'une heure, pour pouvoir retirer son exemplaire de l'ouvrage avec, bien entendu, la signature de l’historien Gaillard…Réminiscences d'un certain Port-au-Prince que les jeunes d’aujourd’hui n’ont point connu… Tempus fugit et rerum edax. (Le temps fuit et emporte toute chose).
2Robert Debs Heinl est un officier supérieur de l’armée américaine envoyé en Haïti en mission de coopération par l’administration du Président américaine auprès du Président François Duvalier pour le renforcement des Forces Armées d’Haïti. Il s’est brouillé avec Duvalier et retourné au Etats-Unis où il a publié, de concert avec son épouse Nancy Heinl, au cours de l’année 1978, un ouvrage sur l’histoire d’Haïti intitulé Written in blood : The Story of the Haitian People 1492-1971. Maintes affirmations de M. Heinl ne sont pas acceptées ou sont tout simplement rejetées par des historiens haïtiens, particulièrement par M. Roger Gaillard.
3C’est également notre opinion personnelle. Pour nous, le grand capital international avait laissé définitivement le pays depuis les suites de l’affaire Galbaud en mars 1793. Il n’y est jamais revenu, en dépit de timides tentatives conjoncturelles, rapidement interrompues d’ailleurs. Il s’agit, selon nous, d’une variable importante pour la compréhension de la crise actuelle. Au moment où nous écrivons ces lignes, la City Bank vient de fermer officiellement ses opérations en Haïti. Pourquoi le grand capital international, les Etats-Unis en tête, en dépit de tous les grands avantages comparatifs, n’a jamais sérieusement investi en Haïti ? Ce serait, à notre avis, une bonne question de recherche.
4 Un titre qui nous rappelle la fameuse conclusion du discours d’investiture du Président Léon-Dumarsais Estimé le 16 août 1946, et que notre chère tante, l’institutrice Léticia Lacoste de la Petite Rivière de l’Artibonite, savait pratiquement par cœur : «Si, bergers du troupeau, nous nous en constituons les loups; si, gardiens de la maison, nous nous faisons les voleurs qui la brisent et la pillent; si, rebelles au meilleur de nous-mêmes, nous manquons à nos engagements solennels, alors il sera temps d’entrer en jugement avec nous et de nous demander des comptes ».
5 Dans la Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie (SHHG), l’historien Alain Turnier avait maintenu, pendant de nombreuses années, une rubrique intitulée « Vieux carnets d’un vieux chercheur ». Dans le cadre de cette rubrique, M. Turnier avait publié des articles remarquables comme : « Pétion-Ville Capitale d’Haïti » en Septembre 1982, « A la recherche du trésor de Toussaint Louverture » en décembre 1983, « Le duel dans la société haïtienne 1902-1915 » en juin 1985, « l’exécution de de Rodolphe Alexandre à Jacmel, son impact national » en septembre 1986. En Octobre 1978, il avait publié dans la revue de la Société une étude intitulée « La mission Chanlatte : Boyer a-t-il réclamé paiement de l’aide fournie par Pétion à Bolivar ?».
6Umberto Eco (1992). Los límites de la interpretación. Editorial Lumen. Barcelona. Pp. 39-40. Cet ouvrage de M. Umberto Eco représente une référence de base pour l’acte de lecture et de la démarche interprétative des textes des auteurs. Dans cet ouvrage, l’auteur a établi la distinction fondamentale entre « utiliser » et « interpréter » un texte. La première démarche relève essentiellement de l’intention du lecteur (intentio lectoris), tandis que la seconde démarche implique des « restrictions », des « contrôles d’autorité » pour parler le langage des bibliothécaires. Ainsi, si les possibilités d’interprétation d’un texte peuvent être multiples, voire infinies, il y a cependant, d’après Umberto Eco, «des interprétations qui sont totalement inacceptables ». Pour cela même, il y a, « les limites de l’interprétation ».
7Ibid.
8 Le journaliste Rodolphe Alexandre a été exécuté de façon tragique pour ses dénonciations de la contrebande et de la corruption. Le récit poignant de cette exécution a été présenté en septembre 1986 dans la Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie par l’historien Alain Turnier sous le titre : «l’exécution de de Rodolphe Alexandre à Jacmel, son impact national », sous la rubrique « Vieux carnets d’un vieux chercheur ». Dans l’ouvrage Avec Mérisier Jeannis, M. Alain Turnier revint sur cette exécution à la page 312.
9 Boisrond Canal représente, selon M. Alain Turnier (2022). , « Le politicien peut-être le plus astucieux de l’époque ». Avec Mérisier Jeannis. Une tranche de vie jacmélienne et nationale. Ed. Société Haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie. Port-au-Prince, p.182.
10 Pour l’historien Alain Turnier, M. Anténor Firmin représente « le plus éclatant fleuron de la haute culture haïtienne » (page 411). Pour le Professeur Watson Denis, en préface de l’ouvrage cité, page 23, « le firminisme [représentait] le seul mouvement politique qui aurait pu opérer, au début du XXème siècle, des changements véritables dans le pays ». Dans les annexes de l’ouvrage de l’historien Roger Gaillard (1993). La République exterminatrice. 4, La Guerre civile, une option dramatique, 15 juillet-31 décembre 1902, Imprimerie Le Natal, Port-au-Prince, le Dr. Pradel Pompilus, pour sa part, est net et clair : avec Firmin au pouvoir et son programme en application, Haïti aurait pu éviter le désastre de l’Occupation américaine de 1915. Le Dr. Pompilus reconnait toutefois que l’Histoire ne s’écrit pas avec des « si ». Nous estimons pour notre part que le mouvement de M. Firmin constituait une opportunité manquée pour aborder de façon rationnelle les problèmes se rapportant à la gestion du pays et la modernisation de l’Etat. D’autres opportunités seront ratées encore par la suite et les tares que dénonçaient M. Anténor Firmin demeurent, plus de cent ans après sa disparition, d’actualité. Sur les luttes de M. Anténor Firmin pour accéder au pouvoir suprême avec une volonté de rationalisation et de modernisation des pratiques de gestion de la chose publique, il y a certes la biographie du personnage par le docteur Jean-Price Mars (1978). Joseph Anténor Firmin. Imprimerie du séminaire adventiste, Port-au-Prince. Mais il y a deux ouvrages assez pertinents. Nous voulons mentionner le texte de Marc Péan (1986). L’échec du firminisme. Editions Henri Deschamps, Port-au-Prince. Ensuite, nous avons l’ouvrage de Roger Gaillard (1992). La République exterminatrice. La déroute de l’intelligence. Imprimerie le Natal, Port-au-Prince.
11 Le général Sextus Berrouët avait joué un rôle déterminant dans l’exécution de M. Mérisier Jeannis le dimanche 26 janvier 1908 et conduit en personne une féroce répression de la colonne des « rasoirs » de la plaine Lafond qui étaient les partisans farouches de M. Mérisier Jeannis.
12Alain Turnier, Op. Cit., Page 81.
13 En effet, pour M. Alain Turnier, Op. Cit., p. 364, « Ainsi, Mérisier figurait également parmi les personnalités les plus éminentes de la politique. Il avait acquis une stature « présidentiable » et la nation observait l’étoile nouvelle ».
[1] Sur cette journée terrible au cours duquel le Président Florvil Hyppolite dirigea personnellement la répression dans les rues de Port-au-Prince, nous recommandons vivement la lecture ou la relecture du chapitre intitulé « une Fête-Dieu pas comme les autres » de l’ouvrage La république exterminatrice : une modernisation manquée 1880-1896 de l’historien Roger Gaillard paru en 1984 aux Editions Le Natal, Port-au-Prince. Dans son ouvrage Avec Mérisier Jeannis. Une tranche de vie Jacmélienne et locale, l’historien Alain Turnier traite de ce tragique évènement du 28 mai 1891 et de ses implications pour la ville de Jacmel aux pages 258 à 259.
14 Alain Turnier, Op. Cit., p. 295.
15 Alain Turnier, Op. Cit., p .317.
16Alain Turnier, Op. Cit., p. 331.
17Alain Turnier Op. Cit., pp.318-319
18 Ibid.
19Alain Turnier Op. Cit., pp.342-343.
20 M. Turnier, Op. Cit., p. 431, revint encore, à la fin de l’ouvrage, sur la question paysanne haïtienne en laissant cette fois parler son cœur : « Sa riche et fulgurante trajectoire [celle de Mérisier Jeannis], néanmoins, dessine un immense point d’interrogation. Son équipée demeure significative. Elle est une rébellion contre un ordre de chose séculaire : l’exploitation, le déséquilibre social. De même que l’écart s’accentue entre les niveaux de vie des pays avancés et ceux du tiers monde, il n’échapperait pas à l’observateur le moins attentif qu’en Haïti le fossé continue de s’élargir entre la ville et la campagne. Sous l’effet de l’érosion, de l’explosion démographique, par suite de l’émiettement provoqué par le partage successoral en l’absence d’un seuil légalement incompressible de la pauvreté rurale, les moyens de production du paysan se rapetissent de plus en plus, invitant à l’exode massif vers les centres urbains ou l’extérieur. Si la ville devait rester indifférente à ce processus de dégradation, un temps viendrait ou, à la faveur de l’alphabétisation, de l’extension des médias, les masses rurales ayant acquis une conscience aiguë de leur dénuement, se lèveront sous la conduite d’un chef instruit et fanatisé pour exiger avec usure ce qui leur est dû, au dépens de la ville dans son ensemble, responsable, du haut au bas de l’échelle sociale de l’exploitation paysanne, dans un authentique conflit de classes opposant des opprimés et des oppresseurs, en dehors des conditions fragiles de couleur ». Et l’auteur parle de la forte possibilité pour qu’il y ait des « Merisier Jeannis de demain ». Il est à noter seulement que M. Turnier écrivait ces phrases prémonitoires au cours de l’année 1982.
21Alain Turnier Op. Cit., p. 29.
22Ibid.
23Voir sous ce rapport l’ouvrage significatif de Watson Denis (2016). Haïti : changer le cours de l’histoire. C3 Editions, Port-au-Prince.
24Marc Péan (1986). L’échec du firminisme. Editions Henri Deschamps, Port-au-Prince.
25Suzy Castor (1988). L’occupation américaine d’Haïti. Edition conjointe Société Haïtienne d'Histoire et de Géographie / Imprimerie Henri Deschamps. Port-au-Prince.
26Michel Hector (1989). Syndicalisme et socialisme en Haïti : 1932-1970. Imprimerie Henri Deschamps. Port-au-Prince.
27Charles Tardieu-Dehoux (1990). L’éducation en Haïti de la période coloniale à nos jours, 1980. Imprimerie Henri Deschamps. Port-au-Prince.
28 Jean Alix René (2019). Haïti après l’esclavage : Formation de l’Etat et culture politique populaire (1804-1846). Communication Plus. Port-au-Prince.
29 Joseph Guerdy Lissade et Gaétan Mentor. « Société haïtienne d’histoire, de géographie et de géologie ». In Le Nouvelliste, 7 décembre 2012. https://lenouvelliste.com/article/ Accédé le 15 juillet 2024.
30 Jacques Cauna « Bibliographie historique haïtienne 1980-1986 (période coloniale et révolutionnaire) ». Revue d'histoire Outre-Mers. Année 1987 276 pp. 333-350. Sur l’évolution de la Société Haïtienne de Géographie et de Géologie, de sa constitution en 1923 jusqu’à l’année 2013, on consultera avec profit le numéro spécial de la Revue de la Société, Numéro 252-252, Juillet- décembre 2013 et surtout l’excellent et instructif article de M. Gaétan Mentor au sein de ce même numéro : « Esquisse historique d’une société savante : la Société haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie (SHHGG) ou 90 années au service de l’intelligentsia haïtienne ». Pp. 44-142.
31 Ibid.
32 La fameuse collection Edmond Mangonès fait partie actuellement du Fonds de la Bibliothèque Haïtienne des Spiritains (BHS) du Petit Collège Saint-Martial. Elle représente l’une des plus riches et des plus diversifiées collections de toute la Caraïbe. Elle peut être consultée à l’adresse suivante : www.bhshaiti.org.
[1] Les activités de vente signature des ouvrages de l’historien Roger Gaillard faisaient, à l’époque, salle comble à l’Institut Français d’Haïti (IFH) se trouvant alors dans la Cité de l’Exposition du Bicentenaire. En juillet 1984, lors de la vente signature du premier volume de la série de la République exterminatrice nous nous rappelons que le stock des ouvrages disponibles pour la vente signature était déjà épuisé au début des activités. Les organisateurs ont alors envoyé chercher un supplément de stock à l'Imprimerie Le Natal de M. Robert Malval situé dans la zone de l'Aéroport. Et le public a attendu patiemment, pendant près d'une heure, pour pouvoir retirer son exemplaire de l'ouvrage avec, bien entendu, la signature de l’historien Gaillard…Réminiscences d'un certain Port-au-Prince que les jeunes d’aujourd’hui n’ont point connu… Tempus fugit et rerum edax. (Le temps fuit et emporte toute chose).
[2] Robert Debs Heinl est un officier supérieur de l’armée américaine envoyé en Haïti en mission de coopération par l’administration du Président américaine auprès du Président François Duvalier pour le renforcement des Forces Armées d’Haïti. Il s’est brouillé avec Duvalier et retourné au Etats-Unis où il a publié, de concert avec son épouse Nancy Heinl, au cours de l’année 1978, un ouvrage sur l’histoire d’Haïti intitulé Written in blood : The Story of the Haitian People 1492-1971. Maintes affirmations de M. Heinl ne sont pas acceptées ou sont tout simplement rejetées par des historiens haïtiens, particulièrement par M. Roger Gaillard.
[3] C’est également notre opinion personnelle. Pour nous, le grand capital international avait laissé définitivement le pays depuis les suites de l’affaire Galbaud en mars 1793. Il n’y est jamais revenu, en dépit de timides tentatives conjoncturelles, rapidement interrompues d’ailleurs. Il s’agit, selon nous, d’une variable importante pour la compréhension de la crise actuelle. Au moment où nous écrivons ces lignes, la City Bank vient de fermer officiellement ses opérations en Haïti. Pourquoi le grand capital international, les Etats-Unis en tête, en dépit de tous les grands avantages comparatifs, n’a jamais sérieusement investi en Haïti ? Ce serait, à notre avis, une bonne question de recherche.
[4] Un titre qui nous rappelle la fameuse conclusion du discours d’investiture du Président Léon-Dumarsais Estimé le 16 août 1946, et que notre chère tante, l’institutrice Léticia Lacoste de la Petite Rivière de l’Artibonite, savait pratiquement par cœur : «Si, bergers du troupeau, nous nous en constituons les loups; si, gardiens de la maison, nous nous faisons les voleurs qui la brisent et la pillent; si, rebelles au meilleur de nous-mêmes, nous manquons à nos engagements solennels, alors il sera temps d’entrer en jugement avec nous et de nous demander des comptes ».
[5] Dans la Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie (SHHG), l’historien Alain Turnier avait maintenu, pendant de nombreuses années, une rubrique intitulée « Vieux carnets d’un vieux chercheur ». Dans le cadre de cette rubrique, M. Turnier avait publié des articles remarquables comme : « Pétion-Ville Capitale d’Haïti » en Septembre 1982, « A la recherche du trésor de Toussaint Louverture » en décembre 1983, « Le duel dans la société haïtienne 1902-1915 » en juin 1985, « l’exécution de de Rodolphe Alexandre à Jacmel, son impact national » en septembre 1986. En Octobre 1978, il avait publié dans la revue de la Société une étude intitulée « La mission Chanlatte : Boyer a-t-il réclamé paiement de l’aide fournie par Pétion à Bolivar ?».
[6] Umberto Eco (1992). Los límites de la interpretación. Editorial Lumen. Barcelona. Pp. 39-40. Cet ouvrage de M. Umberto Eco représente une référence de base pour l’acte de lecture et de la démarche interprétative des textes des auteurs. Dans cet ouvrage, l’auteur a établi la distinction fondamentale entre « utiliser » et « interpréter » un texte. La première démarche relève essentiellement de l’intention du lecteur (intentio lectoris), tandis que la seconde démarche implique des « restrictions », des « contrôles d’autorité » pour parler le langage des bibliothécaires. Ainsi, si les possibilités d’interprétation d’un texte peuvent être multiples, voire infinies, il y a cependant, d’après Umberto Eco, «des interprétations qui sont totalement inacceptables ». Pour cela même, il y a, « les limites de l’interprétation ».
[7] Ibid.
[8] Le journaliste Rodolphe Alexandre a été exécuté de façon tragique pour ses dénonciations de la contrebande et de la corruption. Le récit poignant de cette exécution a été présenté en septembre 1986 dans la Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie par l’historien Alain Turnier sous le titre : «l’exécution de de Rodolphe Alexandre à Jacmel, son impact national », sous la rubrique « Vieux carnets d’un vieux chercheur ». Dans l’ouvrage Avec Mérisier Jeannis, M. Alain Turnier revint sur cette exécution à la page 312.
[9] Boisrond Canal représente, selon M. Alain Turnier (2022). , « Le politicien peut-être le plus astucieux de l’époque ». Avec Mérisier Jeannis. Une tranche de vie jacmélienne et nationale. Ed. Société Haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie. Port-au-Prince, p.182.
[10] Pour l’historien Alain Turnier, M. Anténor Firmin représente « le plus éclatant fleuron de la haute culture haïtienne » (page 411). Pour le Professeur Watson Denis, en préface de l’ouvrage cité, page 23, « le firminisme [représentait] le seul mouvement politique qui aurait pu opérer, au début du XXème siècle, des changements véritables dans le pays ». Dans les annexes de l’ouvrage de l’historien Roger Gaillard (1993). La République exterminatrice. 4, La Guerre civile, une option dramatique, 15 juillet-31 décembre 1902, Imprimerie Le Natal, Port-au-Prince, le Dr. Pradel Pompilus, pour sa part, est net et clair : avec Firmin au pouvoir et son programme en application, Haïti aurait pu éviter le désastre de l’Occupation américaine de 1915. Le Dr. Pompilus reconnait toutefois que l’Histoire ne s’écrit pas avec des « si ». Nous estimons pour notre part que le mouvement de M. Firmin constituait une opportunité manquée pour aborder de façon rationnelle les problèmes se rapportant à la gestion du pays et la modernisation de l’Etat. D’autres opportunités seront ratées encore par la suite et les tares que dénonçaient M. Anténor Firmin demeurent, plus de cent ans après sa disparition, d’actualité. Sur les luttes de M. Anténor Firmin pour accéder au pouvoir suprême avec une volonté de rationalisation et de modernisation des pratiques de gestion de la chose publique, il y a certes la biographie du personnage par le docteur Jean-Price Mars (1978). Joseph Anténor Firmin. Imprimerie du séminaire adventiste, Port-au-Prince. Mais il y a deux ouvrages assez pertinents. Nous voulons mentionner le texte de Marc Péan (1986). L’échec du firminisme. Editions Henri Deschamps, Port-au-Prince. Ensuite, nous avons l’ouvrage de Roger Gaillard (1992). La République exterminatrice. La déroute de l’intelligence. Imprimerie le Natal, Port-au-Prince.
[11] Le général Sextus Berrouët avait joué un rôle déterminant dans l’exécution de M. Mérisier Jeannis le dimanche 26 janvier 1908 et conduit en personne une féroce répression de la colonne des « rasoirs » de la plaine Lafond qui étaient les partisans farouches de M. Mérisier Jeannis.
[12] Alain Turnier, Op. Cit., Page 81.
[13] En effet, pour M. Alain Turnier, Op. Cit., p. 364, « Ainsi, Mérisier figurait également parmi les personnalités les plus éminentes de la politique. Il avait acquis une stature « présidentiable » et la nation observait l’étoile nouvelle ».
[14] Sur cette journée terrible au cours duquel le Président Florvil Hyppolite dirigea personnellement la répression dans les rues de Port-au-Prince, nous recommandons vivement la lecture ou la relecture du chapitre intitulé « une Fête-Dieu pas comme les autres » de l’ouvrage La république exterminatrice : une modernisation manquée 1880-1896 de l’historien Roger Gaillard paru en 1984 aux Editions Le Natal, Port-au-Prince. Dans son ouvrage Avec Mérisier Jeannis. Une tranche de vie Jacmélienne et locale, l’historien Alain Turnier traite de ce tragique évènement du 28 mai 1891 et de ses implications pour la ville de Jacmel aux pages 258 à 259.
[15] Alain Turnier, Op. Cit., p. 295.
[16] Alain Turnier, Op. Cit., p .317.
[17] Alain Turnier, Op. Cit., p. 331.
[18] Alain Turnier Op. Cit., pp.318-319
[19] Ibid.
[20] Alain Turnier Op. Cit., pp.342-343.
[21] M. Turnier, Op. Cit., p. 431, revint encore, à la fin de l’ouvrage, sur la question paysanne haïtienne en laissant cette fois parler son cœur : « Sa riche et fulgurante trajectoire [celle de Mérisier Jeannis], néanmoins, dessine un immense point d’interrogation. Son équipée demeure significative. Elle est une rébellion contre un ordre de chose séculaire : l’exploitation, le déséquilibre social. De même que l’écart s’accentue entre les niveaux de vie des pays avancés et ceux du tiers monde, il n’échapperait pas à l’observateur le moins attentif qu’en Haïti le fossé continue de s’élargir entre la ville et la campagne. Sous l’effet de l’érosion, de l’explosion démographique, par suite de l’émiettement provoqué par le partage successoral en l’absence d’un seuil légalement incompressible de la pauvreté rurale, les moyens de production du paysan se rapetissent de plus en plus, invitant à l’exode massif vers les centres urbains ou l’extérieur. Si la ville devait rester indifférente à ce processus de dégradation, un temps viendrait ou, à la faveur de l’alphabétisation, de l’extension des médias, les masses rurales ayant acquis une conscience aiguë de leur dénuement, se lèveront sous la conduite d’un chef instruit et fanatisé pour exiger avec usure ce qui leur est dû, au dépens de la ville dans son ensemble, responsable, du haut au bas de l’échelle sociale de l’exploitation paysanne, dans un authentique conflit de classes opposant des opprimés et des oppresseurs, en dehors des conditions fragiles de couleur ». Et l’auteur parle de la forte possibilité pour qu’il y ait des « Merisier Jeannis de demain ». Il est à noter seulement que M. Turnier écrivait ces phrases prémonitoires au cours de l’année 1982.
[22] Alain Turnier Op. Cit., p. 29.
[23] Ibid.
[24] Voir sous ce rapport l’ouvrage significatif de Watson Denis (2016). Haïti : changer le cours de l’histoire. C3 Editions, Port-au-Prince.
[25] Marc Péan (1986). L’échec du firminisme. Editions Henri Deschamps, Port-au-Prince.
[26] Suzy Castor (1988). L’occupation américaine d’Haïti. Edition conjointe Société Haïtienne d'Histoire et de Géographie / Imprimerie Henri Deschamps. Port-au-Prince.
[27] Michel Hector (1989). Syndicalisme et socialisme en Haïti : 1932-1970. Imprimerie Henri Deschamps. Port-au-Prince.
[28]Charles Tardieu-Dehoux (1990). L’éducation en Haïti de la période coloniale à nos jours, 1980. Imprimerie Henri Deschamps. Port-au-Prince.
[29] Jean Alix René (2019). Haïti après l’esclavage : Formation de l’Etat et culture politique populaire (1804-1846). Communication Plus. Port-au-Prince.
[30] Joseph Guerdy Lissade et Gaétan Mentor. « Société haïtienne d’histoire, de géographie et de géologie ». In Le Nouvelliste, 7 décembre 2012. https://lenouvelliste.com/article/ Accédé le 15 juillet 2024.
[31] Jacques Cauna « Bibliographie historique haïtienne 1980-1986 (période coloniale et révolutionnaire) ». Revue d'histoire Outre-Mers. Année 1987 276 pp. 333-350. Sur l’évolution de la Société Haïtienne de Géographie et de Géologie, de sa constitution en 1923 jusqu’à l’année 2013, on consultera avec profit le numéro spécial de la Revue de la Société, Numéro 252-252, Juillet- décembre 2013 et surtout l’excellent et instructif article de M. Gaétan Mentor au sein de ce même numéro : « Esquisse historique d’une société savante : la Société haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie (SHHGG) ou 90 années au service de l’intelligentsia haïtienne ». Pp. 44-142.
[32] Ibid.
[33] La fameuse collection Edmond Mangonès fait partie actuellement du Fonds de la Bibliothèque Haïtienne des Spiritains (BHS) du Petit Collège Saint-Martial. Elle représente l’une des plus riches et des plus diversifiées collections de toute la Caraïbe. Elle peut être consultée à l’adresse suivante : www.bhshaiti.org.