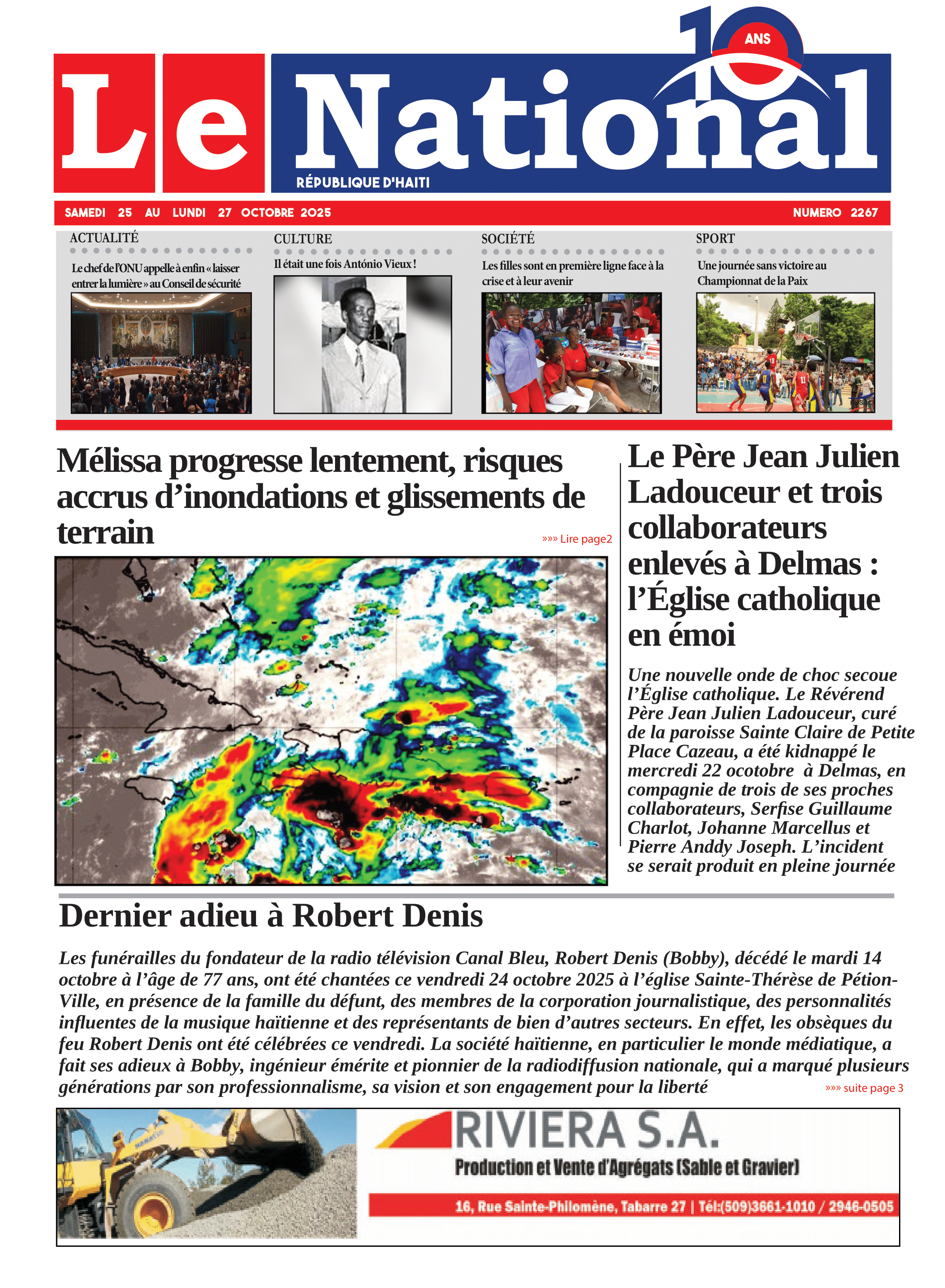Mesdames et messieurs,
Dans l’un de mes articles parus en août 2025, intitulé « Le virus présidentiel qui répand la terreur », je ne voulais pas jouer les prophètes de malheur, même si notre pays est traversé par toutes sortes d’énergies négatives. J’espérais m’être trompé dans mon analyse du phénomène des candidatures présidentielles en Haïti, où le nombre de postulants à ce poste se répand comme une traînée de poudre à chaque élection.
Je pensais qu’après près de quarante ans d’expérience démocratique, les élites du pays auraient tiré les leçons du passé et atteint une maturité civique suffisante pour réduire le morcellement politique, limiter la prolifération des partis et éviter la multiplication de candidatures redondantes, souvent portées par des personnes défendant les mêmes idéologies.
Pourtant, il semble que cet article n’ait été, en définitive, qu’une mise en garde prémonitoire contre un virus politique toujours actif — celui-là même qui, symboliquement, a conduit à la perte de l’Empereur de la nation, l’inoubliable et sacré Jean-Jacques Dessalines.
Je fais référence ici à une liste circulant sur les réseaux sociaux, annonçant la candidature de 47 personnes à la présidence pour les prochaines élections. Une liste non exhaustive, puisqu’aucune femme n’y figure. Pire encore, certains noms restent cachés, tandis que la jeunesse montante en est largement absente. Cette énumération, que j’espère n’être qu’une plaisanterie, n’en révèle pas moins une vérité troublante sur notre culture politique.
En tant que citoyen engagé dans la construction d’une nouvelle Haïti, j’aurais souhaité que ces 47 candidatures soient fausses. Considérer cette inflation de candidatures — parfois tournée en dérision, parfois glorifiée — comme un signe de vitalité démocratique serait une erreur choquante. Il est temps de remettre la qualité au cœur du débat, et de promouvoir une présidence responsable, fondée sur la compétence, l’unité et le sens du bien commun.
Pour sauver un pays en lambeaux, il faut mettre un terme à cette prolifération de candidatures présidentielles qui relève presque d’une obsession collective. Être candidat à la présidence ne saurait être la seule manière pour les Haïtiens de servir leur patrie ou de mettre à profit leurs compétences, leur savoir-faire et leur devoir civique. Le savoir intellectuel doit être valorisé dans tous les domaines, sans vanité, afin de redorer l’image du pays et de le hisser au rang qu’il mérite.
Quant à la prolifération des candidatures au Sénat, à la Chambre des députés et dans les collectivités territoriales, elle pose un autre défi majeur — surtout pour les électeurs des zones rurales, souvent confrontés à une véritable forêt de bulletins au moment de voter. Or, ces institutions constituent le cœur battant de la démocratie et les fondations mêmes du développement national.
Dans la liste présidentielle actuelle, je reconnais presque tous les noms. Beaucoup ont, sans conteste, l’étoffe de présidentiables. Pourtant, c’est précisément cette abondance de figures ambitieuses qui m’inquiète : elle traduit moins une vitalité démocratique qu’une incapacité à fédérer les forces autour d’un projet commun. Le risque est grand de voir se répéter les mêmes fragmentations politiques, éloignant encore le pays de l’idéal d’unité nationale prôné par Jean-Jacques Dessalines.
Avec la multiplication des partis politiques et l’émergence, à la fois nécessaire et historique, de la jeunesse, mon inquiétude grandit face au risque de revivre une prolifération excessive de candidatures présidentielles, comme en 1987, où plus de 200 prétendants convoitaient la magistrature suprême.
Être candidat à la présidence est un droit légitime dans une démocratie. Mais lorsque ce droit se dilue dans un système miné par ses propres acteurs, il devient urgent de trouver des moyens réalistes pour éviter d’aggraver le chaos. Les candidats à la présidence et les partis politiques sérieux portent à cet égard une responsabilité essentielle : celle de redonner du sens à la compétition politique.
Mes observations m’amènent à constater que les idéologies politiques en Haïti sont aujourd’hui vidées de leur substance. Les distinctions entre gauche et droite n’ont plus de réelle signification : elles servent souvent de prétextes à des alliances opportunistes plutôt qu’à de véritables projets de société.
Dès le début de la transition démocratique de 1987, on notait déjà des conflits entre intellectuels, opposés moins par conviction que par intérêts personnels ou familiaux, rapidement maquillés en divergences idéologiques.
Mes propositions
Aujourd’hui, avec plus de 220 partis politiques, le virus présidentiel risque de plonger le peuple dans un embarras du choix qui relève davantage du désordre que de la démocratie.
Étant donné que le pluralisme politique n’exclut ni la cohérence nationale ni les actions communes au service du bien public, je suggère que les candidatures d’orientation idéologique similaire se regroupent sous une plateforme ou un chapeau commun, afin de réduire le nombre de candidats. Cela s’est d’ailleurs déjà fait dans le passé, avec le Front national pour le changement et la démocratie (FNCD), qui avait réuni plusieurs formations politiques autour de la candidature de Jean-Bertrand Aristide. Je peux également citer l’Alliance nationale pour la démocratie et le progrès (ANDP), qui regroupait jadis le MID, le PANPRA et le MNP28. Qui ne se souvient pas non plus de l’Espace de concertation, une coalition regroupant plusieurs organisations, dont le KID, Génération 2000, PANPRA, Haïti kapab et KONAKOM. Plus récemment encore, l’Alliance démocratique, formée en 2005, avait soutenu la candidature de René Préval, candidat de Espwa.
Le regroupement des candidats et des partis politiques permettrait également de réduire les coûts financiers pour le Conseil électoral provisoire (CEP), qui n’aurait plus à financer l’impression de multiples bulletins pour une pléthore de candidats, alors même que l’État ne dispose pas des ressources nécessaires pour en assumer les frais.
Je pense qu’il serait aussi opportun de solliciter les institutions étrangères et nationales d’observation électorale afin de lancer des programmes d’éducation civique à travers des conférences et séminaires, dans le but de motiver les partis politiques, les candidats et les indépendants à se regrouper.
Il convient de rappeler les difficultés rencontrées par les électeurs, en majorité analphabètes, pour identifier correctement leurs candidats. C’est pourquoi la multiplication excessive des candidatures au niveau des collectivités territoriales est également inacceptable. Il faut simplifier le processus électoral afin de ne pas aggraver la situation déjà précaire des populations rurales.
La résolution 2793 du Conseil de Sécurité des Nations Unies a entériné une feuille de route tracée par l’OEA, dont l’un des piliers vise à accompagner les autorités haïtiennes dans l’organisation des élections. Dans ce cadre, les organisations d’observation électorale pourraient apporter un appui technique et financier au CEP pour mettre en place un programme de motivation visant à encourager les regroupements simplifiés de partis, limitant le nombre de candidats à dix pour la présidence dans l’immédiat, puis à cinq à l’avenir.
Un ultime appel
Il appartient désormais à vous, élites intellectuelles et socioprofessionnelles, membres des partis conscients de la gravité de la situation, de faire preuve de lucidité et de courage.
L’avenir du pays dépend de votre capacité à rompre avec la logique de la quantité pour construire enfin une vision collective au service de la nation. Il est temps de redorer l’image de notre pays. Haïti ne sera sauvée ni par la multitude des candidats ni par des slogans creux, mais par la lucidité de quelques esprits sincères, capables de placer la patrie au-dessus de leurs ambitions personnelles, afin de bâtir un projet collectif fondé sur la compétence, la discipline et la responsabilité partagée.
Deux siècles après Dessalines, le véritable acte de liberté consiste à unir nos forces autour d’une vision commune et à libérer la présidence de l’égo des hommes pour la rendre enfin à la nation.
Patriotiquement vôtre,
Dr. Emmanuel Charles
Avocat et spécialiste des questions électorales